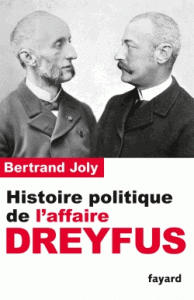 Bertrand Joly, Histoire politique de l’affaire Dreyfus, Paris, Fayard, 2014, 784 p. 32 €
Bertrand Joly, Histoire politique de l’affaire Dreyfus, Paris, Fayard, 2014, 784 p. 32 €
Ce livre est considérable. Agréable à lire, fondé sur une érudition impeccable, libre et distancié, drôle souvent, il est et demeurera longtemps un des trois ou quatre livres importants écrits sur l’Affaire. Le parti pris de Bertrand Joly est en soi original : appréhender non l’Affaire de « l’intérieur » mais de « l’extérieur », non par « le bas » mais par « le haut » ; non du côté de la famille Dreyfus ou de l’État-major mais du côté du gouvernement et de la représentation nationale, non du côté des journalistes et des publicistes mais de celui de la presse, non du côté des individualités mais de celui des groupes ou des institutions auxquelles ils appartenaient. L’affaire Dreyfus, l’affaire Esterhazy, l’affaire Zola, l’affaire Picquart, l’affaire Du Paty de Clam, « l’affaire de Dreyfus » sont à peine évoquées ici, autrement que parce qu’elles permettent de comprendre l’enchaînement des événements – constituant pour ainsi dire, dans cette perspective « retournée », le contexte –, et s’effacent pour laisser la place à l’Affaire, l’affaire politique, dont sont retracées, sur la base d’un travail archivistique étourdissant, les péripéties et fixés les causes, les enjeux et les conséquences en une analyse minutieuse et fine. En décalant ainsi le point de vue, le livre de Bertrand Joly nous offre à lire véritablement une autre histoire, qui est aussi celle des débuts de la Troisième République, une histoire de ses structures, des courants, des groupes et des hommes qui en étaient les acteurs et dont l’auteur suit pas à pas les positions, les hésitations, les évolutions. Mais avant tout, ce grand livre donne un tout autre éclairage à la célèbre Affaire qui remet en question tant d’évidences qui ne le furent en fait jamais et dont l’acceptation, l’exposition et la répétition ont faussé la perception de l’événement. Bertrand Joly nous extirpe de cette vision imposée d’un combat du bien et du mal, de la grande cause morale qui déchira la France pour nous montrer, en ramenant l’Affaire dans ses causes à ses justes proportions, ce qu’elle fut vraiment :
On décrit souvent l’affaire Dreyfus comme un coup de massue tombant sur le jeu politique, le bouleversant et obligeant chacun à dire dans quel camp il se trouve, ce qui entraîne à terme un reclassement surprenant. Il faut inverser totalement cette vision des choses : c’est l’état de déliquescence du jeu politique qui permet à l’erreur judiciaire initiale de devenir une affaire majeure. La principale cause de l’affaire Dreyfus en tant que crise politique se trouve dans la rencontre destructrice entre les défauts structurels du régime et la dépression conjoncturelle provoquée par l’impuissance des modérés ; incapables d’assurer un gouvernement stable, le régime s’enfonce comme dix ans plus tôt dans l’incohérence et, à la veille de l’Affaire, après avoir tout essayé, le centre en est réduit comme en 1887 à violer ses propres règles en demandant l’appui de la droite pour gouverner. Dès lors, il faut choisir : changer le système en y réintégrant la droite ou revenir à l’orthodoxie ; dans les deux cas, la crise est inévitable et ne doit rien au sort de Dreyfus, mais la crise politique et l’affaire judiciaire arrivent à maturité au même moment, et la seconde vient compliquer et en partie masquer la première aux yeux des contemporains (612-613).
Je pense connaître l’Affaire et cette perspective novatrice a remis en question, en reconsidération, beaucoup de ces évidences qui n’en sont plus maintenant. On pourra toutefois faire un très léger – si léger – reproche à ce formidable travail et proposer d’ouvrir une discussion sur un point essentiel, central même, qui est en jeu et en question depuis de longues années : l’antisémitisme et la place qu’il faut lui accorder dans l’Affaire. Commençons par le maigre reproche. Le fait d’avoir écarté les différentes affaires (Zola, Picquart, etc.), et donc leurs sources (BB19, procédures) qui permettent de les connaître et d’en parler justement, se justifie, nous l’avons dit, par l’angle choisi et le propos du livre. Ce parti pris fait toutefois, parfois, courir le risque de passer à côté de réalités qui auraient permis justement d’aller au bout et de l’angle et du propos. Ainsi, pour ne citer que ce seul exemple, de la question du procès Picquart et de ce que furent en l’affaire les rôles respectifs de Zurlinden et de Chanoine. Le travail sur le BB19 aurait ainsi permis à l’auteur de peut-être proposer une autre interprétation de ce moment important, nous permettant de mieux comprendre, relativement à la démission « retenue » du premier, toute l’importance qui put être celle de la correspondance de Picquart à Sarrien (et essentiellement la lettre peu citée du 6 septembre) et comment encore le même se moquera ouvertement du monde dans ses souvenirs quand on sait, grâce à ces papiers, comment il prépara le travail de Chanoine pour que Picquart fût déféré en justice. Mais cela est finalement secondaire et constitue un bien maigre reproche.
En revanche, tout à fait centrale est la discussion que nous proposons d’ouvrir non pas pour tenter un contrepied mais pour aller plus loin encore sur la question fondamentale qui est celle de l’antisémitisme, de son rôle et son importance dans l’Affaire. Bertrand Joly reproche à quelques historiens que « faire de l’affaire Dreyfus une affaire juive », ce qui est, écrit-il, « une tentation parce que c’est une facilité » et il a raison. La question de l’antisémitisme se pose en fait à deux niveaux : celui de l’origine de l’Affaire et celui de son importance et de son poids en 1897-1900. Concernant les origines de l’Affaire, il est aujourd’hui une évidence que Dreyfus ne fut pas choisi parce qu’il était juif. Pas de complot antisémite originel qui permettrait de tout expliquer, nous sommes tous d’accord. Pas de complot antisémite originel mais assurément une judéité pensée rapidement comme une circonstance aggravante pour les Bertin, Fabre, d’Aboville, Sandherr, Picquart, tous antisémites. Ce n’est en effet pas par hasard si les deux lettres – deux et non une – qui prévinrent la presse furent adressées à La Libre Parole, si les rapports Guénée développèrent des « preuves » toutes articulées autour du préjugé, si l’accusation fila les poncifs du genre (puissance génésique, attrait de l’argent, vantardise, arrivisme, antipathie, fierté et arrogance, curiosité fureteuse, dissimulation, etc.) et si la parade de la dégradation laissa une large part aux cris de « mort au juif » qui étaient peut-être un pluriel. Picquart nous renseigne vraiment quand il avait dit à Tassin, au sortir de la parade de dégradation, à propos de Dreyfus, qu’« il n’y a pas un Juif qui n’ait de forçat dans sa famille ». Sur le second point, qui vise donc à s’interroger sur la place de l’antisémitisme dans la période de l’Affaire politique, période comprise entre l’engagement de Scheurer-Kestner et le vote de la loi d’amnistie, Bertrand Joly a tout aussi raison quand il nous dit que la question antisémitique ne peut servir de grille explicative exclusive. Beaucoup d’antidreyfusards, il nous le rappelle et nous le savons depuis les travaux d’Eric Cahm sur l’antidreyfusisme modéré, ne furent jamais antisémites, et mieux même le condamnèrent avec force, comme quelques dreyfusards furent antisémites. Cela dit, Bertrand Joly, dans la logique de son étude et entraîné par la force de sa démonstration, pense la chose en termes politiques et en termes de forces politiques. L’antisémitisme politique, organisé, ne fut en effet pas grand-chose, comme il nous le dit. Mais il ne faut pas ignorer son pouvoir de nuisance, le relais hors mesure dont il profitait dans une presse qui n’était pas que La Libre Parole et L’Intransigeant mais aussi La Croix, La Patrie, L’Autorité, La Gazette de France, La Presse, Le Soleil, L’Éclair, La Cocarde, La Vérité, La France, Le Jour, etc., et, de manière moins obsessionnelle mais tout aussi efficace et nuisible, dans quelques autres titres tels que La Dépêche, les socialistes La Petite République et La Lanterne et aussi Le Figaro auquel, pour ne citer que deux exemples, Barrès donna sa célèbre « formule antijuive » en 1890, ou dans lequel, en 1893, Thiébaud pouvait écrire que le ministre de l’Intérieur David Raynal, « israélite », était « à ce titre, […] un peu notre hôte ». D’autre part, si l’antisémitisme ne fut en tant que force organisée que peu de choses, il ne faut pas oublier ce que fut le poids du préjugé sur une population qui, le partageant par culture et éducation – et le rôle ici du catholicisme ne peut être mis de côté –, se trouvait prévenue. C’est ce préjugé, cette forme banale et « douce » de l’antisémitisme, qui peut expliquer, je le crois, un certain nombre d’engagements antidreyfusards. On n’était pas antisémite, on s’en défendait même, mais on soupçonnait les coreligionnaires de Dreyfus de défendre un traître par principe, par ce qu’il était des leurs, et de mettre en œuvre pour cela des moyens qui montraient une puissance dangereuse. Les juifs mais aussi, nous allons le voir, les protestants… C’est ce qu’exprimait un Demangeon quand il écrivait à Henri Hubert que : « Si Dreyfus est coupable, c’est trop pour un traître – s’il ne l’est pas, c’est encore trop pour une réhabilitation. Car vraiment je ne sais s’il s’agit uniquement de Dreyfus là-dedans, et s’il ne s’agite pas autre chose là-dessous. Sans être antisémite – Homais, je suis impatient de les voir remuer, ces fameux coreligionnaires de Dreyfus, ils m’énervent, ils m’irritent parce que tout ce procès donne la preuve de leurs moyens d’action et donne la mesure de leur fortune. Le cas échéant, ils pourraient faire de tout cela un usage moins généreux, moins humain ; ils pourraient l’employer à autre chose qu’à la défense d’un innocent. » C’est encore ce que pouvait dire Weiss à son ami Brissaud quand il lui disait que : « […] je vois des tas de gens dont la grande préoccupation est le triomphe d’une petite coterie et qui forment un groupement dans l’état ; ces gens-là je les déteste. Je déteste les Jésuites, je déteste les Juifs et les francs-maçons et par-dessus tout cette clique de protestants sectaires qui font à la robe noire une chasse de peau-rouge. Je comprends à la rigueur tout en le blâmant l’individu qui considère que toute religion est un péril et qu’il faut supprimer tout prêtre, mais le rat d’église protestant qui court sus au catholique parce qu’il ne communie pas sous les mêmes espèces m’est absolument odieux, or c’est lui que je vois reparaître à chaque instant, je le suis de l’œil depuis longtemps, ce n’est pas d’aujourd’hui que je le connais et pour moi le péril jésuite ne serait rien en comparaison du péril protestant, si ces gaillards nous tenaient dans leurs griffes. Pour arriver à leurs fins tout leur est bon aussi dès le début de la pièce qui se joue je les ai sentis dans la coulisse prêts à entrer en scène. Moi Drumont, vous n’y songez pas, m’avez-vous jamais connu clérical dans un sens quelconque ! Mais je ne connais même pas les opinions religieuses de la plupart de mes meilleurs amis, de ceux que je fréquente depuis quinze ans. Il me serait aussi impossible de vous dire si Sandoz, qui me raconte toutes ses petites histoires, va à la messe que de vous apprendre ce qu’il y a dans la lune. Je suppose qu’il est catholique mais je n’en sais rien et cela m’est indifférent. Que chacun pense ce qu’il veut et que ces protestants qui ont à juste raison réclamé la liberté de conscience ne courent pas sus aux sœurs de charité comme à des bêtes fauves. La seule chose que je demande c’est qu’on ne fasse pas passer sa coterie avant le drapeau. » C’est enfin ce que pouvait aussi exprimer le neutre Gourmont quand il confiait à ses épilogues : « […] Au premier mot qui fut écrit, en novembre, sur cette affaire, j’eus une certaine joie. Il est toujours agréable de voir le gouvernement, la justice, l’autorité, aux prises avec une affaire grave ; cela affaiblit le vieil esprit de respect et on doit, quand on aime la liberté, encourager tout ce qui peut libérer les hommes. Ma joie fut courte. Au bout de deux jours il fut clair que nous étions en face d’une affaire purement juive, purement biblique – car les Protestants s’en mêlaient, – et qu’il s’agissait moins de sauver un malheureux que d’apothéoser une race, de justifier une confession religieuse. Il était clair que la haute Banque marchait, que M. Reinach songeait à consolider sa réélection et la dot de sa femme, que M. Scheurer-Kestner agissait non comme homme politique, mais comme luthérien éminent, que tous ces gens paradaient revêtus de sentimentalisme que pour mieux nous duper, nous rouler et nous marcher sur le ventre. Les Protestants cherchent toujours à se venger de la Révocation de l’Édit de Nantes ; mais les Juifs, de quoi ont-ils à se venger ? Ils sont partout ; ils ont tout. […] Ils ne sont que six à la Chambre, dit-on ; mais pour que les autres Français fussent représentés dans la même proportion, il faudrait plus de trois mille députés. En quoi M. Reinach, échoué par hasard en France, fils d’un juif allemand, représente-t-il les paysans des Basses-Alpes ? Voilà le scandale. On sait que je suis bien loin d’être anti-sémite ; j’ai des amis israélites ; jamais ni la race, ni la religion, ni les opinions d’un écrivain ne m’ont empêché de le juger avec une indépendance absolue ; je tiens même l’anti-sémitisme pour une erreur ; j’estime que la campagne de M. Drumont a été mauvaise en tant qu’elle a été dirigée contre une race et non contre le capitalisme juif ; mais si je n’ai pas de haine contre les Juifs, je n’ai pas non plus d’amour spécial pour eux ; l’un ou l’autre sentiment me paraîtrait insensé. »
Pour appuyer sa démonstration, Bertrand Joly s’interroge sur les manifestations de janvier-février 1898. Il s’interroge aux motifs que ces événements « sont loin de constituer en France la première la première marque d’hostilité à l’égard d’une communauté jugée étrangère ou hostile » ; que les rapports ou articles à chaud sont souvent emphatiques et furent rapidement relativisés par les rapports, faits deux ou trois jours après, des commissaires et des procureurs généraux ; que ces manifestations demeurèrent finalement peu nombreuses et localisées ; qu’elles durèrent peu ; qu’elles se limitèrent souvent à des gestes symboliques ou des dommages aux propriétés ; qu’elles furent peu organisées, souvent spontanées et hors de contrôle des antisémites de métier, etc. Moralité, si, écrit Bertrand Joly, « leur aspect antisémite est incontestable », il demeure « second par rapport à la motivation patriotique » quand il n’est pas tout simplement « absent ». Si la conclusion ne peut qu’emporter l’adhésion, la démonstration ne nous semble pas convaincante et loin de nous de penser et de dire, on l’aura compris, que si l’antisémitisme fut là, présent, il est l’explication de tout et la seule explication. Que les Italiens furent victimes de nombreuses exactions ne change à rien à celles, et quels qu’en fussent les bilans – qui visèrent les juifs ; que les rapports des commissaires ou des procureurs généraux montrent plus de sérénité que les articles des journalistes qui aiment le sensationnel est évident mais peut aussi s’expliquer à l’inverse comme une volonté des premiers de ne pas créer de l’inquiétude et donner l’impression que la situation leur échappait. Quant aux arguments relatifs au nombre finalement restreint de manifestations, de manifestants, du peu de dégât et de l’absence de groupes ou de structures et du caractère spontané et jeune de la plupart de ces rassemblements, ils ne nous semblent guère susceptibles d’emporter l’adhésion. Les perspectives « quantitative » (le nombre et la durée) et « qualitatives » (absence d’organisation réelle, fait d’étudiants ou d’« aventuriers » en quête d’émotions) ne relativisent à notre sens que peu de choses. Les cris de « mort aux juifs » purent être ou ne pas être suivis d’effets, être le fait de quelques-uns et ne pas être la réponse à un mot d’ordre, ils n’en faisaient pas moins régner la terreur au sein de la population visée sous les fenêtres, avant qu’elles ne volassent en éclat, desquelles ces manifestations – ou ces monômes – se déroulaient. De ce fait, observer l’antisémitisme doit aussi croyons-nous, pour en avoir une mesure exacte et complète, se faire de l’intérieur, du côté juif, et nous inviter à nous demander comment ces événements furent vécus par des familles contre lesquelles quelques individus, tout minoritaires qu’ils fussent, appelaient au meurtre et qu’une grande majorité de la population, sans pour cela vouloir leur mort, regardait avec méfiance et défiance. Bertrand Joly adopte ce nécessaire point de vue, en réponse aux travaux de Stephen Wilson, et y trouve confirmation de son propos. Il cite pour cela Pissarro et sa correspondance à son fils, rappelant son affirmation réitérée « qu’il n’y a absolument rien à craindre ». Pissarro l’écrit, en effet, à Lucien, les 21 et 27 janvier et 22 février 1898 et insiste bien sur le fait que les manifestations sont le fait de « quelques imbéciles imberbes qui ne crient même plus ». Mais cela dit, cette insistance du père à rassurer son fils traduit bien qu’elle put être l’inquiétude ressentie. On pourrait ainsi, encore, rappeler les souvenirs d’André Spire qui, depuis le duel Mayer-Morès s’était mis à toutes fins utiles à la pratique régulière et appliquée l’escrime, rappeler la correspondance d’Edmond Fleg et les inquiétudes dont il fit part à sa mère : « je redoute pour les juifs des moments bien affreux encore à passer », lui écrivait-il le 16 janvier 1898 ou, encore, le 25 : « […] c’est en effet, pour chacun de nous, un malheur personnel, un grand malheur, que l’antisémitisme ait fait des progrès pareils, et qu’à la première occasion nous ayons la perspective de massacres qui vaudront les massacres d’Arménie ». Et le 12 février, encore, il lui disait « avec quelle anxiété j’attends l’issue de cette affaire. On n’en saurait exagérer l’importance. Il me semble que j’ai été aveugle jusqu’à ces derniers temps. J’aurais dû comprendre plus tôt que la question juive est toujours vivante et angoissante et que mon devoir et de m’en occuper. » On pourrait, en retournant en 1894 et aux articles de presse qui ne furent pas que le fait de La Libre Parole, se reporter aux notes du silencieux Ferdinand Dreyfus et à ses interrogations : « A quoi bon fermer les yeux à l’évidence ? La question juive existe en France. L’incendie ira-t-il en grossissant ou en s’éteignant ? Je ne sais. Mais il y a à l’heure qu’il est, dans notre pays, en décembre 1894, une disposition générale hostile aux Français juifs. Quelles sont les causes de cette disposition ? Ces causes sont-elles justes ? Quels en seront les effets ? sur nous ? sur nos enfants ? Y a-t-il des remèdes et quels sont-ils ? » C’est ainsi, dès le lendemain de la condamnation de Dreyfus, que Zadoc Kahn avait été « assailli d’un flot de suppliques » de ses coreligionnaires. Une inquiétude, une terreur parfois, que ressentirent les juifs de France, israélites assimilés ou étrangers franchement arrivés aux pays des droits de l’homme, celui dans lequel, pour paraphraser le proverbe yiddish, Dieu pouvait être heureux. Des sentiments qu’exprima parfaitement Bernard Lazare quand il écrivait dans La Justice le 17 novembre 1894, un mois avant le procès de Dreyfus : « On ne cloître plus les israélites, on ne tend plus de chaînes aux extrémités des rues qu’ils habitent, mais on crée autour d’eux une atmosphère hostile, atmosphère de défiance, de haine latente, de préjugés inavoués et d’autant plus puissants, un ghetto autrement terrible que celui auquel on pourrait échapper par la révolte ou par l’exil. Cette animosité se dissimule communément et cependant le juif intelligent, et il n’est pas rare, la perçoit ; il sent une résistance devant lui, il a l’impression d’un mur que des adversaires ont dressé entre lui et ceux au milieu desquels il vit. »
Cette réflexion sur l’antisémitisme, accord fait sur l’évidence qu’il ne fut pas tout et n’explique pas tout, doit être encore menée. Elle demeure une de nos principales pistes de recherche et mériterait que nous nous y penchions sérieusement et ce collectivement. En attendant, il faut lire le livre de Bertrand Joly pour tout ce qu’il nous apprend, pour les perspectives qu’il ouvre et pour les questions qu’il pose et auxquelles il apporte de convaincantes réponses, des questions qui sont les seules qui méritent, aujourd’hui, pour qui se penche sur l’Affaire, de retenir l’attention. Un livre considérable…
Les lettres de Weiss et Demangeon et ce qui concerne Zadoc Kahn peuvent se lire dans notre Histoire de l’affaire Dreyfus juste parue ; le texte de Gourmont est paru dans le Mercure de France de février 1898 ; les souvenirs de Spire ont été publiés en 1962 chez Albin Michel sous le titre Souvenirs à bâtons rompus ; les lettres de Fleg ont été publiées par André E. Elbaz en 1976 chez Nizet ; les notes de Ferdinand Dreyfus sont citées dans l’article de Pierre-André Meyer publié en 1994 dans le n° 27/1 d’Archives juives.
Ping : Histoire politique de l'affaire Dreyfus | L'affaire Dreyfus