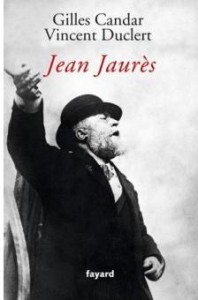 Nous l’attendions, elle est arrivée. Même si nombreuses furent les tentatives biographiques de qualité (on pensera à l’essai de Jean-Pierre Rioux), la référence demeurait encore à cet égard le travail, ancien, d’Harvey Goldberg. Gilles Candar et Vincent Duclert nous livrent donc la toute dernière biographie du grand socialiste, une biographie assurément qui fera date. Pourtant, notre déception, il faut le dire, est grande. Si l’ensemble en est tout à fait remarquable, les deux chapitres consacrés à l’Affaire nous laissent quelque peu sur notre faim et tout particulièrement en ce qui concerne la première phase, celle de la prise de conscience et de l’engagement.
Nous l’attendions, elle est arrivée. Même si nombreuses furent les tentatives biographiques de qualité (on pensera à l’essai de Jean-Pierre Rioux), la référence demeurait encore à cet égard le travail, ancien, d’Harvey Goldberg. Gilles Candar et Vincent Duclert nous livrent donc la toute dernière biographie du grand socialiste, une biographie assurément qui fera date. Pourtant, notre déception, il faut le dire, est grande. Si l’ensemble en est tout à fait remarquable, les deux chapitres consacrés à l’Affaire nous laissent quelque peu sur notre faim et tout particulièrement en ce qui concerne la première phase, celle de la prise de conscience et de l’engagement.
Passons sur les visites que Lazare rendit à Jaurès pour tenter de le convaincre, rencontres qui sont inexactement présentées, qui le sont à des dates et dans un ordre qui ne furent pas les leurs et desquelles les auteurs tirent des conclusions qui n’ont pas lieu d’être (Jaurès « consent à […] suggérer » à Lazare d’écrire à Millerand « pour faire cesser les mises en cause de La Petite République » ; Lazare écrira clairement : « La Petite République fut plus violente, j’y fus insulté par le sieur Zévaès, j’écrivis immédiatement à Millerand, lui disant que je m’adressais à lui pour protester. Millerand ne me répondit pas, mais toute attaque cessa. J’avais vu, avant les attaques de La Petite, Jaurès »… ; voir ici pour le texte complet)… Cela n’est pas d’une importance capitale… Ce qui l’est en revanche est la narration qui est faite de la prise de conscience et de l’engagement dreyfusard du futur auteur des Preuves. Convaincu, Jaurès refuse pourtant de s’engager pour de multiples raisons qui sont justement et clairement exposées (p. 210). Le déclic en aurait été la publication du « J’Accuse!… » (p. 211) et sa première expression son intervention à la Chambre le 13 janvier (p. 212-213). Mais, pris par ses responsabilités de dirigeant, il préfère « ne pas rompre immédiatement avec la majorité » et, comme les autres députés socialistes, il donne pour cela sa signature au manifeste publié le 20 janvier appelant à l’abstention dans cette crise bourgeoise (p. 212). Jaurès s’est donc engagé mais « la grande offensive jaurésienne n’est pas encore venue ». Il faudra attendre le 22, et un nouveau discours à la Chambre, pour que, « inscri[van]t le combat dreyfusard dans la question politique, l’engagement de Jaurès se déploie désormais avec une grande ampleur » (p. 214). Enfin, le 24, en un troisième discours, il aborde la question du huis clos, des pièces secrètes, et demande qu’on lui reconnaisse « le droit de réclamer l’observation des garanties légales » « envers un juif comme envers tout autre » (p. 214-215). Ce portrait du Jaurès dreyfusard ne nous semble pas exact et c’est plutôt celui d’un Jaurès dreyfusiste, pour reprendre la terminologie proposée en 1994 par Vincent Duclert lui-même, qu’il faudrait parler. Car dans son deuxième et troisième discours, Jaurès, comme les auteurs le disent à propos du premier, « ne prend là ni la défense de Zola ni celle de Dreyfus » et se place en effet plus haut que la question de l’innocence d’un homme, posant celles sur la justice et l’armée en République, le respect des libertés individuelles, etc. Mais plus que cela, cet engagement du 22 janvier ne nous semble pas clair et il nous est difficile de suivre les auteurs quand ils écrivent que le même jour, dans La Dépêche, Jaurès « salu[e] Zola » et écrit : « Je veux parler en homme libre, comme aucune menace, aucune insinuation misérable, aucun chantage avoué ou déguisé, ne m’empêcheront de dire et de crier ce que je pense. » « “L’homme libre” à ce moment » est peut-être « l’intellectuel critique dont Jaurès défend la mission politique », ainsi que l’écrivent les auteurs mais il n’est aucunement un dreyfusard. Certes, dans cet important article, Jaurès nous dit qu’il « admire la hardiesse de Zola » mais – et il eût assurément été intéressant de citer plus longuement – il ajoute : « Il se peut qu’il se trompe sur le fond. Tant que le huis clos sera maintenu, nous ne le saurons pas, nous ne pourrons pas le savoir. Mais il a fait, en affirmant sa pensée, acte d’homme ; et en s’attaquant à la haute armée tout entière, à tout le système des grands chefs militaires, à leur puissance de ruse, de mensonge et d’oppression, il a fait acte révolutionnaire. Ceux-là seuls ne l’en loueront pas qui ont le cœur timide. » Mais s’il dit cela, il dit aussi surtout :
Mais qu’il me permette de le lui dire. Il ne peut isoler son acte du milieu social où il se produit. Or, derrière lui, derrière son initiative hardie et noble, toute la bande suspecte des écumeurs juifs marche, sournoise et avide, attendant de lui je ne sais quelle réhabilitation indirecte, propice à de nouveaux méfaits. Derrière le semeur au geste large, s’abattent les oiseaux voraces qui font leur profit de la semence de justice avant qu’elle ait pu germer. Et par une répercussion singulière, Zola, en abattant une partie des forces d’oppression, risque de restaurer une partie des forces d’exploitation. Oui, si son acte révolutionnaire reste isolé, s’il n’est pas complété par l’action révolutionnaire d’ensemble du prolétariat. Que celui-ci, profitant des révélations prochaines, marche donc à fond contre la haute armée réactionnaire, jésuite et louche. Mais qu’il donne, en même temps, contre tout le système social afin que la capitalisme juif ne puisse regagner ce que perdra le militarisme clérical. Dire cela ce n’est pas, comme nous le reproche Clemenceau dans un de ses vigoureux articles, marcher à l’étoile en dédaignant le devoir de l’heure qui passe. C’est au contraire voir la réalité tout entière, le devoir tout entier ; c’est réserver à l’action révolutionnaire du parti socialiste et de la classe ouvrière toute son ampleur, toute son efficacité, toute sa liberté.
« “L’homme libre” à ce moment » nous semble plutôt être, selon Jaurès, bien plus socialiste qu’intellectuel critique. Quant à Clemenceau, puisqu’il est question de lui, c’est en dreyfusard, ou tout au moins en quelqu’un qui était presque arrivé au bout du chemin, qu’il se positionnait dans l’article évoqué : « Rechercher si la proclamation de l’innocence de Dreyfus – supposé qu’il soit innocent – profitera aux opportunistes où à tous autres, voilà ce que je refuse de considérer. Que l’homme soit innocent ou coupable, la justice réclamée, poursuivie, obtenue, la justice produite au grand jour, la justice faite, la justice respectée, profitera – puisqu’il faut parler de profits – à la cause de la justice totale, et c’est assez pour ceux qui l’auront servie dans l’amour de la justice elle-même. »
Certes Jaurès doutait et le célèbre passage que raconte Péguy au sujet de la visite qu’il lui avait rendue avec Tharaud en janvier 1898, et au cours de laquelle ils avaient parlé de l’Affaire sur la base des documents étalés sur son bureau, peut le laisser penser ; certes, nous savons, grâce à sa déposition au procès Zola, qu’il était fixé depuis le procès Esterhazy sur la valeur de l’accusation contre Dreyfus et de la réalité de la collusion pour sauver le « uhlan » ; certes il s’indignait, et bien avant son troisième discours du 24, que les garanties légales ne fussent pas respectées pour tout homme, « quel qu’il soit » (« Idole tarée », La Petite République, 27 novembre 1897). Et il est clair que ce « quel qu’il soit », qu’il qualifiait tour à tour de « citoyen » et d’« homme », était une manière, certes discrète, de prendre en considération celui dont on n’avait pas à se préoccuper, lui reconnaître l’humanité qui lui était niée et la citoyenneté qui lui était refusée. Mais là, déjà, comme il le fera en janvier, Jaurès avait bien tenu à préciser qu’il ne savait rien de la culpabilité ou de l’innocence de Dreyfus comme il avait tenu à affirmer l’existence du syndicat. Et s’il avait rejeté loin de lui la question de la religion du capitaine, c’était pour ajouter que « si l’odeur du ghetto est souvent nauséabonde, le parfum de rastaquouère catholique des Esterhazy et autres écœure aussi les passants ». Ici déjà, comme dans l’article « Révolution » que nous avons largement cité, comme dans ses autres articles sur l’Affaire, de novembre à janvier, Jaurès variait à l’infini le thème : « La campagne juive », « juiverie ou drapeau », « les deux éléments du grand syndicat conservateur, l’élément catholique et l’élément juif », « le clan juif et le clan jésuite », « groupements opportunistes, protestants et juifs d’un côté, […] groupements militaires et cléricaux de l’autre », « puissance capitaliste […] catholique, huguenote ou juive » (« Le huis clos » et « Idole tarée », La Petite République, 20 et 27 novembre 1897 ; « Le ministère et l’armée », La Dépêche, 1er décembre 1897 ; « Lettre de M. Jean Jaurès, député et publiciste », La Revue bleue, 4 décembre 1897 ; « Question ouverte », La Dépêche, 8 décembre 1897 ; « Dreyfus-Esterhazy », La Petite République, 11 décembre 1897 ; « Toute la clarté », La Lanterne, 16 janvier 1898)… Autant d’articles qui préparaient le manifeste du 20 janvier… Et si Jaurès était en effet, lui, contre la plupart de ses amis, partisan de l’action, c’est parce que le « J’Accuse… ! » avait ouvert une porte qui pouvait constituer une opportunité dans la lutte à mener contre le militarisme menaçant et à ce moment triomphant. Nous l’avons vu dans le long extrait cité précédemment : une position révolutionnaire à mi-chemin, et forte de cette conscience, entre exploiteurs et oppresseurs. C’est ce qui s’exprima justement lors de la réunion préparatoire de laquelle sortit le manifeste, ainsi que nous le raconte Les Deux méthodes. Guesde, Vaillant et Jaurès avaient défendu l’intervention et l’action contre les modérés (Millerand, Viviani, Jourde, Lavy) qui l’avaient donc emporté par refus de se mettre « à la remorque d’un écrivain bourgeois » et surtout par la crainte de « compromettre [leur] réélection ». Un manifeste qui prônait donc l’abstention mais illustrait aussi cette question des deux camps ennemis, oppresseurs militaires et exploiteurs juifs ; un manifeste qui appelait les ouvriers à ne pas se mêler d’une lutte dans laquelle les de Mun attendaient de reprendre une place perdue quand les Reinach ne recherchaient dans la « réhabilitation directe d’un individu de leur clan [que] la réhabilitation indirecte de tout le groupe judaïsant et panamisant », le moyen de laver « toutes les souillures d’Israël ».
Il faudra encore attendre pour voir Jaurès rejoindre véritablement les dreyfusards. Pour les autres, certes, il l’était après son discours du 24 janvier. Mais il fallait qu’il allât plus loin encore et c’est ce que lui demandera l’excellent Maurice Charnay, du POSR, quand il écrivait dans Le Parti ouvrier que Jaurès, parce qu’il avait lui-même indiqué l’illégalité, ne devait pas, ne pouvait pas s’arrêter « en chemin ». Dreyfus était incontestablement innocent et le devoir du parti socialiste, le devoir de Jaurès, était de se porter à la tête du combat : « Le Parti socialiste a longtemps hésité à s’engager, à cause des élections, et brusquement, par votre discours qui est l’explosion des sentiments que l’on savait contenus, le voilà dans la bagarre. Il s’agit d’y faire bonne contenance. » (Maurice Charnay, « Au citoyen Jaurès. Lettre ouverte », Le Parti ouvrier, 29 janvier 1898). Et c’est, pensons-nous, réellement après sa défaite aux élections générales de 1898, après sa défaite à Carmaux, qu’il pourra être libre de sa parole et de son action, maintenant « convaincu […] par les révélations du procès Zola que Dreyfus était en effet innocent […] » (« Les prétendus aveux de Dreyfus », La Petite République, 12 août 1898), et parler. Le 21 mai, dans La Petit République, comme à Toulon, le 25 juin, il avait parlé « à cœur ouvert », affirmant sa conviction de la culpabilité d’Esterhazy (« Faux patriotes », La Petite République, 21 mai 1898 « Jaurès à Toulon », Le Petit Provençal, 27 juin 1898) et « partout où [il] le p[ouvait] » (« L’effondrement », La Petite République, 11 juillet 1898), « partout où [il] pass[ait], [il] communiqu[ait] au peuple ouvrier, au peuple socialiste, ce qu[’il] sa[va]it de vérité » (« Vérité et Révolution », Le Petit Méridional, 3 juillet 1898). Dans ses conférences, dans ses articles, il engageait maintenant les socialistes à le suivre, ne fût-ce que, par ce qu’elle contenait, il serait possible de tirer de l’Affaire « un parti incalculable, contre le militarisme, pour le socialisme et la Révolution » (« L’effondrement », La Petite République, 11 juillet 1898). Et c’est bien une réponse à cet engagement que constituait la « Déclaration » du POF du 24 juillet qui invitait les socialistes, « ni Esterhaziens ni Dreyfusards », à se méfier d’un tel combat qui ne pouvait qu’être une diversion et à « marquer les coups » en se concentrant sur les seules victimes dignes d’intérêt, celles qui constituent la classe ouvrière…
Quant à la question antisémite, si elle est posée avec clarté et justesse, elle aurait pu être aussi interrogée au sujet (passons sur la préface au Deslinières) de cet article de La Petite République du 13 décembre 1898 – qui paraissait, ironie du sort, le jour même où étaient lancées dans La Libre Parole les listes du souscription du «monument Henry » –, article dans lequel Jaurès expliquait la « conception sociale des juifs » comme étant « fondée sur le trafic » et que si Drumont avait adopté ce point de vue, ce « socialisme nuancé d’antisémitisme n’aurait guère soulevé d’objections chez les esprits libres ». Un article qui interroge non seulement sur la complexité de ce qu’on appelait à l’époque la « question juive » et de ses représentations mais aussi sur les rapports entre Jaurès, et plus largement le mouvement socialiste, voire le mouvement ouvrier, et l’antisémitisme.
________
Et en complément une intéressante interview de Vincent Duclert par Damien Augias sur nonfiction.fr, « le quotidien des livres et des idées » :
Dans cet entretien, réalisé par Damien Augias, l’historien Vincent Duclert offre sa lecture de l’héritage de Jean Jaurès à l’occasion de la sortie en librairie de l’importante biographie qu’il lui a consacré avec Gilles Candar . Enseignant-chercheur à l’Ecole des Hautes études en sciences sociales (EHESS) et inspecteur général de l’Education nationale, Vincent Duclert est un spécialiste reconnu de l’histoire de la IIIe République, plus particulièrement de l’Affaire Dreyfus – il a publié en 2006 une biographie d’Alfred Dreyfus qui fait autorité –, de Jaurès et de l’histoire politique de la gauche.
Parmi de nombreux titres, il a notamment publié La France, une identité démocratique : les textes fondateurs , La Gauche devant l’histoire : A la reconquête d’une conscience politique et La République imaginée, 1870-1914 . Il est par ailleurs membre de la Société d’études jaurésiennes (SEJ), longtemps présidée par Madeleine Rebérioux, qui a pris l’initiative, avec son président actuel Gilles Candar, de publier les œuvres complètes de Jean Jaurès. Les derniers volumes parus s’intitulent L’Armée nouvelle et Défense républicaine et participation ministérielle (1899-1902) .
Vincent Duclert est également commissaire de l’exposition « Jaurès contemporain » qui ouvrira au Panthéon le 25 juin (et jusqu’au 11 novembre 2014), tandis que son co-auteur de Jean Jaurès, Gilles Candar, est commissaire de l’exposition « Jean Jaurès » qui ouvrira aux Archives nationales le 5 mars (et jusqu’au 2 juin 2014).
Nonfiction – Un siècle après l’assassinat de Jaurès, que reste-t-il de sa pensée et de son action ?
Ce qu’il reste de Jaurès aujourd’hui est fortement fonction de la manière dont le monde politique, mais aussi les communautés de chercheurs, abordent Jaurès. Jusqu’aux années soixante, c’est dans le monde politique que la mémoire de Jaurès a été travaillée, par des partis qui ont été souvent concurrents. Par exemple, la « panthéonisation » de Jaurès en 1924, a été faite par les radicaux, soutenue par les socialistes et fortement contestée par les communistes de l’époque, qui considéraient que « leur » Jaurès était un Jaurès révolutionnaire, qui aurait soutenu la révolution bolchevique – ce dont on ne peut pas du tout être sûr. On est plutôt sûr du contraire, pour deux raisons principales : Jaurès refusait la violence politique et la confiscation du pouvoir par un seul parti. A l’opposé de ces périodes d’affrontement mémorielle, l’invocation de la figure de Jaurès a pu aider les partis de gauche à se retrouver aux fins de conclure des alliances politiques ou électorales comme en 1936. Les commémorations ont cette fonction, surtout celle de l’anniversaire de l’assassinat du 31 juillet 1914.
Le PS de François Mitterrand a su utiliser Jaurès pour rassembler à gauche, en particulier au moment de l’Union de la gauche dans les années 70. Mitterrand lui-même, on le sait, va honorer Jaurès à plusieurs reprises, par exemple au moment de son entrée en fonction en 1981, avec la fameuse marche vers le Panthéon, où il déposera une rose sur le caveau de Jean Jaurès (et sur ceux de Jean Moulin et de Victor Schoelcher). Cette reconnaissance ne signifie pas filiation intellectuelle. On est surtout dans l’ordre du symbolique.
La pensée de Jaurès se présente souvent sous la forme d’un halo sentimental. Dans la commémoration qui s’ouvre aujourd’hui, les historiens souhaitent faire exister Jaurès à travers une connaissance venue du travail scientifique et transmise culturellement. L’entreprise biographique a cette ambition, autant que l’édition des écrits monumentaux de Jaurès (dont la publication chez Fayard de ses œuvres sous la direction de la regrettée Madeleine Rebérioux et de l’actif président de la Société d’études jaurésiennes, Gilles Candar). Cet investissement mené depuis de nombreuses années – la SEJ est née en 1959 – fait connaître l’action politique de Jaurès et sa contribution à la pensée politique et à l’histoire contemporaine. C’est une autre manière de le rendre présent, c’est notre manière à nous historiens.
Dans un ouvrage qui est sorti en septembre dernier, Jaurès. La politique et la légende , vous mettez d’une certaine manière davantage en valeur son parcours d’intellectuel-citoyen, notamment au moment de l’affaire Dreyfus, plutôt que son action politique concrète en tant que parlementaire. L’héritage de Jaurès, dont beaucoup se réclament sans en connaître sans doute toutes les subtilités, est-il avant tout un héritage intellectuel plus que politique ?
Vous avez raison de souligner que Jaurès est un exemple d’une véritable action en politique portée par de nombreux combats individuels et collectifs. Il s’est battu pour de nombreuses lois sociales (sécurité dans les mines, retraites ouvrières, impôt sur le revenu) et des lois de liberté, il a participé à d’innombrables débats parlementaires sur les sujets les plus particuliers comme les plus passionnés, il y a donc chez lui une vraie pratique d’assemblée. De la même manière, Jaurès représente quelque chose de très important pour l’avènement des partis politiques modernes, il a été le premier responsable de l’unité des socialistes et de la formation du Parti socialiste-Section française de l’Internationale ouvrière en 1905. Le bilan de Jaurès est donc important du point de vue politique, bien qu’il n’ait participé à aucun gouvernement. D’ailleurs, même si l’on est à son époque au moment de « l’âge d’or du parlementarisme » sous la IIIe République, son itinéraire politique montre ainsi que l’on peut connaître une grande action politique sans occuper nécessairement des positions de pouvoir gouvernemental, présidentiel…. C’est une leçon qu’il faut méditer, sur le sens à donner à l’action en politique.
Mais ce qu’a montré Jaurès, c’est aussi que la politique réside dans une certaine fidélité à des valeurs : le courage personnel, la fidélité à ses électeurs – lorsqu’il est battu à Carmaux en mai 1898, Jaurès ne cherche pas à être élu à Paris, ce qui était alors possible, il choisira au contraire de reconquérir sa circonscription, ce qu’il réussira d’ailleurs en 1902 –, la dévotion aux citoyens – à travers des pratiques quotidiennes et locales, mais aussi par des engagements sur ces valeurs. Il a montré que le socialisme était pour lui un humanisme, une exigence morale en faveur des libertés et de la justice, il a contribué à ce combat au cœur de l’Affaire Dreyfus, à travers la lutte contre les lois scélérates qui visaient les intellectuels anarchistes, la défense des libertés telle que la liberté d’association en 1901, son engagement dans la laïcité avec le rôle qu’il a joué lors de la loi de 1905 de séparation de l’Eglise et de l’Etat, la lutte contre la peine de mort, le combat contre la guerre imposée aux sociétés et les forces bellicistes avec l’Internationale, autour de la loi des trois ans en France.
De ce point de vue, Jaurès n’est pas uniquement un homme d’action, il a développé une pensée politique profonde. Cela s’explique aussi par le fait qu’il agit comme un philosophe et que la philosophie reste un arrière-plan essentiel de sa vie et de sa pensée.
Vous venez de publier avec Gilles Candar une importante biographie de Jaurès, aux éditions Fayard. Que peut-on dire de nouveau aujourd’hui sur un personnage aussi commenté, aussi étudié et aussi lu ?
C’est aujourd’hui sans doute le moment d’établir le bilan de sa postérité et des travaux qui ont été menés sur Jaurès. Il est important de travailler ces études, ces livres, ces thèses, pour proposer au lecteur une synthèse de toute cette recherche, souvent très collective, accompagnée d’un accès permanent à toute la littérature elle-même, très abondante, de Jaurès. L’ouvrage est, on l’espère, construit avec méthode et clarté, pourvu d’une importante bibliographie, d’une chronologie et de tous les éléments qui permettent de maîtriser ce que Madeleine Rebérioux, grande historienne de Jaurès, appelait « le continent Jaurès », reprenant d’ailleurs une expression de son maître Ernest Labrousse.
Un autre objectif est de comprendre les liens entre Jaurès et la République car son républicanisme n’est pas désuet, au vu de l’importance qu’il a accordée à la question sociale – avant même qu’il ne devienne socialiste – en montrant que la société fabriquait beaucoup d’inégalités et que le rôle de la République était précisément d’apporter du progrès sur le plan social mais également moral, intellectuel et politique. La relecture d’un Jaurès républicain est donc essentielle car son socialisme est venu en définitive de ce républicanisme critique et non pas seulement d’une conversion au marxisme. Il se trouve que, quelques années après être entré en socialisme, il a été amené, par la réflexion intellectuelle mais aussi par empirisme, à se rendre compte que la situation des mineurs de Carmaux, où il va devenir élu, les excluait de la vie politique. Et, pour Jaurès, la domination sociale qui amène l’exclusion des droit civiques, c’est proprement intolérable. Cette réflexion l’amène à comprendre qu’il faut être socialiste pour changer la République et aller vers plus de démocratie.
De ce point de vue, son socialisme se veut démocratique, il le prouve au moment de l’Affaire Dreyfus, où il s’oppose à la majorité des socialistes, qui estiment qu’ils n’ont rien à voir avec un officier bourgeois qui, de surcroît, est un Juif, dans des circonstances où les responsables politiques, socialistes comme les autres, sont traversés par un préjugé antisémite, voire par l’antisémitisme. Jaurès se dresse contre cette injustice et montre alors que Dreyfus, qui a perdu ses attributs de classe dans la dégradation et la déportation sur l’île du Diable, est devenu le symbole de l’humanité souffrante, pour lequel les authentiques républicains doivent se mobiliser. A travers Dreyfus, il y a toute la question de la justice. Il y a ainsi une dimension de fraternité et de solidarité qui est très importante dans la pensée et l’action de Jaurès.
C’est cet homme de combats que nous avons voulu approfondir dans cette biographie, avec tout ce que cela signifie en termes de risques, de sacrifices et de mobilisation de ressources – son dernier combat lui ayant été fatal puisqu’il a été assassiné. C’est d’ailleurs bien un assassinat politique que celui de Jaurès puisqu’à travers celui-ci, on a voulu contrôler la marche à la guerre – ce qui n’a d’ailleurs pas été le cas puisque la France, comme le craignait d’ailleurs Jaurès, s’est laissée entraînée dans la guerre plus qu’elle ne l’a choisie. Jaurès s’élève, dans les derniers jours de sa vie, contre l’apathie des dirigeants français, leur incapacité de prendre des initiatives, leur état de soumission à l’allié russe. Jaurès se révèle là comme un homme d’Etat agissant dans l’intérêt de l’Europe « au bord de l’abîme », se rendant à Bruxelles auprès de l’Internationale, demandant des comptes au gouvernement français, prenant l’opinion à témoin avec ses articles de La Dépêche et de L’Humanité, ne s’arrêtant que quelques heures pour dormir. C’est une course contre la montre pour empêcher le déclenchement d’une guerre que Jaurès pressent comme terrifiante sur la base de ce qu’il a vu dans la guerre des Balkans. Mais si l’Allemagne déclare la guerre la France, Jaurès est prêt à assumer la défense nécessaire de la patrie comme il l’écrit en 1911 dans L’armée nouvelle.
Ce qu’on essaye enfin d’apporter de neuf dans cette biographie, c’est d’éclairer l’articulation chez Jaurès de la politique avec la philosophie, dans laquelle il s’est beaucoup investi – on a bien affaire à un philosophe en politique –, ainsi que l’universalité de son combat, son pluralisme culturel, à travers notamment l’internationalisation de la question ouvrière et sociale, qui se construit d’ailleurs progressivement puisque Jaurès adhère d’abord au programme de la colonisation, avant de le critiquer à la fin de sa vie en dénonçant l’écrasement des peuples colonisés par l’impérialisme colonial.
Il ne s’agit donc pas de nier ces évolutions, mais de souligner la capacité de Jaurès au dépassement des contradictions et à l’établissement de synthèses, entre la patrie et l’internationalisme, entre le socialisme et la République, entre la révolution et le réformisme. C’est bien cela qui est intéressant chez lui, il ne s’agit pas d’un doctrinaire sectaire, Jaurès est attaché au social et au réel, tout en étant porteur d’un message politique qui fera sa postérité, que ce soit chez Léon Blum, Pierre Mendès France, François Mitterrand, Michel Rocard ou François Hollande, qui a d’ailleurs conclu sa campagne présidentielle de 2012 par un discours à Carmaux.
Jaurès a été un député, journaliste et intellectuel connu et reconnu. Son ancrage territorial à Carmaux, dans le Tarn, en tant que député, mais aussi son action à Toulouse comme élu municipal, résonnent comme des légendes de la gauche mais également, plus largement, de la République. Comment cette référence est-elle aujourd’hui mobilisée par les responsables politiques et par les intellectuels ? Vous semble-t-elle fidèle au personnage et à sa vie ?
On entre dans une année de commémoration qui va être importante car Jaurès est une référence fréquente, sentimentale, pour le « peuple de gauche » comme on dit. Jaurès renvoie à un certain « âge d’or » du politique dont beaucoup restent nostalgiques. Certaines sections du PS s’appellent Jaurès, de nombreux lieux publics également, son image comme la photographie mythique de sa silhouette émergeant de la foule lors du meeting contre la loi des trois ans au Pré-Saint-Gervais le 25 mai 1913 illustre beaucoup de livres, au-delà de ceux consacrés à l’homme, sur la gauche, la République, la Belle Epoque même. Jaurès humanise la politique, c’est pour cela qu’il demeure un grand contemporain.
Cette année de commémoration peut être l’occasion de diffuser cette nouvelle connaissance sur les engagements de Jaurès et l’autonomie de sa pensée, notamment philosophique. Il ne faut pas faire de lui un saint et un martyr de la politique mais montrer qu’il a apporté une exigence dans la pratique de l’action politique. Il a d’ailleurs passé des compromis, fait des choix, mais il a aussi donné du sens à la politique, il a écrit sur la politique et il a fait aimer la politique en tant que mobilisation collective, horizon social, sans en masquer pour autant sa dureté. Jaurès est donc une école pour comprendre les raisons de croire encore en la politique, de s’approprier la notion de « dignité politique ». Avec Gilles Candar, nous avons d’ailleurs conclu la biographie de Jaurès par un chapitre qui s’intitule : « Une question de dignité politique ». C’est en effet une leçon très actuelle, pour donner du sens à la politique et du goût pour la politique.
Vous avez récemment publié Réinventer la République , ouvrage dans lequel vous insistez en particulier sur l’héritage de Jaurès (mais aussi de Pierre Mendès France et de Georges Boris) et, plus largement, étudiez les valeurs républicaines, ce que vous appelez « une constitution morale ». Vous écrivez notamment : « Même si elle demeure encore invoquée comme un principe souverain, [la République] s’est éloignée de la société. Pour certains même, elle n’assurerait plus le lien civique. Le désenchantement pour la démocratie se nourrit de l’indifférence, voire de la défiance pour la République. » A votre sens, au-delà d’un mot trop souvent galvaudé, que représente en effet aujourd’hui réellement la République pour les citoyens et leurs représentants ?
Ce que j’ai voulu montrer dans cet ouvrage, qui repose sur d’anciens comme de récents travaux de recherches, c’est le fait que le rapport des citoyens à la République est généralement perçu sous l’angle des institutions, des partis, des personnalités politiques. Or l’histoire nous enseigne, celle de Jaurès en particulier, que le rapport avec la République est celui que nous allons créer nous-mêmes en tant que citoyens, en revendiquant des valeurs morales, les libertés fondamentales notamment. Dans toute une série de combats, ceux de Jaurès par excellence, il y a ainsi l’invocation de ces droits de l’Homme et du citoyen, établis en 1789, qui ont fondé la constitution de la République au-delà de ses seules lois constitutionnelles, invocation qui n’apparaît pas nécessairement dans le système des pouvoirs et l’action des partis. Rappeler que la République n’est pas uniquement constituée par des institutions, mais également par une dimension que portent les citoyens, c’est très important, cela donne de l’avenir à la démocratie.
En étudiant Jaurès, on voit qu’il s’est appliqué dans ses combats à définir cette relation que les citoyens peuvent construire avec la démocratie, et que peut incarner la République.
Presque cent ans après sa mort tragique, alors que nous fêtons également le Centenaire de la Grande Guerre, l’image de Jaurès n’est-elle pas devenue avant tout celle du pacifiste ?
C’est peut-être la nouveauté que nous tentons d’apporter avec cette biographie de Jaurès, dans le contexte du centenaire de la Première Guerre mondiale, c’est-à-dire le travail que nous avons mené sur le combat de Jaurès contre la guerre.
Si Jaurès apparaît aujourd’hui comme un pacifiste, c’est à tort car Jaurès consent à la guerre, sous certaines conditions toutefois qui témoignent de sa volonté de maintenir l’espace de la décision politique. La guerre peut être acceptée dès lors que les peuples auront tout fait pour défendre la paix et qu’ils en ont conscience. Si tel est le cas, une nation est guidée par des « forces morales ». Elle sait pourquoi elle lutte, et elle sait que les raisons de la guerre ne sont pas la conquête et la destruction. Elle a épuisé toutes les possibilités de paix par la négociation, et elle poursuit cette entreprise par la guerre, car il ne s’agit pas d’accepter l’ordre de la guerre annihilant la raison démocratique. Jaurès réfléchissait la guerre défensive et la soutenait en dernière alternative. Une guerre offensive ne peut être selon lui qu’une guerre de conquête alors que la réponse à une agression extérieure ne peut être considérée comme telle. On est aussi en mesure de vaincre dans la guerre défensive, lors de contre-offensives bien menées et dès lors victorieuses, ce qui fut d’ailleurs le cas lors de la Bataille de la Marne en 1914, quelques semaines après sa mort, avec la mobilisation de la société toute entière symbolisée par les fameux taxis parisiens, devenus « les taxis de la Marne ».
Jaurès ne peut pas être taxé de pacifiste intégral. Au contraire, il est resté déterminé en faveur de la paix internationale et des moyens pour construire la paix en refusant la guerre imposée aux sociétés sans qu’elles ne la choisissent. Il exhortait les hommes politiques à prendre leurs responsabilités. Il est de ce point de vue très proche des ces hommes politiques que l’on honore pour leur détermination dans la guerre – Gambetta, Clemenceau ou de Gaulle. S’il n’avait pas été assassiné, Jaurès aurait sans doute soutenu la guerre défensive contre l’Allemagne, il aurait même insisté pour que les civils gouvernent la guerre et ne laissent pas aux militaires la maîtrise des choix politiques – il n’aurait sans doute pas de ce point de vue adhéré à l’Union sacrée qui avait pour conséquence d’abdiquer de sa raison pour se soumettre à l’ordre de la guerre.
Si l’on identifie donc le pacifisme de Jaurès à l’impuissance d’un homme politique faible et soumis, voire un « sans-patrie », injure classique lancée à la figure de Jaurès jusqu’à ce qu’un égaré d’extrême droite décide de passer à l’acte, nous démontrons avec Gilles Candar que cette vision est fausse.
Son attachement au soldat-citoyen, dont vous avez parlé, notamment en cas d’agression, n’est-il pas d’ailleurs à relier au mythe de Valmy et de la « nation en armes », qu’il a d’ailleurs étudié en tant qu’historien de la Révolution ?
Jaurès a en effet écrit plusieurs volumes de l’Histoire socialiste de la Révolution française, sa réflexion sur l’armée populaire et la guerre y est très intéressante. Cela montre tout à fait que Jaurès n’a rien d’un pacifiste opposé par principe à l’outil militaire, il est au contraire attaché à ce que les nations utilisent l’outil militaire et, en le démocratisant, le modernise. Il plaide à cet égard pour une double réforme : celle de l’officier-intellectuel – d’une certaine manière, dans les années 30, de Gaulle honora la pensée de Jaurès avec sa réflexion très indépendante sur l’armée de demain – et celle du soldat-citoyen, comme vous le dites, c’est-à-dire la volonté de « décaserner » le soldat et de le ramener vers la société civile. La caserne apparaît comme le lieu de la soumission, de l’humiliation permanente du soldat, le prototype de l’échec de la professionnalisation.
Dans un récent entretien, votre collègue Marc Olivier Baruch nous confiait, au sujet de la « récupération » politique de la figure de Jaurès par le candidat Nicolas Sarkozy lors de la campagne de 2007, que les responsables politiques d’aujourd’hui « connaissent sans doute moins [l’Histoire] qu’à une certaine époque » car la « formation de nos élites a changé ». Considérez-vous également que les références historiques, comme celle de Jaurès, ont perdu de leur force dans la mesure où elles se sont d’une certaine manière banalisées et dépolitisées ?
La forte controverse de la campagne présidentielle de 2007, lorsque Nicolas Sarkozy reproche à la gauche d’avoir trahi les valeurs de Jaurès, montre déjà que la figure de Jaurès reste un enjeu politique pour la gauche et aussi pour la droite, et au-delà le défi d’incarner une morale en politique en convoquant les grands hommes. Il est certain que les raccourcis de Nicolas Sarkozy sont critiquables mais c’était aussi une manière de demander à la gauche si elle connaissait encore la pensée de Jaurès. De ce point de vue, les réactions de cette dernière à « l’OPA sarkozyenne » n’ont pas été très concluantes.
Je crois que les hommes politiques ont tout à gagner à renforcer leur connaissance de l’histoire, leur réflexion intellectuelle, c’est même, en France, l’un des traits de la « présidentialité ». Le pouvoir en politique vient en effet souvent de cette connaissance de l’histoire politique et des grandes références, non pour en faire un « opium du peuple » mais pour inscrire une politique dans une continuité, ou dans des principes qui peuvent alors exiger des choix, des ruptures même. Afin de conserver le plus essentiel, que la politique doit être interrogée en permanence et qu’elle appelle un effort de sens, dé pédagogie.
D’ailleurs, Jaurès était un homme politique qui s’interrogeait sur son action, il n’était pas nécessairement sûr de lui, il a reconnu des erreurs et il était curieux de tout. Il est d’une certaine manière l’inventeur des meilleurs côtés de la politique moderne, en termes de courage, de réflexion politique et d’enseignements donnés aux combats qu’il menait. C’est bien la leçon qu’il faut retenir de son histoire, et c’est en faisant connaître sa vie, ses textes et ses combats, par des livres, des conférences, des expositions, des hommages aussi, que cette année de commémoration sera réussie.