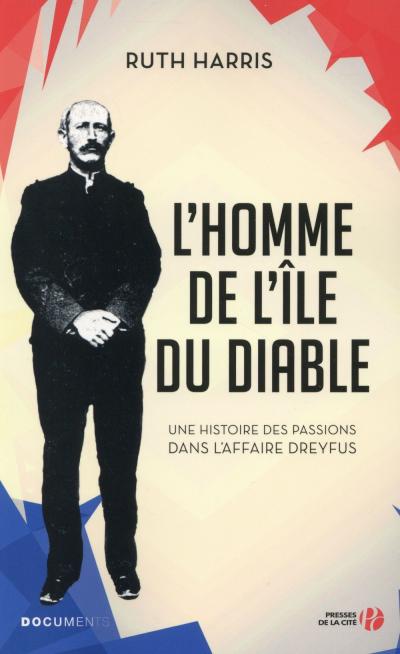 Le livre de Ruth Harris se présente comme une histoire des passions dans l’affaire Dreyfus mais aussi comme un livre qui se veut offrir une autre narration, une autre analyse, en rupture avec l’histoire « républicaine » de l’événement qui a longtemps prévalu. Le projet est assurément passionnant mais n’apporte pas plus, nous semble-t-il, à proprement parler un « éclairage nouveau sur cet événement capital de l’histoire de France » que nous promet le 4e de couverture qu’une « réinterprétation de l’Affaire » (p. 643).
Le livre de Ruth Harris se présente comme une histoire des passions dans l’affaire Dreyfus mais aussi comme un livre qui se veut offrir une autre narration, une autre analyse, en rupture avec l’histoire « républicaine » de l’événement qui a longtemps prévalu. Le projet est assurément passionnant mais n’apporte pas plus, nous semble-t-il, à proprement parler un « éclairage nouveau sur cet événement capital de l’histoire de France » que nous promet le 4e de couverture qu’une « réinterprétation de l’Affaire » (p. 643).
Nous sommes quelques-uns, en effet,, depuis 1994, à avoir tenté de replacer l’événement dans l’histoire et de l’extraire de cette vision manichéenne qui tend à le penser comme un unique affrontement entre deux conceptions du monde et, selon, entre la France du passé et celle de l’avenir, la France de droite et la France de gauche, les mauvais et les bons quand ce ne sont pas les méchants et les gentils. Si Ruth Harris veut nous dire, et nous dit, ce que furent les ambivalences dreyfusardes et « que les frontières entre les deux camps étaient loin d’être aussi étanches et les motivations de chacun, non dépourvues d’ambiguïté », elle ne nous apprend pas grand chose que nous ne sachions déjà. Quelques livres avaient déjà mis en évidence ces ambivalences et ces ambiguïtés, cette porosité des frontières entre les deux camps, montrant par exemple que les motivations à l’origine des engagements ne furent pas toujours héroïques, qu’elles furent parfois uniquement stratégiques et pour certains pour le moins douteuses. De plus (en passant sur les quelques erreurs de noms, de dates, de faits, d’interprétation dont les plus significatives sont les pages qui concernent la Ligue de la patrie française), l’analyse qui est proposée par Ruth Harris dans cette perspective n’est pas toujours exacte. Dans la série et la succession de portraits que constitue son livre – parti pris qui en rend la lecture agréable mais gêne toutefois une compréhension plus large de la thèse –, l’auteur nous présente par exemple, sur la base de ses mémoires et de sa correspondance avec Reinach, un Scheurer-Kestner trouvant « plus judicieux d’œuvrer de façon semi-clandestine » et craignant « d’humilier ceux qui auraient pu mal agir en toute bonne foi » (p. 167), hésitant, mettant en garde Reinach « contre les risques qu’il y aurait à faire des déclarations urbi et orbi » (p. 167), « se couvr[ant] lui-même avec toutes sortes d’arguties morales » (p. 168), antisémite « inconscient » et bientôt « écarté du groupe des dreyfusards pour avoir trop tardé à agir » (p. 177). Ce portrait doit être retouché. Si, en effet, Scheurer-Kestner parla un peu puis se tut tout à fait – il mit en effet en garde Reinach le 4 septembre 1897 « contre les risques qu’il y aurait à faire des déclarations urbi et orbi » après lui avoir demandé précisément le 7 août de le faire (voir sa lettre à Reinach dans BNF n.a.fr. 24898, f. 251 et la lettre à Reinach à Dreyfus du 12 septembre dans BNF n.a.fr. 24901, f. 34-36) –, si Scheurer-Kestner tenta de gagner du temps et ne dit finalement que si peu de ce qu’il savait ce n’est que parce qu’il en fut empêché. Ruth Harris l’évoque d’ailleurs (p. 150-151 et 171) mais sans y voir ce qui lui aurait permis de tracer un portrait plus juste, plus conforme à la réalité. Scheurer-Kestner était un légaliste, soucieux de régler la question « en douceur » et refusant d’avoir recours à des moyens révolutionnaires. Sa stratégie, aux premiers temps, était d’« amener le gouvernement à faire justice lui-même », chose aisée à ses yeux puisque les hommes au pouvoir étaient « des honnêtes hommes et […] des amis personnels » (Mémoires d’un sénateur dreyfusard, p. 95). Cette stratégie n’était peut-être pas la bonne, trahissait aussi une bonne dose de naïveté, mais n’était pas plus guidée par la prudence que par la tépidité. Scheurer-Kestner ne pouvait pas agir autrement puisqu’à ce moment Leblois, ne lui laissant aucune liberté d’action, ne lui avait pas donné d’autre autorisation que celle de « répandre dans “[s]on monde” le bruit que l’innocence de Dreyfus [lui] paraissait certaine » (ibid., p. 87) ? Dans ses mémoires, Scheurer expliquera ainsi clairement, bien peu craintif et clandestin, qu’il était « bien résolu à tenir [s]a parole mais tout aussi résolu à arracher à Leblois, une à une s[‘il] ne pouvai[t] faire mieux, les autorisations de [s]’appuyer sur ce qu[‘il] devai[t] à sa confiance » (ibid., p. 87). Leblois ne se laissa rien arracher et s’obstina à demander à Scheurer, après l’avoir engagé à parler, d’attendre octobre pour agir, expliquant ainsi un silence qui n’était que forcé et qui entravait le désir d’action qui le consumait. Il eût été intéressant de citer cette lettre de Scheurer à Leblois qui l’explique :
Depuis que, grâce à votre confiance, je possède ce terrible secret, j’en suis fort tourmenté ; je trouve qu’il faut, sans attendre, chercher à obtenir qu’on me délie de mon engagement ; mais ne vous inquiétez pas d’une impatience qu’il n’appartient qu’à vous seul de satisfaire. Je ne ferai rien sans votre assentiment. Il me semble qu’il y a quelqu’un [Picquart] qui devrait sentir plus vivement l’immense responsabilité morale qu’il éprouve. Son devoir est de dire ce qu’il sait. Le fera-t-il ? A-t-il le cœur assez haut placé pour marcher sur les inconvénients qui pourraient résulter pour lui, de la divulgation des faits ? Il ne s’agit nullement, dans mon esprit, de le mettre ni en jeu ni en scène ; il ne s’agit que d’être autorisé à me servir de ce que je sais aujourd’hui, en dehors, absolument en dehors de sa propre personnalité que je m’arrangerai à faire disparaître, et de couvrir de ma protection, au besoin.
Vous m’avez dit qu’on devinera de suite d’où viennent les renseignements ! Ce n’est pas sûr ! Et si le soupçon atteignait votre ami, je ne vois pas ce qu’il aurait à redouter. Jamais je n’en donnerai de preuves, entendez-moi, cher Monsieur, je me laisserais plutôt couper la langue, les mains et les pieds. Il est impossible d’admettre qu’un honnête homme garde par-devers lui un si terrible secret et laisse un infortuné livré à la torture imméritée de l’Île du Diable, même pendant un temps limité encore.
Votre ami est certainement un honnête homme ; il en a donné la preuve ; mais il ne faut pas que l’honnêteté s’arrête en route.
Voilà ce que je me dis, tous les jours, depuis mon retour en Alsace. Ce secret me trouble, il me pèse et d’autant plus que je suis homme à respecter religieusement la parole donnée.
[…] Comme je vous l’ai dit, je suis décidé, d’ici au mois d’octobre ou novembre, à affirmer ma persuasion dans une lettre adressée à un journal […]
Mais j’ai des raisons de penser qu’il ne faut pas attendre si longtemps […].
Me voici lancé. Beaucoup de personnes savent aujourd’hui quelle est mon opinion. Puis-je rester sous le coup d’une accusation, ou de légèreté ou de pusillanimité si je tarde trop à agir, après avoir tant parlé ? Je vous le demande. Il faut donc, qu’à partir du moment où nous avons commencé à parler, il ne s’écoule pas un temps trop long jusqu’au moment de l’action. Me voyez-vous, attendant trois ou six mois après une lettre ? Cela est impossible. Me voyez-vous attendant six mois après les déclarations que j’ai faites ? (lettre du 11 août, BNF n.a.fr. 23819, f. 38-39).
C’est pour cela et uniquement pour cela, dans l’impossible situation qui lui était faite, que Scheurer ne parla pas et tenta comme il le put de sauvegarder les apparences et, du fait de son silence, le peu qui lui restait de crédibilité. Comment aurait-il pu faire autrement ? Le 4 octobre, il expliquait à Reinach que « plus tard vous saurez tout et alors vous me rendrez la justice que j’ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour aboutir au plus vite et que je ne pouvais pas aller d’une allure plus accélérée » (lettre du 4 octobre, BNF n.a.fr. 24898, f. 266-267). Scheurer-Kestner, excédé, haussa d’ailleurs le ton, demandant à Leblois de lui « donne[r] » Picquart : « tant que vous ne me l’aurez pas donné, c’est-à-dire tant que vous ne m’aurez pas fourni l’argument nécessaire pour qu’on le fasse venir je me refuserai à continuer ma campagne, car depuis quelque temps je fais un métier inadmissible, grâce à vos résistances » (Scheurer-Kestner, Souvenirs « d’un républicain alsacien », BNF n.a.fr. 12711, f. 351). Mais encore une fois rien n’y fit. Résumant son action, ou le peu qu’il put faire, Scheurer-Kestner pourra ainsi écrire :
Quelle était donc ma volonté lorsqu’au mois d’octobre, revenant à Paris après un séjour à Thann, j’ai entrepris ma campagne ? Ma volonté était de demander la révision légale du procès Dreyfus. Mais je ne pouvais dans les conditions qui m’étaient faites – on sait comment j’étais tenu en tutelle par Me Leblois – arguer d’un fait nouveau. On m’avait bien promis de me donner la liberté nécessaire pour cela en octobre ; mais diverses circonstances en avaient retardé l’exécution.
J’aurais dû attendre, me dit-on.
Attendre quoi ? Que cette autorisation me soit donnée. C’est ce que je voulais faire, c’est ce que j’ai fait. (Mémoires d’un sénateur dreyfusard, p. 217-218).
Aussi, il est faux, pour aller jusqu’au bout de ce propos, de dire, comme Ruth Harris, que Scheurer-Kestner « s’exprim[a] » enfin, en publiant une lettre ouverte dans Le Temps après sa rencontre avec Mathieu qui venait de découvrir l’identité du véritable traître à la place duquel son frère avait été condamné, parce qu’il « dét[enait] enfin la confirmation qu’il attendait pour s’exprimer sans trahir la promesse faite à Leblois » (p. 171). Dans cette lettre, Scheurer, ne disait rien de ce qu’il savait et ne faisait, plaidoyer pro domo, qu’expliquer pourquoi il avait dû « [s]’imposer un silence et une réserve qu’on m’a rendus difficiles ». Il concentrait son propos sur la promesse, autre contrainte, faite à Billot le 30 octobre, d’attendre 15 jours avant de parler et ne disait rien de plus que sa conviction de l’innocence de Dreyfus. Il n’en disait rien de plus parce qu’il ne pouvait toujours rien dire : parler d’Esterhazy l’aurait obligé à parler de Leblois et parler de Leblois était trahir Picquart. Et encore, avait-il dû batailler pour que fût accepté le principe de cet article ; Leblois avait en effet demandé encore un délai supplémentaire pour rédiger une requête, une requête selon Scheurer « qu’il était décidé à ne pas faire » (Mémoires d’un sénateur dreyfusard, p. 177). De même, rien ne nous dit, comme le soutient Ruth Harris, que Scheurer fut « écarté du groupe des dreyfusards pour avoir trop tardé à agir ». Dire cela équivaudrait à soutenir que les dreyfusards furent un groupe organisé. Et nous savons bien qu’ils ne le furent pas. Les dreyfusards furent une multitude de petits groupes qui se croisèrent parfois mais ne cherchèrent que rarement à s’organiser dans le but de l’action à mener. Ainsi, pour ne citer qu’un exemple, Zola pensa son « J’Accuse…! » seul, en entretint Lazare assurément, Leblois quand il fut question de publier, Clemenceau quand il s’agit de trouver la tribune qui l’accueillerait et aucun d’entre eux n’en parla jamais ni à Mathieu, ni à Scheurer-Kestner, ni aux autres. Et si Scheurer, comme Lazare, passa « sur les lignes arrières », il semble plutôt que ce fut non seulement parce qu’il était malade (Leblois en 1906, dans une interview au Temps, en date du 24 juillet, racontera que « lorsqu’après deux mois d’une lutte héroïque, Scheurer-Kestner dut prendre un peu de repos, il pria M. Leblois de demander en son nom à M. Trarieux de le remplacer comme leader parlementaire de l’Affaire » – 24 juillet) mais encore parce que la stratégie qui fut adoptée après le procès Esterhazy ne pouvait lui convenir et l’excluait de fait ; n’oublions pas que comme beaucoup de dreyfusards, il condamna le « J’Accuse…! » et les violences de quelques autres (Gohier, Ajalbert)… Demeure la question de son antisémite « inconscient ». Ruth Harris rappelle les propos de Scheurer-Kestner sur sa volonté de ne pas paraître « affilié à la bande ». Nous avons cité dans notre Histoire de l’affaire Dreyfus de 1894 à nos jours, et auparavant dans les Carnets de Dreyfus et dans notre Bernard Lazare, d’autres passages qui pourraient tendre à confirmer ce point de vue et expliquent comment il se préoccupa, comme il l’écrit, « des apparences [qu’il] risquai[t] de donner en [s]e laissant envahir par des ingérences juives » ; « Jusque-là, expliquera-t-il, j’avais agi tout seul ; la correspondance que j’entretenais avec Joseph Reinach n’était à mes yeux que des échanges d’idées personnelles et le moyen pour moi de rester au courant de ce qui se disait à Paris sur cette affaire ; du reste, il était bien entendu entre nous qu’il fallait éviter, comme le feu, toute apparence de commerce avec la société juive. Je me fis donc une règle de n’avoir aucun rapport avec aucun israélite au sujet de l’Affaire Dreyfus et de résister énergiquement à toute tentative de rapprochement de ce genre. Je fus du reste vite compris » (Mémoires d’un sénateur dreyfusard, p. 108). Pourtant nous ne pensons pas, même si ce n’est qu’une proposition, qu’il faille voir ici cet antisémite « inconscient » dont parle Ruth Harris. Il nous semble qu’il ne s’agisse là que de stratégie. C’est en effet « dans l’intérêt de la cause », pour ne pas donner du grain à moudre aux antisémites, qu’il avait écrit en juillet à Lazare pour lui dire qu’il était préférable qu’ils ne se vissent plus (« Mémoire de Bernard Lazare sur ses activités pendant l’affaire Dreyfus » voir ici). Pour lui, axer le propos du combat sur la question antisémitique était non seulement contre-productif (« Il ne s’agit pas de crier haut, de lever de grands bras, d’enfler la voix, de s’indigner, même ! Tout cela est inutile, donc nuisible ») mais surtout le faire risquait de faire perdre de vue ce qui était à ses yeux les seuls objectifs qui importaient : « Il faut sauver l’individu, rendre l’honneur à sa famille, et sauver l’honneur du gouvernement républicain. Ces intérêts sont assez sacrés pour que nous hésitions, chaque fois qu’il s’agit d’un acte quelconque à commettre, et sur le compte duquel nous ne sommes pas certains d’être des juges infaillibles » (lettre à Reinach du 4 octobre 1897 dans BNF n.a.fr. 24898, f. 266).
Il nous semble que pour montrer les ambivalences de quelques dreyfusards, c’est de Leblois et de Picquart, de Labori aussi, plutôt que de Scheurer-Kestner qu’il eût fallu parler. Un Leblois qui chercha peut-être en l’Affaire, comme le pensait Mathieu, un moyen de se mettre en avant (voir L’Histoire de l’affaire Dreyfus de 1894 à nos jours, p. 474-476) mais surtout qui était lui-même tenu par Picquart qui lui avait écrit pour lui dire ne plus vouloir se « mêler de cette affaire, de ne pas continuer à [s]’en occuper » et que lui, Leblois, n’aurait à agir « qu’en cas de menace » (déposition Picquart dans Le Procès Dreyfus devant le conseil de guerre de Rennes, t. I, p. 461). On comprend ainsi pourquoi et comment Leblois, s’étant pour le moins emballé, se trouvait pris en étau entre ce qu’il avait engagé précipitamment en disant ce qu’il savait à Scheurer-Kestner et en l’invitant à parler et ce que désirait son ami qui lui avait fait comprendre avec fermeté ce que devait être sa conduite à son égard et à l’égard de la confidence qu’il lui avait faite. Quand il s’était agi de parler de sa correspondance avec Gonse, Picquart avait été très net et très ferme en disant à Leblois qu’il n’en était pas question et que s’il « passait outre à son consentement ce serait un abus de confiance contre lequel [il] protesterai[t] publiquement dans des termes qui ne seraient pas tendres » (lettre de Picquart à Joseph Reinach du 10 Xbre [1900], BNF n.a.fr. 24898, f. 223 v°).
De même, s’il semble une évidence que le rôle de Reinach fut essentiel et ininterrompu dans la défense de l’innocent et la dénonciation du danger et de la bêtise antisémites, son portrait en chef d’orchestre nous semble pour le moins abusif. Certes, il tenta de convertir ses amis, ses relations, ses correspondants mais ni plus ni moins que Lazare, qu’Havet, que Pécault, que Monod, etc. Certes, il demanda à Gaston Paris, en octobre 1898, d’écrire sur Picquart (p. 283) exactement comme quatre jours plus tôt, dans la logique qui était celle des partisans de Dreyfus de faire agir les sympathisants dont l’autorité pouvait aider à faire avancer la cause, Havet l’avait fait (voir Ursula Bähler, Gaston Paris dreyfusard. Le savant dans la cité, Paris, CNRS éditions, 1999, p. 93-94). Il n’est ainsi pas plus exact de dire que c’est « à l’instigation de Joseph Reinach » qu’agit Élie Pécaut (p. 337) ou que « Joseph recrute Jean Psichari […] et le prie d’écrire un panégyrique faisant ressortir la personnalité de Picquart » (p. 282). Psichari prit seul cette décision d’offrir à Picquart un panégyrique en effet tiré à 20 exemplaires autographiés et réservé aux seuls amis dont le n° 4, conservé à la BNF, fut offert à Reinach… Enfin, il eût pu être intéressant de rattacher la question du financement de la propagande (p. 326-327), qui ne fut pas une initiative personnelle de Joseph et de Salomon, au Comité de défense contre l’antisémitisme qui en fut le véritable instigateur et pourvoyeur et au sein duquel les deux frères eurent une part active (voir notre Bernard Lazare, p. 219-270).
L’autre ordre de critique que nous pourrions adresser à l’ouvrage de Ruth Harris, dont il faut souligner – ceci n’excluant pas cela – la passionnante lecture, est qu’il ne tient pas toujours les promesses que laisse entrevoir la « documentation extrêmement fournie » sur lequel il se fonde. On regrettera en effet que les quelques sources jamais utilisées et peu connues que Ruth Harris nous révèle ne le soient que de manière si allusive. Combien nous regrettons que l’utilisation faite des archives des Assomptionnistes, jamais réellement exploitées avant cet ouvrage, ne nous permette pas d’en savoir plus sur le comité Justice-Égalité et sur la stratégie qu’il mit en place et l’action qu’il mena pour « noyauter » les élections de mai 1898. Mais cela dit, cet ouvrage demeure passionnant et, dans la série de portraits qui le composent, nous offre quelques formidables pages comme celles sur Jules Soury ou celles sur les « salonnardes ».
Ruth Harris, L’Homme de l’île du Diable. Une histoire des passions dans l’affaire Dreyfus, Presses de la Cité, 2015, 744 p. 24 €.