La SIHAD […] n’a rien trouvé à répondre sur l’essentiel du livre,
alors qu’elle sait être bavarde.
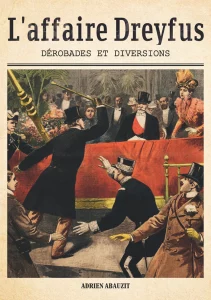 Adrien Abauzit a publié il y a quelques mois un nouveau volume, son quatrième, sur l’Affaire : L’affaire Dreyfus. Dérobades et diversions. Il est, pour l’essentiel, une réponse à notre dernière critique (celle de son troisième volume) et, nous dit-il, une démonstration de ce que la SihaD, composée d’« historiens professant le crédo dreyfusard, ne crai[nt] pas, pour bâtir [son] récit, de prendre de grandes libertés avec les pièces du dossier et de passer sous silence la contradiction antidreyfusarde » (4e de couv.). Nous accusant de nous dérober en ne discutant pas son argumentation quand ce n’est pas en l’ignorant tout à fait, de pratiquer aussi par diversion en « focalis[ant] bien souvent l’attention sur des aspects secondaires », Adrien Abauzit annonce dans son propos liminaire qu’il va « remettre l’affaire à l’endroit, ce qui implique d’anéantir les propos boiteux et les sophismes qui [lui] sont opposés », une véritable « démolition de la nouvelle argumentation adverse » (p. 9).
Adrien Abauzit a publié il y a quelques mois un nouveau volume, son quatrième, sur l’Affaire : L’affaire Dreyfus. Dérobades et diversions. Il est, pour l’essentiel, une réponse à notre dernière critique (celle de son troisième volume) et, nous dit-il, une démonstration de ce que la SihaD, composée d’« historiens professant le crédo dreyfusard, ne crai[nt] pas, pour bâtir [son] récit, de prendre de grandes libertés avec les pièces du dossier et de passer sous silence la contradiction antidreyfusarde » (4e de couv.). Nous accusant de nous dérober en ne discutant pas son argumentation quand ce n’est pas en l’ignorant tout à fait, de pratiquer aussi par diversion en « focalis[ant] bien souvent l’attention sur des aspects secondaires », Adrien Abauzit annonce dans son propos liminaire qu’il va « remettre l’affaire à l’endroit, ce qui implique d’anéantir les propos boiteux et les sophismes qui [lui] sont opposés », une véritable « démolition de la nouvelle argumentation adverse » (p. 9).
Alléchant programme que nous allons discuter.
| Ajout du 5 décembre 2025 : On nous demande, de penser un système, pour ceux qui n’ont pas envie de tout lire, qui permette d’aller directement à telle ou telle question. Voici donc un petit sommaire (il suffit de cliquer pour y aller directement) :
|
Jusqu’à présent, pour commenter les parutions d’Adrien Abauzit, nous avions centré notre propos sur quelques points qui nous semblaient saillants et symptomatiques de la méthode utilisée. Cette fois, pour ce nouveau post, nous relèverons le défi qu’implicitement Adrien Abauzit nous lance et commenterons chaque propos, page à page, paragraphe à paragraphe, ligne à ligne, fût-il d’une dérisoire importance… La chose risquant toutefois de prendre de longs mois, nous ne publierons pas en une fois mais nous procéderons par épisodes. Nous commenterons petit à petit, ajoutant au fil du temps, de ce temps que nous pourrons consacrer à cette tâche. Certains développements ici présentés n’étant toutefois pas nécessairement des plus exaltants, nous avons pris le parti, pour cette première mise en ligne, de bouleverser l’ordre de nos commentaires pour aller directement au plus intéressant. Nous commencerons ainsi par le chapitre I relatif aux dissimulations de « l’académisme dreyfusard » (p. 17-19), puis nous passerons du temps sur la chapitre II relatif à la mort de Félix Faure (p. 21-34), occasion de faire le point sur les sentiments qui furent ceux de l’ancien président de la République relativement à la révision. Nous reviendrons ensuite au début : dédicace, et introduction (p. 10-16), pour reprendre ensuite, avec le chapitre III, le déroulé du volume d’Adrien Abauzit.
• Chapitre I. Qui profite de l’ignorance du lecteur ?, p. 17-19.
Dans notre dernier post, nous reprochions à Adrien Abauzit de jouer sur l’ignorance des lecteurs. Adrien Abauzit nous retourne le compliment et, sous forme d’une série de questions, expose dans son nouveau volume un certain nombre de points « tus et, disons-le, dissimulés par les voix adverses », permettant de « prouver que ce sont les institutions et l’académisme dreyfusard qui « jouent sur l’ignorance des lecteurs », et ainsi de « mesurer le caractère inadmissible de l’accusation de la SIHAD ». Nous allons donc reprendre un à un ces silences et ces dissimulations pour voir en quelle mesure se justifie le propos d’Adrien Abauzit. Notre corpus, ne retiendra que les livres essentiels qui embrassent le plus largement l’Affaire : Thomas (1961), Bredin (1985 ; même s’il n’est pas un travail historien et est avant tout un essai littéraire et historique), Duclert (2006), Joly et Oriol (2014). Et nous y ajouterons, parfois, quelques autres auteurs quand l’axe de leur travail est en rapport avec la question abordée. Et ce sera aussi bien sûr l’occasion de développer quelques points qui le méritent…
1° le complot jésuite chez Reinach.
Marcel Thomas, dont l’étude porte sur l’affaire « de l’intérieur » et ce jusqu’à août 1898 n’avait aucune raison d’en parler, pas plus que Duclert qui propose une biographie de Dreyfus. En revanche, Bredin l’évoque en constatant que Reinach n’apporte pour soutenir sa thèse « aucun élément probant », et Joly et Oriol expliquent tous deux que cette thèse d’un complot jésuite fut un fantasme et que Reinach et les quelques autres qui la véhiculèrent s’emballèrent pour le moins. C’est aussi ce que disent Jean-Marie Mayeur, dans son article sur les catholiques dans le Drouin (L’Affaire Dreyfus de A à Z, 1994 et 2006), et Pierre Pierrard, dans Les Chrétiens de l’affaire Dreyfus (1998). Cela dit, que Reinach ait développé une telle thèse ne doit pas nous étonner : on peut s’attendre de la part d’un anticlérical à ce qu’il satisfasse à l’anticléricalisme.
2° les Dreyfus, famille franco-allemande.
La formule est lapidaire, efficace et frappante, et nous fait bien comprendre le terreau favorable qui en partie doit constituer un début d’explication de la trahison de Dreyfus. En fait de famille franco-allemande, il n’y eut qu’un Allemand dans la famille Dreyfus, Jacques, frère aîné d’Alfred. Et puisqu’Adrien Abauzit aborde la question et que nous répondons, faisons le point qui n’a jamais été fait, après avoir constaté que, contrairement à ce qu’il soutient, la nationalité allemande de Jacques Dreyfus n’a pas été passée sous silence par les historiens de l’Affaire puisqu’on la retrouve mentionnée dans Thomas, Bredin, Duclert et Oriol (Joly n’en parle pas, la question étant sans rapport avec une Histoire politique de l’affaire Dreyfus), mais aussi dans Dreyfus une affaire alsacienne d’Édouard Boeglin (2006), dans Une famille française : les Dreyfus de Michael Burns (1998), chez Reinach et dans Souvenirs et correspondance de Pierre Dreyfus, le fils du capitaine (1936). Qu’en est-il donc ? Aussi loin que remonte leur arbre généalogique, les Dreyfus sont Français. Moïse (arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père de Dreyfus) est né à Rouffach, en Alsace, en 1640. La famille, en France donc depuis le traité de Westphalie qui rattache l’Alsace à la France en 1648, française depuis 1791, demeurera toujours en Alsace, passant de Rouffach à Soultzmatt vers 1700, puis à Rixheim quelques années plus tard où elle restera de longues années. C’est ainsi à Rixheim que naîtra en 1818 Raphaël, le père d’Alfred Dreyfus. Quand Dreyfus est arrêté, sa famille est donc officiellement en France depuis 246 ans et officiellement française depuis que la chose est possible, soit 103 ans. Elle choisira de le demeurer après l’annexion, à l’exception de Jacques Dreyfus qui prendra en effet la nationalité allemande. Cela posé, quelques explications sont ici nécessaires. Après l’annexion, le Traité de Francfort imposait aux Alsaciens et aux Lorrains annexés de faire un choix : rester chez eux et devenir Allemands ou demeurer Français et partir. Les Dreyfus choisirent la France (le père pour lui et pour ses enfants mineurs) et Jacques, l’aîné, majeur, resta en effet en Alsace pour que ne soit pas perdue l’usine familiale. On peut comprendre qu’une famille puisse ne pas vouloir perdre ce qui lui permet de vivre et de cela on voudrait faire un crime aux Dreyfus ou, mieux, une preuve d’un conséquent défaut de patriotisme. Maintenant on pourrait aussi prendre l’angle opposé et voir dans le choix fait par le père, pour lui et ses enfants mineurs, et ainsi de leur éviter la conscription allemande, l’évidence que constitue un tel acte, à savoir un acte de patriotisme. Et cela d’autant plus que si on se renseigne un peu, on verra que le fait de laisser un membre de la famille en Alsace pour diriger les affaires ne fut pas rare (plus de la moitié des entrepreneurs) et qu’au total seuls 8 % des Alsaciens annexés firent le choix de la France (Benoit Vaillot, « L’exil des Alsaciens-Lorrains. Option et famille dans les années 1870 », Revue d’histoire du XIXe siècle, 61/2020). Jacques avait donc fait un sacrifice car c’est bien d’un sacrifice qu’il s’agit pour ce patriote qui, dès la déclaration de la guerre de 70, s’était engagé dans la valeureuse Légion d’Alsace. En devenant Allemand, il se savait, parce qu’il avait porté l’uniforme français, exempté de service allemand et avait un projet clair qu’il mit à exécution : celui, s’il devait avoir des fils, de demander pour eux, comme le disait la loi allemande, au jour de leur dix-septième anniversaire, un permis d’émigration qui leur ferait perdre la nationalité allemande. C’est ce qu’il fera pour ses six fils, l’un après l’autre, puis pour lui, en 1897, lui permettant ainsi d’être réintégré dans la nationalité française.
- Paul Simon, l’aîné des fils de Jacques, engagé volontaire en 1895, servira son pays contre l’Allemagne durant toute la durée de la guerre de 14, et il le fera comme tous ses frères (à l’exception de Jean, le sixième et dernier, mort en 1910 mais engagé volontaire en octobre 1905).
- Le deuxième, Maurice, engagé volontaire en 1897, « Mort pour la France » (comme Du Paty de Clam ; voir dédicace du livre que nous commentons ici), sera tué au front le 29 décembre 1914 ;
- le troisième, Charles, engagé volontaire en 1898, mourra d’une maladie contractée au service, dans son régiment, fin septembre 1914 ;
- le quatrième, René, engagé volontaire en 1899, aviateur en 1914, aura une conduite héroïque qui lui vaudra d’être élevé au grade de chevalier de la Légion d’Honneur et d’être décoré de la Croix de guerre avec palmes… il sera assassiné à Auschwitz le 21 janvier 1944 ;
- le cinquième, Henri Jacques, engagé volontaire en 1901, combattra en 14-18 sous l’uniforme des dragons.
Difficile quand même de faire plus patriotes que ces Dreyfus, Français dès qu’ils le purent, tous engagés volontaires, combattants en 14… des patriotes comme le fut leur oncle, Alfred, retraité en 1907, qui reprendra du service dès le 2 août 1914, sera volontaire pour aller au front et sera au Chemin des Dames.
3° Dreyfus ayant fréquenté « intimement des espionnes ».
Personne n’en parle en effet – et pour la première fois Adrien Abauzit a raison – parce que si Dreyfus a bien connu des femmes (on le lui aurait souhaité), aucun des auteurs évoqués ne pense que ces femmes furent des espionnes et cela pour l’unique raison qu’elles ne le furent pas. D’après Adrien Abauzit, dans son premier volume, Il y en aurait deux : mesdames Bodson et Dery (p. 107-108). Relativement à Bodson, nous en avons parlé en 2018 dans une réponse qu’Adrien Abauzit ne veut pas prendre en considération. Nous écrivions alors :
– Qu’est le passage du livre d’Adrien Abauzit relatif à la dame Bodson, espionne, sinon une affirmation péremptoire qui ne repose sur rien ? Car en effet, si la relation de Dreyfus avec Bodson est avérée, il ne fut jamais même indiqué qu’elle ait été une espionne et il n’y eut jamais – et encore – pour pouvoir le laisser penser que le témoignage tardif de Du Breuil qui ne prouve rien (ce que lui-même le reconnaîtra dans un texte postérieur), témoignage selon lequel Dreyfus aurait fréquenté chez la Bodson un attaché militaire allemand. La Bodson, interviewée pour Le Journal du 6 novembre 1894, racontera qu’elle, qui recevait beaucoup de militaires, considérait le capitaine comme « le plus patriote », « le plus chauvin » d’entre tous et qu’ils s’étaient brouillés quand Dreyfus avait appris qu’elle fréquentait un officier allemand et qu’il refusait de risquer d’être amené à le croiser un jour. Adrien Abauzit nous dira sans doute que ce témoignage de la Bodson est sans valeur. Mais il ne change rien au fait qu’il ne fut jamais même évoqué que la Bodson fût une espionne. Si elle l’avait été, il n’est pas douteux que l’acte d’accusation en 1894 en aurait fait largement mention – et il ne le fait pas – et que Dutrait-Crozon, qui n’en dit mot, n’aurait pas laissé passé cette occasion de prouver l’infamie du « juif ».
Et si l’un comme l’autre n’en parlent pas, c’est tout simplement parce que l’enquête qui fut faite à son sujet en 1894, lors de l’instruction, n’eut jamais rien à dire. Révélons à Adrien Abauzit ce rapport, signé du préfet, Charles Blanc, conservé aux Archives Nationales :
Mme Bodson, née Georgette Patay, âgée d’environ 45 ans, est la femme divorcée de M. Bodson, propriétaire des magasins « À la redingote grise ». Elle demeure avenue Malakoff 99. Elle n’a jamais habité l’avenue des Champs Élysées, mais elle a rendu plusieurs visites à son ancien mari qui demeurait il y a quelques années au n° 144 de cette voie.
Mme Bodson, que l’on dit hystérique, se livre à la galanterie. Elle a eu beaucoup d’amants.
Elle aussi très liée avec la marquise de Belbeuf.
Mme Bodson possède plusieurs immeubles dans la rue Radziwill et ne tire ses ressources que de sa fortune personnelle.
Elle est peu communicative et les noms de ses amants ne sont pas connus des gens qu’elle emploie.
Si madame Bodson s’était livrée à l’espionnage, ne doutons pas que ce rapport de la PP en eût parlé… Concernant maintenant madame Dery (ou Déry mais non Derry), le seul – c’est presque amusant – qui parla d’espionne est… Dreyfus. Juste après son arrestation, ignorant de quoi il était exactement accusé et croyant être victime d’une vengeance, il évoquera son souvenir, et la qualifiera de « sale espionne ». Il s’en expliquera quelques jours après :
Fin 1893, je fis la connaissance de Made Dery, j’allais chez elle 2 ou 3 fois puis au moment décisif, je lâchai pied. Je n’y suis jamais allé en 1894. Au moment du concours hippique, je fis la connaissance de Made Cron, après 4 ou 5 rendez-vous en plein air, je lâchai pied également. Chaque fois, je craignis que ma femme que j’adorais ne l’apprît alors me suis-je dit, dans mon cerveau égaré, peut être que l’une ou l’autre de ces deux femmes aura voulu se venger. Made Dery est en outre une étrangère, peut-être une espionne, me dis-je. Qui sait ? J’accusais presque ces deux femmes. Ma raison n’y était plus.
Et comme pour la Bodson, Dutrait-Crozon ne s’aventurera pas plus sur ce terrain, ce qui est indiscutablement un signe pour les raisons plus haut évoquées. Bien sûr, nous dira Adrien Abauzit, d’Ormescheville, dans son acte d’accusation, n’hésite pas à écrire que « La femme Déry figure en outre depuis plusieurs années sur la liste des personnes suspectes d’espionnage. » Une affirmation, comme souvent chez le rapporteur, qui est un pur fantasme, non pas tant parce qu’il n’existe aucune trace d’elle dans le Carnet B (dont il reste peu de choses) ou dans les dossiers de surveillance des étrangers conservés aux Archives de la PP et aux AN (nous avons vérifié) que parce que pour elle aussi existe un rapport du Préfet de police – toujours de la fin 1894 – qui, si madame Déry avait été « depuis plusieurs années sur la liste des personnes suspectes d’espionnage », aurait sans doute été tout autre :
Madame Dery, Marie Virginie, âgée de 34 ans, originaire de l’Autriche, est mère d’un enfant et demeure rue Bizet, 1, où elle occupe un appartement de 2500 francs de loyer.
Elle ne se livre à aucune occupation et vivrait de ses rentes auxquelles viendrait s’ajouter une pension que lui servirait sa famille qui habite l’Autriche.
Elle a plusieurs frères dont l’un est officier dans l’armée autrichienne et l’autre ingénieur. Ceux-ci seraient en relations avec elle et seraient venus la voir, pour la dernière fois, dans le courant de 1893.
L’officier, lorsqu’il vient à Paris, descend à l’hôtel et prend ses repas chez sa sœur où sa correspondance lui est adressée au nom de Déry. Il est âgé d’environ 35 ans. Quant à l’ingénieur, il entretient des rapports suivis avec M. Aueur, l’inventeur du bec d’éclairage de ce nom.
Mme Déry reçoit la visite de quelques personnes du monde parmi lesquelles on remarque des légionnaires paraissant être des officiers en civil.
Sa correspondance, assez volumineuse, vient principalement d’Autriche. Elle aurait des relations assez étendues.
Ses habitudes sont régulières. Son attitude et sa moralité ne donnent lieu à aucune remarque.
Faut-il insister sur le : « son attitude et sa moralité ne donnent lieu à aucune remarque » qui serait pour le moins étonnant de la part de la Préfecture si madame Dery avait été « depuis plusieurs années sur la liste des personnes suspectes d’espionnage » ?
Au passage, nous avons là encore un parfait exemple de ce que fut cet acte d’accusation de d’Ormescheville, tissus de ragots quand il ne s’agissait pas, comme ici, d’inventions pures et simples contredites par des documents tout à fait officiels et bien évidemment passés sous silence…
4° « Schwartzkoppen désigne le traître par la formule » “Ce canaille De D.” ce qui implique que le nom du traître commence par un “D” ».
Inutile ici de faire la liste des « historiens dreyfusards » puisque tout le monde a bien évidemment parlé de cette pièce. Reste à savoir si le « D » correspondait au patronyme réel du traître et, surtout, si ce D était Dreyfus. Nous renverrons à une des sources favorites d’Adrien Abauzit, qu’il convoque régulièrement… sauf sur cette question. En 2018, tout à fait en vain, nous lui rappelions que lors de la première révision Cuignet avait déclaré :
Quant à la pièce « ce canaille de D… » (n° 25), rien ne prouve qu’elle désigne Dreyfus, et je serais plutôt de l’avis de M. Picquart, qui estime qu’elle ne peut s’appliquer à lui, étant donné le sans-gêne avec lequel l’auteur de la lettre traite ce D…
Et que « Ce canaille de D. » concernât Dreyfus serait d’autant plus curieux que, comme nous le rappelions encore à Adrien Abauzit dans notre premier article de 2018 :
si Dreyfus est bien le « D » de « Ce canaille de D. » tout en étant concerné par la « lettre Davignon », comme le soutient l’auteur, il est une certitude qui est qu’il faut qu’on se penche sur les mois de février et mars 1894 pour comprendre ce qui a bien pu se passer entre Dreyfus et Schwartzkoppen ! Car il a bien fallu qu’il se passe quelque chose pour que celui que Panizzardi qualifie d’« ami » de Schwartzkoppen en janvier 1894 dans la « lettre Davignon » devienne une « canaille » sous la plume de Schwartzkoppen en avril (« Ce canaille de D. »)…
5° Les fuites constatées dans les bureaux où Dreyfus est passé.
Personne n’en parle en effet et uniquement parce que rien ne les prouve ! Sauf erreur de notre part, Adrien Abauzit en liste deux, de ces fuites : la pièce dite « des chemins de fer » et la minute Bayle. Nous ne parlerons pas « des chemins de fer » – lettre qui pour nous date indiscutablement de 1895, à une époque où Dreyfus était à l’île du Diable – puisque nous en avons parlé à chacune de nos réponses en octobre et décembre 2018 et en 2021. Concernant la minute Bayle – et encore une fois – nous avons largement répondu à Adrien Abauzit. Nous redonnons donc ici notre premier développement sur la question, développement… de 2018 :
Difficile de discuter quand Adrien Abauzit disqualifie la découverte que fit Targe en 1904 de la minute réapparue (et qui ne pouvait plus être un crime de Dreyfus, accusé de l’avoir subtilisée pour la transmettre aux Allemands) pour lui opposer les seuls témoignages des tenants de l’accusation et cela au seul motif qu’à ce moment le gouvernement était de « tendance ultra-dreyfusarde » et le ministre de la guerre André un « républicain fanatique » (p. 37) ; difficile de discuter quand il qualifie la pièce retrouvée par Targe de faux en se fondant sur les arguments de Dutrait-Crozon qui n’ont jamais vu la pièce (« n’ont » parce qu’ils sont au moins deux) et ne la discutaient que sur les descriptions données à l’occasion de la seconde révision. Cela dit, elle pose plusieurs questions cette « minute Bayle » : 1° Pourquoi ne pas s’interroger – le faire procéderait de l’équilibre et de la droiture d’intention – sur le fait que si elle n’avait pas été trouvée avant 1904 c’était parce que personne, à l’État-major, pour conforter la culpabilité de Dreyfus, n’avait intérêt à la trouver ? 2° Si on veut admettre que la « minute Bayle » ait en effet disparue et que la pièce retrouvée en 1904 était un faux, en quoi prouvait-elle la culpabilité de Dreyfus ? Juste parce que Dreyfus se trouvait au 1er bureau quand elle fut rédigée ? 3° Si nous partons toujours de la même hypothèse, quelle folie avait pris Dreyfus de soustraire une pièce qu’on ne retrouverait donc pas et qui risquait de l’accuser quand il avait tout loisir de la copier ? 4° Si cette pièce qui datait de mars 1893 était bien en rapport avec une note de Schwartzkoppen interceptée en décembre 1895, pourquoi l’attaché militaire tentait-il seulement de répondre à une question posée deux ans et demi plus tôt ? 5° Si la note de Schwartzkoppen interceptée en décembre 1895 était bien en rapport avec la minute Bayle pourquoi l’attaché militaire allemand y parlait-il d’une « lettre 3e Direction » puisque celle que Dreyfus était censé avoir livrée était une « note » du 1er bureau ? 6° Si la découverte de 1904 était un faux, comment expliquer que s’y trouve de l’écriture de Bayle, qui avait quitté l’État-major le 3 juillet 1895 et était décédé le 20 novembre de la même année ? 7° Pourquoi Adrien Abauzit ne se pose-t-il pas les questions que nous nous posons et dont la plupart étaient celles que se posaient dès 1904 le capitaine Hallouin, Clément Moras, Manuel Baudouin, Henry Mornard, Targe et qu’on trouve en plusieurs endroits dans la procédure de 1904-1906 qu’il affirme pourtant avoir lues ? Équilibre et droiture d’intention…
6° Léonie.
Marcel Thomas, Vincent Duclert et Betrand Joly n’en parlent pas, puisque leur sujet est autre, mais Bredin et Oriol en parlent largement. La question étant traitée dans les commentaires relatifs à l’introduction que nous trouverons plus loin, nous renvoyons au passage qui la concerne.
7° Le petit bleu « pseudo-brouillon, non écrit et non signé par Schwartzkoppen, n’ayant jamais été envoyé par la poste ».
Vincent Duclert et Betrand Joly n’en parlent pas, puisque leur sujet est autre, mais Thomas, Bredin et Oriol le font. Mais là, pour une fois, nous sommes d’accord… ou en partie d’accord. En partie, parce que ce fameux petit bleu portait une signature de convention : « C », et parce qu’il ne s’agit pas d’un « pseudo-brouillon » ou d’un brouillon mais d’un petit bleu finalement jeté à la corbeille plutôt que d’être confié aux bons soins des Postes & Télégraphes. Sinon, nous sommes d’accord – et nous le disons tous – parce qu’il est bien écrit par une autre main que celle de Schwartzkoppen et que, puisque jeté à la corbeille, il n’a pas été confié à la diligence des services postaux. Cela dit, il n’y a rien à discuter ici, puisque tous les historiens qui ont sérieusement travaillé sur l’Affaire n’ont jamais dit autre chose – qui ne change rien et n’indique rien relativement à la culpabilité de Dreyfus ou la pseudo-falsification de Picquart. Si toutefois on veut en savoir plus sur cette question, on pourra se reporter à nos posts, d’octobre 2018, décembre 2018 et 2021.
8° Picquart n’a rien trouvé au procès Zola à répondre « quand ont été dévoilées ses manœuvres pour falsifier le Petit bleu, en vue de le faire passer pour une lettre envoyée par la poste ».
Personne n’en a parlé en effet parce que tous ceux d’entre nous qui ont parlé du procès Zola ne peuvent s’accorder avec cette affirmation démentie par la sténographie. Dire que Picquart n’a rien trouvé à répondre n’est pas exact. Les deux fois où il lui a été parlé de cette demande qu’on l’accusait d’avoir faite relativement à l’autorisation de faire apposer un timbre sur le petit bleu, il a dit que Gribelin devait confondre, que « jamais, jamais, jamais » il n’avait dit cela à Lauth et que jamais il n’avait dit au même qu’il voulait « pouvoir dire là-haut que j’ai intercepté cela à la poste ». Il a donc bien trouvé à répondre et a répondu : que Lauth mentait et que Gribelin, avec lequel il avait « très souvent […] causé de la manière dont on pouvait envoyer des lettres à des espions [avait dû garder] un de ces souvenirs […] dans son esprit ; mais, dans l’espèce, je dis : Non, je ne m’en souviens pas du tout. » Adrien Abauzit nous dira sans doute que nier n’est pas répondre. On conviendra toutefois que quand quelqu’un accuse quelqu’autre d’avoir dit ce qu’il estime ne pas avoir dit il est difficile de faire autre chose que nier.
9° « Esterhazy, simple officier de troupe, n’avait aucune possibilité pour obtenir les pièces du bordereau ».
Personne ne l’a dit non plus puisque tous nous pensons – et sommes même absolument sûrs – qu’Esterhazy avait cette possibilité. Sans même reprendre les démonstrations que quelques-uns d’entre nous ont proposées, lisons simplement ce passage de l’arrêt de la Cour de cassation. Il ne plaira pas à Adrien Abauzit, puisque les magistrats qui la forment sont à ses yeux des vendus. Mais ici est cité largement le rapport de quatre généraux au sujet desquels il aura sans doute à dire, mais qui sont tout de même quatre généraux et quatre généraux dont l’autorité sur les questions relatives à la chose militaire en général et à l’artillerie en particulier sont indiscutables :
[…] une commission, composée de quatre généraux, désignée par le ministre de la Guerre, le 5 mai 1904 – le général de division Balaman, du cadre de réserve, ancien président du Comité technique de l’artillerie, le général de division Villien, inspecteur permanent des fabrications de l’artillerie, le général de brigade Brun, commandant l’École supérieure de guerre, le général de brigade Séard, du cadre de réserve, ancien directeur de l’École de pyrotechnie, – a rédigé un rapport dans lequel, à l’unanimité, ils déclarent : 1° qu’un officier d’artillerie, commettant un acte de trahison, n’aurait pas, dans un écrit en 1894, présenté comme « intéressants » des renseignements sur le canon de 120 et le frein hydraulique universellement connus depuis longtemps, mais qu’il aurait pris soin de spécifier, comme faisant l’objet de sa « note », le canon de 120 court et le frein hydropneumatique dont la création était récente ; que, du reste, « il était possible, et on peut dire facile, pour un grand nombre d’officiers, artilleurs ou non, de se procurer les moyens de fournir sur le canon de 120 court et sur son frein hydropneumatique une note donnant des renseignements intéressants », sans être pourtant « assez complets et assez précis pour permettre la construction d’un frein hydropneumatique pareil à celui du 120 court » ; 2° qu’un officier d’artillerie n’aurait pas, dans un écrit, employé cette expression, insolite et anormale sous sa plume, « la manière dont la pièce s’est conduite » ; 3° qu’un officier d’artillerie n’aurait pas dit ne pouvoir qu’avec une extrême difficulté se procurer le projet de manuel de tir du 14 mars 1894, puisque « ce projet de manuel, dont plus de 2 000 exemplaires avaient été envoyés par la 3e direction, ne pouvait être confidentiel, mais devait servir aux écoles à feu et être par suite l’objet d’instructions faites, non seulement aux officiers de l’armée active et aussi à ceux de la réserve, et même aux sous-officiers que l’on doit exercer à remplir les fonctions de chef de section » ; 4° que si la « note sur une modification aux formations de l’artillerie » visait les dispositions prises de juin à août 1894 pour la mobilisation des régiments d’artillerie, le traître n’aurait pas employé le mot « formation » qui ne sert de titre à aucune des pièces du volumineux dossier existant à la 3e direction, pièces intitulées, tantôt « mobilisation des régiments d’artillerie », tantôt « organisation de l’artillerie » dans le plan de 1895 ; qu’il aurait fait usage « de ces mots plus imposants » ; et que, « en dévoilant une partie si importante de la mobilisation générale, il aurait fourni un renseignement d’une importance telle qu’il n’eût pas un seul instant senti le besoin de corser son envoi, de battre les buissons pour réunir un assemblage disparate de documents quelconques, comme l’a fait l’auteur du bordereau, s’efforçant visiblement de remplacer la qualité par la quantité » ; qu’au contraire, en s’exprimant comme il l’a fait, il a dû avoir simplement en vue le projet de révision de règlement sur les manœuvres de batteries attelées, dans lequel le mot « formation » constituait « le titre vingt fois répété de tous les paragraphes » ; que « les régiments de la troisième brigade d’artillerie étaient chargés d’essayer pendant leur séjour au camp de Châlons en juillet et août 1894 ce projet de règlement » ; qu’il était « entre les mains des officiers » ; et que si l’on suppose la présence au camp de Châlons d’un officier « en quête de documents à livrer », il a pu, même n’appartenant pas à l’artillerie, l’avoir « pendant le peu de temps nécessaire pour y copier la partie réellement intéressante, c’est-à-dire la formation de guerre » ;
Attendu que, sur ce point, la commission des généraux experts conclut dans les termes suivants : « On reconnaîtra que cette hypothèse prend un singulier caractère de probabilité si l’on veut bien remarquer que les trois nouveautés essayées au camp de Châlons en 1894 étaient le manuel de tir, le canon de 120 court (le canon de 120 long a été également tiré avec son frein hydraulique) et le projet de règlement sur les batteries attelées, nouveautés qui se trouveraient ainsi faire justement l’objet de trois notes du bordereau se rapportant à l’artillerie » ;
Or, attendu qu’au camp de Châlons où Dreyfus n’était pas en août 1894, était Esterhazy qui, d’après l’enquête de 1899, se tenait à l’affût d’informations relatives aux « choses de l’armée » et surtout à l’artillerie ; que précisément le journal La France militaire, dans ses numéros des 11 et 15 août, appelait l’attention sur les expériences du camp de Châlons concernant les trois nouveautés dont parlent les généraux experts ; et que le même journal, dans le numéro du 15, entreprenait, au sujet de l’expédition de Madagascar (qui fait l’objet de la quatrième note du bordereau) une série d’articles dans lesquels des renseignements avaient pu être puisés ;
Attendu – quant au manuel de tir – qu’il convient d’ajouter qu’Esterhazy, vers la fin du mois d’août 1894, avait cherché à l’avoir en communication du lieutenant d’artillerie Bernheim, qui lui avait remis, sans parvenir ensuite à se le faire restituer, le règlement sur les bouches à feu de siège et une réglette de correspondance, et que vainement on a invoqué contre Dreyfus la déposition du colonel Jeannel, déclarant lui avoir prêté, en juillet, pendant quarante-huit heures, un des trois exemplaires du manuel de tir déposés à le section technique du 2e bureau ;
Attendu que Dreyfus, expliquant par une confusion involontaire cette déclaration, a affirmé avoir emprunté seulement le manuel de tir allemand dont il avait besoin pour un travail sur l’artillerie de l’armée allemande ; que, du reste, dans l’hypothèse même où les souvenirs du colonel ne seraient pas erronés, Dreyfus, ayant, dès le mois de juillet, rendu l’exemplaire emprunté, ne l’aurait pas, à la fin d’août, offert à l’agent A…, et que stagiaire à l’État-major, il n’aurait pas écrit : « Je ne puis l’avoir à ma disposition que très peu de jours ; le ministre de la Guerre en a envoyé un nombre fixe dans les corps et les corps en sont responsables » ;
Attendu – quant à la « note sur les troupes de couverture » et au membre de phrase additionnel, « quelques modification seront apportées par le nouveau plan » – que, d’une part, Le Journal des Sciences militaires, dans un numéro de mai 1894, publiait une étude sur « le 6e corps et les troupes de couverture » ;
Attendu que, d’autre part, au troisième bureau, d’après l’enquête de 1899, des documents très importants et secrets étaient copiés, non pas uniquement par des officiers, mais, contrairement aux règlements, par des secrétaires (sous-officiers, caporaux ou soldats) ; que des indiscrétions ont pu, de bonne foi, être commises ; qu’elles ont pu l’être même par des stagiaires causant avec des camarades de l’armée ; que l’article du journal et les conversations entendues au camp de Châlons ou ailleurs étaient de nature à fournir, pour la rédaction d’une note dont le texte demeure inconnu, des informations plus ou moins précises et plus ou moins exactes sur les troupes de couverture et les modifications arrêtées déjà pour entrer en vigueur avec le nouveau plan ;
Attendu enfin que le bordereau se termine par les mots : « Je vais partir en manœuvres » ; mais que Dreyfus, en 1894, n’est pas allé aux manœuvres de septembre et n’a pu croire au mois d’août qu’il irait ; qu’en effet, une circulaire ministérielle du 17 mai, mise à exécution en juillet par l’envoi dans les régiments des stagiaires de première année, excluait pour eux comme pour les stagiaires de deuxième année toute participation aux manœuvres de septembre ; et qu’entendu comme témoin dans la nouvelle enquête le capitaine de Pouydraguin a déclaré qu’ayant été plus tard interrogé sur ce point par le lieutenant-colonel Henry, il avait remis à celui-ci une note non retrouvée depuis lors, portant que, dès le printemps 1894, les stagiaires avaient été avertis et savaient qu’ils ne devaient pas aller aux manœuvres cette année-là ;
Attendu, au contraire, qu’Esterhazy, dont le régiment, le 74e d’infanterie, a assisté aux manœuvres de forteresse de Vaujours, a pu, bien que dispensé en sa qualité de major, avoir l’intention de s’y rendre à titre individuel ; et que l’expression incorrecte « partir en manœuvres » se rencontre sous sa plume dans des lettres dont une remontant à 1886 et une autre, datée du 17 août 1894, contemporaine, par conséquent, du bordereau[.]
10° « la Cour de cassation s’est basée sur des “expertises graphologiques” émanant de non-graphologues ».
En dehors de Marcel Thomas et de Bertrand Joly, dont le propos est autre (mais Joly ne parle que de cela dans divers articles dont « L’École des chartes et l’Affaire Dreyfus », Bibliothèque de l’École des chartes, 1989, n° 147, >p. 611-671, tous en ont parlé. Mais quelle est l’importance de cela ? Quand on parle d’écriture, avoir recours, en 1898-1899, à des archivistes-paléographes ou a des philologues n’est peut-être pas complètement dénué de sens. S’adresser, en 1904, pour étudier la valeur scientifique de l’expertise Bertillon et de ses suiveurs (Corps, Valerio, les auteurs de la brochure verte), à des mathématiciens ne l’est pas plus dans la mesure où Bertillon se positionnait en tant que tel. À Rennes, il avait ainsi expliqué que sa démonstration était « principalement géométrique », que rien des « motifs psychologiques qui peuvent avoir guidé l’accusé » ne l’avait intéressé et qu’il n’avait jamais entendu rester que « sur le terrain absolument scientifique » : « il n’est pas douteux pour moi qu’un problème a été posé. Quelle est la solution de ce problème ? Elle est mathématique », dira-t-il encore. Et si Adrien Abauzit doit être choqué par le fait que « la Cour de cassation s’est basée sur des « expertises graphologiques » émanant de non-graphologues », pourquoi ne l’est-il pas à propos de Bertillon qui n’était pas plus graphologue qu’il n’était expert assermenté mais un fonctionnaire de police qui considérait d’ailleurs que : « La graphologie, c’est de l’astrologie », comme nous le démontrions en 2021 à Adrien Abauzit en réponse à un développement dans lequel il accusait Joseph Reinach qui donnait cette citation pourtant bien réelle et très connue d’avoir menti.
11° Labori victime d’un attentat et qui reprend sa place à peine huit jours après.
De cela encore tout le monde parle… Et oui, Labori a été victime d’un attentat et a repris sa place quelques jours après… et alors ? Dans son premier volume, Adrien Abauzit s’en amuse et cite Maurice Barrès : « Je m’étonne avec l’univers d’un attentat, tel que les policier ne trouvent pas les assassins, que les chirurgiens ne trouvent pas la balle et que l’assassin s’en trouve très bien » (p. 289). Et pourtant, Labori l’a bien reçue cette balle ; on trouve d’ailleurs dans ses papiers à la BNF la radiographie faite après l’attentat sur laquelle elle se voit nettement. Il suffit d’y aller voir…
12° La copie faite par Esterhazy, à la demande d’un journaliste anglais, du bordereau, copie qui « différait complètement de l’original ».
Personne n’en a parlé parce que les choses ainsi présentées sont fausses. Avant Adrien Abauzit, cet argument avait été développé dans la revue d’Action française, sous la plume de Dutrait-Crozon. Il y était expliqué que les dreyfusards avaient été dans l’obligation de se passer de ce document essentiel puisque « Esterhazy qui connaît si bien l’écriture du bordereau jusque dans ses moindres détails, cette fois […] s’est attaché à s’écarter le plus possible de l’original » (« Esterhazy », n° 179, 1er décembre 1906, p. 642-643). Si elle différait donc, c’est donc parce qu’Esterhazy avait fait ce qu’il fallait pour ! Mais le problème c’est qu’une nouvelle fois L’Action française pliait la réalité à ses besoins. Labori, quand elle l’a lui avait été offerte, l’avait refusée, cette copie, non pas parce qu’elle était telle que l’imaginent Dutrait-Crozon et Adrien Abauzit mais parce qu’une pièce devant suivre les voies légales pour être recevable devant un tribunal, l’avocat avait donc demandé au livreur de la déposer entre les mains du colonel Jouaust, président du Conseil de guerre, ou à défaut au greffe… Curieuse idée qui serait celle de la défense que de livrer ainsi au tribunal une pièce qui les aurait desservis ! Quant à savoir si la copie « différait complètement de l’original », il suffit de lire la presse de l’époque pour en savoir plus : le journaliste chargé d’apporter le document en France considérait la copie comme présentant « une très forte ressemblance, la différence principale étant que l’écriture actuelle d’Esterhazy était légèrement plus large » (presse du 19 septembre 1899).
13° La déposition Cuignet censurée par la Cour de cassation.
Et non ! personne n’en a parlé parce que rien atteste cette accusation de Cuignet. Et nous renvoyons, infra, à notre commentaire, partie 2°, des pages 13-15 pour voir ce qu’il en est de cette question.
14° La falsification par la Cour de cassation de l’article 445.
Personne n’a soutenu cela parce que ce n’est pas vrai. Mais en revanche tout le monde a parlé de cet arrêt et quelques-uns ont montré que cette accusation, talisman de L’Action française, ne tenait pas. Ici même, en 2021, nous l’avons déjà expliqué à Adrien Abauzit. Nous redonnons donc notre explication qui elle aussi n’a pas retenu son attention :
Adrien Abauzit constate à juste titre notre « condition de non-juriste » et soutient que ce cruel manque nous enlèverait « toute qualité pour apprécier au mieux l’affaire Dreyfus, dont le cœur est tout de même une série de procédure judiciaire ». Que dire ? On ne peut donc travailler sur l’armée sans être militaire, sur la culture du blé en Ouzbékistan sans être agriculteur ou ouzbek ou sur les crimes sans être un assassin ? Peu importe… Adrien Abauzit nous le prouve en allant commenter les travaux de deux historiens « dreyfusards » […] et nous donne un petit TD de droit sur le cas de l’article 445 du code d’instruction criminelle et, à la suite de l’Action française, de sa falsification par la Cour de cassation pour réhabiliter Dreyfus. Malheureux historiens qui ignorent ce que sait l’avocat, à savoir que l’article 111-4 du code pénal affirme que « la loi pénale est d’interprétation stricte ». C’est vrai… seulement c’est oublier l’interprétation téléologique qui permet au juge, quand le texte n’est pas clair, de rechercher l’intention du législateur, d’extraire l’esprit du texte – la fameuse ratio legis – et d’y subordonner sa lettre. Manque de clarté, donc, ou absurdité de l’interprétation littérale. Et c’est justement le cas dans lequel nous nous trouvons avec ce fameux 445, dans le cadre précis qu’est celui de l’Affaire. Expliquons un peu. L’article 445 dit que « Si l’annulation de l’arrêt à l’égard d’un condamné vivant ne laisse rien subsister qui puisse être qualifié de crime ou délit, aucun renvoi ne sera prononcé », autrement dit, si Dreyfus est vivant, et qu’il n’y a pas crime, c’est-à-dire pas trahison, le renvoi devant un nouveau conseil de guerre ne sera pas prononcé. Mais il y a bien trahison. Donc, dans l’absolu, la Cour de cassation ne peut juger au fond, c’est-à-dire casser sans renvoi… Dreyfus est vivant, le crime existe, il y a donc à juger et il doit donc y avoir renvoi… Seulement, le cas qui est le nôtre ici est absurde et ouvre donc la porte à cette recherche de la ratio legis et par conséquent à l’interprétation téléologique. Absurde en effet – s’il est encore nécessaire de l’expliquer – parce les nouveaux juges militaires appelés à se prononcer sur le cas Dreyfus n’auraient pu que, soit entériner purement et simplement l’arrêt rendu par la Cour de cassation qui disait Dreyfus innocent, soit, en ne le suivant pas, condamner un homme dont l’innocence avait été solennellement prononcée par la juridiction suprême. Il est clair, comme l’écrit Baudouin dans son réquisitoire, qu’en « disposant qu’il n’y a pas lieu à renvoi, s’il ne subsiste rien qui puisse être qualifié crime ou délit, le législateur n’a pas entendu se placer à un point de vue abstrait. Il a eu évidemment en vue, comme le texte l’indique, le condamné en faveur de qui la condamnation est ordonnée ». Voilà précisément ce qu’est une interprétation téléologique. N’eût-il pas en effet été absurde de voir Dreyfus jugé pour un crime qu’il n’avait pas commis simplement parce que le crime existait ? Qu’eût été en effet un tel procès où il n’y aurait plus rien à juger sinon le crime ?
Voilà donc une bien drôle de manière de discuter en ne donnant qu’une partie de l’information et en l’assurant par la simple affirmation d’une expertise qui, au final, semble plus que discutable.
Et quant à la fable de la falsification du 445 par la Cour de cassation, plutôt que de s’en tenir à Dutrait-Crozon et aux quelques autres qui s’en revendiquent ou tentent de maintenir vivante sa flammette, Adrien Abauzit aurait pu se reporter au texte de l’arrêt et constater que si la mise au clair de l’interprétation de la loi en était donnée à la fin des attendus (« Attendu, en dernière analyse, que de l’accusation portée contre Dreyfus rien ne reste debout ; et que l’annulation du jugement du Conseil de guerre ne laisse rien subsister qui puisse, à sa charge, être qualifié crime ou délit »), le texte dans sa forme originale était lui aussi donné textuellement dans la première partie (« si l’annulation prononcée à l’égard d’un condamné vivant ne laisse rien subsister qui puisse être qualifié crime ou délit, aucun renvoi ne sera prononcé »). Quel faux serait donc celui qui donnerait, avant le texte falsifié, le texte original, livrant ainsi lui-même la clé de la supercherie ?
À la fin de ce trop long passage, nous nous interrogerons donc sur la conclusion d’Adrien Abauzit qui nous dit que « ce n’est pas en lisant les ouvrages relatant la version institutionnelle que l’on risque d’apprendre tout cela [et que] pour faire passer leur fable, les auteurs dreyfusards n’ont pas d’autre choix que de « jouer sur l’ignorance du lecteur ». » Nous avons vu qu’hormis les points faux qui n’ont pas a être présentés, tout l’est par les auteurs en question et donc qu’Adrien Abauzit nous dit donc ici quelque chose qui n’est pas et ne vaut donc, auprès de lecteurs peu au fait, que parce qu’il est écrit…
Cela dit, nous pourrions jouer aussi à ce drôle de petit jeu et avancer à notre tour que ce n’est pas en lisant Adrien Abauzit et ses prédécesseurs « que l’on risque d’apprendre tout ce qui va suivre » : le lecteur d’Adrien Abauzit
- Sait-il que la fameuse scène de la dictée n’était qu’une curieuse mise en scène dont l’issue importait peu, l’arrestation de Dreyfus ayant été décidée quatre jours avant et l’ordre permettant d’y procéder ayant été signé la veille.
- Sait-il que c’est à La Libre Parole et non pas à un autre journal que fut transmise, et à deux reprises, la nouvelle de l’arrestation de Dreyfus ?
- Sait-il que les experts qui conclurent dans le sens de l’accusation furent invités à rencontrer Bertillon, qu’ils se rendirent à l’invitation et que le seul qui conclut dans l’autre sens fut celui qui ne s’y rendit pas ?
- Sait-il que l’instruction écarta systématiquement les témoignages et rapports (comme celui de la PP qui indiquait que Dreyfus était inconnu dans les cercles de jeux) ?
- Sait-il que le général Mercier affirma à la presse, avant le procès et foulant donc aux pieds la présomption d’innocence, que Dreyfus était coupable ?
- Sait-il que la lettre de Gonse à Boisdeffre du 6 janvier 1895 à propos des pseudo aveux est un faux ?
- Sait-il que l’authenticité du faux Henry fut, au lendemain de sa création – fait unique –, attestée par les grands chefs pour transmission au ministre, véritable aveu de la falsification ?
- Sait-il que Gonse, quand Picquart l’informa de sa découverte, l’encouragea à continuer son enquête sur Esterhazy et lui prodigua des conseils dans le but d’arriver « à la manifestation de la vérité » ?
- Sait-il que Picquart engagea ses chefs à enquêter à propos de la publication du bordereau dans Le Matin et de l’article de L’Éclair et que ses chefs préférèrent ne pas donner suite ?
- Sait-il qu’Esterhazy fut contacté dès la mi-octobre 1897 (soit un mois avant sa dénonciation par Mathieu Dreyfus) par l’État-major pour assurer sa protection ?
- Sait-il que les articles signés Dixi étaient l’œuvre d’Esterhazy sur une trame fournie par les hommes de l’État-major ?
- Sait-il que le ministre de la Guerre, au courant de cette réalité, laissa faire sans inquiéter Esterhazy ?
- Sait-il qu’Esterhazy envoya des lettres de menace au ministre de la Guerre et au président de la République et que ses lettres furent parfois inspirées, le plus souvent dictées, par les hommes de l’État-major ?
- Sait-il que jamais pour cela non plus Esterhazy ne fut inquiété ?
- Sait-il qu’Esterhazy affirma avoir en sa possession une lettre très confidentielle soustraite au ministère de la Guerre et qu’il ne fut pas inquiété ?
- Sait-il qu’au contraire, même, quand il décida de la rendre, on vint la reprendre en échange du reçu qu’il avait exigé ?
- Sait-il que le général de Pellieux fut très largement « éclairé » par les hommes de l’État-major sur ce que devait être son enquête ?
- Sait-il qu’au procès Zola, l’État-major adressa à l’avocat général les questions que les témoins de l’accusation souhaitaient qu’on leur posât ainsi que la manière qui pouvait lui permettre de contrer celles de la défense ?
- Sait-il qu’au moment du même procès, les généraux Gonse et Boisdeffre écrivirent au président du jury pour lui faire quelques promesses relatives à certains réservistes de ses amis ?
- Sait-il que les information, fausses pour la plupart, relatives à François Zola, furent transmises aux journaux par l’État-major ?
- Sait-il que Mercier passa son temps à promettre de publier un document qui prouvait indiscutablement la culpabilité de Dreyfus et qu’il ne le fit jamais ?
- Sait-il que les dépositions des témoins de l’accusation varièrent considérablement d’une procédure à l’autre pour arriver, au final, à l’alignement ?
… et nous pourrions continuer ainsi pendant des pages et des pages…
Mais reprenons donc la lecture de ce nouveau volume et passons au plus intéressant.
• Chapitre II. Dérobades et diversions sur l’assassinat de Félix Faure. La mort de Félix Faure, p. 21-22.
Adrien Abauzit revient sur son précédent volume et nous dit
- que la « version graveleuse » de la mort de Félix Faure est fausse.
- que Félix Faure a été assassiné par empoisonnement ;
- que l’assassin est « probablement » Marguerite Steinheil, exécutrice des hautes œuvres du « Syndicat » ;
- que les mobiles du crime étaient l’« opposition au Syndicat » de Félix Faure et son projet de coup d’État.
La thèse n’est pas nouvelle et vient, rappelons-le – avec quelques infimes différences –, tout droit de chez André Galabru (L’assassinat de Félix Faure, Paris, éditions du Trident, 1988), qui lui-même l’avait trouvée dans La Libre Parole de 1899 et 1908, dans le très délicat et anonyme L’assassinat maçonnique, le crime rituel, la trahison juive (1905), dans le non moins délicat La République juive. Ses trahisons, ses gaspillages, ses crimes ! de Charles Fleury (1910) et dans Les Morts mystérieuses. Les Oubliettes modernes d’Albert Monniot (1918 puis 1934). Elle tient tout entière en quelques paragraphes de Drumont :
[Félix Faure] était vraiment un patriote noblement soucieux de la grandeur de son pays et fermement résolu à écraser le complot international et juif.
Sur ce point, il n’y a plus de doute. Félix Faure allait adresser un message à la nation, faire appel à l’armée et à la France, qui lui aurait répondu par une formidable acclamation.
C’était l’heure décisive, l’heure suprême. En voyant que tout était perdu, les meneurs du complot dreyfusard ont-ils fait un dernier effort, ont-ils eu recours au crime ?
C’est l’opinion de beaucoup, parmi les mieux informés de la politique contemporaine.
Cette opinion n’est pas une vague rumeur, un propos en l’air ; elle repose à la fois sur l’ensemble de la situation d’alors et sur d’innombrables petits faits qui, rapprochés les uns des autres, auraient été, tout au moins, de nature à justifier l’ouverture d’une instruction sérieuse. (« Drames de la terre et de la mer », La Libre Parole, 27 avril 1912)
Nous allons donc voir cela en suivant et en discutant la démonstration d’Adrien Abauzit. Commençons.
Nous sommes d’accord sur le premier point avec Adrien Abauzit : la version graveleuse est fausse et plus que fausse, elle est idiote. Nous sommes d’accord sur ce point, et sur cet unique point, et nous allons voir pourquoi les « preuves et les indices de l’assassinat » qu’invoque Adrien Abauzit, après de nombreux autres, ne peuvent nous convaincre et pourquoi nous continuerons – et encore longtemps – à porter crédit à la version officielle, celle du rapport des médecins.
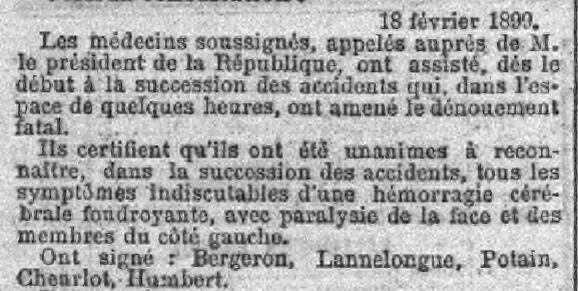
Listons pour commencer les « preuves et les indices de l’assassinat » selon Adrien Abauzit :
-
- thérapeutique anti-empoisonnement,
- version controuvée du Journal officiel,
- douleur au cou,
- absence d’autopsie,
- embaumement rapide, hors des délais légaux,
- texte-aveu de Pressensé,
- version absurde de Saint-Simonin dans Les Propos de Félix Faure,
- Climat hostile à Félix Faure à l’Élysée.
- Apoplexie foudroyante durant plusieurs heures [oublié par Adrien Abauzit dans sa liste, p. 21-22].
- Faure était en bonne santé [idem].
Chapitre II. Félix Faure et la révision, p. 22-23.
Adrien Abauzit, qui nous reproche de nous dérober et de pratiquer par diversions, ne répond pas ici à ce que nous disions et, parlant de paille quand nous lui parlons de poutre, décale le propos en ne retenant que ce qui est relatif à Faure et à la révision et en oubliant ce qu’était notre propos : l’impossibilité d’affirmer, autrement que gratuitement, que Faure « rest[ait] convaincu de la culpabilité [de Dreyfus] » et que s’il se savait menacé c’était « en raison de son engagement antidreyfusard » (p. 45). Faure n’a jamais pris publiquement le moindre parti et personne ne pourra jamais trouver trace reposant sur une source indiscutable d’un engagement quelconque. Concernant la sphère privée, s’il put avoir, dans les premiers temps, une conviction et l’affirmer – nous y reviendrons –, rien, dans ses écrits intimes ou dans ce que nous connaissons de sa correspondance privée, ne nous permet de savoir ce qu’il en fut à partir de la fin de l’été 1898. Officiellement, Faure tint toujours à demeurer dans son rôle et il suffit de lire un peu son Journal et un peu aussi ses lettres à Le Gall conservées dans ses papiers aux AN pour en être sûr : en refusant par exemple de voir les dossiers que les deux camps cherchaient à lui soumettre, se refusant à tout commentaire officiel et officieux, Félix Faure ne s’est jamais engagé, ni dans un camp ni dans l’autre, et rien ne peut permettre d’affirmer, ni à Adrien Abauzit ni à nous, ce que furent, peu avant sa mort, une conviction et des sentiments relativement à l’innocence ou à la culpabilité de Dreyfus qu’il conserva toujours pour lui. C’est précisément ce que nous disions dans notre précédent post :
Déjà, il faut dire pour commencer que Félix Faure ne s’est jamais « engag[é] » du côté antidreyfusard. Il ne s’est pas engagé parce que, président de la République, il ne le pouvait pas et demeura toujours, comme l’exigeait sa charge, au-dessus des partis. On sait en revanche que s’il fut longtemps convaincu de la culpabilité de Dreyfus et l’était peut-être encore à la veille de sa mort (nous l’ignorons et rien ne nous permettra de le savoir), il était, comme en témoignera à plusieurs reprises son Directeur de cabinet, Le Gall, partisan de « la révision prompte et complète ».
Félix Faure ne dit donc jamais rien et il n’y a que les faits qui peuvent nous permettre de comprendre ce que pouvaient être ses sentiments, sinon sur le cas Dreyfus en tous cas sur la question de la révision. Mais n’anticipons pas cette question qui sera longuement exposée à la suite et faisons un petit détour, nécessaire, du côté des sources.
Le témoignage de Louis Le Gall
Déplaçant donc le propos, Adrien Abauzit ouvre donc un tout autre débat en confiant à ses lecteurs sa « stupéfaction » que nous ayons pu écrire que « Félix Faure aurait été partisan de la révision prompte et complète » et que pour soutenir cette affirmation nous n’ayons trouvé qu’à « invoquer le témoignage de Louis Le Gall, chef de cabinet de Félix Faure ». À ce témoignage, irrecevable à son point de vue puisque Le Gall a été « déjà convaincu de mensonge », il nous oppose ce qu’il appelle les « faits », à savoir que : « tant les amis que les ennemis de Félix Faure ont toujours observé qu’il était opposé à la révision du procès Dreyfus »… Et pour cela, Adrien Abauzit nous donne deux noms : Clemenceau et Marguerite Steinheil… et une citation de chacun.
Puisque l’idée est ici de commenter, de tout commenter, et de retrouver Adrien Abauzit sur le terrain qu’il a choisi, commençons par voir le reproche qu’il formule, à savoir de que nous n’avons trouvé qu’à « invoquer le témoignage de Louis Le Gall, chef de cabinet de Félix Faure, déjà convaincu de mensonge ». En fait nous n’avons pas TROUVÉ QUE le témoignage de Louis Le Gall mais nous n’avons UTILISÉ QUE le témoignage de Louis Le Gall, et si nous nous en sommes contentés ce n’est que parce qu’il nous semblait, sur ce point précis et sur ce point surtout, suffisant. Adrien Abauzit, qui nous reproche d’être trop bavards et dans le même temps de ne pas l’être assez, nous oblige à l’être tout à fait pour aller au bout de cette question des sources qui n’est pas sans intérêt. Intéressons-nous pour commencer au témoignage de Louis Le Gall puisque d’un revers de plume Adrien Abauzit l’annule. Tout d’abord demandons-nous pourquoi il faudrait écarter ce témoignage de celui qui partagea pendant de longues année le quotidien de Félix Faure ? Au principe qu’il a été « convaincu de mensonge » ? Soit. Mais qui l’a convaincu de mensonge ? Une seule personne… la source d’Adrien Abauzit : André Galabru. En premier lieu, il faudrait se demander ce que peuvent valoir les avis toujours définitifs du « rigoureux » André Galabru… mais le moment est prématuré et remettons cette question, dont on verra ce qu’il en est au fil des paragraphes qui vont suivre, à plus tard. André Galabru conteste donc le témoignage de Le Gall et le fait non seulement sur la narration qu’il donne de la dernière journée de Félix Faure mais encore sur ce qu’il dit de ses sentiments relativement à l’Affaire :
Le Gall était dreyfusard et probablement franc-maçon, et son témoignage s’applique, peut-être dans un souci hagiographique, à minimiser les positions antidreyfusardes du chef de l’État en insistant beaucoup sur les doutes qu’il eut après la découverte du faux Henry […] et en passant quasiment sous silence le retour à ses convictions premières quelques temps après. (p. 223-224).
Il est clair que les souvenirs de Le Gall, qui fut le chef de cabinet d’un Président qui le considérait comme « un véritable ami » et qui témoignera, dans son Journal comme dans sa correspondance, de la « véritable affection » qu’il lui portait, se montra à la hauteur de cette amitié dont il s’honorait. Il est clair que Le Gall voulut, avec ses souvenirs, défendre « une mémoire qui m’est bien chère », et ainsi remplir son « devoir d’ami fidèle » (p. 264), et que pour ce faire il eut à cœur de donner de celui qu’il avait servi avec dévouement l’image la plus positive possible. Sur la première période de Faure, période d’indiscutable conviction de la culpabilité de Dreyfus, il est vrai que Le Gall minimise quelque peu les sentiments du Président même s’il est d’une parfaite exactitude dans ses développements sur le reproche qu’il pouvait formuler à l’égard des dreyfusards et sur ce respect scrupuleux de la Loi et de la Constitution qui lui imposait de demeurer toujours en dehors et au-dessus des passions et pour ce faire d’aller jusqu’au bout d’une logique qui lui commandait même de refuser de s’informer. En revanche, sur la seconde période, Le Gall n’avait d’autre choix que de « passer sous silence le retour à ses convictions premières » puisque ce fameux retour est un pur fantasme qui n’existe que parce qu’André Galabru l’affirme. Mais là encore n’anticipons pas ce point que nous développerons largement par la suite… S’il est évident que nous devons manier avec prudence ces souvenirs – comme tous les souvenirs, à vrai dire –, on ne peut les écarter. Quand on voit, par exemple, la parfaite rigueur avec laquelle Le Gall nous donne à lire les lettres de Faure dont les originaux sont aujourd’hui consultables aux AN et à la transcription desquelles il ne manque pas la moindre virgule, quand on voit combien, sur tout ou presque, ses souvenirs s’accordent avec le Journal de Félix Faure que nous pouvons lire depuis 2009, il est impossible de les considérer comme nuls et non avenus… bien au contraire. C’est bien pour cela que nombreux furent les auteurs qui voulurent les considérer comme une source d’importance, et la source la plus juste à bien des égards… De nombreux auteurs au premier rang desquels – et c’est tout à fait extraordinaire – il faut compter André Galabru lui-même ! Car tout au long de son livre, bien loin de contester Le Gall, André Galabru l’utilise très largement et s’il l’utilise, c’est donc comme une source fiable :
« selon Le Gall »,
« Le Gall souligne »,
« ajoute Louis Le Gall »,
« Louis Le Gall ne croyait pas si bien dire »,
« Il est maintenant parfaitement établi par tous les témoignages dont celui de Louis Le Gall »,
« si on en croit le témoignage de Le Gall »,
« comme on peut en conclure de l’examen des révélations de Le Gall », etc.
Comment fait-on alors le tri ? Le Gall a été « convaincu de mensonge » mais ne ment pas toujours selon André Galabru qui l’utilise très largement. Mais ne discutons pas et oublions Le Gall qui ne sera plus guère convoqué dans ces pages (puisque nous voulons nous placer et demeurer sur le terrain choisi par Adrien Abauzit), même si, minimisant ici, exagérant là, il nous offre un document dont on ne peut faire l’économie, comme, en le citant abondamment, André Galabru nous l’indique.
Le témoignage de Marguerite Steinheil
Voyons maintenant la première source qu’Adrien Abauzit oppose et préfère à la source Le Gall, pour affirmer que Félix Faure était antidreyfusard et opposé à la révision : les Mémoires de Marguerite Steinheil. Nous allons nous y intéresser mais avant il faut noter combien il est inédit d’utiliser comme source – et surtout première, essentielle et si ce n’est unique – les mémoires de celle qui serait la criminelle – puisque c’est ce que défendent André Galabru et Adrien Abauzit – qui, par définition, n’allait certainement pas raconter, si elle est vraiment criminelle, la vérité… Et en en tout cas pas concernant la mort de celui qui est censé être sa victime… Inédit, en effet, ce cas de figure selon lequel, pour connaître les mobiles d’un crime, on fonde l’essentiel de sa conviction sur le témoignage de l’unique accusé qui, menteur, se dit innocent et que l’on sait coupable…
Mais passons encore. Avant de nous intéresser à la source Steinheil, voyons la citation que nous oppose Adrien Abauzit afin de prouver à ses lecteurs que « pour véhiculer la fable institutionnelle, la SIHAD est prête à plaider n’importe quoi, y compris contre l’évidence la plus frappante » :
Mais [Félix Faure] croyait, de toute sa conscience, qu’une révision serait une catastrophe nationale.
Elle est intéressante cette citation que nous donne Adrien Abauzit et qui n’est jamais qu’une parole (celle de Marguerite Steinheil) contre une autre parole (celle de Le Gall). Elle est surtout intéressante pour le « Mais » initial. Parce qu’en effet, s’il y a un « mais » en ouverture c’est que le segment donné contrebalance un autre propos qui le précède – et qui n’est pas repris ici. Retournons donc au texte de Marguerite Steinheil et lisons, page 85, la citation, en restituant le segment initial qu’Adrien Abauzit n’a pas conservé :
Quant au Président, il me serait difficile d’affirmer qu’il fut absolument convaincu de la culpabilité du capitaine, ou, du moins, que cette conviction survécut au colonel Henry. Mais il croyait, de toute sa conscience, qu’une révision serait une catastrophe nationale.
Il est dommage qu’Adrien Abauzit n’ait pas conservé ce début qui nous dit justement – en opposition totale à ce qu’il soutient – que si, selon Marguerite Steinheil, Félix Faure demeurait opposé à la révision, il n’était peut-être plus aussi convaincu que cela de la culpabilité de Dreyfus. Et de ce fait, il serait intéressant de savoir sur quelle base Marguerite Steinheil pourrait être la source qui permet de prouver l’antirévisionnisme de Faure, et ne plus l’être quand il s’agit de sa conviction relative à la culpabilité ou à l’innocence ?
Mais passons encore et revenons à la source Steinheil et à ce que du coup peut valoir la petite phrase, même incomplète, que nous oppose Adrien Abauzit. Pour les auteurs qui ont sérieusement travaillé, et travaillé sérieusement, sur la question (Thierry Billard et Bertrand Joly), il ne fait aucun doute que les mémoires de Marguerite Steinheil sont à manier avec énormément de précautions. Même la source d’Adrien Abauzit, André Galabru, convient lui-même du caractère souvent douteux des mémoires de Steinheil. Mais bien évidemment, ce faisant, c’est au final pour nous expliquer que :
Si d’autres témoignages sont suspects chez Marguerite Steinheil, ce n’est pas le cas, répétons-le pour ceux qui concernent son enfance, sa vie parisienne, et ses relations avec Félix Faure (bien que là, elle n’ait pas tout dit). Les dissimulations et les embrouillaminis n’apparaîtront que plus tard car, pour l’instant, la critique attentive ne permet pas de déceler de grosse inexactitudes ou invraisemblances dans son récit.
Ce qu’elle nous relate de l’affaire Dreyfus tout particulièrement, est tellement précis et cadre tellement avec ce que nous savons (ou ne savons pas) par ailleurs de cette tumultueuse affaire, qu’il est exclu qu’elle ait pu inventer les propos qu’elle prête au Président de la République au plus fort de la crise. Et même s’il y avait quelques exagérations et quelques maquillages de détails, ceux-ci ne peuvent remettre en cause le contenu essentiel de son témoignage que rien ne permet jusqu’ici d’écarter, et que corroborent comme nous le constaterons d’autres témoignages. (p. 89)
Marguerite Steinheil ment donc… mais ne ment pas sur tout… Assurément pas quand elle parle de l’affaire Dreyfus. Et elle ment tellement peu sur la question que ce qu’elle peut nous en dire « cadre tellement »… même avec ce que nous « ne savons pas » ! Donc, selon André Galabru, si nous comprenons bien, Le Gall dit la vérité, sauf quand il parle de l’affaire Dreyfus et Marguerite Steinheil ment le plus souvent, sauf quand elle parle de l’affaire Dreyfus ! Vu comme cela, en effet, les choses sont simples… mais peut-être faudrait-il un peu fonder cela. Les témoignages corroborant ? Laissons-les pour le moment de côté puisque nous les verrons bientôt. Il saute aux yeux, à lire les mémoires de Marguerite Steinheil, que tout y est arrangé, gonflé, écrit en effet pour valoriser celle qui tient la plume et montrer quelle femme d’exception elle fut, entre égérie et éminence grise (même si, comme l’a souligné Thierry Billard, elle peut dire qu’elle ne le fut jamais – p. 62-63 – après avoir écrit – p. 61 – que Félix Faure « se servait de mon intuition et j’eus la grande satisfaction de lui éviter plus d’un faux pas. Je le voyais après les Conseils de cabinet et il me mettait au courant de ce qui avait été dit et fait… »). Ainsi, alors que personne n’a jamais douté de ce que fut la nature de la relation qu’entretenaient Marguerite Steinheil et Félix Faure, la principale intéressée, elle, ne la veut présenter que comme exclusivement platonique et explique qu’elle fut la cheville ouvrière, mieux même la seconde main, de Mémoires de Félix Faure… Mémoires qui ont bien évidemment disparu :
À ces Mémoires, je contribuais par une foule de notes et de commentaires, jetant un peu de lumière sur certaines personnalités et sur certains faits. Parfois nous travaillions chacun de notre côté et parfois nous collaborions. Bien souvent j’ai passé une après-midi tout entière à lire et à classer des documents, tandis que le Président, dans le salon voisin, donnait des audiences. (p. 65-66).
De ce qui pouvait constituer ces Mémoires de Faure, Marguerite Steinheil se contente de nous donner quelques vagues informations. Comme l’écrit André Galabru :
Certes, les « Mémoires » de Mme Steinheil ne font aucune révélation sur le continu [sic pour contenu ?] de ces documents, mais le peu qu’ils livrent et surtout la suite des événements ne peuvent pas nous faire éluder leur existence.
Qu’est-ce que ce « peu » que nous livrent les mémoires de Marguerite Steinheil ? André Galabru, qui, comme tout le monde, n’a jamais vu les fameux documents en question, reprend pour nous le dire, en résumé, un passage des souvenirs de Marguerite Steinheil :
Ces « Mémoires » devaient constituer une histoire de la France secrète depuis la guerre franco-prussienne et traitaient l’évolution de la politique intérieure et extérieure de la France, de l’alliance franco-russe, de l’expansion coloniale, des système électoraux, et surtout relataient l’histoire secrète de l’affaire Dreyfus.
C’était sans doute là le morceau explosif de ces confidences qui, « si elles eussent été publiées, disons dix ou quinze ans plus tard, un grand nombre de soi-disant personnes en vue auraient dû disparaître pour échapper au mépris du monde entier, tout autant à la haine de leur propre concitoyens ». (p. 97)
Sans anticiper de ce que nous dirons plus tard de la méthode d’André Galabru, nous voyons ici, en parenthèse, comment on peut faire dire à un texte ce qu’il ne dit pas. Le : « surtout » et le « C’était sans doute là le morceau explosif de ces confidences » ne reposent sur rien d’autre que sur les espoirs de celui qui écrit et la volonté qui est la sienne de donner un peu de solidité à sa thèse. Car en effet, si on va à la source d’André Galabru, pages 65-66 des mémoires de Marguerite Steinheil, on lira tout autre chose :
Ces cahiers constitueraient une sorte d’histoire anecdotique et secrète de la France depuis 1880 [la version anglaise, originale, dit : « since the Franco-Prussian War »].
[…]
Nous écrivions ces Mémoires sur du papier écolier que j’apportais moi-même, car nous savions que le papier du Président était compté ! Tout était traité dans cet ouvrage volumineux : l’évolution des politiques intérieure et extérieure de la France ; le jeu des alliances et des ententes ; les dessous de l’Affaire Dreyfus [la version anglaise, originale, dit : « the secret story of the Dreyfus Affair »] ; les manœuvres des divers prétendants au trône de France… Il y avait des chapitres sur des problèmes financiers, sur l’expansion coloniale, les armements, les systèmes électoraux, les rouages de l’Administration, l’Armée et la Marine… Et, certes, si une étude critique, consciencieuse, impartiale, sobre – basée sur des faits et des documents irréfutables – des événements qui forment l’histoire non dévoilée de la Troisième République valait la peine d’être écrite – et qui pourrait le nier ? – alors Félix Faure avait raison d’utiliser chaque jour quelques heures de son temps – et du mien – à écrire ces Mémoires… Il est certain, toutefois, que s’ils avaient été publiés moins de dix ou quinze années après, un grand nombre d’hommes « éminents » auraient été obligés de disparaître pour échapper au mépris du monde entier et à l’exécration de leurs compatriotes.
La mise en regard de la source et de ce qu’en fait André Galabru sous forme de résumé est étonnante. Dans le texte de Steinheil, l’original, l’affaire Dreyfus n’est qu’un épisode parmi les autres que rien ne distingue, que rien n’en fait, comme le soutient André Galabru – et même s’il fait précéder son affirmation d’un « sans doute » –, « le morceau explosif de ces confidences »… Personne ne connaît ces papiers mais André Galabru, qui donc ne les a pas plus vus que quiconque, sait ce qu’ils contiennent et quelles en sont les plus terribles morceaux !
Mais revenons à Steinheil. Nous allons voir au fil de ces pages combien est problématique cette source et combien il est dangereux de fonder une démonstration sur une base aussi peu fiable. Il est d’ailleurs amusant de constater qu’écrivant cela nous sommes en accord – une fois n’est pas coutume – avec les sources habituelles d’Adrien Abauzit, dont il sera intéressant de donner ici un petit florilège :
[…] elle se réfugie dans les racontars où nul contrôle n’est possible. […] C’est le déplorable roman d’une aventurière sans esprit, sans style, sans caractère et même sans imagination. (Gil Blas, 21 avril 1912)
[…] nous avons un livre, sans couleur, morne et terne, un livre où les faits, même les plus notoires, sont manifestement faussés ; on y trouve des récits extravagants et surtout… surtout une insupportable vanité de parvenue, de petite bourgeoise orgueilleuse, qui s’est, crue reine parce qu’elle fut admise dans l’intimité d’un président de la République, qu’elle nous représente comme un pauvre homme.
[…] Elle se lance alors dans de mystérieuses histoires de coup d’État qu’aurait voulu tenter Félix Faure, elle se campe en bonne républicaine qui veut dissuader le président d’attenter à la sûreté de l’État, elle se donne un rôle de confidente à laquelle on confie de précieux papiers qu’elle défend contre l’indiscrétion de trop nombreux intéressés. (L’Intransigeant, 21 avril 1912).Reste à savoir si ce n’est pas le roman chez la concierge !
À première vue, il semble bien que ces « Mémoires » soient purement et simplement un tissu d’extravagances. (La Libre Parole, 19 avril 1912).Les mémoires de Meg. – Ils vont paraître. On les annonce. Ils seront sûrement une déception. En effet, Mme Steinheil n’a jamais dit la vérité, ne peut pas dire la vérité et ne dira jamais la vérité. Elle racontera des blagues, elle mettra en valeur son propre rôle, elle versera un pleur sur Félix Faure, elle glissera sur la qualité de ses visites à l’Elysée et notamment sur la dernière, qui ne fut pas la plus banale. Elle saupoudrera une fois de plus de lévites et d’hommes noirs – car elle a l’imagination courte – l’épisode sanglant de la nuit de l’impasse. (L’Action française, 21 avril 1912).
La « preuve » Clemenceau
Si la source Steinheil n’a que peu de valeur et ne peut en avoir qu’à condition d’être croisée avec d’autres sources – et nous verrons bientôt que ce qu’elle peut dire par rapport aux sentiments qui étaient ceux de Félix Faure relativement à la révision doit être pour le moins relativisé… –, voyons ce qu’il en est de la seconde – et dernière, donc – source d’Adrien Abauzit : Georges Clemenceau. Adrien Abauzit en donne une citation qu’il veut considérer comme une preuve supplémentaire :
C’est Félix Faure qui avait entrepris, pour son propre compte et pour le compte des autres coupables, d’étouffer la révision du procès Dreyfus.
Clemenceau a bien écrit cela, c’est indiscutable… Comme est indiscutable qu’un ami de Rochefort écrivit, dans L’Intransigeant, quelques mois plus tôt, le 8 septembre 1898 :
après avoir collaboré à l’odieuse besogne dreyfusarde, l’inconscient Félisque est retourné à Rambouillet avec Mme Faure et Melle Lucie.
Qu’est-ce que cela prouve, en dehors du fait qu’on ne peut donc pas dire, comme le fait Adrien Abauzit au sujet de la petite phrase de Le Gall dont nous nous contentions dans notre précédent post, que notre « assertion était contredite par les faits : tant les amis que les ennemis de Félix Faure ont toujours observé qu’il était opposé à la révision du procès Dreyfus » ? Ni Clemenceau ni l’ami de Rochefort ne fréquentaient Félix Faure. Ni l’un ni l’autre ne savaient quoi que ce fût de ses pensées. Ces deux avis, contradictoires, ne sauraient, ni l’un ni l’autre, avoir valeur de témoignage et moins encore valeur de preuve. Et, d’ailleurs, Adrien Abauzit aurait pu aller beaucoup plus loin et ajouter à sa citation la quasi-totalité des dreyfusards puisque tous ou presque développèrent cette idée d’un Faure non seulement antirévisionniste mais encore à la botte des nationalistes. Tous le pensèrent et tous l’écrivirent, tous qui ne fréquentaient pas plus Félix Faure que ne l’avaient fait Clemenceau ou l’ami de Rochefort et tous qui jamais ne furent dans la confidence de ses pensées intimes. Quelques-uns, même, comme Pressensé, soutinrent que Faure était prêt, en 1899, juste avant sa mort, à reprendre le grand projet de Cavaignac de faire arrêter les dreyfusards et de les faire traduire en justice. Et alors ? Qu’est-ce que cela prouve ? Qu’est-ce qu’un article de polémique, qu’est-ce que cent articles de polémique, articles de combat, peuvent prouver d’autre que ce que sont les opinions ou les fantasmes de ceux qui les écrivent ? Ou alors, s’ils prouvent quelque chose, il faudra convenir que le complot jésuite – dont parle souvent Adrien Abauzit pour s’en offusquer – que les dreyfusards affirmèrent avec certitude et régularité au même moment était une réalité… Et il est curieux, quand même, de n’avoir de cesse de dire que les dreyfusards ont toujours menti et de prendre pour argent comptant ce qu’ils disent quand la chose peut permettre de soutenir ce qu’on a à démontrer… Pour comprendre ce qu’écrivit Clemenceau, pour comprendre ce qu’écrivirent au même moment tous les dreyfusards ou presque, et pour comprendre aussi ce que pouvait dire, à l’opposé, l’ami de Rochefort, il nous faut – avant de voir passer en revue les autres « preuves et les indices de l’assassinat » –, revenir sur les faits et voir se dérouler les événements. Ce sera l’occasion de faire le point sur la double question qui nous intéresse de savoir si Faure pensait Dreyfus coupable et s’il était – puisque Adrien Abauzit l’affirme comme une certitude et que les deux sources qui nous sont opposées et qui devaient la régler ne règlent rien du tout… – pour ou contre la révision de son procès.
Félix Faure et la révision
Revenons en arrière, au tout début de l’affaire politique. À ce moment, Félix Faure est convaincu de la culpabilité de Dreyfus. Il le dit à Albert de Monaco le 12 février 1898, comme en témoignent son Journal (p. 296) et une lettre d’Albert de Monaco à Reinach dans laquelle le Prince raconte à son correspondant que le Président lui avait dit : « Dreyfus est bien vraiment coupable, vous pouvez en être assuré ! » (lettre à Reinach du 31 mars 1899, BNF NAF 13550, f. 41). En juin, encore, il exprime le même point de vue à Alexandre Ribot, ainsi que ce dernier le consigna dans ses notes : « Le Président me dit qu’il n’a pas vu le dossier mais qu’il est convaincu de la culpabilité » (AN 563/AP 5, note en date du 16). Là s’arrêtent nos certitudes. Comme nous le disions dans notre précédent post, à l’origine de cette longue discussion, nous ignorons et rien ne nous permettra de savoir – les souvenirs de Steinheil, seule source, étant à utiliser avec précaution et les certitudes de Clemenceau sur ce point n’ayant pas la moindre valeur – si les sentiments de Félix Faure relativement à la culpabilité de Dreyfus changèrent au cours du temps. Quant à la révision, Félix Faure y fut-il opposé de tout temps, comme le soutiennent, avec les dreyfusards, Marguerite Steinheil et Adrien Abauzit ? Faure y devint-il à un moment favorable, comme le soutiennent Le Gall et André Galabru ? Et si tel était le cas, revint-il à ses premières amours comme le défend André Galabru ? Des sentiments personnels de Félix Faure, là encore nous ne saurons jamais rien même si nous savons qu’il pouvait juger avec sévérité « la campagne menée par les partisans de la révision », comme il le dit encore à Ribot. Mais ce disant, il est important de noter que ce jugement ne portait aucunement sur une question de fond ; son seul reproche touchait en effet à la forme : comme il ajoutait à Ribot : « ils sont inexcusables d’avoir recours à des moyens révolutionnaires lorsque les voies légales leur étaient ouvertes » (AN 563/AP 5, note en date du 21 janvier 1898). La seule chose que nous pourrions donc dire, c’est qu’il n’existe aucune trace, à aucun moment, dans les sources existantes et dont la valeur ne peut être discutée, d’une quelconque position de Félix Faure relativement à la révision. Mais cela posé, s’il y fut peut-être opposé, il ne s’y opposa nullement parce que, gardien de la Loi et toujours animé par elle, il n’eut jamais que pour seule attitude, jusqu’au bout, de laisser les événement se dérouler. C’est ce que le 16 juin 1898, il pouvait encore dire à Ribot, juste après avoir affirmé, comme nous l’avons vu, sa conviction de la culpabilité de Dreyfus : « Le G[ouvernemen]t n’a rien a faire que de laisser la question suivre son cours ».
Un attitude qui contraste pour le moins avec l’antirévisionniste que nous présente Adrien Abauzit et dont nous parle Marguerite Steinheil quand elle prête à Félix Faure, un mois après cette note, ces paroles :
Si l’on reprend l’Affaire, nous n’en verrons jamais la fin. Une révision du procès de Dreyfus amènerait l’anarchie et peut-être la guerre civile. Dreyfus a été déclaré coupable… Si nous tenons bon, tout se calmera. (p. 73).
Ou encore quand, plus loin, elle nous explique que Félix Faure « fit tous ses efforts pour empêcher lé révision » (p. 97). Tout de l’attitude de Félix Faure vient démentir ces phrases et confirmer ce que nous venons de dire et que nous allons voir en détails maintenant. Déjà, il y a une chose qu’il faut quand même bien se dire – et il est difficile ici de contrer Le Gall à ce propos –, c’est que quoi qu’on veuille et quoi qu’on pense, ce n’est pas Loubet, successeur de Faure, qui ouvrit la voie à la révision mais bien Félix Faure, tout d’abord en confiant la présidence du Conseil à Brisson qui en sera l’artisan à partir de septembre 1898. Il semble évident que le choix de Faure de nommer Brisson avait été uniquement motivé par la majorité que ce dernier avait su réunir pour faire tomber le cabinet précédent et par le fait que de tout temps, Brisson, « caractère droit, républicain » comme l’écrit Faure dans son Journal, s’était montré loyal avec lui. Mais il est intéressant de constater que si Faure avait été alors convaincu de la culpabilité de Dreyfus, il n’était pas cependant prêt à donner le pouvoir à ceux qui étaient le fer de lance de l’antirévisionnisme et de l’antidreyfusisme et dont l’accession au pouvoir aurait été le coup d’arrêt porté à toute tentative de révision. Ainsi Félix Faure avait-il aussi voulu Brisson parce qu’il représentait « une garantie contre toute tentative de Cavaignac » (Journal, p. 350), ce Cavaignac nationaliste, antidreyfusard, champion de l’antidreyfusisme depuis janvier 1898, dans lequel Félix Faure voyait un potentiel Boulanger (p. 350) et auquel, pour cela, il refusait catégoriquement de confier la présidence du Conseil (p. 349). La presse antidreyfusarde et antirévisionniste le lui reprochera et lui reprochera surtout d’avoir choisi Brisson, quelle considérait comme l’homme de la révision ; « M. Faure a des complaisances bien étranges », écrivit Boisandré dans La Libre Parole du 26 juin (« Le rôle de M. Faure »). Et si, le nommant, Faure avait pu, par extraordinaire, ne pas le savoir, il avait dû être rapidement fixé, lisant, au lendemain de sa nomination, la presse déchaînée ou mieux encore l’ordre du jour de la loge Les droits de l’homme, de la même obédience maçonnique que celle à laquelle il appartenait lui-même, demandant au « frère Brisson, président du conseil d’engager le processus de révision »…
Quand Cavaignac démissionna après la mort d’Henry, début septembre, ce n’est pas un Faure, qui « t[int] bon » contre la révision et l’anarchie qui en résulterait, ou qui « fit tous ses efforts » pour l’empêcher, comme l’écrit Steinheil, qui montra une opposition, comme nous dit Adrien Abauzit, qu’amis et ennemis de Félix Faure auraient toujours observée. Le nouveau ministre de la Guerre qu’il cherchait serait celui de l’établissement des responsabilités de l’État-major et, si elle devait se faire, de la révision. C’est ce que nous dit le général Zurlinden dans ses souvenirs :
Vers le soir [4 septembre 1898] , je vais à l’Élysée […]. Le Président me retient à dîner ; la conversation roule sur la tristesse des événements. J’insiste « sur la nécessité de dégager l’armée de cette malheureuse « affaire », qui se gâte de jour en jour : il est à désirer qu’un officier général veuille bien se sacrifier pour intervenir au milieu du déchaînement des passions ; pour voir clair dans les agissements de l’état-major et sévir en conséquences ; pour examiner loyalement si la révision du procès Dreyfus s’impose ; et, si cela est, pour la réclamer énergiquement, au nom de l’armée elle-même. L’officier général qui me paraît tout désigné par son expérience, son autorité, sa fermeté, pour remplir ce rôle, est le général Saussier. » Le Président m’approuve hautement. (Mes souvenirs depuis la guerre. 1871-1901, op. cit., p. 181).
Et quand, devant le refus de Saussier, Félix Faure proposa finalement le poste à Zurlinden, ce fut toujours sur la base d’une motivation qui ne montre guère un Président voyant la révision comme la catastrophe à combattre et empêcher, comme nous le dit encore Zurlinden :
[5 septembre] Le Président Félix Faure me reçoit dans le jardin de l’Élysée. Il me dit d’accepter [le portefeuille de la Guerre]. « La révision ne vous engagera pas, ajoute-t-il ; d’après la loi, c’est au Garde des Sceaux seul à décider si elle doit avoir lieu. » (p. 183)
Une attitude qui fut d’ailleurs une sérieuse source d’inquiétude, à l’Élysée, pour l’entourage militaire du Président. Le général Legrand-Girarde, alors chef de bataillon attaché à la Présidence, et tout à fait antidreyfusard, note ainsi dans ses Carnets de souvenirs, à la date du 10 septembre 1898 :
On semble espérer ici, dans la maison [i.e. l’Élysée], que la révision pourra être évitée. Est-ce bien l’avis du grand chef ? On voudrait qu’à l’occasion du toast qu’il va prononcer aux prochaines manœuvres, il fît une déclaration catégorique dans ce sens. Bon et moi sommes chargés par le général de préparer un paragraphe dans ce sens. Je crois bien que nos pensums risquent bien d’aller à la cheminée et qu’un autre aura fait le discours, sans doute dans un sens différent (p. 153).
Et Legrand-Girarde voyait juste. Le fameux paragraphe dut en effet aller à la cheminée puisque Faure ne fit, dans son toast, aucune allusion, même discrète, au refus de la révision, et ce malgré le pressant appel du général Négrier le jour même de son propre discours :
Jamais, à aucune époque, les chef de l’armée n’ont été plus respectueux des lois, plus unis, plus prêts à se dévouer les uns pour les autres ; jamais nous n’avons eu plus de confiance dans nos troupes, et cette confiance, les troupes nous la rendent. En toutes circonstances, elles nous en donnent la preuve. Pour développer encore cette force morale, nous savons que nous trouverons en vous le plus solide appui.
Plutôt que de donner le solide appui attendu, plutôt que de rassurer l’armée sur la révision, Félix Faure, dans son toast, se contenta de parler « d’épreuves passagères [qui] ont toujours rendu plus intime l’union du peuple et de l’armée » (presse du 17 septembre), claire allusion à l’Affaire qui fit comprendre à certains observateurs que, si l’épreuve devait être « passagère » – parfait euphémisme –, c’est que proche en était le règlement et que ce règlement pourrait bien en être la révision. C’est ainsi que l’on peut comprendre ce qui s’était passé quelques jours plus tôt, le 12 septembre, quand Félix Faure avait obligé le ministre de la Guerre, Zurlinden, à surseoir à la démission qu’il comptait donner et au conseil des ministres à surseoir à la discussion sur la révision. Pour toute la presse, la chose ne pouvait faire de doute : il était clair que s’exprimait ici le refus de la révision de Félix Faure. Comme l’écrira Le Soir :
M. Félix Faure est absolument opposé à la révision, […] il a manifesté énergiquement son opinion au Conseil des ministres de lundi dernier et […], lui présent à l’Elysée la révision ne se fera pas, que les dreyfusards du cabinet ou d’ailleurs se le tiennent pour dit. (« Démenti à une note tendancieuse », 15 septembre 1898)
Et ici se trouve l’explication de l’attitude des dreyfusards et tout particulièrement de Clemenceau qui avait fait de Faure l’obstacle à la révision dont il défendait la nécessité. Car en effet, cette certitude d’un Faure antirévisionniste, antidreyfusard, servant des nationalistes, si elle n’était pas simplement motivée – comme le pensait le général Legrand-Girarde –, par la volonté de « le compromettre pour l’amener à s’en aller et augmenter le gâchis » (Un quart de siècle…, p. 157), si elle ne l’était pas non plus, comme le soutenait un rapport de police, une stratégie dreyfusarde pour forcer le Président à prendre position (23 août 1898, F7 15953/3), était née de cette lecture et de l’absolue conviction qu’existait, de ce fait, « un malentendu entre [Brisson] et le Président de la République » (lettre de Le Gall à Faure du 23 septembre, AN). Une information dont la reprise par toute la presse avait incité le gouvernement à envoyer un démenti officiel à l’agence Havas :
Les informations publiées par certains journaux sur ce qui s’est passé dans les conseils des ministres tenus lundi à l’Élysée, notamment en ce qui concerne une intervention quelconque de M. le Président de la République, sont absolument inexactes. (presse du 15)
Un démenti auquel personne ne voulut croire (comme le montre l’extrait du Soir qui en est le commentaire) et qui nécessita une intervention de Valoys, « Dangeau militaire de M. Félix Faure » et absolument et définitivement antirévisionniste, qui expliqua au Journal que :
En ce qui concerne l’affaire Dreyfus, M. Félix-Faure n’a pas eu à intervenir et n’en a jamais eu la pensée. S’il peut avoir une opinion, que personne n’est en droit de prétendre connaître, il a gardé cette opinion, pour lui, sans la manifester en quoi que ce soit, pas plus en paroles qu’en actes.
Les termes de la loi de 1895 sont précis : c’est au gouvernement, c’est-à-dire au garde des sceaux responsable devant le Parlement, de décider si certains articles de cette loi sont applicables. Les Chambres approuveront ou désapprouveront. Vous pouvez donc démentir tous les bruits mis en circulation. (presse du 16)
Et pourtant, si nous lisons Zurlinden :
[12 septembre, conseil des ministres] […] s’ouvre la discussion sur la révision. Elle prend deux séances. Plusieurs ministres sont absolument décidés, avec M. Brisson, à faire la révision, « qui paraît réclamée par l’opinion publique ». D’autres hésitent et semblent s’y opposer. Le Président de la République intervient ; il croit s’apercevoir – il me l’a dit plus tard – que la majorité va être contraire à M. Brisson et qu’il en résultera une crise ministérielle. Comme il était attendu aux manœuvres, il désirait ajourner cette crise jusqu’à son retour, d’autant plus que le garde des sceaux avait eu réellement peu de temps pour étudier le dossier. Il allégua cette raison, et fit décider au Conseil que la question serait tranchée à son retour. (p. 189)
Permettre au Garde des Sceaux de s’informer complètement mais avant tout à éviter à tout prix une crise ministérielle … et même au profit de celui de la révision qu’il protégeait, finalement, en protégeant le président du Conseil qui bataillait pour l’obtenir. C’est pour cela, pour tout cela – et il est dommage qu’André Galabru et Adrien Abauzit aient tout à fait oublié ces passages d’un livre auquel ils rendent hommage – qu’Henriette Dardenne, fille de Cavaignac et tout aussi antidreyfusarde que son père – qui avait vécu ces événements en direct (elle avait alors 18 ans) et avait, pour ses livres, travaillé sur la base des archives de son père et des longues conversations qu’elle avait eues avec lui et avec Cuignet –, tracera de Félix Faure un portrait du président en parfait et total dreyfusard et en parfait et total révisionniste. Certes y jouait une grande part de piété filiale mais, pour elle, Félix Faure avait tout bonnement « trahi sa mission » :
Pourquoi Félix Faure trahit-il sa mission ? Il n’ignore pas que les Chambres réunies, c’est Brisson par terre et, pour lui, l’obligation d’appeler Cavaignac à la présidence du Conseil. Cela, il le veut encore moins le 3 septembre [démission de Cavaignac] que le 26 juin [formation du cabinet Brisson]. Car, aujourd’hui, sa résolution n’est pas seulement dictée par un sentiment inavouable de rivalité personnelle, mais encore par le souci jalousement dissimulé de favoriser la manœuvre de Brisson et les vues révisionnistes. Ce souci va se révéler bientôt plus nettement encore dans on insistance auprès du général Zurlinden – qu’il sait enclin à la révision – pour le décider à accepter la succession de Cavaignac – et quelques jours plus tard, pour retarder la démission du général (converti par l’étude des dossiers), qui, le 12 septembre, ne pourrait manquer de provoquer la dislocation du cabinet Brisson sur la question de la révision. (p. 197).
Et revenant sur sur la question du Conseil du 12 septembre, quelques pages plus loin (p. 204), Dardenne porte une lourde accusation, expliquant encore que Faure s’était joué de Zurlinden, et que s’il l’avait obligé à surseoir à sa démission, ç’avait été pour « donn[er] ainsi le temps aux meneurs dreyfusistes d’obtenir de Sarrien qu’il requière de Picquart la rédaction – dans sa prison – d’un mémoire exposant ses arguments à l’appui de l’innocence de Dreyfus » ! Ce n’est pas d’un antirévisionniste dont elle nous fait ici le portrait mais bien d’un complice des dreyfusards et d’un complice actif. Dans un autre ouvrage (la biographie qu’elle consacrera à son père : Godefroy Cavaignac : un républicain de progrès aux débuts de la 3e République), Henriette Dardenne pourra encore dire que « la certitude était acquise que Félix Faure s’est fait complice de l’engagement de la révision » (p. 514). Elle en donnait pour preuve que s’il n’avait pas obtenu que Zurlinden sursît à sa démission, la révision eût été définitivement arrêtée (p. 528).
Quand finalement Zurlinden démissionna, après la conseil des ministres du 17, nous ne savons pas si Faure, comme le soutiendra Le Gall, « sans prendre part à la discussion, avait gardé pendant toute la durée de ce Conseil une attitude qui ne permettait pas de douter de ses sentiments » (p. 171). Mais ce que nous savons, c’est que Félix Faure n’empêcha rien et entérina de fait la décision, prise au cours de ce conseil des ministres, de soumettre la question de la révision à la commission consultative du ministère de la Justice. Drumont, le lendemain, ne pouvait que faire le portrait d’un Président bien peu antirévisionniste :
Félix Faure n’a même pas su faire l’effort minime qu’on attendait de lui. il n’a même pas eu le courage de dire a Brisson et à ses complices ce que toute la France criera demain :
« Vous commettez un acte de haute trahison en prenant, sans le consentement des Chambres, une résolution contre laquelle protestera bientôt toute la France, une résolution qui peut avoir les plus graves conséquences pour le pays. Vous n’avez pas le droit de profiter de l’absence des Chambres pour décider absolument le contraire de ce que les Chambres avaient voulu. » (« Le triomphe des Juifs », La Libre Parole, 18 septembre)
La suite ne sera pas différente. Le 26 septembre, le Conseil de cabinet, réuni au ministère de l’Intérieur, avait décidé de la révision. Un décision importante mais qui demeurait en suspens jusqu’au lendemain, du fait de l’absence de deux ministres et de la nécessité de la prendre de manière définitive en conseil des ministres, autrement dit en présence du président de la République qui était alors à Rambouillet… Un Conseil important qui, comme l’écrivait Le Figaro en l’annonçant, allait permettre d’être « définitivement fixé ». Attaqué dans la presse par les dreyfusards qui continuaient leur campagne, attaqué aussi par les antidreyfusards qui lui reprochaient ses silences et sa mollesse, mais sollicité par eux pour mettre un coup d’arrêt aux projets de Brisson, Félix Faure garda sa ligne de conduite : celle de demeurer dans son rôle et celle de laisser faire le cabinet qu’il avait nommé tant qu’il demeurait dans la Loi dont il était le représentant et le garant du respect. Deux jours avant, il avait écrit à Le Gall :
Je ne puis rien sur les opinions qu’on peut me prêter, soit dans un sens, soit dans l’autre – Mais il faut démentir tous faits quelconque qu’on m’attribuerait.
Tant que le Gouvernement reste dans la Loi, je ne puis ni ne veux intervenir, il répondra de ses actes devant les Chambres. Ma règle de conduite, c’est la Loi – Personne ne m’en fera sortir. (AN, repris par Le Gall dans ses souvenirs, p. 174)
Le matin de ce Conseil des ministres, le 27, revenant de Rambouillet, l’attendait une lettre. Cette lettre – absolument inédite, conservée dans une collection particulière –, écrite à 8 heures du matin, lui était adressée par Déroulède :
Monsieur le Président,
La Patrie souffre ; la nation divisée s’épuise et se mine.
Vous pouvez beaucoup pour la France, vous pouvez tout pour l’Armée : défendez-les, défendez-nous.
Il dépend de vous d’être, tout à l’heure, le ralliement de tous les bons Français.
L’immense majorité du Peuple vous acclamera.
Très respectueusement
Paul Déroulède
Faure répondit-il à Déroulède ? Nous n’en saurons jamais rien, les lettres de Faure à Déroulède ayant disparu. Mais qu’il y eut réponse ou pas importe peu puisque Faure la donna, cette réponse, dans les faits. Il ne se montra pas celui de qui « dépend[ait], d’être tout à l’heure, le ralliement de tous les bons Français », ou en tout cas pas dans le sens que Déroulède l’entendait et l’espérait. Pendant ce conseil, il ne prendra pas même la parole, ni pendant la discussion ni après, pour agir sur la décision d’un cabinet qu’il savait pourtant contraire à l’avis de la représentation nationale dont le vote unanime du 7 juillet, après le discours de Cavaignac, fermait de fait la porte à la révision. Il n’aura pas ici le scrupule qu’il aurait pu avoir. Et la chose est d’autant plus frappante que quelques jours plus tôt, encore, le 24, deux jours avant le conseil de cabinet, Faure avait enfin accepté non pas de prendre connaissance des dossiers qu’on s’obstinait à vouloir lui montrer mais de lire la longue lettre que Zurlinden, devenu antirévisionniste et démissionnaire pour cette unique raison depuis quelques jours, avait envoyée au Garde des Sceaux le 16 septembre. Une lettre que Zurlinden lui faisait transmettre, en accord avec lui (« Le Président de la République m’a autorisé à lui envoyer… »), afin de « servir de guide pour comprendre les affaire Dreyfus et Picquart ». À sa lettre au Garde des Sceaux, Zurlinden avait même ajouté pour le Président quelques détails supplémentaires relatifs à la pseudo tentative de corruption de Sandherr par les frères Dreyfus et aux pseudo enquêtes de Picquart dans le but « de trouver quelqu’un d’assez taré ou compromis pour le substituer à Dreyfus » (lettre du 24 septembre 1898 de Zurlinden à Blondel, AN 460/AP 10), petites affaires dont nous parlerons dans notre seconde livraison. Et malgré ce pensum, malgré la demande de Déroulède, Félix Faure ne tenta pas même de contrer ses ministres. Une neutralité bien coupable comme l’écrivit L’Étendard :
Mais cette neutralité même semble plaire à M. Félix Faure, qui a coupé volontairement les lanières dont son prédécesseur eut orné volontiers le hochet du pouvoir.
S’il a sur l’affaire Dreyfus des sentiments personnels, M. Félix Faure, après un timide essai de révolte, les a modestement mis de côté. Il est bien obéissant, bien soumis, bien respectueux de toutes les infamies gouvernementales. (29 septembre 1898)
Et pour parachever cela, le lendemain, Félix Faure refusa de recevoir une délégation de 12 députés nationalistes venus au nom de plus d’une centaine de collègues, prier Félix Faure de convoquer les Chambres.
Le Chef de l’État Républicain a-t-il pas fait répondre par ses gens aux Délégués de 130 députés : « je suis irresponsable, qu’on sache une fois pour toutes, que la France peut succomber sous les coups des hommes les plus pervers de mon Cabinet, je m’en lave les mains… »
L’attitude de Félix Faure a prouvé aux Députés qu’ils n’obtiendront rien par les voies régulières. L’Élysée se désintéresse de tout et le Cabinet peut violer cyniquement la Légalité constitutionnelle. (« La mise en demeure, La Gazette de France, 20 septembre »)
Pour justifier ce refus, le Président avait mis en avant l’impossibilité constitutionnelle dans laquelle il était de recevoir la délégation venue le trouver. Un argument qui ne tenait guère, comme l’expliqua la catholique et nationaliste Vérité :
[…] on peut ouvrir la Constitution et la lire, article par article. Nulle part on n’y trouvera aucune disposition interdisant au président de la République d’entendre telle ou telle personne, de recevoir telle ou telle délégation. […]
L’excuse mise en avant par M. Félix Faure est donc un scrupule plus ou moins sincère, et en tout cas sans le moindre fondement. Cette excuse déguise mal l’embarras où il s’est mis par l’oubli de son vrai rôle constitutionnel qui l’obligeait à défendre l’armée dans le conseil des ministres autrement qu’il ne l’a su faire. Elle déguise mal un manque d’égards formel envers les représentants de la nation qui étaient en droit de lui venir exposer leurs doléances. (Auguste Roussel, « Le refus de M. Félix Faure », 29 septembre 1898).
D’autres reprochèrent au Président, qui immédiatement après ce refus avait quitté Paris pour une partie de chasse à Bois-Boudran chez le comte Greffulhe, d’avoir d’autres préoccupations et une très personnelle hiérarchisation des priorités. C’est ce qu’écrivit Paul de Cassagnac dans son Autorité :
Il y a là une dure leçon d’ironie, je ne connais rien de plus humiliant pour un député, pour un citoyen, que d’aller, l’écharpe en sautoir, sonner chez un ancien tanneur en faveur de qui on a eu l’imprudence de voter autrefois, et de s’entendre répondre qu’il ne peut ni ne veut vous voir. Et, si peu que nos étourdis collègues eussent insisté, M. Félix Faure les invitait à aller chasser avec lui – mais à la condition formelle de ne pas causer politique.
Car, chez le président de la république, en France, c’est comme à Venise : on y chante, mais on n’y parle pas.
La France n’a rien à attendre, rien, du monsieur qui occupe ces fonctions étranges, où un homme est à l’engrais, avec interdiction d’être utile à son pays.
Ce pays peut courir les plus redoutables périls ; nos institutions militaires peuvent, ainsi qu’on l’a vu pendant ces derniers mois, être scandaleusement et odieusement attaquées, le président de la république s’en f… et chasse !
L’armée est outragée chaque matin par les sans-patrie d’en haut et d’en bas, par les juifs, par les communards ; on déverse la boue sur les épaulettes, la boue sur le drapeau, la boue sur tout, et le président de la république s’en f… et chasse !
La fortune publique est en péril, on marche à la faillite et à la banqueroute. Le président s’en f… et chasse !
La fortune privée est menacée par le socialisme, devenu maître du gouvernement, maître du Parlement. Et le président de la république s’en f… toujours et chasse !
À chaque douleur du pays, à chaque malheur national, il se console avec des lapins.
Le lapin, chez lui, guérit tout, calme tout, remplace tout.
Quand l’Angleterre nous nargue, nous insulte, nous somme de déguerpir des postes que nous avons conquis, le président de la république, ému, s’essuie les yeux avec un lapin. (« Chez le Président », L’Autorité, 30 septembre)
S’il fut antidreyfusard, s’il fut contre la révision, le moins qu’on puisse dire est que Félix Faure ne montra guère une grande énergie à affirmer sa conviction et à « faire tous ses efforts » pour combattre les projets de son président du Conseil…
Continuons. Le 17 octobre, après que le ministère avait engagé la procédure de révision, c’est encore une fois le silence que Félix Faure opposa à une nouvelle initiative des mêmes 12 :
Les députés soussignés, délégués de 139 de leurs collègues ;
Considérant que le ministère de M. Brisson n’a obtenu le vote de confiance de la Chambre qu’a cause de ses déclarations nettement contraires à la révision du procès Dreyfus, et que ce ministère, en commençant la procédure de révision, a violé ses propres engagements ;
Considérant qu’il ne s’agit plus d’une question exclusivement judiciaire, et quelle a pris, par la dernière discussion du conseil des ministres, un caractère nettement politique ;
Ont l’honneur de prier le président de la république de convoquer immédiatement le Parlement. (presse du 17 octobre)
Et que penser encore de son refus de recevoir et même de faire expulser sans ménagement de l’Élysée, le mois suivant, le 25 octobre, le nouveau ministre de la Guerre démissionnaire par antidreyfusisme et refus de la révision, le général Chanoine, venu le voir ? Et que penser de son refus de défendre l’Armée par une déclaration publique comme, à son tour, était venu lui demander le général Jamont ? Et que penser, s’il avait été opposé à la révision ainsi que nous le dit Adrien Abauzit, de la manière dont il accueillit, dans son Journal, la démission d’Henri Brisson, qui avait, contre l’avis du pays – l’opinion publique et la représentation nationale –, obtenu, un mois plus tôt, de transmettre la demande de révision du procès de 1894 à la Cour de cassation :
Il semble très heureux d’être débarrassé du fardeau du pouvoir. Il a trouvé une différence sensible entre le gouvernement d’aujourd’hui et celui de 1885. Je crois d’ailleurs que son départ lui fera rendre justice. C’est un honnête homme, esclave de sa conscience. (p. 356)
Il nous semble qu’un antirévisionniste convaincu et actif, qu’un antidreyfusard « engag[é] », aurait trouvé, pour accueillir le départ de son dreyfusard et révisionniste président du Conseil, d’autres mots.
Doit-on pour autant déduire de tout cela que Félix Faure, contrairement à ce que pensent Marguerite Steinheil, André Galabru, Adrien Abauzit et avant eux les dreyfusards, souhaitait cette révision et que s’il ne fit rien pour la combattre c’est qu’il en était partisan ? Nous ne le savons pas mais c’est ce qu’affirmera Hugues Le Roux, membre de l’antidreyfusarde Ligue de la Patrie française, qui, en 1902, dans une lettre en réponse à une mise en cause, expliquait que Faure, qui l’honorait de son amitié – et infirmant encore une fois, par là-même, le péremptoire : « tant les amis que les ennemis de Félix Faure ont toujours observé qu’il était opposé à la révision du procès Dreyfus » –, lui avait dit en en janvier 1899, peu avant sa mort, que « la révision du procès Dreyfus est nécessaire parce qu’elle est légale » (lettre à Vaughan, L’Aurore, 26 juillet 1902). Et c’est encore ce que dira, quelques années après, le même Le Roux qui se souviendra pour Gil Blas de sa dernière entrevue avec le président :
Félix Faure me fit appeler. Après les effusions amicales du retour, il me regarda longuement et me dit ces mots, que je n’oublierai jamais : « Pourquoi vous, mon ami, qui pouvez passer pour recevoir mes conseils, avez-vous envoyé votre signature à la Patrie Française ? »
– « Mais, fis-je, parce que tous ceux qui ont ma mentalité, tous ceux que j’estime, ont signé cette protestation.
– « Ce n’est pas une raison. Ils sont dans l’erreur, la révision doit se faire, elle se fera.
Il faut que la France soutienne son vieux renom de nation juste. » (Berthe Delaunay, « La vérité sur la mort de Félix Faure. Témoignage d’un ami », Gil Blas, 22 décembre 1908).
De toute cette démonstration Adrien Abauzit retiendra peut-être ce seul nom et nous rétorquera, empruntant à Galabru, « qu’il suffit, comme le fit « L’Action française » du 23 décembre 1908 d[e] relever toutes les inexactitudes historiques [de cette seconde déclaration], pour peser à son juste poids son degré de crédibilité » (p. 127). Voyons donc l’article de L’Action française :
D’après M. Le Roux, le président lui aurait dit que la « Patrie française » était dans l’erreur, que la révision devait se faire. Mais tout le monde sait que, révisionniste au moment de la découverte du « faux Henry » (août-septembre 1898), Félix Faure avait été effrayé, en janvier 1899, par les scandales dreyfusiens de la Cour de cassation et qu’il secondait vivement l’effort de résistance esquissé par le cabinet Dupuy (dépôt de la loi de dessaisissement, etc.).
Il faut brouiller les dates, placer au même moment la découverte du faux Henry et la fondation de la Ligue de la Patrie française, pour concevoir ou accepter les rêveries de M. Hugues Le Roux, qui va jusqu’à dire que Félix Faure « n’apprit le faux Henry que par les journaux et après le drame du Mont-Valérien ».
On sait que Le Roux se trompe ici (si Berthe Delaunay a bien retranscrit fidèlement les paroles de son interlocuteur) quand il dit plus haut dans cet entretien (passage non repris ici) que Faure n’avait appris l’existence du « faux Henry » qu’après la mort du faussaire. Faure avait été au courant dès les aveux d’Henry et, prévenu, avait quitté précipitamment Le Havre pour rentrer à Paris et réunir ses ministres. Une erreur en effet mais qui n’annule pas pour autant le témoignage sur le sentiment possible de Faure relativement à la révision dans la mesure où, comme on le verra à la suite, la thèse du changement d’attitude ne repose sur rien. Adrien Abauzit sera peut-être tenté de le faire. Mais nous doutons qu’il le fasse puisque cette thèse n’est pas du tout celle qu’il défend. Là où L’Action française et André Galabru, qui la reprend, montraient de la prudence et concédaient un révisionnisme, de courte durée certes mais un révisionnisme quand même, Adrien Abauzit soutient la permanence de l’antirévisionnisme de Faure – « tant les amis que les ennemis de Félix Faure ont toujours observé qu’il était opposé à la révision du procès Dreyfus » – et, ce qu’il écrivait dans son dernier et ce pourquoi nous avions commenté (voir le début de ce chapitre), de son antidreyfusisme : « [Faure] reste convaincu de la culpabilité de [Dreyfus] » ; « son engagement antidreyfusard ».
La pseudo-bascule de la loi de dessaisissement
Il est temps, pour continuer à voir défiler les semaines jusqu’au jour tragique de sa mort, de nous intéresser à ce changement d’attitude annoncé et de voir ce qu’il en est. Reprenant l’article de L’Action française – sans le dire mais il cite par ailleurs l’article en note à propos du seul Le Roux –, André Galabru écrit :
Selon Le Gall, confirmé sur ce point par les « Mémoires » de Marguerite Steinheil, il aurait ensuite penché pour la révision après l’épisode du « faux Henry » et le suicide du colonel (septembre 1898 [rien ne dit cela dans les Mémoires de Steinheil, bien au contraire !]). La nomination de Brisson comme président du conseil, puis des généraux Zurlinden et Chanoine comme ministre [sic] de la Guerre aurait été, selon Le Gall, la concrétisation de cette volonté de révision. Puis, devant les scandales et les manœuvres du parti dreyfusard pour noyauter la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, il serait revenu à sa première attitude et aurait favorisé le vote de la « loi de dessaisissement » ? (p. 71)
Pour étayer cela – L’Action française ne donnant pas ses sources –, André Galabru nous donne tout d’abord une note de Félix Faure de… février 1898 (p. 71-72). On conviendra qu’il est hardi expliquer ce qui s’est passé après septembre 1898 avec un document datant de février de la même année, soit huit mois plus tôt !!!… et surtout quand on explique que c’est en novembre-décembre, soit dix ou onze mois plus tard qu’aurait eu lieu le changement ! André Galabru reprendra d’ailleurs cela dans son second volume, Variations sur l’Affaire, écrivant : « […] même après l’épisode du « faux Henry », [Félix Faure] restera franchement hostile à la révision et éconduira ceux qui, comme Scheurer-Kestner ou le prince de Monaco, tenteront de l’ébranler et de le faire changer d’avis » (p. 58-59). Faut-il rappeler que Scheurer avait vu Félix Faure en février 1898 et que la visite du prince est celle de la même date, comme nous le précise une note en bas de page ? Ensuite, André Galabru évoque, encore une fois, les mémoires de Steinheil dont, en prolepse, il évacue la possible objection d’un hardi : « peu suspects puisqu’en opposition avec sa sensibilité plutôt dreyfusarde » (p. 71). Curieux argument mais développement intéressant. André Galabru ne fait alors qu’évoquer Steinheil et il faut aller dix-sept pages plus loin, p. 88, pour lire la citation qu’il évoque ici. Après avoir commis une erreur de date, avançant de 15 jours les événements, il écrit :
15-30 novembre [sic] : […] Félix Faure, après avoir penché pour la « révision » au moment du suicide du colonel Henry, (août-septembre 1898) effrayé par les scandales dreyfusards de la Cour de Cassation, est maintenant plus hostile que jamais à la « révision » et s’en ouvre de nouveau à sa confidente :
« Félix Faure écarte toujours l’idée de « révision » encore bien plus fermement qu’avant la tragédie d’Henry .» (p. 88)
Les deux dernières lignes entre guillemets, de Marguerite Steinheil, ne se trouvent pas dans l’édition française de ses mémoires mais dans l’édition anglaise, originale, de 1912, qu’a utilisée André Galabru. Elles s’y trouvent bien, p. 101, mais légèrement différentes :
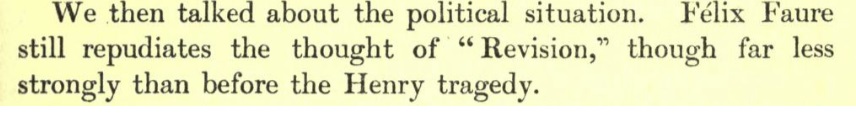
« Though far less strongly » n’a jamais voulu dire « encore bien plus fermement » mais l’exact contraire :
Nous avons ensuite évoqué la situation politique. Félix Faure répudie toujours l’idée de « Révision », quoique avec beaucoup moins de fermeté qu’avant la tragédie d’Henry.
Voici qui modifie pour le moins le sens du propos. André Galabru, encore une fois, fait dire au texte ce qu’il avait envie d’y lire. Mais que ce soit « encore bien plus fermement » ou « avec beaucoup moins de fermeté », l’idée de retour « à sa première attitude » est bien là, nous rétorquera-t-on peut-être en considérant comme étant sans intérêt ce nouveau bricolage de texte. Le problème est que cette source est la seule qu’André Galabru puisse mettre en avant et nous avons vu quel crédit on peut lui accorder. Il ne reste donc que celle de L’Action française, qu’André Galabru ne revendique pas, mais qui, ne reposant elle-même sur aucune source, n’est pas recevable…
En fait Félix Faure ne favorisa – pour reprendre le mot d’André Galabru – rien du tout, n’ayant aucun regard et aucun pouvoir sur les votes des députés et des sénateurs. Au début, Faure ne fut guère partisan de cette loi de circonstance. L’antidreyfusarde Henriette Dardenne, dans la biographie qu’elle consacra à son père, raconte que Godefroy Cavaignac était allé voir Félix Faure pour « l’entraîner à une initiative conforme à ses vues, en faveur du dessaisissement de la Chambre Criminelle ». « Il n’y a rien à attendre de lui », dit Cavaignac à sa fille en rentrant chez lui (p. 518). De même, Legrand-Girarde, dans ses Carnets de souvenirs, raconte à la date du 12 janvier 1899 que Constans, Mézières, Pallain, étaient, chacun à leur tour, venus voir Félix Faure pour lui demander d’agir, que « la situation [était] grave », « qu’avec de la poigne on ferait faire aux magistrats ce qu’on voudrait »… « Tout cela est peine perdue », confie Legrand-Girarde (p. 183). Et s’il est vrai que Félix Faure soutint finalement le projet, s’il est vrai qu’il fut même prêt, comme il le confiera à son Journal, à faire jouer l’article 7 de la Constitution en cas de conflit entre la Chambre et le Sénat, ce n’était pas par antidreyfusisme ou pour tenter de bloquer la révision, mais – comme toujours et comme nous l’expliquions à Adrien Abauzit dans notre dernier post – par respect de la loi et de la Constitution puisque l’enquête confiée aux doyens avait été votée par la Chambre et que le rôle du gouvernement ne pouvait être que de suivre ce que serait leur avis. C’est ce que Faure explique, à la date du 29 janvier 1899, dans son Journal :
[…] devant l’avis très net du premier président, le gouvernement ne pouvait hésiter à se l’approprier, ou plutôt à y trouver la cause déterminante qui l’amenait à saisir toutes les chambres de l’affaire instruite par la chambre criminelle seule.
C’est le seul moyen de donner à l’arrêt qui interviendra une autorité suffisante pour être accepté sans protestation par l’opinion publique.
Si au contraire, devant l’avis du premier président et des deux doyens, la chambre criminelle juge seule, il y aura une protestation indignée et l’opinion publique n’acceptera pas qu’après l’enquête on ne tienne aucun compte de l’opinion des magistrats qui en ont été chargés (p. 382).
Une volonté et un soutien qui n’étaient donc pas une entrave la révision, comme le crurent les dreyfusards de l’époque, et avec eux par la suite André Galabru et aujourd’hui Adrien Abauzit, mais une volonté et un soutien qui avaient pour but, au contraire, de favoriser une loi qui, seule à ce moment, pouvait – et plus que jamais depuis l’avis donné par le premier président Mazeau – permettre de faire accepter l’arrêt… et le faire accepter quel qu’il fût… et donc même s’il devait être la cassation du procès de 1894 qui avait condamné Dreyfus !
Il semble clair après tous ce qu’on vient de lire que Faure ne fut pas opposé à la révision pour autant que la révision fût la Loi – d’où le reproche, comme on l’a vu qu’il adressait aux dreyfusards de lui préférer des moyens révolutionnaires. Il n’eut jamais que ce souci, celui de se conformer à la Loi, celui de ne pas sortir dû rôle que la Constitution définissait comme sien et qui explique ses refus de prendre connaissance du dossier, ses refus de recevoir ceux qui voulaient passer outre ou au-dessus, et qui explique aussi ses silences. Parce qu’il connaissait son rôle et n’avait aucune intention d’en sortir, parce que la seule voix qu’il écoutait était celle de la Loi, il ne fut donc pas antidreyfusard, comme le pense Adrien Abauzit, pas plus qu’il ne fut opposé à la révision contre laquelle il ne fit jamais rien. Devint-il dreyfusard (au sens strict de : convaincu de l’innocence de Dreyfus), comme le pensait Mercier, ce dont Legrand-Girarde essaya de le dissuader (p. 184) ? Comme nous le disions dans notre précédent post, nous n’en savons rien et rien ne nous permettra de le savoir… Nous ne le pensons pas mais nous noterons juste, sans en tirer la moindre conclusion, cette petite phrase que Félix Faure rapporte dans son Journal et qu’il avait opposée à Turrel quand ce dernier lui avait dit que le cabinet Brisson se partageait entre convaincus de l’innocence et convaincus de la culpabilité :
J’ai fait observer que de pareils sentiments ne devaient pas être ainsi exprimés et que si des hommes croyant à l’innocence de Dreyfus prenaient des mesures contre la manifestation de cette innocence, ils assumeraient une grande responsabilité vis-à-vis de leur conscience. (p. 288).
Pour clore cette question, une dernière chose qui pourra apporter un éclairage supplémentaire : il est tout à fait inexact de dire, comme le fait Adrien Abauzit dans son précédent volume, que quand Brisson obtint la révision, Félix Faure ne pouvait « que s’incliner » (p. 45). Faure avait bien sûr toute latitude de s’y opposer. Le Gall, dans une de ses lettres à Faure, conservée aux AN, l’évoque :
En résumant, je conclus de tout ceci que nous ne sommes pas au terme des agitations. Tout sera exploité : votre force, et c’est peut-être la seule qui existe encore, sera votre calme, et le calme, pour moi, consistera surtout à vous garder des entraînements où on vous sollicitera de tous côtés et par tous les moyens. Touchard et de Lanessan me disaient que l’avis de la Commission des Six restait douteux… Le premier s’en réjouissait, le second s’en désolait, espérant toutefois que Brisson passerait outre et soumettrait la question à la Cour de cassation, qui doit selon lui avoir, seule, le dernier mot en cette triste affaire. Si les choses se passent ainsi, je vois les efforts que feront les antirévisionnistes pour obtenir que vous vous opposiez à la décision de Brisson. C’est là que nous entendrons des cris et des hurlements, quel que soit le parti auquel vous vous arrêterez… C’est là aussi que votre attitude devra être ferme et qu’après avoir bien pris conseil de votre conscience, vous devrez fermer les oreilles à tous les cris et attendre de l’avenir la justification de votre conduite. Nous avons vu déjà de semblables conjonctures et nous avons vu qu’une règle de conduite droite et s’appuyant sur le devoir constitutionnel était la sauvegarde du Président de la République.
Félix Faure ne fera rien et toujours pour cette raison que nous expliquions dans notre précédent post et que nous avons rappelée ici :
Tant que le Gouvernement reste dans la Loi, je ne puis ni ne veux intervenir, il répondra de ses actes devant les Chambres. Ma règle de conduite, c’est la Loi – Personne ne m’en fera sortir.
Mais tout cela dit, nous dira peut-être Adrien Abauzit, quand bien même Félix Faure eût été sinon convaincu de l’innocence de Dreyfus, tout au moins révisionniste, n’en demeurerait pas moins que pour les dreyfusards, il était l’âme damnée qui œuvrait dans l’ombre pour empêcher la révision. Tel était le mobile du crime et peu importe de ce qu’il pût en être des sentiments réels du Président. Les dreyfusards l’auraient donc assassiné pour permettre une révision – qu’il n’empêchait pas et qui suivait son cours ! Ils l’auraient assassiné alors que dans les faits c’est sous sa présidence que la révision était devenue une réalité ! Marguerite Steinheil aurait été le bras armé du fantasmatique « Syndicat » qui aurait commandité ce crime d’un président de la République, crime qui n’est pas des moindres tout de même. Pour dire cela, Adrien Abauzit nous explique que Marguerite Steinheil était liée à la famille Scheurer-Kestner… Dans son précédent volume, il écrit :
Félix Faure s’ouvre à Marguerite Steinheil du projet qu’il médite [projet de coup d’État dont il sera question plus loin]. Cette dernière en parle à sa mère, Mme Japy, qui en parle à son tour au Syndicat, via Scheurer. Pour mettre un terme à ce « coup d’État » salvateur, la mort de Félix Faure est décidée (p. 61).
Pauvre Scheurer-Kestner, parrain d’un Syndicat du crime, qui aurait commandité un assassinat – ce qui est déjà extraordinaire quand on connaît un peu l’homme –, de surcroît assassinat d’un de ses amis (voir Le Journal de Faure) et qui, encore, retiré de la bataille à ce moment, tentait de rendre plus douce une maladie qui le dévorait et allait l’emporter quelques mois plus tard ! Est-ce raisonnable ? Et quelles preuves pour avancer cette accusation ? Un vieux lien de famille ? Un projet de coup d’État ? De même, et anticipons, admettons que cette mort inattendue de Faure soit – ce qu’elle n’est pas – étonnante, admettons que le rapport des médecins soit – ce qu’il n’est pas – curieux, admettons que la question de l’absence d’autopsie et que le rapide embaumement posent – ce qu’ils ne font pas (nous examinerons ces points plus loin) – question. Admettons tout cela. Mais en quoi cela prouverait-il un assassinat ? Quelles preuves, quels indices même et à défaut de preuves, peut avancer Adrien Abauzit pour l’étayer ? Avant de les passer en revue, faisons un saut de quelques pages dans le dernier livre d’Adrien Abauzit pour en finir avec la question du mobile. Voyons si, comme le soutient, après André Galabru, Adrien Abauzit, Félix Faure préparait un coup d’État et que c’est pour l’en empêcher que les dreyfusards l’auraient fait assassiné par Marguerite Steinheil.
• Chapitre II. Diversion maladroite sur le projet de coup d’État ou des difficultés de la SIHAD à lire des articles de presse, p. 24-28.
Avant d’entrer dans le vif du sujet, voyons ce qu’il en est de la question des sources, ces articles de presse que nous semblons avoir du mal à lire. Adrien Abauzit se demande pourquoi nous avons écrit dans notre précédent post :
ne trouvez-vous pas, Adrien Abauzit, qu’il est difficile de fonder toute la preuve sur un article de journal, de surcroît un article sous pseudonyme, et un pseudonyme omnibus, qui donne la parole à un mystérieux informateur dont personne ne saura jamais rien, ni le nom, ni la qualité ?…
Pour comprendre ce que nous dit ici Adrien Abauzit, il faut résumer un peu la question telle que la pense Adrien Abauzit. Si, un jour, les dreyfusards prirent la décision d’éliminer Félix Faure c’est parce qu’il préparait un coup d’État. Marguerite Steinheil qui en était au courant parce que Félix Faure lui disait tout, en parla à sa mère à qui elle ne cachait rien, sa mère en parla à Scheurer-Kestner avec lequel elle était liée et la terrible décision fut prise. Le « Syndicat » fut le commanditaire de l’assassinat et Marguerite Steinheil en fut l’exécutrice. L’article signé Quisait, publié dans L’Intransigeant, donnait le détail de ce projet de coup d’État :
On savait que le président Félix Faure était vivement sollicité de prendre des mesures énergiques ; on n’ignorait pas qu’à un député – encore vivant – qui lui avait conseillé un véritable coup d’État, il n’avait pas répondu par un refus absolu.
[…]
Au commencement de février [1899], [Faure] recevait la visite du député auquel j’ai déjà fait allusion et celui-ci lui exposait un plan très bien étudié. Le président était frappé par la simplicité de ce projet qui comportait une petite opération de police accomplie au lendemain d’une chute provoquée du ministère, c’est-à-dire pendant un interrègne, une proclamation mettant le pays en demeure de se prononcer entre l’armée nationale et ses détracteurs et une dissolution de la Chambre.
[…] le président demanda à réfléchir, et à une date que je ne puis préciser exactement, mais qui doit être très voisine du 13 février, il fit dire au député de venir le revoir le 17. On peut induire la réponse qu’il comptait lui donner du fait suivant : LE PRÉSIDENT AVAIT RÉDIGÉ UN PROJET DE PROCLAMATION.
L’anonyme informateur de l’anonyme Quisait
Adrien Abauzit se demande pourquoi nous avons écrit ce que nous avons écrit parce que, dit-il ici, « les articles [de Quisait] n’y sont pas donnés en qualité de preuve, mais de résumé des événements ». Nous voulons bien jouer ainsi sur les mots mais ce « résumé », présenté comme un témoignage, devient l’unique narration de l’affaire, empruntée toujours à André Galabru : celle d’un mystérieux Quisait, « témoin anonyme », qui « dévoilait au public français, dans le journal L’Intransigeant, le dessous des cartes de cette sordide affaire » (p. 58 du précédent volume d’Adrien Abauzit). Un « témoin anonyme » que rien ne nous dit intime de Félix Faure et dont nous ne savons rien d’autre que ce qu’en dit Adrien Galabru, à savoir qu’il était « probablement parlementaire », autant dire que nous n’en savons rien du tout. Et le plus amusant est que, comme souvent (nous y reviendrons aussi plus loin), André Galabru voit ce qui n’existe pas. Quisait ne fut jamais « un ancien homme politique, député ou sénateur ». Nous l’avions expliqué dans notre dernière réponse, explication qui n’a pas retenu l’attention d’Adrien Abauzit. Nous écrivions alors :
Quant à cette histoire de coup d’État, elle ne repose que sur le témoignage d’un anonyme (et très complotiste) Quisait qui, nous dit Adrien Abauzit, était « probablement parlementaire ». Adrien Abauzit se targue, dans les premières pages de ce livre, d’avoir – enfin – utilisé la presse… Il aurait dû le faire, vraiment (trois clics sur Google), et ne pas se contenter de reprendre en les extrapolant les références fausses ou approximatives de Galabru qui parle d’un « ancien homme politique, député ou sénateur ». Quisait ne fut jamais un parlementaire mais un journaliste de L’Intransigeant (ou plus exactement une signature omnibus ; on la retrouve dans L’Intransigeant de 1905 à 1919) qui était allé voir, pour recueillir ses paroles, « un solitaire que l’on ne voit jamais aux premières ; qui paraît deux fois par an à la Chambre, les jours où il espère que le tigre dévorera le dompteur, mais qui n’en suit pas moins, d’un œil attentif, la marche de la politique et qui en connaît maints dessous » (« Le roman rouge de l’impasse Ronsin racontée par un témoin », L’Intransigeant, 18 décembre 1908).
Mais encore une fois passons sur ces erreurs dont l’accumulation commence quand même à faire du volume. La source de toute l’histoire serait donc un journaliste, anonyme, rapportant – avec quelles garanties d’exactitude ? – les paroles d’un « témoin » tout aussi anonyme, dont la seule légitimité pour porter témoignage sur des événements auxquels il n’a jamais assisté et à propos des pensées secrètes d’un président de la République qu’il n’a probablement jamais croisé, est qu’il suivait d’un « œil attentif, la marche de la politique et qui en connaît maints dessous » ! Et des propos rapportés qui, curieusement, apparaissaient comme par enchantement en confirmation de la lettre publiée la semaine précédente par L’Espérance du peuple, lettre dont il sera bientôt question.
Mais passons à la suite. Une fois son « résumé » donné, Adrien Abauzit fonde sa preuve pour avancer la thèse du coup d’État – qui faisait rire même L’Intransigeant (voir supra) –, sur quatre éléments :
-
-
- 1° la lettre à Marguerite Steinheil publiée par L’Espérance du peuple dans laquelle Faure parle d’une proclamation dont il l’a souvent entretenue ;
- 2° les mémoires de Steinheil qui parlent du projet de coup d’État du Président ;
- 3° l’aventure de Reuilly, tentative de coup d’État de Déroulède ;
- 4° l’article de Pressensé.
-
Voilà donc le dossier. Feuilletons-le :
1° La lettre de Marguerite Steinheil publiée par L’Espérance du peuple. Rien n’en en garantit l’authenticité… et comme il en sera question bientôt, nous n’en dirons pas plus pour le moment.
2° Les mémoires de Steinheil, dans lesquelles elle affirme en effet que Faure « a[vait] cru que le seul remède serait une sorte de coup d’État », ont déjà été commentés (« Félix Faure et la révision. p. 22-23 »).
3° Déroulède. Dire que le « coup d’État » de Déroulède est une preuve parce qu’il « prouve bien que quelque chose était en préparation » est pour le moins aventureux. Et si quelque chose était en préparation, le moins qu’on puisse dire, vu comment ce « coup d’État » vira au grotesque, est que la préparation était pour le moins insuffisante. Tellement insuffisante même que, juste avant de tenter son coup de force, Déroulède avait pu dire à Xavier de Magallon : « Certes je ferai quelque chose ; quoi, je n’en sais rien, mais je ferai quelque chose. » Dans l’histoire de la préparation, on conviendra qu’on a fait plus préparé…
4° Pressensé. Nous e parlerons bientôt. Mais si nous en parlerons, il y a deux ou trois choses qu’il faut dire dès maintenant. Pressensé y parle de « ce même destin qui a couché Félix Faure sur un lit de mort à la veille de décisions peut-être criminelles et sûrement irréparables ». Nous sommes convaincus que Pressensé parle ici de ce qu’y voit Adrien Abauzit… même si, sur le principe, rien ne nous garantit que « décisions peut-être criminelles et sûrement irréparables » y soit une allusion. Mais comme nous l’avons expliqué, Pressensé, comme Clemenceau, comme la grande majorité des dreyfusards, étaient convaincus que Faure était à la botte des nationalistes et, peut-être, préparait un coup d’État. Et revient la sempiternelle question : et alors ? Encore une fois qu’est-ce que cela prouve ? Les dreyfusards étaient aussi persuadés que les jésuites fomentaient un grand complot contre la République qui fut un fantasme. Et indépendamment de cela, indépendamment aussi d’opérer un tri dans les faits sur des critères qui ne doivent rien à la science, il faut comprendre une chose : les dreyfusards ne formaient pas un bloc homogène, un monolithe, une grande camorra organisée… un syndicat. Chacun travaillait dans son coin, en petits groupes qui la plupart du temps ne se croisaient pas et parfois, même, faisaient tout pour s’éviter. Ainsi, pour ne citer qu’un exemple, la publication du « J’Accuse…! » ne fut connue que de trois dreyfusards et les plus mécontents quand le fameux article parut furent justement les dreyfusards. On connaît ainsi les réactions des Ferdinand Buisson, qui s’en effraya, de Monod, qui le « blâma », d’Édouard Rod, qui en condamna le caractère extrême, d’Émile Duclaux, qui en refusa la brutalité, de Gaston Deschamps, qui en regretta « les injures », de Paul Stapfer, qui s’insurgea contre sa « violence intempestive » et de Scheurer-Kestner qui parla de « révolte » pour qualifier ses sentiments à sa lecture, le considérant comme une « faute » qui ouvrait l’« l’ère des bêtises ».
Refermons la parenthèse et reprenons notre propos. À la suite, Adrien Abauzit écrit que « la SIHAD admet finalement que je ne me limite pas aux articles de Quisait… » Mais nous n’admettons finalement rien du tout ; la formule était ici rhétorique. Voici ce que nous avons écrit :
Avant d’aller au fond du sujet, une petite question : ne trouvez-vous pas, Adrien Abauzit, qu’il est difficile de fonder toute la preuve sur un article de journal, de surcroît un article sous pseudonyme, et un pseudonyme omnibus, qui donne la parole à un mystérieux informateur dont personne ne saura jamais rien, ni le nom, ni la qualité ?… Un article de journal et de quel journal ? De L’Intransigeant qui, sous Rochefort ou sous Bailby, ne s’est jamais embarrassé avec la vérité ! Mais peu importe parce qu’Adrien Abauzit (ou plus exactement André Galabru) a une autre « preuve » : enfin… un autre article, plutôt, issu cette fois de L’Espérance du Peuple (de Nantes),
Passons encore…
Les lettres de L’Espérance du Peuple
Adrien Abauzit, immédiatement après, ajoute que « la SIHAD se retrouve contrainte de contester l’authenticité de la lettre publiée par L’Espérance du Peuple ». Une nouvelle fois nous ne sommes contraints de rien du tout. Et si nous contestons en effet cette lettre, ou plus exactement ces deux lettres – puisqu’il y en deux –, ce n’est que parce qu’elles sont contestables et nous allons, encore et plus largement, expliquer pourquoi. Dans notre dernier post, à propos de la seconde lettre, nous écrivions :
Une lettre étonnante et qui, si elle était vraie, montrerait la légèreté, l’inconscience d’un président qui, rédigeant des proclamations de coup d’État, en entretient longuement sa maîtresse, ce qui déjà en soi serait formidable et l’est plus encore quand on sait que la maîtresse en question était liée à la famille Scheurer-Kestner… mais admettons… le cœur a ses raisons… une lettre étonnante, donc, mais surtout une lettre dont personne n’a jamais vu l’original et qui est (l’article le dit) sans signature !!!
Adrien Abauzit saute sur cette dernière phrase : notre « “rigueur” est prise en défaut »… « Comment la SIHAD a-t-elle pu passer à côté de cela ? » Combien est étonnant notre « passage à vide » puisque l’auteur de l’article « écrit le contraire de ce qu[e nous] affirm[ons] : “J’espère que la lettre suivante, dont j’ai eu l’original entre les mains“ »…. et plus loin, Adrien Abauzit reprend la description de la lettre donnée dans l’article : « le papier est un papier simple, mais très beau, l’écriture un peu tremblée ; derrière le dernier feuillet se trouve une tache d’encre violette…»… Vraiment, il n’est pas simple de discuter ainsi et à vrai dire cette fausse naïveté (parce qu’elle ne peut être que telle) est étonnante… Bien sûr que l’auteur de l’article a vu – ou plus exactement dit avoir vu – la lettre puisqu’il en donne le texte… Mais ce n’est bien sûr pas cela que nous disions. L’auteur de l’article dit avoir vu la lettre et en donne le texte, en l’accompagnant d’une description censée l’authentiquer, mais quelle garantie avons nous que cette lettre existe réellement ? La description qui en est faite ? Curieuse description qui semble n’être là que pour assurer la crédibilité du document et surtout du témoignage : « l’écriture tremblée de l’homme inquiet », la tache violette au verso et le « papier simple, mais très beau »… et encore, si on se reporte au texte, et à la suite que ne reprend pas Adrien Abauzit : le passage « souligné d’un trait d’ongle » qui nous dit l’importance que pouvait y attacher la destinataire et, « dans l’angle supérieur gauche », le « petit chiffre 3 » ou du moins qui y ressemble, puisqu’« il est, en effet, un peu effacé ». Quel luxe de détails. On aurait envie d’y croire si cette lettre de Félix Faure n’était pas la seule, de toutes celles que nous connaissons, écrite sur un papier libre. Toutes les lettres de Félix Faure sont en effet toujours, pour les lettres officielles, écrites sur le papier à entête de sa fonction (Chambre des Députés, Ministère de la Marine ou Présidence de la République) et, pour les lettres intimes, sur un papier à son chiffre, comme le montre cette lettre – signée ! – à Marguerite Steinheil :
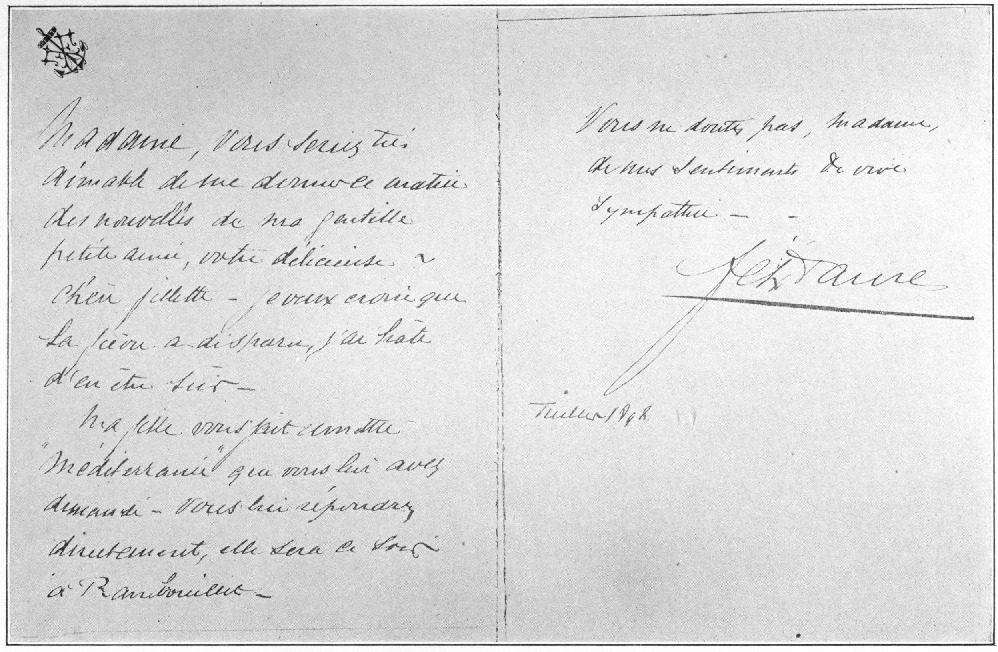
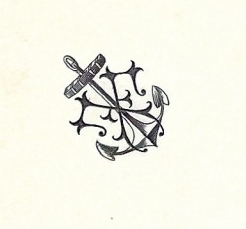
André Galabru n’a pas vu cette lettre de L’Espérance du Peuple, pas plus qu’Adrien Abauzit, pas plus que nous, pas plus que qui que ce soit en dehors de celui qui la cite mais ne la montre pas et donc, du coup, la seule garantie que nous puissions avoir de la réalité de cette lettre serait la parole de celui qui la publie ? Une pièce ne peut avoir de valeur que si on peut la voir, sans quoi elle n’existe pas. Et tant que nous n’aurons pas vu cette pièce, qui tombe si à propos, nous la considérerons comme suspecte. C’est un peu l’histoire du bordereau et de sa publication en 1896. Le 14 septembre 1896, L’Éclair en donna le texte (qu’on trouvera plus bas ; introduction p. 10-11). Quand on le compare à l’original, on y voit un texte qui n’a rien, mais rien du tout à voir… Si le bordereau n’avait pas été publié en fac-similé par Le Matin le 10 novembre 1896, nous en serions resté à la version fautive et intéressée de L’Éclair. Nous le répétons donc : une pièce ne peut avoir de valeur que si on peut la voir (et c’est pour cela que sont données des références ; mais encore faut-il donner les bonnes), sans quoi elle n’existe pas… C’est un peu, encore, l’histoire du « faux Henry » au procès Zola. La pièce existait certes et avait par son texte et la langue dans laquelle elle était rédigée tous les caractères d’un faux. C’est en la voyant et en constatant qu’elle était composée de deux papiers différents que le faux ne fut plus un simple soupçon mais devint une réalité. Quand Pellieux en avait donné le contenu au procès Zola, Labori, confrère d’Adrien Abauzit, lui avait dit :
Quelque respect que j’aie pour la parole de soldat de M. le général de Pellieux, je ne puis accorder la moindre importance à cette pièce. Tant que nous ne la connaîtrons pas, tant que nous ne l’aurons pas discutée, tant qu’elle n’aura pas été publiquement connue, elle ne comptera pas. Et, c’est au nom du droit éternel, au nom des principes, voyez-vous, que tout le monde a vénérés depuis les temps les plus reculés et depuis que la civilisation existe, que je prononce ces paroles !
[…] Ce ne sont pas des paroles d’hommes quels qu’ils soient, qui donneront de la valeur à ces pièces secrètes. Ces pièces, il faudra ou que l’on n’en parle pas ou qu’on les montre ; c’est pourquoi je dis à M. le général de Pellieux : « Apportez les pièces ou n’en parlez plus ! »
Adrien Abauzit ne sera pas sensible à la parole de l’homme Labori mais pourrait l’être à celle du confrère. Car dans une instruction, dans un procès, dans un travail historique aussi, qu’est une pièce qu’on ne peut pas voir, qui n’est que citée – toute décrite qu’elle soit –, dans un journal partisan, une pièce
-
-
- qui est présentée comme étant tenue en lieu sûr (à New York !) par son propriétaire et n’est pas montrée ;
- dont le nom du propriétaire n’est pas donné et pour lequel il faut se contenter d’un unique « M. X. » ;
- qui n’est pas reproduite, ne permettant ni d’en contrôler le texte, ni d’en identifier l’écriture ;
- dont la description indique qu’elle n’est pas écrite sur le papier qu’utilisait toujours Félix Faure ;
- qui est donnée comme n’étant pas signée quand toutes les lettres de Faure que nous connaissons – à tous ses correspondants, à sa famille, à le Gall, comme à Marguerite Steinheil – le sont ;
- et pour laquelle, pour en expliquer la provenance, il faut se contenter de l’information que celui qui la détient l’a payée cher et que pour avoir une réponse précise à cette question de provenance, il faudrait demander à Marguerite Steinheil !
-
Et pourtant, c’est cette pièce qui n’existe que parce qu’on dit qu’elle existe, qui est la seule de toutes celles que nous connaissons qui soit écrite sur un autre papier que le sien et qui ne soit pas signée, dont n’est connue qu’une transcription dans un journal et dont personne n’a pu voir l’original qui permet à André Galabru, et après lui à Adrien Abauzit, de soutenir leur thèse. Une pièce qui ne saurait avoir la moindre valeur et qui n’en aura jamais, tant il est évident qu’on ne la verra jamais. L’auteur de l’article avait d’ailleurs promis « qu’un jour viendra où probablement nous produirons autre chose qu’une copie »… 117 ans après, nous attendons encore.
C’est pour cela que, dans notre précédent post, nous ironisions un peu :
Quand on se souvient de tout ce qu’a développé Adrien Abauzit au sujet du petit bleu parce qu’il était non signé, quand on se souvient de son « coup » de la lettre à Macron dont il s’est montré si fier, la chose devient plus qu’amusante…
À cela, Adrien Abauzit répond que :
Le sophisme ne prend pas, car les deux documents n’ont rien à voir : Le Petit bleu n’est pas une lettre mais un brouillon écrit par quelqu’un d’autre que son auteur théorique, et que Picquart, par ses falsifications maladroites, a essayé de faire passer par une lettre envoyée par la poste.
Nulle part nous n’avons dit que ces lettres avaient « à voir ». Nous nous sommes juste étonnés qu’Adrien Abauzit puisse contester l’authenticité du Petit Bleu en partie parce qu’il n’était pas signé (il faut rappeler qu’il porte un C en signature) quand ici la chose ne lui pose aucun problème. C’est tout. Quant au petit bleu – qui a quand même le mérite de pouvoir être vu, à la différence de l’hypothétique lettre de L’Espérance du Peuple –, dont nous parlons à Adrien Abauzit depuis 2021, nous n’allons pas y revenir ici et renvoyons à nos différents posts sur la question (octobre 2018, décembre 2018 et 2021).
Mais continuons encore car la suite est intéressante et constitue un parfait exemple de la manière de pratiquer que nous tentons de montrer à celui-là même qui nous reproche d’une part de « prendre de grandes libertés avec les pièces du dossier » et d’autre part de nous dérober et de pratiquer par diversion. Relativement à la première lettre, dans notre précédent post, nous écrivions encore :
Une lettre étonnante, une lettre pour le moins douteuse mais qui a aussi, pour Adrien Abauzit, une autre importance puisqu’elle révèle qu’on avait « fait pression sur lui [Félix Faure] pour lui faire « sanctionner » une trahison ». Si Adrien Abauzit était allé vraiment voir la presse, comme il dit l’avoir fait et l’a fait un peu, un tout petit peu, il n’aurait pas fait confiance à L’Intransigeant, qu’il cite ici, et qui disait cela dans son numéro du 12 décembre. Il serait allé voir, en ligne, le numéro de L’Espérance du Peuple qui en était à l’origine, et que l’Intransigeant « résumait », et y aurait non seulement vu qu’il s’agissait d’une autre lettre (il y en a deux) que celle dont il parle (L’Espérance du Peuple du 13 décembre 1908) mais surtout que la lettre en question, la première, ne disait absolument pas ce qu’il avait appris dans L’Intransigeant, indiquant bien, si c’était nécessaire, le peu de crédit qu’il faut porter à ce journal. En effet, dans le numéro de L’Espérance du peuple du 11 décembre, on ne lit absolument pas qu’on a « fait pression sur lui [Félix Faure] pour lui faire « sanctionner » une trahison » mais, dans cette lettre extraordinairement suspecte que le journal citait en partie, que Félix Faure avait besoin de voir sa maîtresse « pour oublier quelques instants auprès de [son] petit cœur aimant cette pieuvre de la trahison dont les tentacules m’enserrent de tous les côtés et changent mes nuits en cauchemars ». Voilà qui est pour le moins bien différent…
Adrien Abauzit, déplaçant le propos, se dit
au regret d’indiquer à la SIHAD que la trahison en question est bien une mention du Syndicat et que le passage « les tentacules […] changent mes nuits en cauchemars » illustre parfaitement que Félix Faure est l’objet de pression. Autrement pourquoi trembler ? L’article de L’Intransigeant ne dénature en rien le propos du Président de la République assassiné.
Notre remarque ne portait que peu sur la sensation d’étouffement, sur le sentiment d’être prisonnier d’un entourage composé de traîtres (puisqu’il semble bien qu’il s’agisse de cela) et qui peut-être, mais rien ne le dit explicitement, fait pression sur lui pour on ne sait quoi… Elle porte sur la pression exercée « pour lui faire “sanctionner“ une trahison, ce qu’il ne le fera jamais », ce qui n’a rien à voir du tout avec le besoin de voir Marguerite Steinheil pour oublier dans ses bras « cette pieuvre de la trahison dont les tentacules m’enserrent de tous les côtés et changent mes nuits en cauchemars ». Ce que nous disions à Adrien Abauzit, c’est que plutôt que de reprendre chez André Galabru le résumé qu’en donnait L’Intransigeant, il aurait mieux fait d’aller directement à la source de L’Espérance du Peuple qui lui aurait permis de trouver non pas une lettre mais deux lettres, et dont la première ne parle aucunement de « “sanctionner“ une trahison »… Car il est formidable ce texte de l’Intransigeant qui n’a pas vu la lettre dont il parle en empilant les conditionnels :
Un numéro du journal L’Espérance du Peuple de Nantes circulerait en ce moment à la Chambre. Ce numéro contiendrait un document des plus graves concernant les dessous de l’affaire Steinheil. Il s’agirait d’une lettre qu’aurait écrite…
Et il ne suffit pas qu’il y soit question de trahison pour coller avec le sujet. Trahison de quoi ? Trahison de Dreyfus ? trahison de l’entourage de Faure, comme le laisse entendre la seconde lettre de L’Espérance du Peuple que nous donnons à la suite ? Trahison que constituerait la révision ? Pourquoi pas trahison que serait la loi de dessaisissement, loi de circonstance ? Ou encore trahison de ceux qui peut-être informaient les journalistes qui s’acharnaient sur lui depuis son élection, les Drumont, Delahaye, etc. ? Et que veux dire ici « sanctionner » ? Punir ? Rendre exécutoire ? Confirmer par une approbation légale ? Que signifie ici ce mot entouré de guillemets et qui n’est pas dans le texte original ?
Mais bon, laissons L’Intransigeant et revenons à L’Espérance du Peuple et voyons la seconde et fantastique – au sens premier du terme – lettre. Pour une parfaite compréhension, il nous faut la reproduire ici :
Il faut que je vous écrive, cela me fera du bien ; maintes fois déjà je vous ai dit combien j’étais espionné, trahi, même par des gens qui me doivent beaucoup. Ce matin encore je me suis aperçu de la disparition d’un document important pour moi, vous savez, cette proclamation dont nous avons si longuement parlé ensemble.
Je suis las de ces luttes, je sens autour de moi comme une menace perpétuelle de mort, surtout depuis cette malheureuse Affaire Dreyfus !
Vous m’avez demandé, ma petite Meg, pourquoi je ne consentais pas à cette (ici un mot illisible), c’est que cela n’est pas possible, mon mon [sic] devoir me commande de m’y opposer et je m’y opposerai de toutes mes forces quoi qu’il puisse arriver.
Mais je dois vous ennuyer de ces histoires sérieuses, je ferais mieux de laisser parler mon cœur et de vous dire tout ce qu’il renferme pour vous ; cependant, quand je songe à ces horribles histoires, je me sens envahi d’une grande tristesse.
J’ai vu D… ce matin, je l’ai fort mal reçu, malgré vos conseils, vous me pardonnerez, mais la disparition de ce brouillon m’avait mis dans un état de surexcitation extrême, je suis las, très las même.
Ah ! petite Meg, que ne pouvons-nous vivre tous deux loin de ces gens.
Votre mère a encore vu S… hier, ne dites pas non, un de mes bons amis X… me l’a dit. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que cette fréquentation nous sera fatale à tous les deux, je vous l’ai déjà dit bien des fois, S… est l’agent d’un parti qui ne me pardonne pas ma décision [nouveau mot presque illisible), veillez bien sur vous ; s’il allait vous arriver malheur.
J’ai terminé complètement mon projet de réforme, M… l’a vu, je ne sais quelle a été son impression ; que m’importe d’ailleurs, n’est-ce point vous qui me l’avez inspiré ?
Au revoir, petite Meg, demain j’aurai un moment de liberté, j’en profiterai pour aller chez vous. Un baiser.
Une lettre absolument parfaite, dans laquelle tout est… Tellement parfaite que semblent même s’y trouver présents, si on suit la proposition d’André Galabru, Déroulède (D) et Scheurer-Kestner (S). Tellement parfaite et même si le contenu en est aberrant : Adrien Abauzit ne cite pas le passage mais Marguerite Steinheil, exécutrice des hautes œuvres du « Syndicat », aurait conseillé à Félix Faure de recevoir Déroulède ? Félix Faure l’aurait mal reçu alors qu’il était censé le suivre dans ses projets de coup d’État ? Et tellement parfaite, et tellement authentique avec ces deux mots curieusement illisibles – Faure avait une écriture facilement lisible – dont le premier semble s’imposer : « révision ». C’est en tout cas, et en toute évidence, ce qu’y lit André Galabru (p. 100). Une lettre parfaite donc et qui le sera plus encore quelques jours plus tard quand paraîtra l’article de Quisait qui en offrait, comme par magie, la confirmation. Tellement parfaite qu’on voudrait y croire, naturellement, comme Adrien Abauzit qui peut, dans ce dernier volume, se satisfaire de l’absence de signature (« l’absence de signature de la lettre n’a aucune importance »), au motif que « son contenu est très clairement propre à Félix Faure » (p. 26). Propre au Félix Faure de cette version complotiste sans aucun doute mais pas propre au Félix Faure que nous restituons depuis le début, dans ses sentiments à l’égard de la révision, et que nous allons voir bientôt apparaître à propos de la question du coup d’État. C’est pour cela que quand sortit cette correspondance, Albert Monniot lui-même, un des principaux artisans de cette légende, appela ses lecteurs et ses amis, dans La Libre Parole, à la méfiance :
Je trouve que, depuis quelques jours, il vient beaucoup trop d’eau à notre moulin….
Voilà que parait, chez un confrère de province, une nouvelle lettre de Félix Faure à Mme Steinheil, où se trouvent explicitement confirmées toutes nos déductions : complot dreyfusard ourdi autour du Président, résolution de résister au syndical de trahison, pressentiment de l’assassinat,
Et pendant que nos confrères des départements ont communication de ces documents, ils nous parviennent sous une autre forme d’une source anonyme, mais toujours helvétique comme les lancements dreyfusards de naguère.
Je ne mets pas en doute la bonne foi de nos confrères et rends hommage à leurs intentions. Je conviens même que ces documents présentent un réel intérêt et tous les caractères de la vraisemblance.
Mais on nous annonce déjà la production prochaine d’une preuve matérielle de la trahison de Dreyfus fournie par cette correspondance, et cela me parait beaucoup trop beau.
Elles prennent des voies si détournées pour nous parvenir, ces révélations, que nous sommes privés de tout contrôle et naturellement incités à la défiance.
Nous sommes bien obligés de penser que si la police a volé les papiers politiques de Mme Steinheil, ce n’était pas, vraisemblablement, dans le but d’alimenter et de fortifier les polémiques des journaux d’opposition.
N’oublions pas qu’il a suffi de ce qu’on a appelé le faux Henry pour ruiner devant l’opinion le formidable faisceau de preuves accumulées contre le traître, discréditer tous les témoignages, faire oublier jusqu’aux aveux.
Nous avons apporté, de l’assassinat de Félix Faure, des témoignages qui peuvent être gênants, mais qui ont l’avantage d’être irrécusables, puisque ce sont des faits ; nous resterons sur ce terrain solide, prêt à faire état d’un nouveau contingent de preuves… quand elles auront pour nous le caractère de preuves.
Quand le hasard nous fait la partie trop belle, j’ai de la méfiance. (« Méfiance ! », 15 décembre 1908)
Et même si cet amateur de complot trouvait là l’occasion d’en imaginer un nouveau, il n’avait pas tort en conseillant la méfiance, raison pour laquelle, d’ailleurs, il ne fera pas la moindre allusion à cette trop parfaite correspondance quand il publiera en 1918 ses Morts mystérieuses. Il avait d’ailleurs été entendu et quatre jours après, il pouvait écrire dans la même Libre Parole :
Mon article Méfiance, c’est un fait à noter, a coupé court aux publications de lettres sensationnelles de Félix Faure à Mme Steinheil. De bonne foi, simplement fumiste ou malintentionné, l’informateur a mis une sourdine à des révélations qui auraient entaché de légitime suspicion les preuves et témoignages que nous avons apportés, le jour où le caractère fantaisiste de ces révélations eût été démontré. (« Le drame de l’Élysée », 19 décembre).
Car en effet, comment ne pas remettre en question cette lettre trop parfaite après les documents que nous avons donnés et qui non seulement contredisent tous cette prétendue volonté de s’opposer « de toutes [s]es forces quoi qu’il puisse arriver » à la révision mais encore nous disent ce que fut jusqu’au bout l’attitude de Faure, gardien et servant de la Loi et de la Loi seule.
Félix Faure préparait-il un coup d’État ?
Tout cela étant dit, il nous faut maintenant entrer dans le sujet qui est ici au centre du propos : Félix Faure préparait-il un coup d’État ? Avait-il pour plan ce qu’expliquait Marguerite Steinheil :
Son plan est – ou plutôt était – celui-ci : avec l’aide de l’armée, car il savait qu’il pouvait obtenir – ou compter sur – le concours de plusieurs généraux, Félix Faure a rêvé de rendre la Présidence indépendante du Parlement, d’établir un gouvernement militaire et de jouer le rôle de dictateur… (p. 81)
Pour mémoire, pour Adrien Abauzit, après André Galabru, la chose ne fait aucun doute et est « établi[e] », nous dit-il dans ce nouveau volume, par quatre éléments : la fameuse lettre de L’Espérance du Peuple, l’extrait des souvenirs de Marguerite Steinheil juste cité, le fait que Déroulède ait tenté de faire marcher un général sur l’Élysée et l’article de Pressensé. Nous avons déjà parlé de ces quatre « preuves » et nous n’y reviendrons pas. Quoi qu’en dise Adrien Abauzit, il faudrait y ajouter un cinquième : le « résumé » de l’anonyme Quisait qui est l’origine de la thèse d’André Galabru qu’il reprend et dont nous avons précédemment donné un extrait, voire même un sixième, qu’Adrien Abauzit donnait dans son précédent volume : une petite phrase d’un article de Déroulède publié dans son Drapeau :
Quand je conseillais au très regretté Président, Félix Faure, de saisir le pays, par voie de message ou tout autrement, du grand problème constitutionnel […]. (Le Drapeau, 6 juillet 1901 ; troisième volume d’Adrien Abauzit, p. 59).
Peut-on sérieusement croire que si l’anonyme informateur de l’anonyme Quisait avait raison, que si les choses s’étaient en effet passées comme il le raconte, Déroulède se serait contenté de cette petite phrase perdue dans un article publié dans un journal au tirage confidentiel ? Peut-on croire que si, comme le soutien Adrien Abauzit dans son troisième volume, « Félix Faure avait semble-t-il donné son accord après avoir hésité » au « projet de “coup d’État“ » (p. 61), Déroulède se serait contenté de parler de « conseils » ? Et peut-on croire que devant la Haute Cour, quand il comparaissait pour avoir tenté d’attenter à la sûreté de l’État, Déroulède, fanfaron et cabotin, aurait laissé passer l’occasion de raconter par le menu la visite dont parle l’anonyme informateur de l’anonyme Quisait ? En fait, et c’est tout a fait extraordinaire, Déroulède parla devant la Haute Cour d’une visite à Félix Faure mais pas de cette entrevue pour le moins hypothétique de février 1899. Déroulède parla de la seule entrevue attestée qu’il eut avec Félix Faure président, et qui est plus que certainement la même que celle dont il est question dans l’article du Drapeau. Une entrevue dont le résultat fut pour le moins différent que celle qu’imaginait l’anonyme informateur de l’anonyme Quisait. Voici ce que déclara Paul Déroulède à ses juges :
Je suis accouru à l’Elysée le lendemain de l’élection de Félix Faure et je lui ai dit : « Vous êtes un homme de cœur et vous pouvez être un homme populaire. Il y a une grande tâche bienfaisante à accomplir vis-à-vis du pays. Il y a le tirer de l’oligarchie parlementaire. Il y a à faire un coup d’État absolument pacifique ». Car ce sera sous un souffle sortant de n’importe quelle bouche que le régime parlementaire disparaîtra.
Je suis donc allé trouver Félix Faure pour lui demander de rendre ce grand service à la Nation, mais il m’a répondu, très loyalement : « Je suis le serviteur de la Constitution, c’est en vertu de cette Constitution que j’ai été nommé, je ne peux pas y porter atteinte. Je connais, comme vous, le mal dont souffre le pays, mais ce mal est inguérissable. Vous n’aurez pas de révision ni par le Congrès qui s’y refusera, ni par un chef d’État tenant son pouvoir de ce Congrès et lié par ses engagements. »
Je ne crois pas offenser la mémoire de cet honnête homme en révélant ici sa résistance à mes propositions. Sa popularité lui aurait permis d’accomplir cette besogne aussi simple et aussi peu dangereuse en période parlementaire qu’en période plébiscitaire. Il ne faut pas beaucoup de choses pour vous renverser : le gouverneur de Paris y suffirait et à défaut du gouverneur de Paris, le général de Galliffet s’il avait dix ans de moins !
Eh bien, cette proposition de révision inconstitutionnelle repoussée par Félix Faure avec beaucoup de loyauté et d’énergie, j’ai essayé de la présenter constitutionnellement au Congrès. (Le Drapeau, 26 novembre 1899).
Peut-on croire que si, quelques mois avant cette audition devant la Haute Cour, Faure avait été frappé par le projet soumis et avait demandé un temps de réflexion, l’invitant à venir le revoir pour obtenir sa réponse, mieux même aurait « semble-t-il donné son accord après avoir hésité », comme nous le dit Adrien Abauzit, Déroulède ne l’aurait pas raconté alors pour lui préférer le récit d’un premier échec ? Et peut-on une seule seconde imaginer que si Faure avait en effet été prêt à suivre Déroulède dans son audacieux projet, ce dernier se serait contenté, près d’un an après sa mort, d’un « Je ne crois pas offenser la mémoire de cet honnête homme en révélant ici sa résistance à mes propositions » qui valait pour la visite de 1895 et, seule information, valait donc dans l’absolu ? Et imagine-t-on encore qu’il aurait pu se passer d’un tel argument, face à la Haute Cour réunie pour le juger, fait qui donnait une justification à son acte postérieur de quelques jours à cette conversation et aurait pu montrer qu’il n’avait finalement que voulu traduire en action ce que Félix Faure n’avait eu le temps de mener à bien ?
Le Félix Faure que nous voyons ici, dans ce souvenir de Déroulède, est bien celui qu’on connaît et dont l’attitude ne fut pas différente de ce qu’elle sera deux ans plus tard quand Robert Mitchell, de la part de ses amis dont était Déroulède, vint retenter la même démarche. Rappelons cela, dont nous parlions dans notre précédent post à Adrien Abauzit, information intéressante qu’une nouvelle fois il n’a pas retenu :
Nous savons que Déroulède avait approché Faure une ou deux fois mais nous n’avons aucune date et rien, vraiment rien, ne nous dit que ce fût juste avant sa mort. Nous savons aussi qu’à chaque fois le président avait opposé un refus à son interlocuteur comme il l’avait fait fin 1897 quand Robert Mitchell était venu le voir, au nom de ses amis Drumont, Déroulède, Habert, Judet, Delahaye, etc., pour présenter aux législatives à venir des hommes réunis sous le drapeau plébiscitaire présidentiel afin de le faire élire président à vie. Dans son Journal, publié il y a quelques années par Bertrand Joly, Faure raconte cette entrevue et sa réponse qui fut un unique : « C’est intéressant ». Et à la suite, Faure notait :
Ces gens-là se figurent toujours qu’il est possible à un républicain de trahir la République. Ce sera peut-être une occasion de montrer au pays ce que valent les soi-disant patriotes et d’en finir une bonne fois. Pour cela il convient de les laisser marcher et il faut rester attentif à leurs agissements, mais sans se confier à personne.
Félix Faure aurait-il donc radicalement changé d’idées et de principes, entre fin 1897 et début 1899 ? Peut-être… mais ce ne sont pas les « preuves » du « prudent » André Galabru reprises par Adrien Abauzit qui nous permettront d’en être convaincus. Mais quoi qu’il en soit, nous voyons mal Faure trahir la République dont il était le représentant et la Loi dont il était le garant ; « Ma règle de conduite, c’est la Loi – Personne ne m’en fera sortir » avait-il écrit à Le Gall – de l’intérêt, encore une fois, Adrien Abauzit, de faire le travail d’archives – en septembre 1898 (lettre du 24 septembre 1898, AN 460/AP 10).
Félix Faure, serviteur de la République et de ses lois, n’était pas un homme de coup d’État. Et il faut se souvenir de cette conversation de la mi-octobre avec Zurlinden qui la rapporte dans ses souvenirs. Quand avaient commencé à courir les fantasmes de coups d’État dans les rangs dreyfusards et dont témoignaient leurs journaux, l’ancien ministre était passé voir Félix Faure à propos d’une nouvelle qui avait été lancée par la presse et qui annonçait son arrestation. Faure lui avait dit avoir déclaré qu’il n’avait pas la moindre inquiétude au sujet du fervent républicain qu’il était et Zurlinden, partant, l’avait assuré que ses « convictions étaient tellement fortes à cet égard que si [lui]-même, M. le Président de la République, [voulait] faire un coup d’État, [il le] trouver[ait] en travers ». « Je ne vous en donnerai pas l’occasion, soyez-en sûr », lui avait répondu Félix Faure (p. 216-217).
Déroulède et Félix Faure, au temps de la présidence du dernier, se virent donc en 1895 et c’est la seule visite qui puisse être attestée. Que Déroulède ait essayé, au plus fort de l’Affaire, de faire agir Faure n’est pas douteux et nous nous souvenons de la lettre inédite dont nous avons précédemment donné le texte et à laquelle, dans les faits, Félix Faure ne montra qu’une chose : « sa résistance à [s]es propositions ». Mais, à vrai dire, est-ce la peine de discuter longtemps sur ce point ? Non, puisque Faure ne reçut pas Déroulède en février 1899, vers le 13, comme le soutient l’anonyme informateur de l’anonyme Quisait. Il ne le reçut pas le 13, pas plus qu’un autre jour de février, parce que la chose était rigoureusement impossible. Déroulède, malade, en convalescence, était à Nice depuis le 21 janvier et ne reviendra à Paris que le 18 février à 9 heures du matin, pour être présent au Congrès afin de prendre la parole à l’occasion de l’élection du nouveaux président de la République. Et l’argument possible d’un aller-retour de Nice ne serait pas recevable : hormis le fait, qu’à l’époque, l’aller-retour Nice-Paris mobilisait 39 heures, uniquement pour le voyage en chemin de fer, le dépouillement de la presse croisé avec le dossier « Journées du Président », suivi constant par la Sûreté (conservées aux archives de la PP), qui nous permet de suivre l’emploi du temps au jour le jour de Félix Faure, et croisés avec les rapports de surveillance de Déroulède à Nice (conservées aux AN), nous assure que cette visite n’a jamais eu lieu. Le 17 février, ignorant encore que quelques heures plus tard (14h20) Déroulède allait revenir à Paris, le préfet écrivait à la Présidence du Conseil, sur la base des rapports de la Sûreté, pour dire que Déroulède, dans sa villa du Roc-Fleuri, « jusqu’à ce jour[,] n’a paru vouloir se préoccuper que du rétablissement de sa santé, et […] a consigné sa porte aux différentes personnes venues pour l’interviewer ; il a seulement reçu dans la journée d’hier une délégation de l’association Poëtique des Alpes-Maritimes, […] venu[e] pour lui offrir la présidence du Banquet de l’association fixé au 26 courant à l’Hôtel Continental et de Genève. M. Déroulède a fait valoir son état de santé pour décliner cette invitation ». (AN F7 15947/1)
Petite genèse d’une infox
Nous allons continuer à lire le dernier volume d’Adrien Abauzit mais les lignes qui précèdent fermant le chapitre de l’assassinat, il peut-être intéressant de faire une pause pour dire ce que fut cette légende et comment et pourquoi elle naquit.
Adrien Abauzit, dans son troisième volume, cite un certain nombre de réactions, « réactions abjectes », pour nous montrer que « la mort de Félix Faure donne l’occasion à la gauche de révéler son véritable visage ». Il cite Clemenceau et Dejeante. Il aurait pu donner de nombreux autres extraits. Celui-ci, par exemple :
Comme homme politique, Félix Faure défie toute biographie. Il aura surtout, dans ses quatre ans de présidence, manqué de cette modestie qui sied si bien à une absence complète de talent [nous soulignons]. Il aura passé par l’Élysée sans laisser en France de sympathies ou d’antipathies. Il fut ce qu’on appelle un neutre.
Faute de capacité pour faire autre chose, il faisait du protocole. On sentait qu’au milieu des périls que la France et la République ont courus depuis plusieurs mois la maîtresse préoccupation de ce chef d’État fut de se demander si, à dîner, il placerait à sa droite ou à sa gauche la femme de tel ou tel ambassadeur. Il était là pour lever son verre à la santé de celui-ci ou de celui-là, et il faut reconnaître qu’il a scrupuleusement accompli cette mission, qu’il serait exagéré de qualifier de présidentielle.
En somme, sa personnalité fut plutôt gênante pour le bon renom de la nation française à l’étranger, car s’il a pu se vanter d’avoir apporté de Saint-Pétersbourg à Paris le traité d’alliance avec la Russie, lequel avait été signé par son prédécesseur, il avait contracté d’autres alliances, non politiques ou militaires, mais matrimoniales, qui, à certains moments, devenaient singulièrement embarrassantes. Il se trouvait ainsi le prisonnier de ses débuts dans la vie et à la merci du premier à qui il plaisait de l’attaquer.
Ou encore celui-ci :
La Fortune, dont les préférences sont parfois singulières, avait pris celui-là dans ses bras ; elle avait fait de ce notable commerçant, qu’aucun mérite spécial ne distinguait, l’égal, l’hôte et presque l’ami des souverains les plus hautains de la vieille Europe ; elle le dépose doucement dans la mort au moment où il rêvait peut-être d’un nouveau cordon, d’une Annonciade à ajouter à la Toison d’Or.
« La mort, a dit Guizot, semble toujours imprévue, surtout lorsque la vie a été grande. »
Nulle vie ne fut moins grande que celle de Félix Faure si nulle destinée ne fut plus haute. La situation générale, cependant, est telle ; elle est si pleine de dangers à l’extérieur comme à l’intérieur, qu’elle donne à cet événement un caractère presque tragique. Les craquements d’une société qui se désagrège et tombe en ruines font comme un écho sinistre au dernier soupir que vient d’exhaler dans ce palais, qui fut celui de Napoléon, cet égoïste sans méchanceté et sans fiel, ce veinard extraordinaire qui fut comme la personnification la plus complète de la médiocrité bourgeoise triomphant jusqu’à l’apothéose.
[…] Voilà à quelle heure de l’histoire finit cet homme incolore et blafard, ce privilégié qui, à une époque où tout le monde a souffert dans ses croyances, dans ses espoirs, dans son patriotisme, dans ses intérêts même, a été constamment et imperturbablement heureux..,
Terribles textes mais qui ne sont pas dus à la plume de ce qu’Adrien Abauzit nomme « la gauche ». Le premier est l’œuvre de Rochefort et a été publié dans L’Intransigeant, postdaté du 19 février 1899 et le second a été publié par Drumont dans La Libre Parole, du 17 février 1899, Drumont qui ne faisait que varier là les articles contre Félix Faure qu’il n’avait eu de cesse de publier depuis son élection. Et, dans ces deux articles, l’un comme l’autre avaient fustigé le rôle qui avait celui de Félix Faure dans l’Affaire. Rochefort, dans le même article, avait écrit :
C’est à cette incessante contrainte qu’il faut sans doute attribuer le rôle plus qu’effacé qu’il a joué dans cette monstrueuse affaire Dreyfus, sur laquelle il n’a jamais osé se prononcer nettement, de peur de devenir la proie des dreyfusards ou des nationalistes.
Et Drumont, qui avait parlé de cet homme imperturbablement heureux quand existait
à l’intérieur, un complot contre la Patrie, ouvertement tramé par des traîtres qui se glorifient de leur crime…
C’est amusant. Et ce qui est bien plus amusant encore, est que sept jours plus tard, le 23 février, le même Drumont avait changé de plume et d’encre :
On lira plus loin la page d’histoire émouvante et troublante qu’un de nos amis, admirablement informé, a écrite sur cette fin de Félix Faure enveloppée de si étranges obscurités.
Celui qui a disparu tout à coup de la scène du monde d’une façon qui a surpris d’abord parce qu’elle était imprévue et subite, et qui inquiète maintenant parce qu’elle apparaît inexplicable et mystérieuse, n’eut en nous ni des amis ni des ennemis.
Il fut un homme ; il eut les faiblesses et les vanités d’un homme. Mais il fut aussi un vrai Français. C’est peut-être de cela qu’il est mort.
Nous saluons donc celui qui s’en va vers l’éternel repos au milieu de cette pompe extérieure, de cet appareil magnifique qui lui plaisaient de son vivant.
Nous le saluons non pour ce qu’il a fait, mais pour ce qu’il aurait voulu faire, pour la bonne volonté qui était en lui, pour la douleur sincère qu’il éprouvait au fond de lui-même, de la campagne monstrueuse organisée contre cette armée qu’il aimait profondément. Plus énergique et plus viril, il aurait vite mis à la raison le traître et les agents de l’étranger…
Moins patriote et plus docile aux ordres du Syndicat, il aurait probablement vécu… (« Celui qui s’en va », La Libre Parole, 23 février 1899).
L’explication de ce petit retournement, se comprend aisément : tellement utile est la thèse de l’assassinat. Et elle ne naquit pas de rien. Elle fut la réponse à un mot d’ordre, celui que Marcel Habert, ombre et second de Déroulède, après avoir eu son attention attirée par le premier article qui avait parlé de mystère à propos de la mort de Félix Faure, avait lancé dès le 17 février dans une réunion de la Ligue des Patriotes au café des Prince. Un mot d’ordre selon lequel
il fallait répandre avec soin, dans le public, le bruit, déjà mis en circulation par la Patrie, de l’empoisonnement de M. Félix Faure par les dreyfusards. (rapport de la Sûreté, Haute Cour de Justice, Affaire Buffet, Déroulède, Guérin et autres inculpés de complot. Documents I, Paris, Imprimerie Nationale, 1899, p. 17.
• Chapitre II. Dérobades monumentales, p. 23-24.
La question étant close, revenons en arrière… Adrien Abauzit – qui d’un post maintenant ancien n’a répondu qu’à 8 des 50 points que nous soulevions, comme si les quarante-deux autres n’existaient pas – affirme que nous n’examinons aucune des preuves ou indices qu’il invoque et, entre autres, relativement aux questions médico-thérapeutico-légalo-toxicologique… Questions, explique-t-il, qui constituent le « plus probant » (p. 23). Pour ce faire, il reprend ce que nous écrivions :
Si toutes les « preuves » d’Adrien Abauzit (ou d’André Galabru) s’écroulent les unes après les autres, demeurent toutefois la question de la mort de Félix Faure et celle des soins qui lui furent prodigués, soins inadéquats dans les cas d’apoplexie et particulièrement recommandés dans ceux d’empoisonnement. La chose serait à vérifier mais nous ne le ferons pas, la lecture des traités de médecine nous rebutant tout à fait.
Et en commentaire, Adrien Abauzit ajoute que, « étant « rebutée », la SIHAD ne fera pas le travail censé être le sien » et que, du coup, elle « devrait se taire sur la question ». Nous taire ? Mais c’est justement ce que nous avons fait en refusant de nous aventurer sur un terrain qui n’est pas le nôtre. Car en effet, quand nous ne connaissons pas un sujet, quand un sujet touche à une spécialité qui n’est pas la nôtre, à la différence de nombreux improvisateurs, nous nous taisons. Quand nous abordons un sujet qui n’est pas de notre domaine de compétence, ce n’est qu’après une long travail d’identification des sources, de dépouillement et de lecture, puis de croisement que nous prenons la parole. Si nous n’avons pas fait ce travail, nous nous taisons. Cela dit, le reproche est extraordinaire et le retournement audacieux ; s’il y a quelqu’un qui devait le faire, ce travail, ce n’est certes pas nous, lecteurs d’Adrien Abauzit qui ne croyons pas que Faure ait été assassiné et qui sommes donc ceux à convaincre ; c’est à Adrien Abauzit de le faire, et à lui seul, puisque c’est lui qui avance l’argument et lui qui a donc à prouver la validité de ces vérités cachées qu’il veut nous révéler.
S’il nous a fallu quelques mois pour publier cette réponse, c’est justement parce que nous l’avons finalement fait ce travail qu’Adrien Abauzit, se contentant de reprendre une référence d’André Galabru, n’a pas fait. Nous l’avons fait du mieux que nous avons pu, en y passant un temps important mais qui demeure insuffisant pour pouvoir nous permettre de revendiquer une quelconque compétence. Mais tout insuffisant qu’il soit, il va toutefois nous permettre de discuter un peu. Mais avant d’entrer au cœur du sujet, il nous faut faire un saut de quelques pages et aller aux pages 33-34 du présent volume où Adrien Abauzit reprend un passage de notre précédente réponse qui suivait l’extrait juste cité. On y lisait :
Mais si cela est vrai, si en effet les soins apportés à Félix Faure étaient de ceux que l’on pratiquait habituellement dans les cas d’empoisonnement, ne peut-on tenter une simple explication ? Faure, la chose est connue, pour stimuler et satisfaire ses insatiables appétits prenait de la cantharide, aphrodisiaque réputé puissant et qui ne semble jamais l’avoir été mais dont la surdose est mortelle… N’a-t-il pas simplement, ce fameux jour, abusé de son « remède d’amour » ? Et on comprendrait alors bien pourquoi on parla officiellement d’apoplexie, façon convenable d’expliquer la mort subite d’un président de la République, et plus convenable en tout cas qu’une overdose causée par un proto-viagra !
Citant ce passage, Adrien Abauzit explique tout d’abord que la SihaD « est contrainte de reconnaître que la version graveleuse de la mort de Félix Faure […] ne résiste pas à l’examen ». Mais nous ne sommes contraints de rien du tout et certainement pas de reconnaître que la version « graveleuse » ne résiste pas à l’examen. Nous n’y sommes pas contraints parce que nous n’y avons jamais cru, n’y croyons toujours pas et n’y croirons jamais et pour l’unique raison que cette version est stupide. Ensuite, Adrien Abauzit explique que « pour éloigner à tout prix le lecteur de la réalité [sic] de l’assassinat », la SihaD s’accroche « purement gratuitement, sans l’ombre de la moindre preuve, à la fiction selon laquelle Félix Faure aurait été victime d’un mauvais dosage d’aphrodisiaque ». Mais nous ne nous accrochons à rien du tout et il suffit de lire ce qui est écrit, de repérer la présence en ouverture d’un « si », conjonction de subordination qui est la marque de l’hypothèse, remarquer le conditionnel et la forme interrogative et que, du coup, en déduire que ces quelques lignes veulent simplement dire : pourquoi, s’il était prouvé que les traitements apportés avaient en effet été ceux qu’on pratique dans les cas d’empoisonnement, faudrait-il uniquement envisager la thèse de l’assassinat ? Ne pourrait-il y avoir d’autres explications, comme par exemple…………. ? Quand on meurt empoisonné, il y a deux possibilités : soit on a été empoisonné, soit on s’est empoisonné, volontairement ou involontairement (telle est d’ailleurs la thèse proposée par Marguerite Steinheil ; Mes Mémoires, p. 100). On ne peut dire qu’une des deux possibilités est la « réalité » sans avoir montré que l’autre ne l’est pas… Pas plus.
Mais justement, maintenant que nous avons fait le travail, voyons ce qu’il en est :
Les soins apportés à Faure : empoisonnement ou apoplexie ?
Avant de commencer, et pour une meilleure compréhension, il nous faut nous intéresser à la deuxième des « preuves et [d]es indices de l’assassinat » de Félix Faure, donnée par Adrien Abauzit, p. 21 : la version controuvée du Journal officiel. Adrien Abauzit écrit que les cinq médecins ayant « appliqué des thérapeutiques anti-empoisonnement », le Journal officiel ment nécessairement puisque, comme il l’écrivait dans son précédent volume, l’annonce officielle de la mort du Président « ne parle pas d’empoisonnement mais “d’apoplexie foudroyante“ » (p. 51). Si les médecins ont en effet « appliqué des thérapeutiques anti-empoisonnement », la chose ne peut se discuter. Reste à être sûr que tels étaient bien les soins apportés… ce que nous verrons bientôt. Maintenant, et faute d’avoir encore réglé cette question, il faut convenir d’une évidence : même en admettant que les thérapeutiques aient bien été celles appliquées dans les cas d’empoisonnement, le Journal officiel pouvait difficilement parler d’autre chose que d’une apoplexie foudroyante puisque telle était la conclusion officielle des médecins qui parle d’hémorragie cérébrale, cause de l’apoplexie.
Du sens d’« apoplexie foudroyante »
Dans son précédent volume, empruntant toujours à André Galabru, Adrien Abauzit explique, toujours à propos du Journal officiel, qu’il est incohérent de parler d’apoplexie foudroyante alors que « l’agonie [a] duré plus de cinq longues heures » (p. 47). C’est vrai, il est écrit « foudroyant » et longue fut l’agonie. Mais ce qu’il est intéressant de savoir c’est que dans le vocabulaire médical le mot « foudroyant » n’indique pas la soudaineté, raison pour laquelle une apoplexie foudroyante qui dure cinq heure n’a rien de « singulier », pour reprendre le mot d’André Galabru (p. 121). Si l’on consulte la thèse de médecine consacrée à l’apoplexie de François Raynaud, nous lisons cet avertissement :
[…] Apoplexie foudroyante. Nous qualifierons par cette expression les apoplexies qui entraînent la perte des malades dans les premières heures qui suivent l’invasion de l’attaque. Dans tous ces cas, le coma, la paralysie, la perte du sentiment, la résolution générale, la sterteur de la respiration, sont fortement prononcés ; l’intensité de ces symptômes augmente incessamment jusqu’à la mort. Il faut bien se garder de prendre dans toute la rigueur de sa signification le terme d’apoplexie foudroyante, qui, dans son terme grammatical, semblerait devoir être synonyme de mort subite ; jamais, en effet, une hémorrhagie cérébrale n’a fait mourir subitement ; dans les plus fortes attaques, les malades ont toujours deux ou trois heures d’agonie. (Dissertation sur l’apoplexie ou l’hémorrhagie spontanée des centres nerveux, Paris, Didot, 1834, p. 36).
C’est ce que nous dit aussi Guillaume-Edmond Villeroy dans sa thèse intitulée : Essai sur l’apoplexie, ou hémorrhagie cérébrale :
La durée de l’hémorrhagie de cette espèce est courte, et sa terminaison funeste : c’est l’apoplexie foudroyante des auteurs. Les malades succombent ordinairement au bout de quelques heures ; rarement vivent-ils deux ou trois jours. Quelques auteurs pensent que la mort peut être instantanée, la maladie ne durer que quelques minutes. M. Rostan, qui a observé des centaines d’apoplectiques, assure qu’il n’en a jamais vu périr au moment même de l’attaque, que tous ces malades ont vécu quelques instans [sic], quelquefois plusieurs heures, et même plusieurs jours […] (Paris, Didot, 1830, p. 14).
Telle est la réalité que nous confirme encore le classique du domaine, le Nysten (Dictionnaire de médecine, de chirurgie, de pharmacie, des sciences accessoires et de l’art vétérinaire). Dans l’édition de 1855, qui est celle que nous avons consultée, on lit, en définition : « Apoplexie foudroyante : celle qui détermine la mort en trois, quatre ou vingt-quatre heures » (p. 95).
Des sangsues, saignées, vésicatoires et injections de sérum
Cela posé, interrogeons-nous sur la question de savoir si le Journal officiel en a menti et si les thérapeutiques mises en œuvre pour soigner Félix Faure sont celles qui étaient « pratiquées en cas d’empoisonnement ». Pour le prouver, Adrien Abauzit, dans son précédent volume, renvoyait à André Galabru, dont il reprenait une note infrapaginale (p. 122) : « Le précis de médecine du professeur Grasset, de la Faculté de Médecine de Montpellier ou celui du professeur Lemoine de la Faculté de Médecine de Lille, l’établissent » (p. 51). Deux noms d’auteurs à la bibliographie pléthorique, pas de titres, par d’édition, pas de pagination. Au lecteur de s’en satisfaire et d’avoir confiance… Adrien Abauzit aurait dû aller y voir, avant de reprendre ce que dit son prédécesseur. Parce que quand on y va, ce que nous avons donc fait, on ne trouve aucunement l’information qu’y a vue André Galabru et que reprend Adrien Abauzit. Mais peut-être avons-nous mal cherché ou n’avons-nous pas cherché dans les bons traités malgré le nombre important de ceux que nous avons dépouillés (nous ne doutons pas, si c’est le cas, qu’Adrien Abauzit nous le montrera). Si l’on suit l’abbé Renault, source d’André Galabru que reprend Adrien Abauzit pour connaître ces thérapeutiques, les médecins procédèrent à des tractions de la langue après avoir posé sangsues et vésicatoires, opéré des saignées et fait des injections de sérum. Quand on va voir les nombreux Grasset et Lemoine, et aussi les traités, manuels et essais d’autres auteurs, nous trouvons essentiellement, concernant les cas d’empoisonnement, les lavements, qui ne furent pas appliqués à Faure, et rien d’autre que cela sans doute parce que les empoisonnements étudiés étaient essentiellement par ingestion et que, comme le dit Louis Hugounen, dans son traité des poisons (hygiène industrielle-chimie légale), l’injection sous cutanée, qui est la thèse d’André Galabru et après lui d’Adrien Abauzit, demeurait « très rare dans les empoisonnements criminels » (Paris, Masson, 1891, p. 15). Mais cela dit, nous avons bien trouvé mention des saignées, sangsues, vésicatoires et injections de sérum, recommandés pour différents diagnostics et, la plupart du temps ensemble, adjoints parfois à d’autres thérapeutiques et ce – la chose est surprenante –… précisément dans les cas d’apoplexie (Grasset, Thérapeutique appliquée, consultations médicales sur quelques maladies fréquentes, Montpellier, C. Coulet, 1893, p. 17 ; Lemoine, Manuel de Thérapeutique clinique, Paris, Vigot, p. 467 ; Grasset, « Traitement de l’apoplexie », La Médecine moderne, n° 1, 1898 ; Lemoine, Interventions médicales d’urgence, Paris, Vigot, 1911, p. 340), contredisant donc un anonyme médecin, source d’André Galabru que reprend Adrien Abauzit, qui, en 1908, affirmait dans La Libre Parole : « Jamais il ne viendra à l’idée d’un praticien de faire une injection de sérum dans un cas d’hémorragie cérébrale » (p. 52).
Des tractions de la langue
Saignées, sangsues, vésicatoires et injections de sérum… il ne nous manque que les tractions de la langue à propos desquelles André Galabru nous dit que « les précis de médecine de l’époque [les] conseillent en cas d’empoisonnement et non “d’hémorragie cérébrale foudroyante“ » (p. 122). On les retrouve en effet dans les cas d’intoxications aiguës – et sans les autres soins ! – mais, pour ce que nous avons pu trouver, dans un seul cas : celui d’une intoxication aux oxydes de carbone qui ne saurait guère nous intéresser dans le cas précis qui est celui de Félix Faure. En revanche, ces tractions de la langue sont systématiquement effectuées dans les cas de « suspension de la vie » (Jean-Vincent Laborde, Le traitement physiologique de la mort : Les tractions rhythmées de la langue. Moyen rationnel et puissant de ranimer la fonction respiratoire et la vie. Détermination expérimentale du mode d’action ou mécanismes du procédé, Paris, Alcan, 1894), et on comprend bien pourquoi elles furent pratiquées à Félix Faure qui « était tombé dans le coma, […] ne pouvait plus articuler une parole, remuer les lèvres, donner un regard », comme le précise un article du Temps qu’Adrien Abauzit utilise par ailleurs (« Félix Faure. La mort du Président »).
Des injections d’éther et de caféine
Mais il nous faut aller un peu plus loin. Le témoignage de l’abbé Renault est celui qu’ont retenu, pour leur démonstration, André Galabru et, après lui, Adrien Abauzit. Mais il y en a d’autres qui parlent d’autres soins, d’injections d’éther et de caféine, qui sont des revitalisants et qui, à nouveau, sont conseillés dans les cas de perte de connaissance comme dans ceux d’apoplexie (Huchard et Fiessinger, Clinique thérapeutique du clinicien, Paris, A. Maloine, 1907, p. 92 ; Lemoine, Manuel de Thérapeutique clinique, op. cit., p. 468 ; Lemoine et Gérard, Formulaire consultations médicales et chirurgicales, Paris, Vigot, p. 560).
De la douleur à la nuque
Continuons encore et allons jusqu’au bout de la question, même si la chose ne sera abordée que plus loin par Adrien Abauzit. En réfutation à la version « graveleuse » qui nous paraît tout autant ridicule que sans intérêt, Adrien Abauzit oppose aussi quelques informations de l’article du Temps du 18 février 1899 auquel nous venons de faire allusion et dans lequel il est dit que Félix Faure avait ressenti « une vive douleur à la nuque » qui, selon Adrien Abauzit, « est normale si une piqure par une fille aiguille a été faite au niveau du bulbe rachidien » (p. 34), confirmation de la confidence du général Estienne – confidence faite en 1920 à un monsieur, qui avant de disparaître l’avait confié à son fils, qui l’avait confié à André Galabru –, confidence qu’il rapportait dans son précédent volume (p. 55-56). Normal sans doute pour une piqure mais normal aussi dans les cas d’hémorragie cérébrale, comme nous le dit le Traité de médecine clinique et thérapeutique, publié en 1897 sous le direction de Samuel Bernheim et Émile Laurent chez Maloine, qui parle d’une « tension douloureuse » au cou « qui descend de l’occiput le long des vertèbres » (tome 2, p. 412). Une observation qui va de soi, et tout particulièrement dans le cas de Faure puisque, victime d’une hémorragie bulbo-protubérantienne, était concernée la partie inférieure du tronc cérébral. Mais Adrien Abauzit a dû oublier qu’il n’est pas question que de douleurs à la nuque dans ce témoignage de Blondel publié dans Le Temps. En effet, si on va à la source, on s’apercevra que Blondel parle en effet de douleur à la nuque mais parle aussi, et plus généralement, de douleur à la tête : 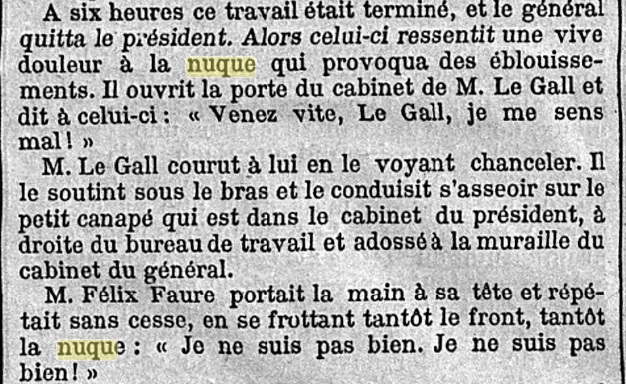
Et ces douleurs à la tête constituent justement un des symptômes de l’hémorragie cérébrale comme nous le confirment les traités de médecine de l’époque – que nous pratiquons maintenant avec ardeur : Georges Dieulafoy parle de « céphalée » (Manuel de pathologie interne, Paris, Labé, 1859, vol. 2, p. 258) ; Jean-André Rochoux, dans ses Recherches sur l’apoplexie, parle de « tournoiement de tête beaucoup plus fort », parfois de « sensation très pénible de déchirure, ou de quelque chose qui éclate dans la tête » (Paris, Méquignon-Marvis, 1814, p. 76).
Et puis se pose aussi la question du temps que nous pouvons retourner à Adrien Abauzit. Si en effet nous avons vu qu’une apoplexie foudroyante peu durer plusieurs heures, en est-il de même pour une injection de poison ? Peut-on croire que si Marguerite Steinheil avait réalisé sa petite opération criminelle un peu après 17h, Félix Faure aurait mis autant de temps à rendre le dernier soupir ? La chose serait étonnante si on en croit Louis Hugounen qui, dans son traité des poisons (hygiène industrielle-chimie légale), explique qu’ainsi administré l’action du poison est si « prompte qu’une intervention devient inutile » (p. 15).
Des autres symptômes
Et pour en revenir à l’article du Temps, Blondel parle aussi d’éblouissements, éblouissements que l’on retrouve invariablement chez les auteurs précédemment cités dans les cas d’hémorragie cérébrale… Et il parle aussi de jambes molles qu’on retrouve encore chez les mêmes auteurs et toujours au même propos… Et, pour finir, il ne faudrait pas oublier cette paralysie de la face et des membres, côté droit, puis côté gauche, dont parlent les témoignages et que signale le rapport des médecins appelés au chevet de Félix Faure, signes patents non d’un empoisonnement mais d’une apoplexie.
Alors ? Il n’y a donc aucun mystère, aucune dissimulation des autorités, aucun rapport truqué des médecins, aucun mensonge au Journal officiel et dire, comme le fait Adrien Abauzit que « les médecins qui ont tenté de sauver Félix Faure ont tous conclu qu’il avait été empoisonné, si l’on en juge aux thérapeutiques qu’ils ont appliqués [sic] » n’est pas recevable. De conclusion des médecins, il n’y en a qu’une et ne saurait y en avoir qu’une, celle de leur rapport que nous citions précédemment et qui semble bien être le bon diagnostic.
Autopsie et embaumement
Mais demeurent deux autres « preuves et indices » : l’absence d’autopsie et l’embaumement, signes selon Adrien Abauzit, comme il l’écrit dans son troisième volume, que « les autorités de l’époque ont cherché à dissimuler les causes de la mort » (p. 54). « [L]e caractère mystérieux de la mort de Félix Faure aurait dû donner lieu à une autopsie », permettant ainsi « d’être fixé sur l’empoisonnement ou non » (p. 53). Et ce d’autant plus, explique encore Adrien Abauzit après André Galabru, qu’on avait autopsié Sadi Carnot, assassiné par Sante Caserio, bien que les causes de la mort fussent évidentes. C’est vrai… mais cette autopsie de Sadi Carnot n’avait bien évidemment pas pour but de savoir si l’ancien président avait été assassiné, puisque cet assassinat fut public. Il avait pour but, comme le dit le rapport d’autopsie, de :
De décrire la blessure qui a été faite et les lésions qu’elle a produites ;
D’examiner le poignard dont Caserio déclare s’être servi et de dire si la forme de cet instrument correspond aux lésions constatées ;
De rechercher les causes de la mort et de dire si elle devait résulter nécessairement de la blessure ;
De dire, eu égard au siège de la blessure, à la forme de l’arme à la position du blessé, de quelle manière et dans quelles conditions le coup a été porté ;
De procéder & toutes les autres constatations utiles à la manifestation de la vérité. (Lacassagne, L’assassinat du président Carnot, Paris et Lyon, Storck et Masson, 1894, p. 64).
Alors pourquoi Félix Faure ne fut-il pas autopsié ? Pour éviter d’occasionner du chagrin supplémentaire à la famille ? Pour satisfaire à la demande de cette même famille, comme l’avait demandé celle de Sadi Carnot qui y avait dû finalement s’y résoudre, pour répondre aux questions qui se posaient, mais à la seule condition qu’elle fût partielle ? À en croire Marguerite Steinheil, dans une conversation qu’elle avait eue avec Blondel et qu’elle rapporte dans ses mémoires, telle était la raison. Mais la source Steinheil posant sérieusement problème, nous attendrons une autre source pour avoir confirmation. En fait, la raison en était d’une parfaite simplicité : il n’y eut pas d’autopsie parce que, contrairement à ce que soutient Adrien Abauzit, et comme nous l’avons développé précédemment, pour les médecins qui avaient accompagné le Président, il n’y avait rien de mystérieux dans ce décès. Comme l’expliquait un « médecin bien connu et neuropathologiste avisé » (« Grandes actualités. Les malades et les morts célèbres », Gazette médicale de Paris, 15 février 1898), à propos de la mort de Félix Faure : « Il n’est pas besoin d’autopsie pour dire, à quelques millimètres près, en quel point siège la lésion destructive » (Le Figaro, 18 février 1898).
Adrien Abauzit ajoute dans ce même troisième volume « que l’étrange ne s’arrête pas ici » : le corps de Félix Faure « est embaumé en toute hâte, en violation des prescriptions légales » dans la mesure où, citant André Galabru, il nous dit que « la législation […] fixe un délai minimum de 24 heures entre le décès présumé et le début des opérations d’embaumement » (p. 53). Cette affirmation appelle deux nécessaires petites précisions. Si le fait est vrai – un arrêté du 25 janvier 1841 le stipule pour Paris et un autre du 28 décembre 1866 l’étend à toute la France –, il n’est non seulement pas question de « décès présumé » mais de « déclaration de décès » (ce qui n’est pas pareil) mais encore ces arrêtés s’appliquent, non pas à l’embaumement seul, mais « à l’autopsie et aux opérations analogues », autrement dit : autopsie mais aussi moulage, momification et embaumement. La chose peut sembler pinailleuse mais elle est d’importance parce que si on se penche sur l’autopsie – soumise donc à la même réglementation que l’embaumement – de Sadi Carnot, puisqu’on en parlait, on constatera que le décès fut constaté le 25 avril 1894 à 00h38 et que l’autopsie fut pratiquée ce même 25 avril à 14h, soit 13h22 plus tard !… et donc bien avant le délai légal…
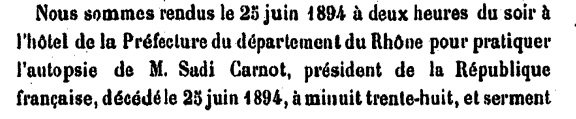
Lacassagne, op. cit., p. 65.
Et cela s’explique simplement, comme nous le dit Sandra Menenteau dans l’excellent L’autopsie judiciaire. Histoire d’une pratique ordinaire au XIXe siècle (Rennes, PUR, 2013, p. 231), parce que la législation ne fut jamais d’application stricte :
Il se dégage des procédures criminelles et correctionnelles que le délai de 24 heures n’est généralement pas observé. Plus de la moitié des autopsies médico-légales a lieu bien avant la fin du délai recommandé. Et la part atteint plus de 80% en y intégrant les examens pratiqués le lendemain de la découverte du décès. En effet, le changement de dates ne signifie pas pour autant que 24 heures se sont réellement écoulées ; il est tout à fait possible d’envisager qu’un individu décède en soirée et que son autopsie soit réalisée à la première heure le lendemain.
Autant de mystères qui n’en sont décidément pas.
La bonne santé de Félix Faure
Il nous reste encore un point à voir. Le dernier argument que développait Adrien Abauzit dans son précédent volume est qu’il est pour le moins curieux que soit mort subitement cet homme en bonne santé. Pour appuyer cela, Adrien Abauzit cite :
-
-
- un extrait d’un article du Figaro du 17 février 1899 qui dit qu’ « à le voir résister aux fatigues et tasser son entourage, on n’eût jamais pu croire que ce quinquagénaire, vigoureux et droit, était si près de la mort » ;
- une interview de son médecin Lannelongue dans L’Écho de Paris du lendemain, qui assurait que Faure n’avait jamais eu « aucun symptôme » d’un quelconque « malaise précurseur et indicateur d’une attaque prochaine » ;
- et enfin le témoignage du cardinal Richard, extrait du Figaro du 18, que « M. Félix Faure était mieux portant que jamais ».
- Et quant à l’artério-sclérose dont Félix Faure était « censé souffrir », nous dit encore Adrien Abauzit, « tout cela n’est qu’un grossier enfumage » (p. 52-53).
-
Ces sources sélectionnées par Adrien Abauzit existent bien mais sont largement contredites par d’autres qui rapportent ou attribuent, aux mêmes interviewés, des paroles exactement contraires. Si nous prenons le cardinal Richard – dont les paroles ne sont pas la réponse à une interview, contrairement à ce que dit Adrien Abauzit, mais des paroles rapportées par le vicaire général Thomas (ce qui n’est pas pareil) –, il est étonnant de voir le témoignage différent livré par Le Matin en 1908, propos recueillis de ce qu’il aurait ainsi confié à quelques amis et relations :
Je fus introduit à trois heures trente de l’après-midi, le 16 février 1899 – a raconté le cardinal Richard – dans le cabinet du président, et, malgré la grande courtoisie avec laquelle il m’accueillit, je fus frappé par l’état de surexcitation anormale dans lequel il se trouvait. Il semblait à la fois agité et souffrant. Il me demanda l’autorisation de rester debout et, tout en parlant, marcha de long en large, dans son cabinet. J’eus bientôt l’impression qu’il écoutait mal ce que Je disais, et je mis sur le compte de son état nerveux l’impatience à peine déguisée qu’il montrait. Lorsque l’audience fut levée, il m’accompagna avec rapidité jusqu’à quelques mètres de la porte, comme pour hâter ma sortie. Ce n’était point la première fois que j’approchais le chef de l’État, et je partis péniblement impressionné, par cette entrevue. (« L’affaire Félix Faure », Le Matin, 30 novembre 1908).
Qui faut-il croire ? Le vicaire général Thomas confiant au Figaro les paroles du Cardinal ou les amis consultés par Le Matin ? Adrien Abauzit, reprenant André Galabru, pourra nous dire que l’article du Matin avait été démenti par La Croix quelques jours plus tard en citant de larges extraits de la lettre pastorale du Cardinal Richard du 23 février 1899, qui, dit-il, « réduit à néant » « la fable de la fébrilité » (p. 126-127). « Réduit à néant » est un peu fort ; la lettre pastorale ne dit pas grand chose, à vrai dire, et si elle ne dit rien de cette fébrilité ne peut-on penser qu’une lettre pastorale n’était peut-être pas le lieu de le faire ? Nous ne saurons donc rien, rien d’autre que la presse est une source plus que problématique et qu’il faut éviter de prendre ce qu’elle dit pour argent comptant. Il en est de même de ces paroles de Lannelongue dans L’Écho de Paris du 18 février qu’Adrien Abauzit donne en argument. Des paroles qui furent imprimées comme furent imprimées ces autres paroles du même docteur, publiées le même jour dans Le Temps et dont ce qu’elles disent est tout différent :
Nous avons pu recueillir auprès du docteur Lannelongue quelques détails précis sur les causes véritables de la fin soudaine du président de la République. M. Félix Faure a succombé à une apoplexie, déterminée par la rupture d’un vaisseau sanguin dans le bulbe rachidien.
Cette mort subite, si elle a surpris universellement, n’a cependant pas étonné les médecins qui avaient pu approcher le président et qui avalent été appelés à lui donner leurs soins depuis son avènement à la première magistrature de l’État. M. Félix Faure était atteint de sclérose des artères, et c’est cet état pathologique qui a déterminé l’accident mortel d’hier.
Nous rappelons, pour le public non initié à la terminologie médicale, que la sclérose des artères ou l’artério-sclérose consiste dans une dégénérescence pathologique suivie d’induration morbide d’une des tuniques des artères ; celles-ci perdent alors progressivement leur élasticité en même temps qu’elles deviennent cassantes.
Il y a environ dix à onze mois que le docteur Lannelongue avait été appelé à soigner M. Félix Faure, qui était atteint d’une arthrite déformante du genou gauche, conséquence d’une chute remontant à une époque assez éloignée. C’est en le traitant pour cette affection qu’on reconnut chez le président l’existence de l’artério-sclérose.
À cette époque, il fut soumis à un traitement électrique qui dura environ deux mois. Mais on laissa ignorer ce fait au public, pour que l’on ne pût exagérer l’état du président. M. Félix Faure continua à se livrer assidûment à ses occupations et à ses promenades. Néanmoins, ceux qui purent l’approcher constatèrent qu’il était atteint d’une légère claudication du côté gauche, ce qui explique l’usage presque permanent qu’il faisait d’une canne. (« Félix Faure. Les causes de la mort »)
Des propos que l’on retrouve encore, autre interview, dans Le Figaro, toujours du 18 :
Quelques personnes cependant, M. Lannelongue entre autres, savaient que le chef de l’État était atteint de la maladie appelée artério-sclérose, c’est-à-dire d’un trouble, de nutrition des vaisseaux sanguins, qui leur ôte de leur souplesse, les rend friables, calcaires et cassants. Rien ne prédispose plus aux hémorragies cérébrales.
Il y a une dizaine d’années, M. Félix Faure fit une chute, et contusionna fortement son genou gauche. Il lui en était resté une déformation locale légère, bientôt compliquée de corps étrangers articulaires. Dans la cavité articulaire du genou, il avait de petites boules de substance calcifiée qui, de temps à autre, lui causaient une douleur vive, et l’obligeaient, pour quelques secondes, à suspendre sa marche.
L’an dernier, ces phénomènes douloureux prirent assez d’intensité pour qu’un examen minutieux fût pratiqué. Cet examen porta non seulement sur l’arthrite sèche du genou, mais encore sur la santé générale. On ausculta le cœur qu’on trouva un peu gros avec un léger bruit de tintement métallique à là base, (signe de sclérose de l’artère aorte), et quelques rares intermittences.[…]
C’est pour ces motifs que le professeur Lannelongue ne fut pas extrêmement surpris lorsque hier, a. 6 h. 50, au moment où il rentrait, en son hôtel de la rue François-Ier, on vint le chercher précipitamment. II savait que Ie Président avait un système artériel très fatigué. Même, au cours d’une conversation récente, il avait fait part de ses inquiétudes à M. Louis Barthou, l’ancien ministre de l’intérieur. (« Conversation avec le professeur Lannelongue »)
Qui faut-il croire ici ? Le Temps et Le Figaro ou L’Écho de Paris ? Adrien Abauzit, au sujet des articles qu’il n’a pas cru devoir retenir, ne nous dira peut-être pas que Le Figaro et Le Temps, qu’il considère comme des organes du « Syndicat », ne pouvaient bien évidemment que défendre cette thèse, utile à ses desseins. Il ne nous le dira pas parce que dans ce cas il n’aurait pas lui-même cité Le Figaro de la veille et très précisément l’article qu’il a sélectionné – et qui à vrai dire ne prouve pas grand chose ; celui qui dit qu’ « à […] voir [Félix Faure] résister aux fatigues et tasser son entourage, on n’eût jamais pu croire que ce quinquagénaire, vigoureux et droit, était si près de la mort » –, article d’ailleurs dû à la plume de Jules Cornély, important dreyfusard et considéré par toute la presse antidreyfusarde comme une des grandes figures du « Syndicat »… Adrien Abauzit n’aurait pas non plus cité les paroles du cardinal Richard dans l’article du Figaro du lendemain, le numéro même dont sont extraits les propos que nous citions au sujet de l’inutilité de l’autopsie ou ceux de Lannelongue au sujet de l’artério-sclerose. De même, Adrien Abauzit n’aurait pas repris la narration de Blondel au sujet de la douleur à la nuque, extraite du même Temps de ce même 18 février, précisément le numéro qui donne la narration que nous venons de lire, et qui montre bien que contrairement à ce qu’il soutient, l’artério-sclérose n’était pas « un grossier enfumage ». Car en effet, ces problèmes de santé, qu’évoque Lannelongue dans Le Temps et Le Figaro – et peut-être ainsi pourra s’opérer le tri –, furent une réalité comme nous le disent de nombreux autres témoignages. Dans la Gazette médicale de Paris, le docteur Marcel Baudouin écrira que
Tous ceux qui avaient vu de près l’ancien Président n’ont point été trop étonné de ce brusque dénouement. Cet homme, malgré sa vaillance et son désir inouï de rester toujours en scène, portait sur sa figure même les traces de l’usure prématurée, caractéristique de tous les grands travailleurs de notre époque, et de tous les grands manieurs d’affaires du monde. Rien qu’à le considérer, on devinait sous sa peau, à l’aspect un peu rude, des rameaux artériels sclérosés, prêts à se rompre, au moindre déclanchement de la pompe foulante centrale. (« Bulletin », n° 8, 25 février 1899).
Le Matin, en 1908, racontera que :
[…] dans les six mois qui précédèrent sa mort, les ministres s’aperçurent, non sans surprise, qu’il n’était plus aussi attentif aux délibérations du gouvernement, et l’on constata même à plusieurs reprises, les efforts, presque surhumains qu’il devait faire pour ne point s’endormir.
Son attitude à ce moment était celle d’un homme très souffrant, très malade même, et plus d’une fois les ministres, dont le témoignage ne peut être indifférent, quittèrent le palais présidentiel en exprimant les craintes que leur causait l’état de santé du président de la République. (« L’affaire Félix Faure. Faits inédits », 1er décembre 1908).
De cela, Charles-Dupuy, son ancien président du Conseil, en avait témoigné :
Dans les journées qui précédèrent la catastrophe du 16 février, je remarquai chez le président un malaise manifeste. Dans la matinée du dernier jour, il présida le conseil avec sa lucidité accoutumée, mais, nous donna à tous une impression de fatigue et de nervosité. Aussi, lorsque, à huit heures du soir, M. Blondel vint m’avertir que le chef de l’État était dans l’état le plus grave, fus-je, plus affligé qu’étonné. (« L’affaire Félix Faure », Le Matin, 29 novembre 1908)
Comme encore un autre de ses anciens ministres, Hanotaux :
Il y a donc un an, déjà, que Félix Faure est mort ; il y a un an que Paris s’est réveillé en apprenant sa fin soudaine. Ce fut une grande surprise pour tous : on le voyait si actif, si jeune, si allant ! Mais ceux qui l’avaient approché s’étonnèrent moins ; car ils le savaient malade, atteint au cœur. Il se tenait debout, frais et souriant, il portait beau ; mais parfois, la main, d’un mouvement rapide, montait vers la poitrine et contenait un spasme douloureux. (« Félix Faure », Le Journal, 17 février 1900).
Ou encore un autre de ses anciens ministres, le général Zurlinden :
Au commencement de 1899, il me sembla que la santé du président Félix Faure s’altérait. Un matin, il me fit appeler de bonne heure, à l’Élysée, et me reçut au 2e étage, dans une chambre des plus simples. Il était couché dans un lit en fer ; et après m’avoir parlé service, il me dit qu’il avait eu une syncope pendant la nuit, et une autre au matin. Sur le moment, je pensai que c’était une rechute de l’affection du cœur, dont il souffrait déjà, lors de son premier déplacement présidentiel au camp de Sathonay, et qui l’avait forcé alors à se faire accompagner par un médecin.
Puis, je m’aperçus qu’il avait rompu avec la régularité de ses habitudes, pour se promener à cheval au Bois. Autrefois, on était sûr de le rencontrer de sept heures à neuf heures du matin, trottant, galopant gaiement dans les allées cavalières. Maintenant, ses heures de sortie variaient tous les jours, et il allait beaucoup au pas. Le 15 février, je le croisai dans l’avenue de l’Hippodrome à 11 heures et demie. Il me fit signe de l’accompagner ; et, sur ma demande, il me dit que sa santé laissait à désirer, « qu’il s’était mal levé, avec les jambes molles… » puis il changea de conversation.
Le lendemain, il était mort. (Mes souvenirs depuis la guerre. 1871-1901, op. cit., p. 229-230).
Autant de témoignages que confirmait encore celui de Legrand-Giarde qui dit que Faure « avait fait une absence dans la journée » de son décès (p. 187), ou encore un autre, qui fut de ses grands amis, un intime même, Ernest Daudet, le frère aîné d’Alphonse, l’oncle de Léon, qu’on ne peut soupçonner de dreyfusisme. En 1901, il écrira dans Le Gaulois :
Atteint d’une artério-sclérose, maladie qui consiste, on le sait, en un durcissement des artères, très las depuis longtemps, cruellement éprouvé par les inquiétudes et les soucis du pouvoir, devenus si cuisants dans les derniers mois de sa vie, le Président était hors d’état de résister à une crise instantanée et violente, et son trépas quasi foudroyant ne s’explique que trop. (« Le vrai Félix Faure », 13 octobre 1901)
Et nous pourrions encore en ajouter (par exemple : Hugues Le Roux, « Félix Faure est-il mort empoisonné ? », Le Matin, 28 novembre 1908). Et Félix Faure se sentait donc tellement en bonne santé, aux derniers jours de sa vie, que la veille même de son décès, il avait griffonné une note portant l’adresse du « médecin à prévenir en cas de besoin ». Une note qu’on peut voir dans les fonds Félix Faure conservé aux AN.
Continuons, mais avant de voir les deux dernières « preuves et les indices de l’assassinat », il nous faut encore ouvrir encore une petite parenthèse.
Faure aurait-il gracié Dreyfus ?
Dans son précédent volume, Adrien Abauzit nous donnait une « ultime précision » :
Le successeur de Félix Faure à la tête de l’État est « Panama Ier », autrement dit, Émile Loubet. Le 19 septembre 1899, Dreyfus retrouve la liberté suite à un décret de grâce de ce même Panama Ier. Son défunt prédécesseur aurait-il accepté de prendre un tel acte ? Probablement pas.
Oui c’est vrai, le décret de grâce est signé de Loubet parce que nous sommes en République et qu’en République cette prérogative appartient au Président de la République. L’idée de la grâce avait été proposée par Waldeck-Rousseau qui lui même avait été convaincu de sa nécessité par le général de Galliffet. L’idée en était non pas de sauver Dreyfus mais d’arriver à sauver l’Exposition universelle par l’apaisement que l’immense majorité des Français souhaitait et surtout, dans son esprit – la grâce étant un prélude à l’amnistie – de protéger les militaires impliqués. Contrairement, à ce qu’écrivait Adrien Abauzit dans son premier volume, cette amnistie n’a pas été pensée pour permettre « aux dreyfusards d’échapper à la justice » (p. 291). L’amnistie éteignait toutes les actions et procès pendants pour les deux camps. Et il est intéressant, par parenthèse, de voir que les seuls qui protestèrent contre cette loi d’amnistie furent Dreyfus, Reinach, Picquart et Zola et que le général Mercier, par exemple, au-dessus de la tête de qui planait un procès en Haute Cour, ne se manifesta pas. Mais revenons à la grâce. Le 13 septembre, Galliffet avait écrit à Waldeck-Rousseau :
[…] le moment est venu de pacifier les esprits, de mettre fin à nos querelles, pour nous permettre de songer aux besoins du pays et de ne pas oublier que l’exposition universelle de 1900 doit ouvrir avec le nouveau siècle une ère de paix et de travail.
J’estime, et en cela, je crois être d’accord avec la plupart de mes camarades, que M. le Président de la République nous obtiendrait les résultats que je me permets de souhaiter, s’il se décidait à signer un décret de grâce en faveur du condamné Dreyfus.
J’estime en même temps que cette mesure de souveraine pitié ne serait pas comprise de tous, s’il n’était pas, en principe, résolu de mettre pour toujours hors de cause les officiers généraux ou autres qui ont été mêlés à cette malheureuse affaire. Il faut leur ouvrir les portes de l’oubli.
Loubet ne pouvait qu’y souscrire. Quant à savoir ce qu’aurait fait Félix Faure, évitons de faire de l’histoire-fiction ou de se perdre dans l’uchronie. Personne n’en sait rien, ni Adrien Abauzit, ni nous. Maintenant, après avoir lu les pages qui précèdent et ce que fut, tout au long de l’Affaire, l’attitude de Félix Faure qui ne semble pas avoir été aussi antirévisionniste que nous l’affirment Adrien Abauzit, et avant lui André Galabru, et avant lui encore les dreyfusards, quand on a vu quel souci il avait de la Loi, de la Constitution, et surtout de la bonne santé du pays, il ne nous semble pas évident d’affirmer qu’il ne se serait pas rallié, comme Loubet, à la proposition de Galliffet qui permettait en effet d’arriver à l’apaisement, de sauver l’Exposition et de permettre à quelques officiers compromis d’échapper aux ennuis qui les attendaient. Mais bien évidemment, la proposition devait être présentée, ainsi que Galliffet le disait dans la lettre précitée, comme une unique « mesure de souveraine pitié » qui se justifiait, à ses yeux, par les circonstances atténuantes du verdict et par la demande immédiate formulée par le conseil de guerre que fût adoucie la sentence (recours en grâce pour épargner à Dreyfus une nouvelle dégradation).
Fermons la parenthèse et voyons maintenant les deux dernières « preuves » d’Adrien Abauzit, puisque nous avons pris le parti de tout discuter et cela même si, après avoir lu les pages qui précèdent, la chose nous semble d’un médiocre intérêt.
Mermeix et l’article de Pressensé
Nous ne perdrons pas de temps avec Saint-Simonin, dû au trop célèbre Mermeix, dont l’explication est qualifiée par Adrien Abauzit d’absurde et qui est en effet peu convaincante en tous cas sur le point qu’il donne des raisons à l’origine de l’hémorragie cérébrale dont est mort Félix Faure. Inutile, peu convaincante et en aucune manière une preuve de quoi que ce soit. Passons donc à Pressensé qui est vraiment plus intéressant. Selon Adrien Abauzit (information qu’on trouve déjà dans La Libre Parole, dans le Fleury et dans le Monniot), la fin d’un article de Pressensé serait un indice probant, si ce n’est une preuve de l’assassinat de Félix Faure. Mieux même, comme il l’écrit dans son précédent volume, il serait une « presque revendi[cation du] crime » (p. 63). Pour mémoire, Pressensé, importante figure dreyfusarde, s’adressant à Charles-Dupuy, président du Conseil, écrivait dans Le Journal du peuple, le 3 mars 1899, soit une quinzaine de jours après la mort de Félix Faure :
Qui sait si, à l’heure même où vous tenez les cartes biseautées dont vous avez préparé la partie, ce même destin qui a couché Félix Faure sur un lit de mort à la veille de décisions peut-être criminelles et sûrement irréparables, ne vous réserve pas quelque tragique surprise après laquelle il ne vous restera plus qu’à passer la main à un joueur plus heureux ou plus honnête.
Il ne nous paraît pas simple de lire dans ce texte ce que, dans son précédent volume, y lit Adrien Abauzit, à savoir que Pressensé y « fait des allusions à peine voilées à l’élimination du Président » ? Il y parle indiscutablement de la mort de Faure mais où Adrien Abauzit y voit-il qu’il y est question de son « élimination » ? Dans le mot « destin » ? Dans « tragique surprise » ? Peut-on raisonnablement imaginer que Pressensé aurait ainsi avoué, tranquillement, dans un journal tiré à 60 000 exemplaires, le meurtre d’un président de la République commis par ses amis ? Et si Adrien Abauzit avait voulu lire l’intégralité du texte, il y aurait vu ce qu’écrit Pressensé deux colonnes avant, parlant de cette mort aux « circonstances si obscures qu’elles ont suggéré aux ingénieux historiens de la Libre Parole l’hypothèse d’un assassinat dreyfusard ». Pressensé aurait donc avoué le crime de ses amis tout en se moquant quelques lignes plus tôt de la thèse et de ses propagateurs ? Car les dreyfusards s’en moquèrent largement de cette cette petite théorie complotiste et c’est sans doute aussi ce que faisait ici Pressensé. Deux jours plus tôt, d’ailleurs, dans le même Journal du Peuple, Émile Janvion pouvait ainsi s’amuser de « la théorie chère à Saint-Auban (Lux) et aux autres nationalistes dépités, qui pour corser le mélo, maitre-chantent l’empoisonnement dans le journal du maitre-chanteur Drumont […] » (« La vérité sur la mort de Félix Faure ») ? Comme le notait alors le tout a fait antidreyfusard et absolument antisémite Père Bailly :
Les défenseurs de Dreyfus, avec un ensemble curieux, plaisantent jaune, de ceux qui croient aux assassinats politiques. Ah ! Ah ? Ah ! s’écrient-ils, a-t-on jamais rien vu de si drôle !
C’est très drôle, en effet, que ces menaces écrites au lendemain d’une mort compliquée ; c’est très drôle de voir un des principaux témoins très officiel, succomber si vite à l’hôtel.
Tant de morts subites tirées du grand sac du hasard constituent quelque chose de fort drôle à ceux qui en profitent ; mais elles-font peur.
Et l’un d’eux, dans ses éclats de rire de ce matin, déclare qu’il s’amuse fort de voir que cela donne la colique aux patriotes, pour lesquelles ces coliques paraissent le lot privilégié. (« Coups de tonnerre », 9 mars 1899).
Une nouvelle et dernière preuve qui ne semble guère plus convaincante que les autres.
Mais il est temps de conclure ce passage. Il semble clair, à la lecture de ce que nous venons de développer ici qu’il n’est pour le moins pas évident de soutenir, comme le fait Adrien Abauzit, que « l’empoisonnement ne fait aucun doute » (p. 55) ou, « sereinement », « qu’il est hors de doute de Félix Faure a été assassiné » (p. 63). Félix Faure, qui ne fit jamais rien pour empêcher la révision du procès Dreyfus quand il l’aurait pu, était malade, souffrait d’artério-sclérose, allait mal et de plus en plus mal depuis quelques temps et décéda d’une l’apoplexie foudroyante, en présentant tous les symptômes d’une hémorragie cérébrale qui en est la cause (jambes molles, éblouissements, douleurs à la tête, hémiplégie), explication du choix que firent les médecins des soins qu’ils pratiquèrent parce qu’ils s’imposaient dans ce cas précis : sangsues, vésicatoires, saignées, injections de sérum, d’éther et de caféine et, après que Félix Faure était tombé dans le coma, tractions de la langue pour tenter de le faire revenir à la vie. Il ne fut pas autopsié parce que, les raisons de la mort étant claires, il n’y avait aucune raison de le faire et fut embaumé, rapidement comme on le faisait le plus souvent à l’époque et ce malgré la législation, peut-être pour ralentir une décomposition rapide que l’embaumement n’empêcha d’ailleurs pas. Il n’ y eut ici aucun mystère. Et si par extraordinaire, en dépit de tous les arguments ici développés, il fallait s’obstiner dans cette thèse de l’empoisonnement, il y aurait une piste à creuser qui serait celle de savoir quel poison aurait bien pu être utilisé et observer quels en sont les symptômes… L’Action française parla quelques années plus tard de cantharidine, poison efficace, auquel André Galabru préfère, comme il le dit dans son second volume, le cyanure de potassium (p. 74-75). Si on pouvait encore croire, après tout ce qu’on vient de lire, à l’empoisonnement criminel de Félix Faure, il faudrait trouver un autre poison que ces deux-là parce que ce que disent les traités de toxicologie en matière de symptômes à leur sujet est bien loin de ce que nous connaissons des dernières heures du président comme le sont les soins, malgré ce que peuvent affirmer avec assurance Adrien Abauzit et André Galabru, qui furent apportés au Président mourant.
• Chapitre II. Diversion sur la cellule dreyfusarde et des difficultés de la SIHAD à lire un télégramme et une interview, p. 28-33.
Cette parenthèse fermée, reprenons le volume d’Adrien Abauzit et voyons la dernière question de ce chapitre II, celle au sujet de la prétendue cellule dreyfusarde de l’Élysée et de cet audacieux titre selon lequel nous aurions du mal à lire une interview et un télégramme dont il nous a donné dans son précédent volume une lecture qui montre une créativité peu commune. Mais n’en faisons pas reproche à Adrien Abauzit qui n’a fait ici que reprendre le document et la démonstration qu’en donnait dans son premier volume (p. 213-214) André Galabru, document « accablant », p. 212), Redonnons le contexte : une cellule dreyfusarde était présente à l’Élysée et un télégramme le prouve. Dans notre dernier post, nous avons montré ce qu’il en était. Dans ce nouveau volume, Adrien Abauzit répond et, en conclusion à ces quelques pages, « précise au lecteur que la SIHAD a consacré près de la moitié de sa critique à la seule question du télégramme. C’est dire à quel point elle n’a rien trouvé à répondre sur l’essentiel du livre, alors qu’elle sait être bavarde » (p. 33). Si Adrien Abauzit exagère quelque peu (la partie sur le télégramme représente précisément 29,59%, en signes, de la totalité du post ; peu sur de son calcul, il parle ailleurs (p. 23) de « plus d’un tiers »… plus juste mais toujours excessif), il est vrai que, contrairement à ce que nous faisons ici, nous n’avions pas répondu à tout parce que, comme ici, chaque ligne aurait mérité une longue explication et que notre temps libre n’est pas extensible à l’infini. Et si nous avons passé du temps sur ce télégramme, c’est non seulement parce que le sujet en est amusant, encore parce qu’on y retrouvait que Zola, ce qui n’est pas une mince affaire, se serait fait payer grassement par l’étranger pour écrire son « J’Accuse…! » mais surtout parce que tout ce passage du troisième livre d’Adrien Abauzit contient en lui-même et en un très pédagogique exemple, toute sa méthode et rien que sa méthode. Redonnons, pour une parfaite compréhension, le document tel qu’il nous le donne :
Présidence de la
République Française
Service télégraphique
n° 162/996/45240
Expédié le 18
à 2 h 25 minutesLondres le 18 Xbre 1897
11 h 30 du matinShan, hôtel Burton
rue Duphot, Paris.Voyez Zola immédiatement. Dites-lui éditeur World assure payement de la somme qu’il demanderait, quelle qu’elle soit, s’il veut aller à la Guyane et s’assurer par lui-même de la situation du capitaine.
World croit publicité seule peut amener mise en liberté et que Zola est le seul homme pouvant accomplir ce fait.
World paiera les dépenses d’une publicité qui sera universelle : succès presque certain.
Accusez réception par télégramme de ce message. Faites connaître au plus tôt également la réponse de Zola à TUOHY, Warwick gardens.Sphère
Pour Adrien Abauzit, qui pose les questions « qui n’intéressent pas les historiens dreyfusards et le beau monde des certitudes officielles », tout est clair :
-
-
- le télégramme est écrit par Sphère : « nom de guerre » ;
- il est adressé à Shan : « nom de guerre » ;
- il parle de Tuohy : « nom de guerre ».
- « Expédié le 18 [décembre 1897] à 2h25 minutes », il a été envoyé de nuit, à l’abri des regards ;
- Portant l’en-tête de l’Élysée, il a été envoyé de la Présidence.
- Y étant question de Zola, y apparaissant le mot « publicité », et le 18 décembre 1897 étant à un peu moins d’un mois du 13 janvier 1898, il concerne donc la publication du « J’Accuse…! »…
-
Il est clair qu’une offre financière est faite à Zola par un agent dreyfusard, probablement pour qu’il publie son futur torchon, J’Accuse. Le payeur serait un éditeur anglais, « World ». Il y avait donc une taupe dreyfusarde à l’Élysée et Félix Faure avait raison de se sentir épié. (p. 58)
Et Adrien Abauzit, dans son précédent volume, ne proposait pas cette lecture, il la donnait comme étant la vérité, une vérité que les historiens dreyfusards que nous sommes ont tout intérêt à ensevelir. Dans notre réponse, nous expliquions à Adrien Abauzit qu’il affirmait un peu rapidement et qu’il aurait dû chercher un peu : déjà, nous l’informions que ce document n’avait pas été passé sous silence par « les historiens dreyfusards et le beau monde des certitudes officielles » (troisième volume, p. 58) puisque deux d’entre nous en avaient parlé en 1998 et 2014. Ensuite, nous lui expliquions aussi que
-
-
- le World n’était pas anglais mais américain.
- qu’il n’était pas question d’un Shan dans le télégramme mais d’un Shaw.
- que ce Shaw n’était pas un « nom de guerre » et qu’il se prénommait Stanley.
- Que Tuohy n’était pas non plus un « nom de guerre », que lui aussi avait un prénom et même un visage dont nous montrions à Adrien Abauzit une photographie.
- Que tous deux, Shaw et Tuohy, travaillaient pour le World, tous deux et sans doute aussi le troisième, ce Sphere (qui ne porte pas d’accent sur le « e ») au sujet duquel nous n’avons rien retrouvé (ce qui est assez logique puisqu’il devait être un administratif du journal et que les archives du World, seule piste possible, ont semble-t-il disparu).
- Que personne à l’époque n’utilisait le système horaire sur 24 heures et que 2h25 pouvait aussi bien concerner le matin (2h25 du matin) que l’après-midi (2h25 du soir) et que de toute façon la question ne se posait pas puisque nous avions la réponse dans le document lui-même dans la mesure où y figurait en toutes lettres la précision qu’André Galabru avait dû oublier en recopiant le télégramme (dont il donnait la cote – cote fausse !) : 2h 25 minutes du s[oir], soit 14h25, comme on dit aujourd’hui.
-
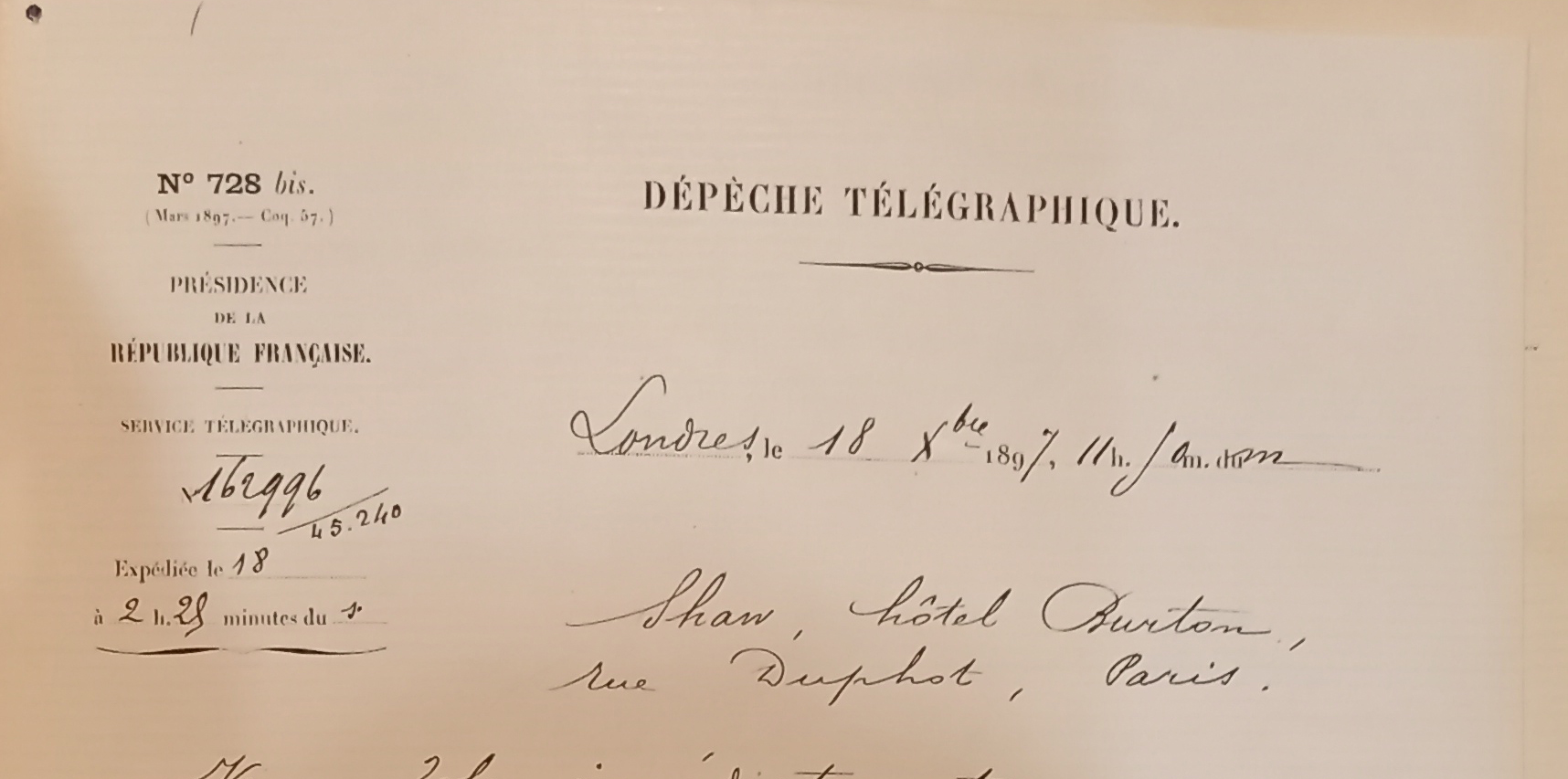
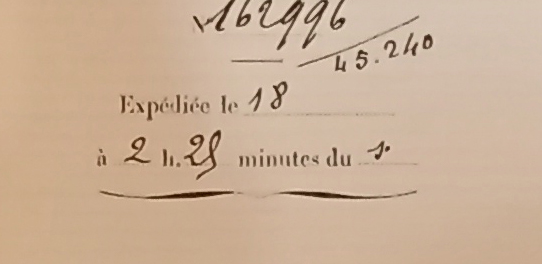
Et une question qui se posait d’autant moins que, comme on le verra à la suite, le « 2 h 25 » était l’heure de réception et non celle d’expédition qui était 11h50 du m[atin] (le 11h30 donné par Adrien Abauzit après André Galabru étant tout aussi faux, comme on le voit sur le document qui suit).
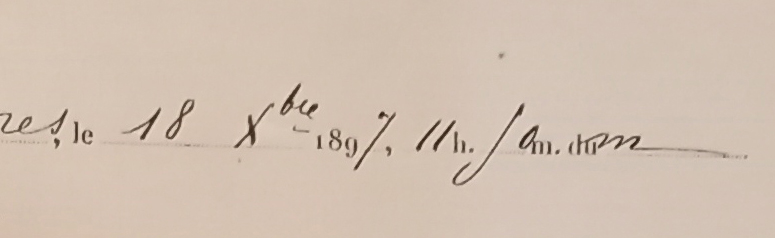
Récapitulons. Dans la transcription de ce document, qu’André Galabu présentait comme « scrupuleusement recopié[e] en en respectant l’ordonnancement et la calligraphie [sic !] » (p. 212), :
1° le nom de Shan est faux ;
2° Sphere est mal orthographié
3° L’heure de réception donnée est incomplète
4° L’heure d’expédition est fausse.
5° la cote du document est fausse.
Mais l’important n’est pas là, même si la chose inquiète et inquiète encore plus le fait qu’autant d’erreurs ne posent aucun problème à Adrien Abauzit qui fait comme si elles n’existaient pas et peut même, sereinement, parler de nos difficultés à lire un télégramme. Ainsi restitué, ainsi expliqué, tout s’écroule : plus donc de taupe qui travaille la nuit, plus de « noms de guerre » mais des identités (en partie) parfaitement vérifiables qui rendaient pour le moins fragile la thèse défendue. Mais nous donnions aussi d’autres explications à Adrien Abauzit : que ce document n’avait pas été adressé de l’Élysée mais à l’Élysée, et qu’à la présidence le papier à entête était utilisé pour les documents entrant pour transmission au Président, papier sur lequel était remplie la partie imprimée servant à marquer l’expédition (« expédié le ………. / à …. h. …… minutes du …. ») qui permettait ainsi de noter l’heure de réception. Un télégramme qui avait été envoyé à l’Élysée mais aussi, et dans le le même temps, après interception par les Postes & Télégraphes, à l’Int[érieur], à la Sûr[eté], à l’Élysée, au P[résident]t [du] C[onseil] et aux Affaires [étrangères]. C’est ce que montre la colonne de gauche de la pelure des Postes et Télégraphes que nous donnions dans notre précédent post et dont nous reproduisons le détail ici.
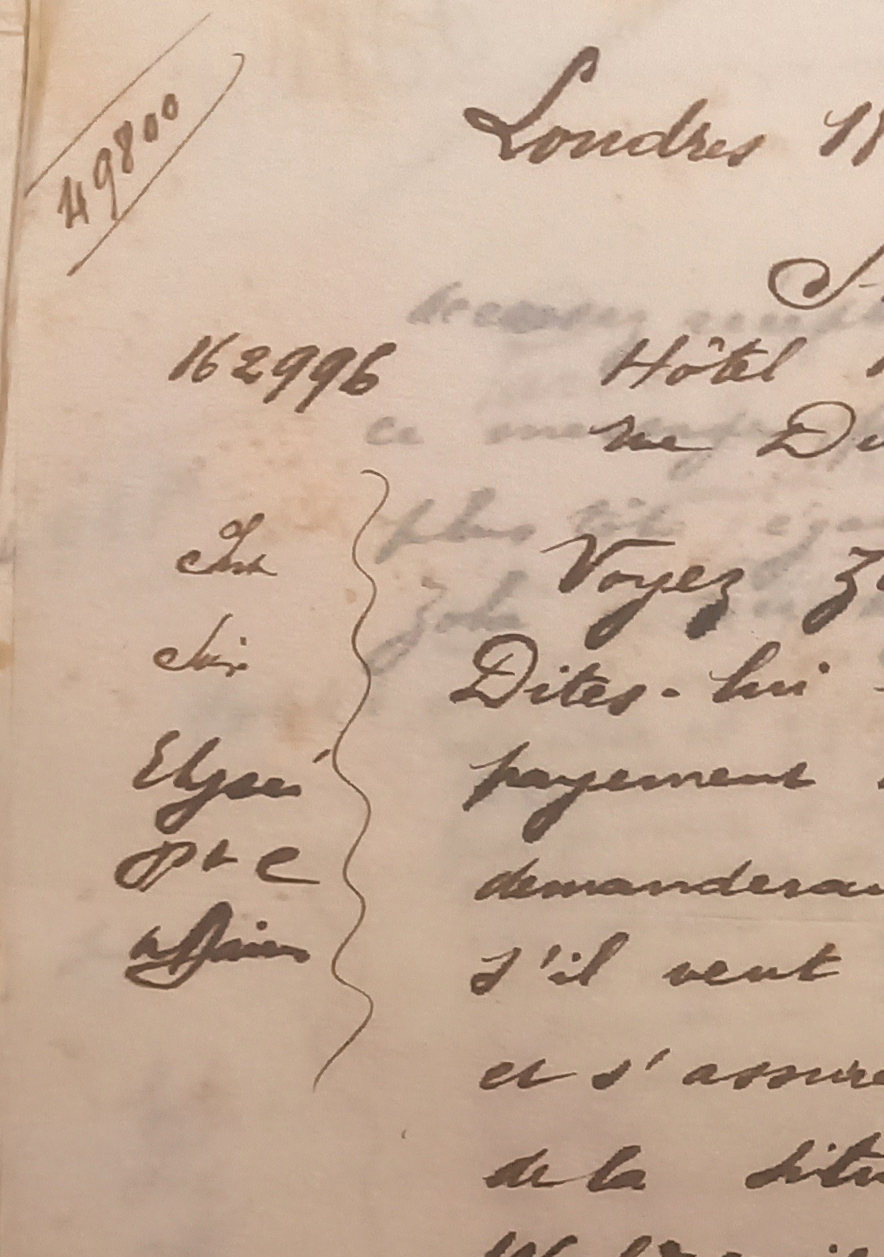
Ce n’est que cela que nous voulions montrer : que ce n’est peut-être pas nous qui prenons « de grandes libertés avec les pièces du dossier » et comment sont écartées les questions qu’il faudrait se poser comme celle relative au fait que le télégramme porte deux lieux (la Présidence et Londres) et deux dates (18 décembre 2h25 et 18 décembre 11h50 ; la question des dates a été d’ailleurs simplement réglée par Adrien Abauzit qui a laissé de côté le 11h30 [sic] pour ne se souvenir que du 2h25). Cette démonstration, qui s’intéresse moins au télégramme et à ce qu’il dit qu’à la méthode suivie pour le faire parler, Adrien Abauzit la considère comme constituant des « précisions intéressantes ». Nos explications « sont une hypothèse plausible, qui impliquerait que le télégramme n’ait pas été envoyé par une taupe dreyfusarde depuis l’Élysée », et Adrien Abauzit se dit « prêt à accepter ces éclaircissements », mais ajoute qu’il « est impossible de la tenir comme conclusion définitive tant que les trois mystères qu[‘il a] évoqués ne sont pas résolus » (p. 33) . Ces trois mystères évoqués, on les trouve p. 29 :
– Quelle est l’identité de Sphère [sic] ?
– Quelle nécessité pousse Sphère [sic] à cacher son identité ?
– Si Sphère [sic] est un membre du journal World à Londres, alors pourquoi s’adresse-t-il en Français [sic] à Stanley Shaw ? Et pourquoi, dans un télégramme en réponse, envoyé à Londres, Shaw écrit-il à son tour en Français [sic] ? Le personnel du journal World, à Londres, étant bien entendu composé d’anglophones.
De ces trois mystères, « deux n’ont pas même été envisagé par la SIHAD », précise Adrien Abauzit. Non c’est vrai… et si nous ne l’avons pas fait c’est que jamais nous n’aurions pu y penser. Nous avons parlé de Sphere (qui s’écrit définitivement sans accent), plus que probable administratif du World, pour lequel nous n’avons rien retrouvé et au sujet duquel nous ne retrouverons jamais rien à moins que ne surgissent tout à coup les archives du journal. Mais pourquoi devrait-on chercher son identité puisque nous la connaissons ? L’identité de Sphere est Sphere… Bien sûr, nous n’en avons aucune certitude. Mais pourquoi Sphere devrait-il être un « nom de guerre » et pas un patronyme ou un prénom (peu commun mais attesté dans les deux cas aux États-Unis et au Royaume-Uni depuis le XVIIIe siècle par les bases généalogiques), voire un surnom ou un pseudonyme ? Et admettons qu’il soit un « nom de guerre ». Pourquoi en utiliser un quand les véritables patronymes des autres sont donnés ? Quelle curieuse idée que celle de se dissimuler tout en révélant les autres ? Ah ! c’est vrai, parce que le télégramme est en français et qu’il devrait être en anglais ! Mais enfin… Il est évident que ce télégramme, exhumé par André Galabru et repris par Adrien Abauzit, recopie d’une recopie (celle de la pelure des Postes & Télégraphes envoyée à la Sûreté, à l’Intérieur, à la Présidence, aux Affaire étrangères et à la Présidence du Conseil), n’est pas dans la langue originale mais qu’il en est une traduction faite par les Postes & Télégraphes ; traduction parce que nous en sommes en France et qu’on y parle français et traduction parce qu’elle est destinée à un public qui n’était pas nécessairement anglophone, dans cette France ou l’anglais n’était alors qu’une langue facultative au programme du secondaire, de plus rarement enseignée dans les faits (voir les mémoires de Sarcey), et que personne ou presque ne pratiquait même quand il l’avait appris en classe… Ainsi, le Journal des économistes du 28 juillet 1883 déplorait qu’en France, les seuls bacheliers capables de parler anglais étaient des anglais de naissance ! Et qu’on aille voir les autres documents de la même source : qu’on télégraphie de Londres, Berlin, Rome ou Saint Pétersbourg, les textes transmis sont toujours traduits.
Mais là ne s’arrête pas la réfutation d’Adrien Abauzit. Page 33, toujours, il écrit :
[…] les développements de la SIHAD sur le contenu de ce télégramme sont une pure spéculation complètement détachée du texte en question. C’est arbitrairement qu’elle rattache le télégramme à une proposition faite à Zola d’interviewer Dreyfus.
Pour fonder cela, Adrien Abauzit nous explique que nous « donn[ons] à son contenu un sens qu’il n’a manifestement pas » (p. 29), que nous « projet[ons] un postulat qui [nous] arrange, fruit de [notre] seule imagination, sur le réel » (p. 32), et cela parce que le télégramme ne parle aucunement d’une interview mais ne parle que du fait de « s’assurer lui-même [Zola] de la situation du capitaine ». C’est indéniable, il y a bien écrit, textuellement, sur ce télégramme : « s’assurer lui-même [Zola] de la situation du capitaine » – et en n’oubliant pas que cet texte n’est jamais qu’une traduction dont nous manque le texte original. Mais sur cette base, posons-nous une simple question : si le World désirait envoyer Zola à l’île du Diable pour « s’assurer lui-même de la situation du capitaine », ou, comme le dit Shaw dans la lettre à Zola que nous avons publiée dans notre post précédent, « de [l’]envoyer [Zola] de la part du “World” à l’île du Diable », quel en était l’objectif ? Que signifie « s’assurer lui-même de la situation du capitaine » ? « S’assurer » signifie : se rendre certain par le moyen d’une vérification et « situation » : position, condition d’une personne. Comment vérifier la condition (conditions de vie, d’emprisonnement), la situation du capitaine si ce n’est en le voyant, en le rencontrant ? Et le voir pourquoi faire ? si ce n’est pour en témoigner – sinon pourquoi y aller ? Mais Adrien Abauzit nous le dit : aucune question d’ « entretien » dans le texte du télégramme mais une mention claire : celle de « publicité » (p. 30-31). Et publicité dit « coup de communication » (p. 32) et « coup de communication » dit « J’Accuse…! » Publicité à l’époque, ou très certainement publicity, puisque ce texte est une traduction de l’anglais, signifie « état d’être public », « notoriété » – « mise en lumière » même, comme on le verra bientôt. C’est ce que nous dit, par exemple, le Nouveau dictionnaire anglais-français et français-anglais de E.-C. Clifton (Paris, Garnier frères, 1905, p. 764) :
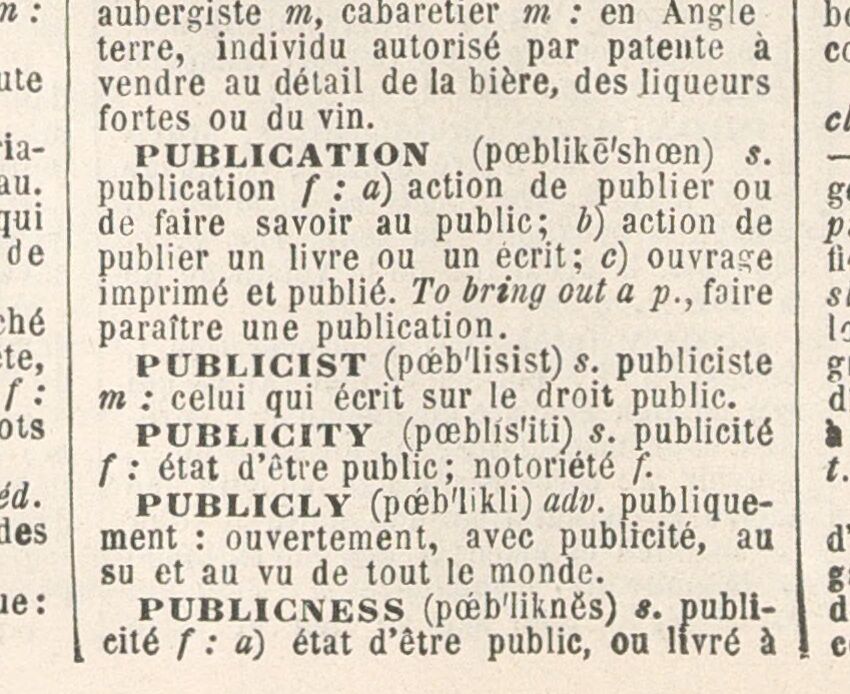
État d’être public… « World croit publicité seule peut amener mise en liberté et que Zola est le seul homme pouvant accomplir ce fait », dit la traduction française du télégramme… autrement dit que seul le fait de rendre publique la situation de Dreyfus peut amener une mise en liberté (quelle naïveté, au passage), que Zola est le seul à pouvoir le faire et que, pour cela, le journal paiera les dépenses nécessaires pour assurer un écho mondial à cette révélation. Zola serait donc envoyé à l’île du Diable pour s’assurer de la situation du capitaine, en témoignerait dans le World et le World donnerait à ce témoignage toute la visibilité nécessaire. Il s’agit bien ici d’un « coup de communication », même si le mot est ici un tantinet anachronique. Et s’il y a bien un coup de communication, c’est celui, publié à grand bruit, d’un article de Zola sur Dreyfus écrit de l’île du Diable ! Mais Adrien Abauzit nous le dit : « “Publicité“, aux dernières nouvelles n’est ni un signifié, ni un signifiant, du mot “interview“ » (p. 30). Il n’est pas question d’interview dans le télégramme mais juste de « s’assurer lui-même [Zola] de la situation du capitaine » et nous faisons « dire à un document ce qu’il ne dit nullement »… Soit ! Mais il faudrait alors qu’Adrien Abauzit nous explique en quoi il est évident que « s’assurer lui-même de la situation du capitaine » caractérise l’écriture et la publication du « J’Accuse…! » qui parle de tout à fait autre chose ? Quel rapport peut-il bien exister entre un voyage en Guyane et le « J’Accuse…! » ? Adrien Abauzit ne peut pas affirmer cela en nous disant que la chose est « clair[e] » et écrire que nous « donn[ons] à son contenu [du télégramme] un sens qu’il n’a manifestement pas » (p. 29) ou que « la SIHAD voit « en toutes lettres ce qu’aucune phrase, aucun segment du télégramme, ne dit ni de près ni de loin. »
Poursuivons… et allons regarder le fameux article du 16 janvier 1898 du World, précédemment évoqué et dont Eric Cahm donnait en 1998 le texte dans un Bulletin de la SihaD. Quel en est le titre ? « France refuses to allow Zola to see Dreyfus for the World », autrement dit : La France refuse à Zola de voir Dreyfus pour Le World…. Adrien Abauzit est catégorique : « “voir Dreyfus“ ne signifie pas réaliser un entretien destiné à être publié dans un journal »… Voir peut-être pas (et encore), mais « see » oui, indiscutablement. Il signifie « voir » mais il signifie aussi « avoir des rapports avec », « rendre visite », « converser ».
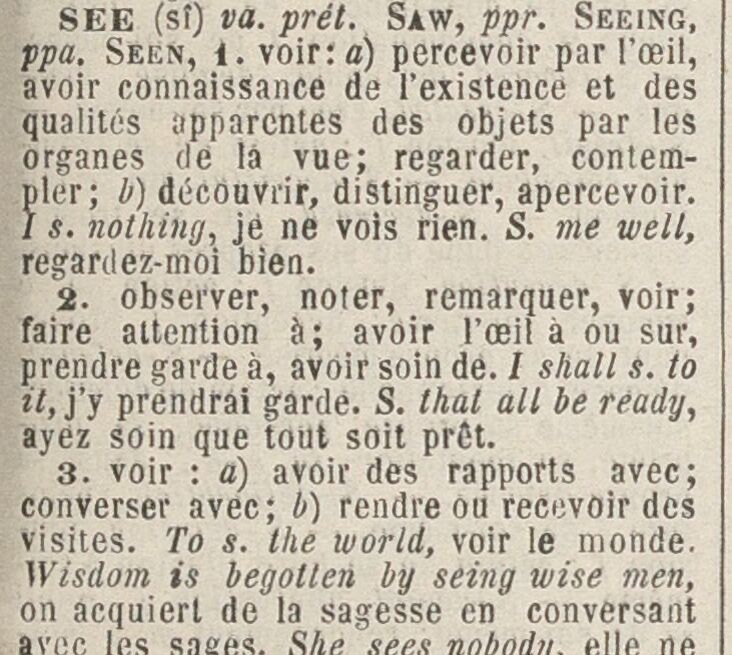
Nouveau dictionnaire anglais-français et français-anglais de E.-C. Clifton (Paris, Garnier frères, 1905, p. 855)
Et c’est au final comme en français : quand on dit à quelqu’un qu’on passera le voir, c’est rarement dans l’unique but d’aller le contempler ; c’est plutôt pour lui rendre visite, pour avoir des rapports avec lui, pour converser… Et nous revenons à ce que nous disions tout à l’heure. Le voir pour Le World pourquoi ? Lui rendre visite pour Le World pourquoi si ce n’est pour avoir des rapports avec lui, pour converser avec lui et donc pour recueillir son témoignage ? Et pourquoi recueillir son témoignage sinon pour le publier ?… autrement dit pour l’interviewer et publier cette interview… Lisons l’article :
Le World a alors demandé au gouvernement français d’envoyer un journaliste [interviewer] Dreyfus sur l’île du Diable, en Guyane française, pour obtenir sa propre histoire. Le gouvernement, craignant la publicité, a refusé. M. Zola fut alors invité à se rendre en Guyane comme envoyé spécial du World.
Il est évident que cet article se reporte au télégramme. Seulement, dit Adrien Abauzit, le mot « interviewer » est entre crochets : « Il semblerait que le mot “interviewer” ne soit pas dans le texte original et qu’il soit inséré entre crochets par la SIHAD » (p. 32). Pourquoi le mot est-il entre crochets dans la transcription que nous donnions dans notre précédent post ? Il l’est parce que dans son article de 1998, Eric Cahm, qui pour la première fois donnait ce texte (« L’affaire Dreyfus dans la « presse jaune » américaine en janvier 1898 : deux interviews, avec Zola et Lucie Dreyfus », Bulletin de la SihaD, n° 4, hiver 1997-1998, p. 25-26), et que nous reprenions, l’avait ainsi transcrit, suivi du mot « illisible ». Comme nous ne voulons rien laisser sous le boisseau, nous avons donc fait ce que nous n’avions pas fait pour notre précédent post, à savoir aller rechercher le texte original. Il ne fut pas simple à trouver et nous l’avons fait venir d’une bibliothèque américaine :
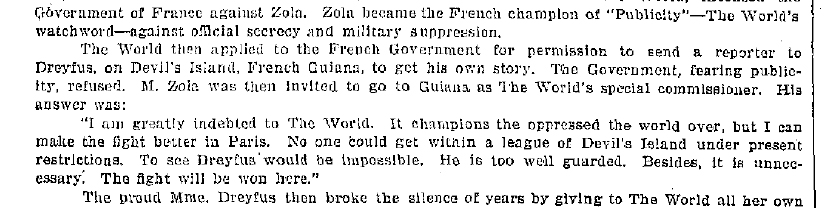
Adrien Abauzit va pouvoir se réjouir : Eric Cahm, qui nous a quittés en 2002, s’est trompé et le mot « interviewer » ne se trouve en effet pas dans l’article ! Cela nous confirme, s’il en était nécessaire, qu’il faut toujours retourner à la source, et ne pas se contenter de citer un auteur même quand on a pleine confiance en lui. Nous savons que dans la « réponse » qu’il fera à ce long post, Adrien Abauzit, ce qui lui permettra d’oublier et de faire oublier le reste de la démonstration, sautera sur cette erreur, parlera de la rigueur prise en faute d’Eric Cahm et au-delà de lui de la SihaD (notre responsabilité ne pouvant qu’être collective). Pourtant si Adrien Abauzit est honnête, il ne le fera pas, parce qu’il comprendra que le mot injustement restitué entre crochets est ici implicite :
The World then applied to French Government for permission to send a reporter to Dreyfus, on Devil’s Island, French Guiana, to get his own strory.
[Le World a alors demandé au gouvernement français la permission d’envoyer un reporter auprès de Dreyfus sur l’île du Diable, en Guyane française, pour obtenir/recueillir sa propre histoire/son propre récit.]
Envoyer un journaliste à Dreyfus pour obtenir/recueillir sa propre histoire/son propre récit (l’histoire, le récit qui lui appartient et n’appartient qu’à lui) ne peut que signifier l’entendre de sa bouche et l’entendre de sa bouche veut dire « interviewer ». Et Zola nous le confirme quand il répond :
No one could get within a league of Devil’s Island under present restrictions. To see Dreyfus would be impossible. He is too well guarded.
[Personne ne pourrait s’approcher à moins d’une lieue de l’Île du Diable avec les restrictions actuelles. Voir Dreyfus serait impossible. Il est trop bien gardé.]
« Voir Dreyfus serait impossible »… « Voir » dans le sens de lui rendre visite, d’avoir des rapports avec lui, de converser avec lui. Et c’est parce qu’il était trop bien gardé que cela était impossible. C’est ce que nous dit plus clairement encore, dans une autre traduction, un article de La Libre Parole du 5 février 1898 qui reprend l’article en question [et on notera, à propos du mot « publicité » et de ce que nous disions précédemment, la traduction de « fearing publicity » par « craignant la lumière » !] :
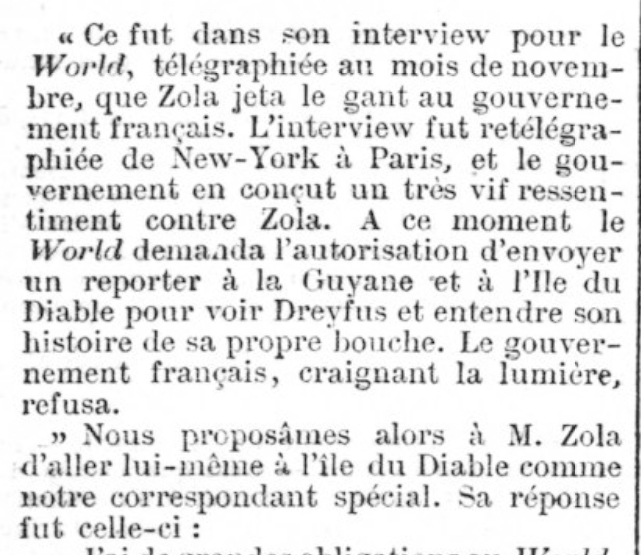
Le mot ne s’y trouve pas nous dira encore Adrien Abauzit… pourtant il est indiscutable qu’ : « […] envoyer un reporter […] pour voir Dreyfus et entendre son histoire de sa propre bouche » est une autre parfaite, et plus parfaite encore, périphrase d’interviewer !
Mais nous connaissons l’autre parade, étonnante ; elle est dans le dernier volume d’Adrien Abauzit : « En tout état de cause, il s’agit encore d’envoyer un journaliste et non Zola » et, dans l’article, « il n’est nullement précisé que c’est en vue de réaliser un entretien en vue d’une publication » (p. 32). Pourtant le lien entre les deux paragraphes et la relation de cause à effet ne semblent-ils pas s’imposer ? Par le titre de l’article, tout d’abord ? : « France refuses to allow Zola to see Dreyfus for the World ». Et puis surtout parce que dit l’article lui-même : le World demanda l’autorisation d’envoyer un reporter […] à l’île du Diable pour voir Dreyfus et entendre son histoire de sa propre bouche ». Le gouvernement refusa et le journal proposa « alors à M. Zola d’aller lui-même à l’île du Diable comme notre correspondant spécial ». Aller à l’île du Diable comme correspondant spécial pour y faire quoi, sinon parvenir à obtenir ce que le reporter n’avait pas eu le droit de faire, à savoir « rencontrer Dreyfus et entendre son histoire de sa propre bouche » ? Il nous paraît difficile de soutenir que la demande faite à Zola n’était pas, l’envoyant en Guyane, de le faire rencontrer Dreyfus pour recueillir sa propre histoire, de l’interviewer… Et il l’est d’autant plus que « special commissioner » (« commissaire spécial »), qu’on trouve dans le texte du World et que La Libre Parole a traduit pour une meilleure compréhension en « correspondant spécial », a un sens spécial dans le monde de la presse anglaise : celui d’un type de journaliste particulier, envoyé sur des missions spéciales, missions prolongées, plongé au cœur de l’action et partageant les risques et vivant la vie de ceux dont il doit, pour son journal, raconter les faits et gestes (« The Penny-a-liner », Chamber’s Journal, 22 février 1873)…
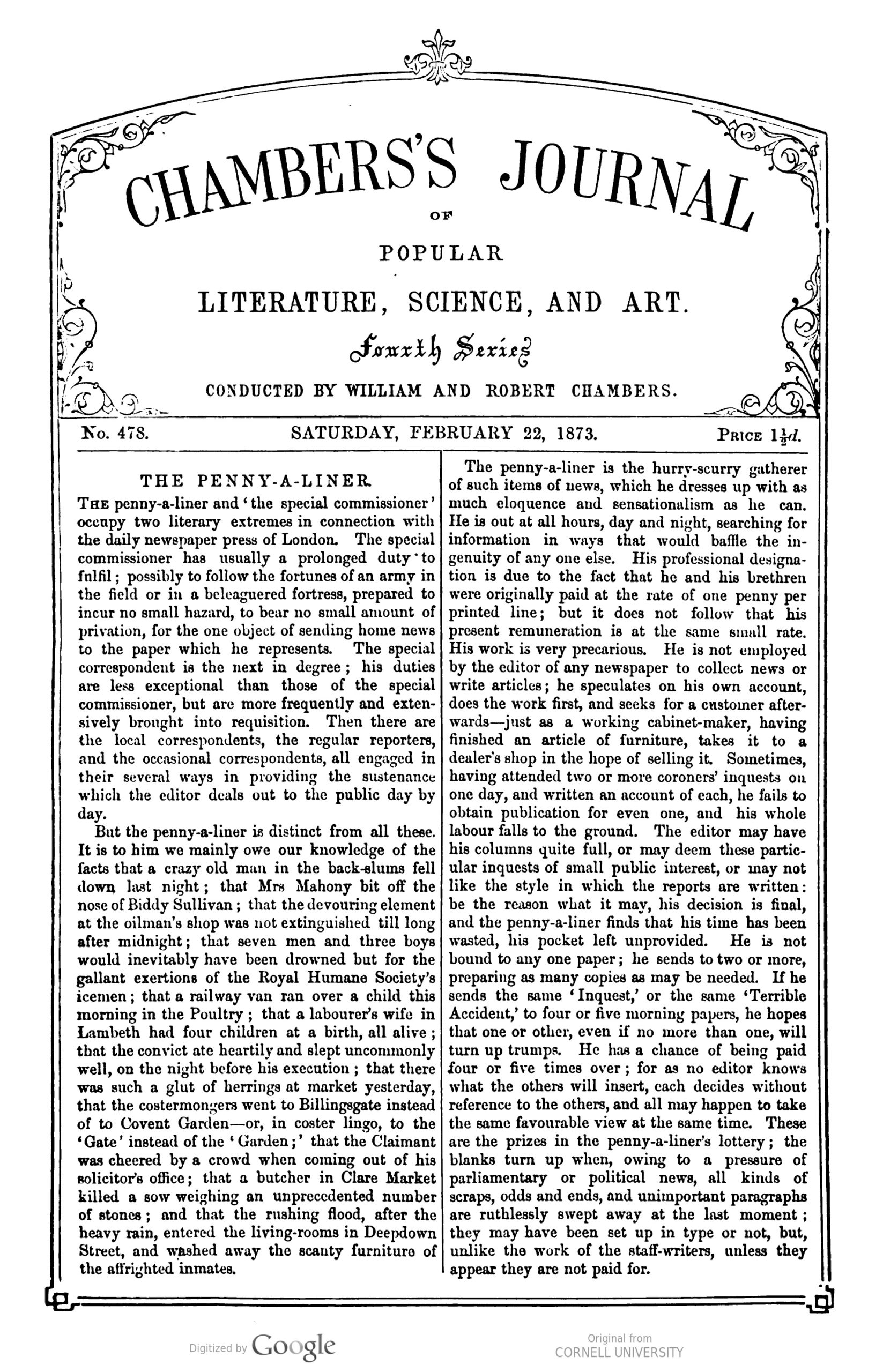
Encore une fois, si, par extraordinaire, on ne voyait pas cette évidence, nous nous demanderions bien, alors, comment on pourrait voir, dans la phrase : « nous proposâmes alors à M. Zola d’aller lui-même à l’île du Diable comme notre commissaire spécial », une commande du « J’Accuse…! »… ou alors, signifiant et signifié du segment suivant : « faire dire à un document ce qu’il ne dit nullement » nous échappent totalement. Si Adrien Abauzit dit que rattacher le télégramme a une proposition d’interview est « arbitrair[e] », il faudrait se demander comment on devrait qualifier le fait de le rattacher à la publication du « J’Accuse…! » ? Et d’ailleurs, si tel était le cas, comment expliquer le contenu de cet autre télégramme de Shaw, écrit en réponse à celui que lui avait envoyé Sphere, que nous donnions dans notre précédent post et qui, comme toujours, n’a pas retenu l’attention d’Adrien Abauzit :
Paris, 18bre 97 3 30
Sphère [sic]
Londres
Message reçu.
Vais voir Zola. J’avais exactement écrit ce matin la même chose à Scheurer.
S. Shaw, 26 rue Cambon
Si on suit Adrien Abauzit, serait-ce donc à dire que Scheurer-Kestner avait été aussi approché pour écrire « J’Accuse…! » ?
Concluons : s’il y eut un climat hostile à Félix Faure à l’Élysée, ce n’est certainement pas ce télégramme qui nous le prouvera, comme ce n’est pas non plus lui qui nous montrera que Zola a été payé par les Anglais pour écrire son célèbre article. Maintenant, avant de conclure et de refermer le dossier, il nous reste à voir le dernier élément, toujours sur la même question, que met en avant Adrien Abauzit.
| Ajout du 2 août 2025 : Nous remettons la main sur un document que nous avions complètement oublié et qui justifie ce petit ajout non seulement parce qu’il règle définitivement la question de l’identité de Sphere, celle – si la chose n’était pas faite au terme de ce long développement – de l’interview et celle d’une demande qui serait à l’origine du « J’Accuse…! ». Le document en question est la lettre du 18 décembre 1897 à Scheurer-Kestner qu’évoquait Shaw dans celle publiée juste au dessus et dans laquelle il disait à Sphere avoir contacté le matin même le vice-président du Sénat. Donnons-en le texte : 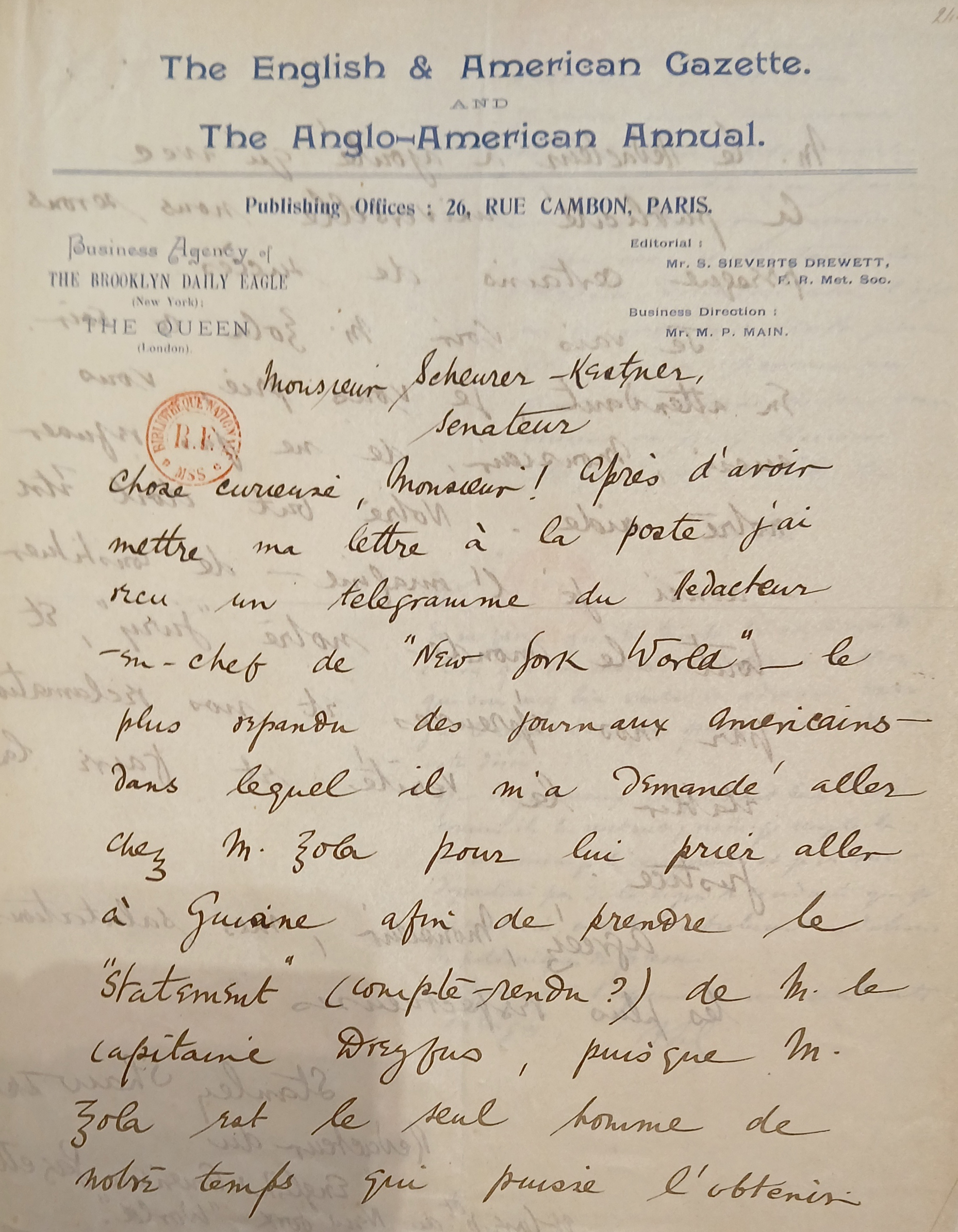 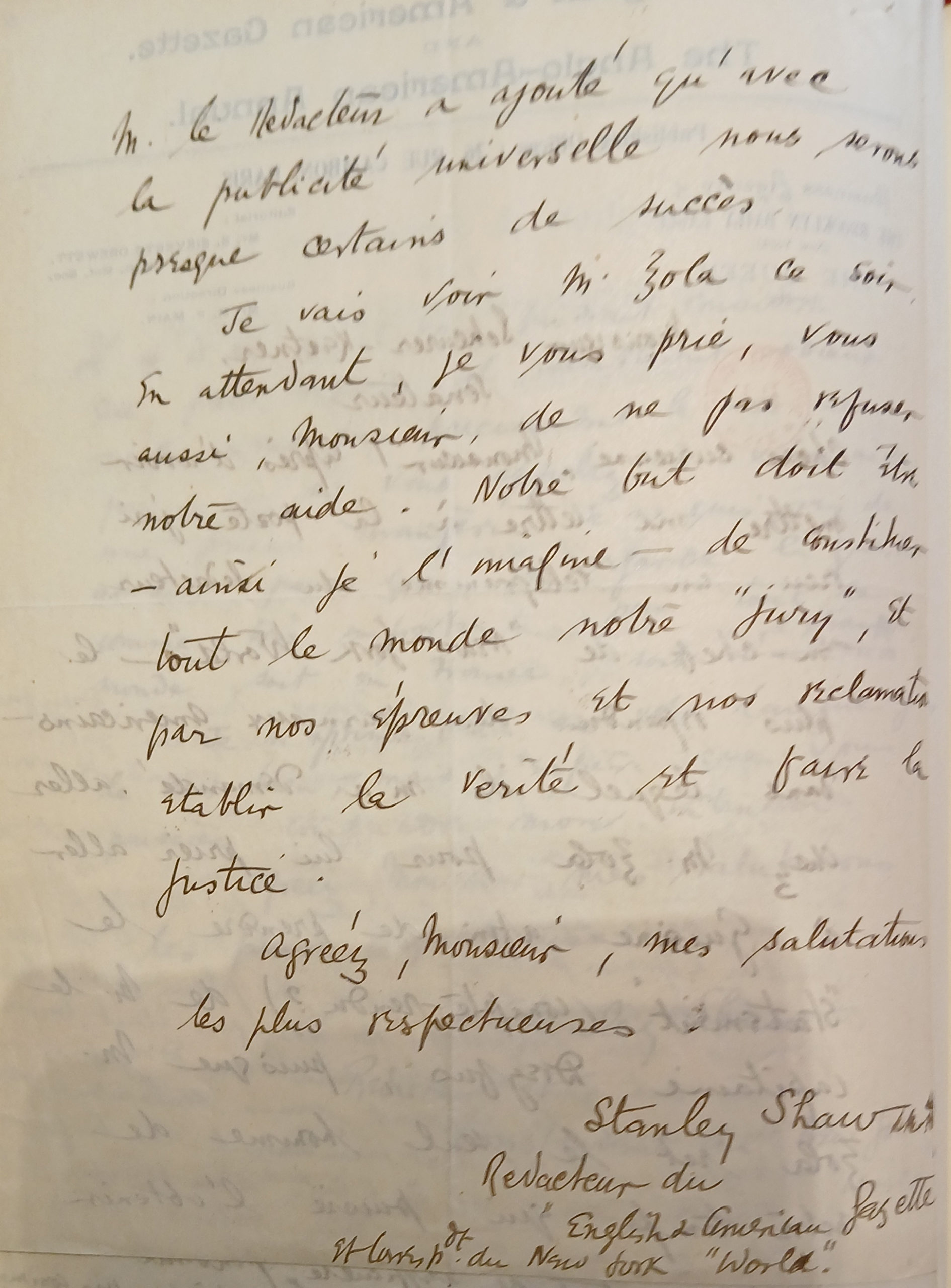 On y apprend donc On y apprend donc 1. Que Sphere n’est bien évidemment pas un « nom de guerre » mais celui, comme nous le proposions d’un administratif du journal et en l’occurrence de son rédacteur en chef. 2. Qu’il est bien question de faire interviewer Dreyfus : « il m’a demandé aller chez M. Zola pour lui prier aller à Guiane afin de prendre le “statement” (compte-rendu ?) de M. le capitaine Dreyfus »… Et nous en revenons à ce que nous disons à propos de la traduction du télégramme et dont le texte devait assurément porter « Statement » que les traducteurs des Postes & Télégraphes ont traduit par : « s’assurer lui-même de la situation du capitaine ». « Statement » ? Compte rendu, exposé, déclaration. Prendre le compte rendu de M. le capitaine Dreyfus,.. prendre l’exposé de M. le capitaine Dreyfus… prendre la déclaration de M. le capitaine Dreyfus… Est-il besoin encore d’insister ? 3. Et est-il aussi nécessaire d’insister sur le fait qu’en aucun cas « aller chez M. Zola pour lui prier aller à Guiane afin de prendre le “statement” (compte-rendu ?) de M. le capitaine Dreyfus, puisque Zola est le seul homme de notre temps qui puisse l’obtenir » et qu’ajouter : « M. le rédacteur a ajouté qu’avec la publicité universelle nous sommes presque certain du succès » ne peut, à moins de déborder d’imagination, concerner le « J’Accuse…! » ?…… |
Du climat hostile à Félix Faure à l’Élysée
Dans son second article au sujet des lettres de L’Espérance du Peuple que nous avons précédemment cité, Albert Monniot mettait en avant un autre élément, un témoignage de poids, celui de Flourens, ancien ministre :
[…] un nouveau témoignage du crime a été produit, celui de Félix Faure lui-même.
Nul ne songera, en effet, à contester le récit de M. Flourens, ancien ministre des affaires étrangères, rapportant le propos du Président au cours du dernier entretien qu’il eut avec lui.
Un fonctionnaire de la police, rencontrant M. Flourens, qui avait été ministre dans un cabinet où Félix Faure était sous-secrétaire d’État, lui avait demandé de conseiller au Président de se méfier de « ses intimes ».
L’ancien ministre avait transmis le soir même cet avertissement, probablement sans y attacher d’autre importance, par acquit de conscience, et Félix Faure lui avait alors déclaré :
– Croyez-vous que j’ignore qu’on en veut à ma vie ?… Rassurez-vous, mon ami. Toutes les précautions sont prises. »
Celui qui rapporte ce propos, encore une fois, est un ancien ministre des affaires étrangères, un homme qui a l’habitude de peser ses mots, que son républicanisme éprouvé, comme son caractère, mettent à l’abri du soupçon.
Nous pouvons donc considérer comme acquis au procès ce fait que le président Félix Faure savait sa vie menacée, en raison de son attitude politique. (« Le drame de l’Élysée », 19 décembre).
Curieusement, Adrien Abauzit utilise peu (voir son troisième volume, p. 46) ce témoignage, « témoignage le plus précis », comme l’écrit son prédécesseur André Galabru (p. 101), et il a bien eu raison parce que s’il est en effet le seul témoignage qui soit crédible, le seul même qui soit indiscutable, rien ne dit, comme le soutient Albert Monniot, que si Félix Faure savait sa vie menacée, c’était « en raison de son attitude politique », ou comme l’écrivait Adrien Abauzit dans son troisième volume, « en raison de son engagement antidreyfusard » (p. 45). Et quand bien même Monniot aurait-il raison, il est évident que l’article de Flourens ne peut faire allusion à Marguerite Steinheil quand il évoque les « intimes » mais surtout pas à l’affaire Dreyfus. Flourens, dans son article, croit se souvenir, que cet échange avait eu lieu à l’époque de la réception de Ferdinand de Bulgarie. Il ne le jurerait pas, écrit-il, mais le pense et il semble bien qu’il ait raison puisque ce dîner fut le seul donné à chef d’État, pour ce que nous avons pu retrouver, auquel fut présent Flourens. Et ce dîner s’étant tenu le 29 avril 1896, Faure n’avait pas encore rencontré Marguerite Steinheil et l’affaire Dreyfus était quasi-oubliée et ne reviendra à la une des journaux que cinq mois plus tard quand sera lancée la fausse nouvelle de l’évasion du prisonnier de l’île du Diable. Félix Faure ne pouvait être alors considéré comme un obstacle à la révision puisqu’il n’en était pas question. Bien sûr – et nous en reparlerons dans notre prochaine livraison –, Adrien Abauzit nous expliquera que Picquart agissait déjà en coulisse pour le « Syndicat » dont il était le stipendié. Mais quand bien même serait-ce vrai, Faure ne pouvait être une cible puisqu’il ne s’occupait pas d’une affaire qui avait alors disparu de l’actualité. Mais quelle était alors cette menace ? Si Adrien Abauzit a envie d’aller aux archives de la PP, il y trouvera la réponse en compulsant les deux lourds dossiers intitulés : « Menaces envers M. Félix Faure » et « Projets d’attentat contre M. Félix Faure ». Deux lourds dossier qui n’évoquent pas l’affaire Dreyfus…
• Chapitre II. André Galabru remporte la partie contre la SIHAD, p. 33-34.
Nous avons déjà répondu en partie à ce qui est développé ici, relativement à la « version graveleuse ». N’y revenons pas. Nous voudrions juste développer ici un petit point relatif au « mépris » qui serait le nôtre à l’égard d’André Galabru. Au début de son volume (rappelons que nous commentons l’introduction à la suite de ce chapitre II), Adrien Abauzit nous reproche notre condescendance et notre mépris quand nous évoquions, dans notre précédent post, « Galabru, ancien militaire, professeur de philosophie, employé dans l’industrie pharmaceutique et chanteur à ses heures. Adrien Abauzit a trouvé le livre de notre professeur/chanteur/marchand de médicaments… » Nous avons écrit cela, c’est vrai, mais notre phrase est ici – encore une fois – citée incomplètement et tirée de son contexte. Dans son intégralité, elle montre moins du mépris à l’égard d’André Galabru que de l’ironie à l’égard d’Adrien Abauzit :
Avant de commencer, il est amusant de voir Adrien Abauzit qui, dans son premier volume, disqualifiait l’expert Crépieux-Jamin au motif qu’il était dentiste, foncer tête baissée dans la littérature de Galabru, ancien militaire, professeur de philosophie, employé dans l’industrie pharmaceutique et chanteur à ses heures. Adrien Abauzit a trouvé le livre de notre professeur/chanteur/marchand de médicaments « prudent et on ne peut plus rigoureux ».
Encore une fois passons et poursuivons… Si nous ne voyons pas en quoi et quelle partie remporte André Galabru, nous sommes sûrs d’une chose : c’est que ce n’est pas celle de l’histoire. Adrien Abauzit a raison sur un point : aucun historien – qu’il nomme académique – n’avait réalisé ce travail avant André Galabru. En effet, et cela parce qu’aucun historien n’a de raisons de douter de la thèse officielle de l’hémorragie cérébrale et que, s’il fallait prouver la thèse de l’assassinat, il faudrait d’autres preuves que celles d’André Galabru dont aucune, et elles sont nombreuses, ne résiste, comme on vient de le voir, à l’examen. D’autres preuves et une autre méthode aussi que celle qui consiste, comme nous venons juste de le voir, à donner une cote fausse pour un document qu’on révèle, document de quelques lignes dans lequel on fait 4 erreurs de lecture ; lecture purement gratuite, sans l’ombre de la moindre preuve de ce télégramme comme d’une commande faite à Zola pour le « J’Accuse…! » ; citations réécrites comme, entre autres, le passage de Steinheil relatif aux pseudo-mémoires qu’elle était censée avoir écrites avec Félix Faure, ou comme celui des souvenirs de Steinheil à propos du prétendu retour « à sa première attitude ». Il y aurait encore beaucoup à dire. Nous nous contenterons de quelques exemples qui nous permettront de mieux comprendre encore la méthode qui est à l’origine de ce travail qu’Adrien Abauzit, dans son précédent volume, nous disait « prudent et on ne peut plus rigoureux » et aussi « particulièrement bien documenté ».
Prenons, pour varier, son second volume : Variations sur l’Affaire (« Samidzat Auto-édité », sans date [1997]). P. 50-51, André Galabru fait le lien entre l’affaire de l’impasse Ronsin et l’affaire Dreyfus en expliquant qu’il n’est pas « interdit de penser qu[e la veuve Prévost] fut l’intermédiaire entre Meg (Marguerite) et la police du moment du complot contre Félix Faure, et que c’est par son intermédiaire que Marcel Prévost fut chargé de la mission de décider Zola à basculer, moyennant finances, dans un engagement total aux côtés des dreyfusards ». Un Marcel Prévost, explique encore André Galabru, qui avait dû mourir prématurément (puisque son épouse est veuve en 1908) et qui était celui dont parle Henri Guillemin, ce Prévost qui, en septembre 1897, « avait été délégué auprès de [Zola] » « pour agir en faveur du capitaine Dreyfus ». Marcel Prévost n’avait pas été délégué par qui que ce soit pour quoi que ce soit. Il avait juste été présent à deux dîners chez Scheurer-Kestner qui notera, dans ses souvenirs, à propos du second dîner où était aussi présent Zola : « Quelle différence [Zola] avec Marcel Prévost, à la jolie tête fine et brune du Midi, à l’œil scrutateur et à la bouche sensuelle et sceptique ; mais celui-là il manque de puissance ! Cela se voit, cela se sent dans ce qu’il dit ; j’ai l’impression que le premier fera “quelque chose” et que le second, tout en le regrettant, ne fera rien. » Le Marcel Prévost dont il est question ici, le Marcel Prévost de Scheurer-Kestner, n’est pas mort prématurément et n’est pas le mari d’une choriste de l’Opéra que l’affaire Steinheil rendra un temps célèbre : écrivain célèbre, président de la SGDL en 1899, puis à nouveau en 1903, il sera élu à l’Académie française en 1909 et mourra dans son lit en 1941 ! Il n’a tout simplement rien à voir – parce que nombreux sont les Prévost – avec le mari de Mathilde Laurillard – épouse puis veuve Prévost –, prénommé Charles Louis Adolphe !
Encore, p. 70, André Galabru nous parle de la statue de Marguerite Steinheil au Sénat, la Muse de la source, « où [elle] se trouve encore », et s’en étonne : « Elle n’avait aucun titre à figurer au Palais du Luxembourg, si ce n’est, sans doute, l’aide qu’elle a apporté au “Syndicat”. » Le problème, encore une fois, est que pour arriver à ce genre de déductions hardies – ou le « Syndicat » explique tout et où tout explique le « Syndicat » –, André Galabru convoque des informations ni fraiches ni justes. En 1997, quand il publie son second ouvrage, la statue n’était plus visible au Palais du Luxembourg depuis 1973, date à laquelle elle avait été remisée dans une cave, avant d’être affectée à Orsay en 1984 (et non 1986 comme dit le site du musée d’Orsay). Cette Muse de la source, de Jean-Baptiste Hugues, achetée par l’État en 1909, placée au Sénat en 1910, n’a jamais représenté Marguerite Steinheil… pour une raison toute bête : la première version de cette statue date de 1881 et en 1881 Marguerite Steinheil avait douze ans !
Mais le plus beau est sans doute ce passage relatif à la mort de Zola qu’André Galabru conclut ainsi, en tout simplicité :
Attentat des antidreyfusards pour se venger d’un homme qu’ils détestaient ? Possible, mais pas vraisemblable. En revanche, « l’hypothèse d’un assassinat politique », pour reprendre les propres termes du fils de Zola, n’est-elle pas plus crédible, car, s’il s’agit d’un assassinat politique, ce n’est certes pas les antidreyfusards, vaincus en 1902 et exsangues, qui auraient pu l’effectuer, mais bien ceux qui, étant au pouvoir, avaient le plus à craindre d’un témoin au courant de pas mal de choses touchant l’Affaire et la mort de Félix Faure.
Que dire à propos de cette théorie lancée au petit bonheur et qui pour ce faire reprend, en leur faisant dire le contraire de ce qu’elles disent, les propres paroles du fils d’Émile Zola ?
Les chapitres I et II étant finis, revenons en arrière, au début du livre.
• La dédicace.
Adrien Abauzit rend hommage à Du Paty de Clam, Mort pour la France. Du Paty fut un héros en 14 et, à ce titre, mérite assurément un hommage. Mais pour que l’hommage soit parfait, il ne faut pas se tromper sur son prénom. Le prénom usuel de Du Paty de Clam » n’a jamais été Armand mais Ferdinand. Lui rendre hommage, c’est aussi lui conserver son identité. Mais bon, n’en faisons pas reproche à Adrien Abauzit ; il n’est pas le seul à commettre cette erreur…
• Introduction. p. 9. Les deux mouvements de l’acrobatie.
Nous renvoyons au début de ce post où tout a été dit.
Introduction. p. 10. Les imprécisions et les « changements de version d’un texte à l’autre en l’espace de quelques semaines ».
Nous passons et y reviendrons par la suite, puisque le propos sera développé plus loin.
• Introduction, p. 10-11. Sur l’improbable canular Léonie ou de la dimension dogmatique du dreyfusisme.
Cette question a déjà été très largement commentée par nous dès 2018 mais, puisque nos remarques n’ont pas retenu l’attention d’Adrien Abauzit, recommençons. Donc… Adrien Abauzit nous explique ici que « Mathieu a “découvert” la violation du principe du contradictoire intervenue lors du premier procès […] grâce aux pouvoirs magiques […] de Léonie […] » [nous enlevons dans les citation d’Adrien Abauzit tous les gras]. Et de citer à la suite le passage des souvenirs de Mathieu relatif au sujet. Sur cette base, Adrien Abauzit écrit que nous « accrédit[ons] l’existence des visions de Léonie », et nous cite : « Assurément… Léonie a eu une “vision”… C’est ahurissant mais c’est ainsi puisque Mathieu le raconte. » Redonnons donc intégralement notre dernière réponse de 2021 puisqu’elle répond encore à ce qu’écrit Adrien Abauzit à nouveau aujourd’hui… en 2024 !
Dans notre réponse, nous tentions – parce que nous sommes opiniâtres – d’expliquer une simple chose à Adrien Abauzit : Léonie a eu une vision puisque Mathieu le raconte, comme il raconte tout dans son livre – la fausse évasion, etc. –, et que vraiment, si cela n’avait pas eu lieu, il n’aurait pas eu grand intérêt à la raconter. Nous ne disions pas autre chose et écrivons clairement que cette histoire de vision est « ahurissant[e] ». De quel droit, et sur quelle base, aurions-nous pu dire que Mathieu mentait ? Nous ne croyons définitivement pas aux visions mais nous n’avons aucune raison de douter de ce que dit Mathieu. Maintenant, écrire ça ne veut pas dire que nous y attachions une quelconque importance et c’est ce qui explique d’ailleurs que Bertrand Joly (qui soit dit en passant écrit une histoire politique de l’affaire, pas une histoire de l’affaire) et Vincent Duclert aient laissé de côté cet épisode dont l’intérêt est pour le moins relatif. Ce que nous disions à Adrien Abauzit, c’est que ce ne sont pas les séances de spiritisme qui permirent à Mathieu Dreyfus d’avoir cette certitude de l’illégalité mais les confidences de quelques-uns que sont Develle, Reitlinger, etc. Adrien Abauzit cite Mathieu qui dit bien qu’il n’insista pas quand Léonie lui fit part de sa vision et qu’il comprit quelques jours plus tard quand Gibert lui fit part de sa conversation avec Félix Faure. Ayant le sentiment de nous asséner le coup de grâce, Adrien Abauzit modestement triomphe : « Mes contradicteurs, je l’admets volontiers en tant que non-historien, sont bien mieux informés que moi en matière de “suggestion mentale”, de “transmission de pensée”, ou de possibilité de “voir à distance”, dès lors, je crois reconnaître ne pas avoir les armes pour leur répondre sur ce terrain. » Un véritable coup de grâce… Nous nous étions refusés jusqu’alors de faire même une allusion, trouvant l’argument trop facile, à ce qui va suivre… Mais celui qui écrit la phrase qu’on vient de lire est le même que celui qui, dans son premier (p. 347), affirme hautement qu’il « ne crain[t] pas d’écrire que de sa main, [en 1917] la Vierge a repoussé l’envahisseur » et – la démonstration de la réalité du fait n’est pas évidente – qu’il « faut bien croire que les Français de l’époque, ayant vécu ces événements, ont bien assisté à cette intervention de la Vierge, puisque le 9 juin 1924, la commune de Barcy a élevé un petit monument, sur lequel repose une statue de Marie. »
Mais revenons à Léonie… Adrien Abauzit en conclut donc : « Au bout du compte, retenons qu’“après un siècle de recherches, après des milliers d’articles, des centaines de livres, de dizaines de colloques”, personne ne sait comment Mathieu Dreyfus a été mis au courant de la violation du principe du contradictoire au procès de 1894, et par ce fait, de l’existence, du dossier secret. » Mais si, Adrien Abauzit, on le sait, nous vous l’avons expliqué et vous le reprenez p. 83 et le développez en citant Bertrand Joly p. 84. Pensez-vous que vos lecteurs auront oublié d’une page à l’autre ?
Profitons de ce passage pour revenir sur quelques points importants de cet épisode, qui ne représente à vrai dire guère d’intérêt, et qui permettront de développer quelques points peu connus. Quel est l’intérêt d’Adrien Abauzit à développer à l’infini cela ? Faire rire, certes, mais quoi de plus qui soit susceptible d’intéresser le lecteur ? Mathieu Dreyfus, après avoir résisté, en bon rationaliste qu’il était, a consulté, encouragé par quelques amis, une voyante… et alors ? Il raconte que cette voyante a eu des visions… ce qui est indubitablement le minimum qu’on puisse attendre d’une voyante… et alors ? Qu’est-ce que cela indique sinon que le parfait rationaliste qu’il était devait être bien désespéré pour avoir recours à ce genre de moyens ? Pour Adrien Abauzit, c’est du moins ce que nous comprenons du chapitre de son premier volume, tout cela serait bien sûr faux, serait « la farce du millénaire » (p. 194) et Mathieu serait lui-même tellement persuadé « de l’absurdité de son propos » qu’il y aurait « ajouté un argument plus rationnel » (p. 197) sur lequel nous reviendrons à la suite. Mais enfin, si cela était faux, quel était l’intérêt de Mathieu Dreyfus de le raconter quand personne ne lui demandait quoi que ce soit ?… et de surcroît de le raconter dans des souvenirs qu’il n’eut jamais l’intention de publier et qui ne paraîtront pour la première fois qu’en 1978, soit 48 ans après la mort de son auteur et 75 ans après qu’y avait été porté le point final ? Quel intérêt pouvait être celui de Mathieu Dreyfus de mentir dans un texte qui n’avait pas pour objet d’être un jour livré à la publicité ?
Adrien Abauzit parle de l’« argument plus rationnel » ajouté par Mathieu. Pour comprendre, deux mots : Mathieu explique qu’un ami, le Dr Gibert, celui justement qui l’avait initié aux séances avec Léonie, lui avait fait part, quelques temps après les propos énigmatiques de la voyante, d’une confidence de son ami Félix Faure, président de la République, confidence relative à la transmission, lors du procès, d’un dossier secret à l’insu de l’accusé et de sa défense. Adrien Abauzit soutient que de son vivant le Dr Gibert n’a jamais rien affirmé relativement aux confidences de Félix Faure et donc que Mathieu ment. « Leur dossier étant vide, ajoute-t-il dans son premier volume, les dreyfusards ont été contraints de fournir de nouvelles explications plus invérifiables les unes que les autres », et il s’attarde ensuite sur une information de Demange, recueillie auprès d’un avocat de ses amis. Mathieu, qui en parle, n’en donnant pas le nom, Adrien Abauzit peut conclure qu’on « ne […] saura jamais » qui était ce « fameux confrère anonyme » (p. 199). Voici donc deux « preuves et indices » des mensonges dreyfusards et en l’occurrence ici des mensonges de Mathieu. Détaillons pour une parfaite compréhension : les propos recueillis de Félix Faure sont un mensonge de Mathieu, puisque de son vivant le Dr Gibert n’a jamais rien affirmé relativement à ces confidences, comme l’est la source de l’avocat ami de Demange, dont Mathieu ne donne pas le nom et qu’on ne connaîtra donc jamais, autrement dit qui de toute évidence n’existe pas… En 2018, nous avions appris à Adrien Abauzit qui était l’avocat. Il s’agissait de Salles, ce que nous savons par les souvenirs de Scheurer-Kestner publiés en 1988. Mais en fait, nous le savons depuis bien plus longtemps, puisque tout le monde ou presque en a parlé ; nous le savons même depuis 1898, depuis que son nom avait été donné dans la presse. Demange en avait très clairement parlé dans une longue interview au Matin (numéro non conservé à la BNF, reprise du Journal des Débats), racontant que Salles l’avait informé que, comme le lui avait confié un officier membre du conseil de guerre de 1894, une pièce secrète avait été soumise au moment du délibéré, à l’insu donc de la défense. Salles avait d’ailleurs été cité par la défense au procès Zola. Labori lui avait posé une question la plus ouverte possible, à savoir s’il ne connaissait pas « un fait qui puisse être intéressant pour la défense de M. Émile Zola ». Mais Delegorgue, le président, avait refusé cette question qu’il jugeait ne pas en être une et avait recentré le débat sur une question qui le fermait et empêchait le témoin de dire ce pourquoi il était venu : « Avez-vous quelque chose à dire relativement à l’affaire Esterhazy ? » Et bien sûr, sur cette question, le témoin n’avait rien à dire… (Procès Zola, p. 258-261). Quand, quelques mois plus tard, avait fuité dans la presse l’information de la confidence que Salles était censé avoir reçue, l’avocat avait fermé sa porte et s’était refusé à répondre aux reporters venus le voir nombreux. Un silence qui avait été interprété comme un aveu comme en témoigne cet entrefilet du Radical du 16 février 1898 :
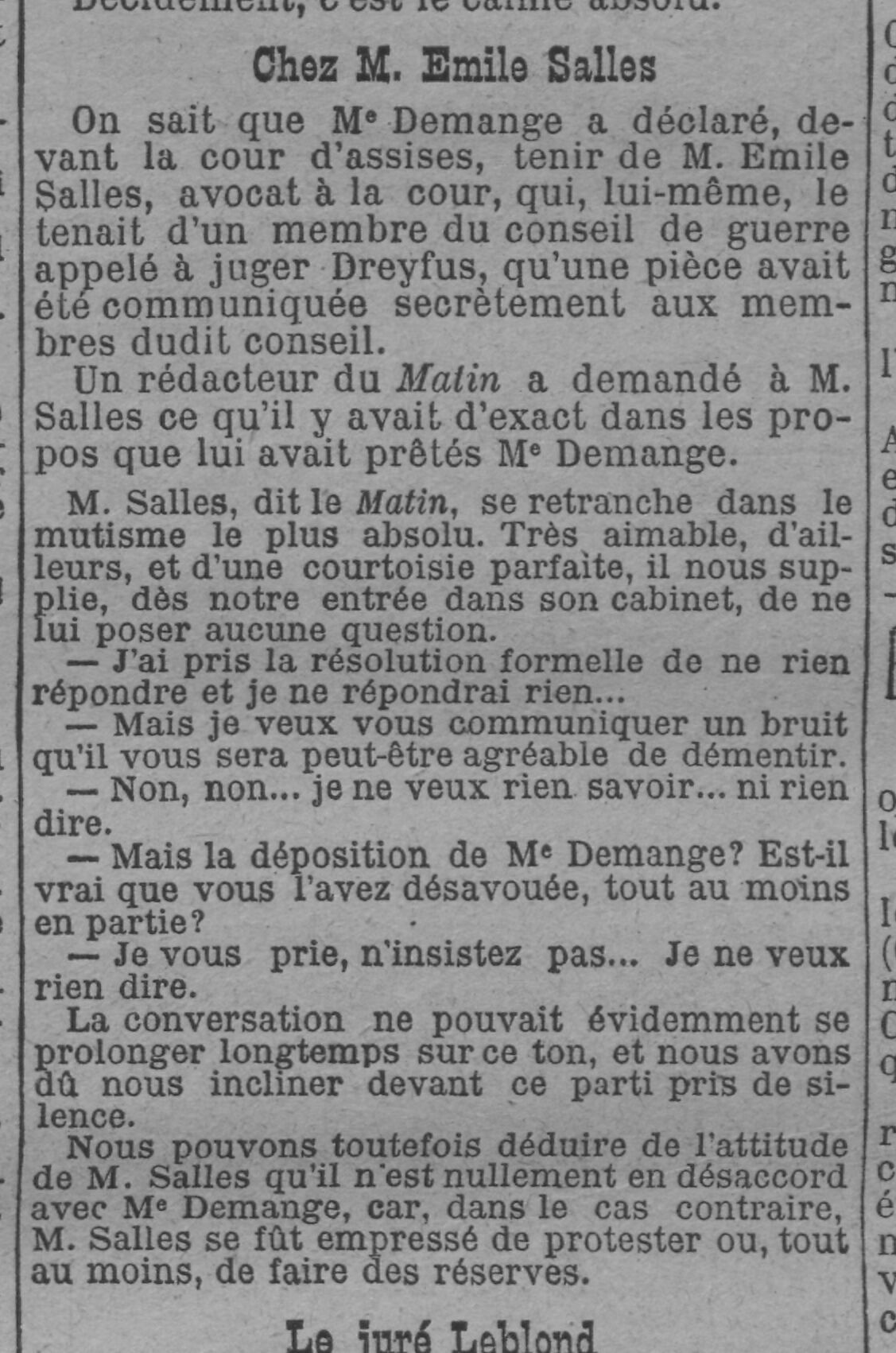
Et quand finalement, quelques mois plus tard, Salles se décida à parler, ce n’avait été que pour affirmer sa conviction de la culpabilité de Dreyfus et se dégager de tout dreyfusisme… mais, ce disant, à aucun moment il ne jugea nécessaire d’infirmer les propos que lui prêtait Demange :
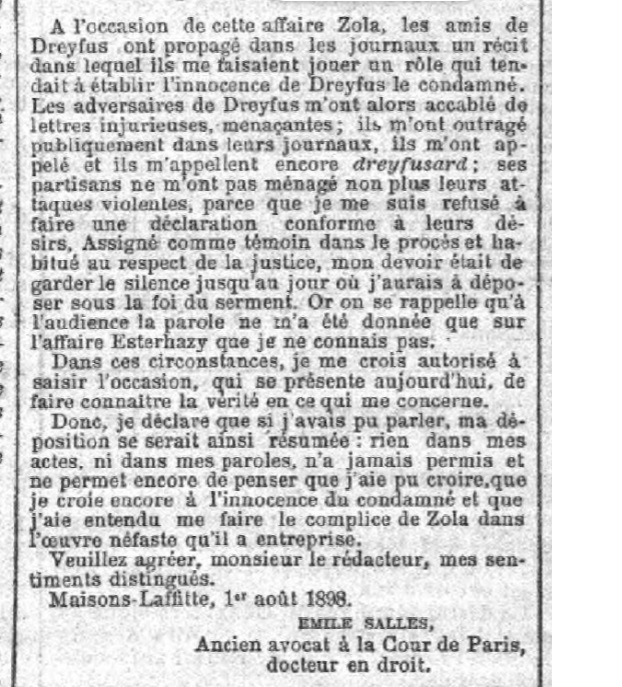
Presse du 3 août 1898
Pour faire gagner du temps à tout le monde et éviter une nouvelle discussion sur un probable « il ne confirme pas », « dire que les dreyfusards lui ont fait « jouer un rôle » équivaut à infirmer », etc., donnons un dernier document qu’Adrien Abauzit aurait pu trouver et qui permet aussi de comprendre dans quelle situation s’était retrouvé l’avocat et pourquoi il tenait tant à faire entendre qu’il n’avait jamais été « le complice de Zola dans l’œuvre néfaste qu’il a entreprise ». Il s’agit d’une lettre en date du 12 février 1898 du général Brugère au général Billot, ministre de la Guerre, lettre « absolument personnelle et confidentielle » dans laquelle le premier rapportait au second une conversation qu’il avait eue avec le colonel Echemann, membre du conseil de guerre de 1894 qui avait condamné Dreyfus, celui-là même dont les propos à Salles étaient à l’origine de toute l’affaire. Echemann y racontait une récente discussion avec Salles, chez lui, à Verdun :
Vous rappelez-vous, m’a-t-il dit [Salles], la conversation que nous avons eue ensemble, en 1895, dans ma maison de campagne, au sujet de l’affaire Dreyfus. Vous aviez fait partie du Conseil de guerre qui l’a jugée et vous m’aviez dit que vous étiez très perplexe lorsque vous êtes entré dans la salle des délibérations mais que vous n’aviez plu eu d’hésitations après avoir vu la pièce secrète qui vous avait été communiquée.
Vous êtes tout à fait dans l’erreur, me suis-je aussitôt écrié. Vous aviez mal interprété mes paroles. – je me souviens très bien que pendant les tirs de guerre exécutés en 1895 par mon régiment dans la forêt de St Germain je suis allé vous voir de la part de votre frère, et que vous m’avez parlé de l’affaire Dreyfus et de votre ami Me Demange. Je vous ai répondu que cet avocat avait été très éloquent, que sa plaidoirie très remarquable à bien des points de vue m’avait beaucoup touché, qu’elle m’avait même ébranlé, mais qu’en revoyant les pièces du dossier dans la salle des délibérations, je n’avais plus douté de la culpabilité de Dreyfus. Je n’ai pas parlé de pièce secrète et comme vos questions me gênaient beaucoup, j’ai changé immédiatement de conversation et je n’ai pas tardé à vous quitter.
Me Salles m’a alors appris qu’il avait parlé à Me Demange de cette conversation de 1895 ; qu’il allait ête appelé à déposer devant la cour d’assises dans l’affaire Zola et qu’il serait dans doute appelé à prononcer mon nom. Je lui ai dit que s’il agissait ainsi il commettrait une infamie parce que je n’avais pas tenu le propos qu’il me prêtait.
Un document qui nous dit bien que Demange ne fit que raconter ce qui était et donc que Salles fut bien une des sources des dreyfusards relativement à la question de la transmission illégale du dossier secret au moment du délibéré. Lisant tout cela, on ne peut que s’étonner qu’Adrien Abauzit, qui a travaillé sur les procédures et sur la presse, soit passé à côté de cet Émile Salles et puisse affirmer avec aplomb qu’on « ne […] saura jamais » qui était ce « fameux confrère anonyme ».
Quant au témoignage de Gibert, nous avons, ici encore, répondu à Adrien Abauzit, dans ce même papier de 2018. Et nous y étions revenus en 2021, puisqu’Adrien Abauzit n’avait pas retenu notre réponse. À la suite de l’extrait précédemment cité, nous ajoutions :
Et en passant, il est dommage d’ailleurs qu’une nouvelle fois vous ne commentiez pas la réfutation que nous faisions de votre : « de son vivant, le docteur Gibert n’a jamais déclaré avoir reçu de confidences de Félix Faure ». Dommage que vous n’évoquiez pas le document inédit que nous vous avons soumis, signé de Gibert, de son écriture et sur son papier a en-tête, qui sont justement ces confidences écrites faites à Mathieu…
Mais continuons un peu sur cette question. Dans son deuxième volume, Adrien Abauzit écrit : « Au bout du compte, retenons qu’“après un siècle de recherches, après des milliers d’articles, des centaines de livres, de dizaines de colloques”, personne ne sait comment Mathieu Dreyfus a été mis au courant de la violation du principe du contradictoire au procès de 1894, et par ce fait, de l’existence, du dossier secret. » Nous évoquions, plus haut, Gibert, Develle, Reitlinger, Salles, qui tous lui en parlèrent. Des confidences dont Mathieu ne pouvait rien faire en dehors de chercher qui pouvait se dissimuler derrière le « D » de la pièce « Ce canaille de D. », évoquée par deux de ces informateurs (nous reparlerons de ce point dans notre seconde livraison). Mais ce qui lui ouvrit véritablement la voie, ce qui fut pour lui le vrai informateur de l’illégalité du dossier secret puisque là, enfin, il pouvait s’en saisir, c’est la publication de L’Éclair en date du 15 septembre 1896 :
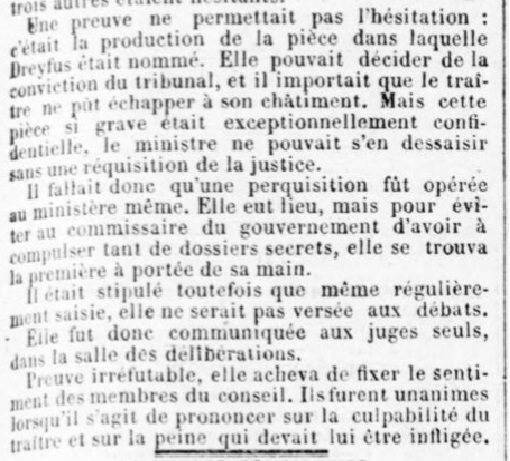
Il est étonnant qu’Adrien Abauzit puisse écrire qu’ « Au bout du compte, retenons qu’“après un siècle de recherches, après des milliers d’articles, des centaines de livres, de dizaines de colloques”, personne ne sait comment Mathieu Dreyfus a été mis au courant de la violation du principe du contradictoire au procès de 1894, et par ce fait, de l’existence, du dossier secret » puisque lui-même parle de cet article dans son premier volume. Et là encore, il va nous falloir nous étendre un peu. Dans son premier volume, toujours, Adrien Abauzit attribue, sans même tenter la moindre démonstration, l’article de L’Éclair à Picquart, non comme auteur mais comme inspirateur (p. 191-194). Laissons de côté les réfutations de Picquart que par définition Adrien Abauzit ne peut accepter et qu’il qualifie, sans autre explication, de « défense pathétique », pour aller voir le document. À la publication de cet article de L’Éclair, il n’y eut qu’un homme, un seul homme, de l’état-major qui demanda une enquête et des poursuites contre L’Éclair, et cet homme fut Picquart, justement, et cela parce que, comme il l’écrira à son chef dans une note du 22 septembre 1896, « la Section de statistique n’a aucune existence officielle […] » et qu’en conséquence, c’est un « renseignement confidentiel » qu’avait publié L’Éclair, renseignement « de nature à porter préjudice au service de la Section » qui nécessitait donc, estimait-il, « de donner un avertissement ». « Le chef de la section de statistique, concluait-il, a donc l’honneur de demander que des poursuites soient menées contre le journal L’Éclair. ». Bien sûr, Adrien Abauzit, qui apprendra cela et lisant ces lignes, nous dira sans doute que Picquart voulait ainsi donner le change puisqu’il était l’informateur du journal… mais si Picquart avait été l’informateur, comme le soutient Adrien Abauzit sur la seule base d’une conclusion qu’il estime « logique », Picquart aurait fait montre en l’espèce d’une terrible inconscience… ou aimait pour le moins se faire peur. Et s’il peut être intéressant et sans doute nécessaire d’expliquer pourquoi, s’il était l’auteur de la fuite, Picquart faisait cette demande d’enquête, il serait plus intéressant encore de se demander pourquoi Boisdeffre et Gonse firent le choix de ne pas l’ordonner.
Maintenant regardons ce que dit ce fameux article. Résumons-le : il racontait que des fuites, dès le début de 1894, avaient été constatées mais que les recherches entreprises pour en découvrir le coupable n’avaient rien donné. En septembre, une lettre chiffrée échangée entre les attachés militaires allemand et italien avait permis d’identifier enfin le traître. La lettre en effet, une fois décryptée, en donnait le nom en toutes lettres : « Décidément cet animal de DREYFUS devient trop exigeant. » Une enquête avait été alors menée qui indiquait en effet que Dreyfus, qui inspirait à son chef « une vive répulsion », était par sa situation « à même de livrer ces secrets dont on constatait “la fuite” ». Mais le ministre n’avait pas la moindre marge de manœuvre. Confondre le traître ne pourrait se faire qu’en révélant la lettre, et révéler la lettre équivalait à avouer non seulement le détournement d’un document diplomatique mais encore la possession du chiffre de correspondance des attachés militaires étrangers. Par chance, quelques jours plus tard, un nouveau document avait été intercepté, « lettre non signée », « bordereau d’envoi d’un dossier » d’un espion à l’ambassade allemande qui annonçait la livraison :
1° De la description détaillée du frein de la pièce de 120 court qui n’était pas encore
en service ;
2° Du projet de manuel de tir de l’artillerie ;
3° Du projet de manuel de tir de l’infanterie ;
4° Des mesures arrêtées pour la mobilisation de l’artillerie à la suite de la loi du 29
juin 1894, supprimant les pontonniers et créant vingt-huit nouvelles batteries ;
5° Du plan d’opération pour l’expédition de Madagascar établi par le général
Renouard, premier sous-chef d’État-major de l’armée.
L’article racontait ensuite l’enquête qui rapidement avait abouti à Dreyfus. Les similitudes entre son écriture et celle – « qui du reste était déguisée » – du bordereau étaient « telles » que le chef du 1er bureau, auteur de la découverte, « resta convaincu qu’elles émanaient de la même personne ». Dreyfus avait été ensuite filé « et bientôt les agents du service des renseignements purent s’assurer que le capitaine Dreyfus entretenait, à Paris même, des relations avec une personne affiliée au service d’espionnage du grand état-major allemand ». Dreyfus avait été ensuite convoqué le 15 octobre au matin. Le commandant Du Paty de Clam, chargé de l’accueillir, lui avait demandé de prendre en dictée une lettre qui était mot pour mot le bordereau intercepté. Aux premiers mots, « le capitaine pâlit ; sa main trembla, la plume décrivait des sinuosités ». La main fut bientôt « agitée par un tremblement nerveux » ; Dreyfus se trahissait. Il avait donc été arrêté et aussitôt mené au Cherche-Midi. Des perquisitions à son domicile avait été ensuite effectuées qui ne donnèrent aucun résultat : « Les pièces compromettantes avaient été mises à l’abri, probablement dans le coffre-fort d’un complice. » Ce complice, l’État-major le connaissait. Mais il avait préféré ne pas s’en occuper pour ne pas courir le risque que cette introduction d’un civil dans l’affaire ne fît échapper le traître au conseil de guerre en le menant devant la cour d’assises. Dans l’optique du procès, des expertises de la lettre avaient été commandées à cinq experts dont deux seulement s’étaient montrés affirmatifs quand les trois autres étaient demeurés hésitants. Le bordereau ne pouvait donc « être qu’un élément moral dans la cause » et pour cela l’accusé, qui persistait « à protester de son innocence », risquait d’« échapper à son châtiment ». La décision avait donc été prise de produire la première pièce interceptée, « si grave », si « exceptionnellement confidentielle ». Le ministre ne pouvant « s’en dessaisir sans une réquisition de la justice », une perquisition avait donc été « opérée au ministère ». Mais il n’était pas question de verser un tel document aux débats. « Elle fut donc communiquée aux juges seuls, dans la salle des délibérations. » (On en trouvera le texte intégral ici).
Qui aurait eu intérêt à inventer l’histoire du chiffrage de la pièce « Ce canaille de D » qui, nous le savons, était en clair, si ce n’est ceux à l’origine de l’illégalité dont ils justifiaient et excusaient ainsi le recours ? L’article lui-même le disait : « Le ministre de la Guerre ne crut pas devoir faire usage contre Dreyfus d’une lettre qui pouvait être considérée comme faisant partie de la correspondance diplomatique, et dont la traduction indiquait en tout cas que nous connaissions un chiffre qui, précisément à ce moment, pouvait nous être de la plus grande utilité. » Qui avait intérêt aussi à inventer l’histoire du complice laissé en liberté, si ce n’est le général Mercier à qui il avait été reproché de n’avoir guère cherché de ce côté ? Ainsi pourrait-on comprendre pourquoi le complice, si complice il y avait, avait pu passer à travers les mailles du filet : l’arrêter aurait permis à Dreyfus d’échapper au conseil de guerre et de là, peut-être, à son juste châtiment. De même de la fable de la perquisition au ministère. Quel intérêt de l’inventer si ce n’est pour protéger ceux qui avaient intérêt à montrer que si le procédé de la transmission de la pièce en salle des délibérations n’était pas des plus réguliers, la décision en avait été prise au terme d’une procédure qui respectait – ou tout au moins semblait respecter – la légalité ? Et que penser de cette mention du manuel de tir de l’infanterie dans la version délibérément fautive du bordereau ? Il n’en avait jamais été question que dans les dépositions Brault et Sibille lors de l’instruction d’Ormescheville. Et comme il n’avait jamais été possible de prouver que Dreyfus avait eu entre les mains le projet de manuel de tir d’artillerie (la question avait été abandonnée au procès), il était possible de le faire pour celui de l’infanterie puisque ses deux camarades avaient témoigné du désir qui avait été celui de Dreyfus d’avoir des renseignements à son propos. Quel eût été l’intérêt de Picquart de transformer ainsi le texte, qu’il connaissait, du bordereau, et qui ainsi ne pouvait être utile qu’à Mercier et à l’État-major ? Préparer le terrain pour le mémoire que Lazare allait publier quelques semaines plus tard, nous répondra sans doute Adrien Abauzit, comme il l’écrivait dans son premier volume (p. 194). Mais pour cela il faudrait ne pas se contenter de dire qu’existait entre Lazare et Picquart une entente, il faudrait le prouver et trouver une explication aux phrases terribles, dans leurs notes personnelles et leur correspondance privée, que chacun écrivit sur l’autre, le premier trouvant le second bien trop antisémite et le second trouvant le premier bien trop juif. Nous en reparlerons dans notre seconde livraison.
Mais revenons pour finir du côté de Léonie. Et reposons la question : si Mathieu a inventé cette histoire de voyante, quel était son intérêt ? Qu’est-ce que cela changeait ? Qu’est-ce que cela prouvait puisque l’article de L’Éclair avait annoncé à toute la France l’existence du dossier secret ?
• Introduction, p. 11-13. Sur les spéculations sans queue ni tête concernant l’envoi du manuel de tir.
Adrien Abauzit cite le passage du bordereau le concernant, un extrait de son premier livre, puis le général Roget et enfin Demange. Pour Adrien Abauzit, preuve est faite que le manuel de tir n’a pas été envoyé à l’ambassade et que c’est contre toute logique que nous soutenons le contraire. Là encore nous avons répondu. En 2021 – il semble que nous allons nous répéter ainsi tout au long de ces pages –, variant deux longs développements de 2018, nous écrivions, relevant l’ambiguïté syntaxique qui autorise deux compréhensions :
Redonnons-le texte :
5° Le projet de manuel de tir de l’artillerie de campagne (14 mars 1894). Ce dernier document est extrêmement difficile à se procurer et je ne puis l’avoir à ma disposition que très-peu de jours. Le ministère de la guerre en a envoyé un nombre fixe dans les corps et ces corps en sont responsables, chaque officier détenteur doit remettre le sien après les manœuvres. Si donc vous voulez y prendre ce qui vous intéresse et le tenir à ma disposition après, je le prendrai. À moins que vous ne vouliez que je le fasse copier in extenso et ne vous en adresse la copie.Première lecture (accusation) :
Le projet de manuel de tir de l’artillerie de campagne (14 mars 1894). Ce dernier document est extrêmement difficile à se procurer [i.e. je ne l’ai pas] et je ne puis l’avoir à ma disposition que très-peu de jours [i.e. et si je le récupère je ne pourrai l’avoir que peu peu temps]. Le ministère de la guerre en a envoyé un nombre fixe dans les corps et ces corps en sont responsables, chaque officier détenteur doit remettre le sien après les manœuvres. Si donc vous voulez y prendre ce qui vous intéresse et le tenir à ma disposition après [i.e. si vous êtes prêt à faire la copie de ce qui vous y intéresse et me le rendre], je le prendrai [i.e. je le le procurerai et vous le transmettrai]. À moins que vous ne vouliez que je le fasse copier in extenso et ne vous en adresse la copie.Seconde lecture :
Le projet de manuel de tir de l’artillerie de campagne (14 mars 1894) [i.e. le voici]. Ce dernier document est extrêmement difficile à se procurer [i.e. j’ai eu du mal à l’avoir] et je ne puis l’avoir à ma disposition que très-peu de jours [i.e. et je ne l’ai que pour quelques jours]. Le ministère de la guerre en a envoyé un nombre fixe dans les corps et ces corps en sont responsables, chaque officier détenteur doit remettre le sien après les manœuvres. Si donc si vous voulez y prendre ce qui vous intéresse et le tenir à ma disposition après [i.e. si vous voulez y copier ce que vous intéresse et me le mettre de côté une fois que vous aurez terminé], je le prendrai [i.e. je viendrai le récupérer]. À moins que vous ne vouliez que je le fasse copier in extenso et ne vous en adresse la copie [sauf si vous préférez que je vous envoie une copie que je ferai réaliser et sous-entendu ici, il faut me le rendre].Les deux versions sont possibles étant donné la langue plus qu’approximative dans laquelle est écrit ce morceau. Mais ce qui importe, et que nous évertuons à expliquer à Adrien Abauzit, c’est que ce texte ne vaut que par son contexte et que c’est ce contexte qui permet d’en comprendre le sens. Reprenons le bordereau, et ce que nous disions précédemment :
……………………… je vous adresse cependant, Monsieur, quelques renseignements intéressants :
1° Une note sur……………………….
2° Une note sur……………………….
3° Une note sur……………………….
4° Une note relative à……………..
5° Le projet de manuel de tir de l’artillerie de campagne (14 mars 1894). ………………………..Si l’auteur du bordereau avait envoyé une note sur le manuel et non le manuel, comme le soutient Adrien Abauzit, sans doute aurait-il continué avec un 5° qui aurait été, comme les autres : « une note sur le manuel… » ?
……………………… je vous adresse cependant, Monsieur, quelques renseignements intéressants :
1° Une note sur……………………….
2° Une note sur……………………….
3° Une note sur……………………….
4° Une note relative à……………..
5° Une note sur le projet de manuel de tir de l’artillerie de campagne (14 mars 1894).Si on écrit, ainsi que commence le bordereau, qu’on adresse par un courrier « quelques renseignements intéressants » qui sont : 1° une note, 2° une note, 3° une note, 4° une note, 5° le manuel de tir, c’est qu’on a envoyé 4 notes et un manuel de tir… pas 5 notes…
De cela, que nous répétons donc depuis le début, depuis le premier compte rendu, en 2018 (rappelons que nous sommes en 2024), Adrien Abauzit ne dit rien et fait comme si l’argument n’existait pas. Et c’est nous qui nous nous dérobons, nous qui « n’examin[ons] aucune des preuves ou indices qu[‘il] invoque » et nous qui faisons dire aux textes ce qu’ils ne disent pas.
Cela dit, à la suite, Adrien Abauzit, relevant le « caractère saugrenu de cette assertion » qui consiste à dire que « l’espion envoie le manuel de tir à l’ambassade pour ensuite demander qu’on le lui renvoie pour en faire une copie », ajoute : « Comme si personne à l’ambassade n’était capable de se munir d’un stylo [sic] pour faire cette copie ! Pour reprendre une formule déjà employée dans Nouvelle réplique, à moins que tout le personnel de l’ambassade ne soit manchot, la thèse de la SIHAD est invraisemblable. » Manchot, certainement pas. Mais l’auteur du bordereau insistant sur le fait qu’il n’avait le manuel à sa disposition que très peu de jours, il fallait faire vite et Esterhazy le pouvait, disposant de copistes qui régulièrement travaillaient pour lui. Mais accordons-nous avec Adrien Abauzit et admettons qu’il n’ait pas été envoyé, ce manuel. Pourquoi alors proposer aux Allemands de le faire copier dans le cas où ils en voudraient le texte intégral ? Le personnel de l’ambassade était-il manchot ?
Et encore une fois, quelle est l’importance de tout cela ? Qu’importe en effet ce que dit cette phrase écrite en un français approximatif ? Il y est question d’un manuel et c’est tout ce qui compte. Que le manuel ait été envoyé ou n’ait pas été envoyé ne change absolument rien : l’auteur du bordereau l’avait à sa disposition ou pouvait se le procurer qu’il l’ait envoyé ou qu’il proposa de le faire. Et passer du temps sur cette question dérisoire et secondaire est justement ce que la langue française définit précisément tout autant comme étant une dérobade que comme une diversion.
• Introduction. Sur les pièces « télémètre » et « chemins de fer » : pour essayer de s’en sortir la SIHAD dénature les débats et change de version en cours de route, p. 13-15.
Adrien Abauzit explique que la SihaD a dû « confesser des “imprécisions”… qui en réalité sont des erreurs factuelles, trompant complètement le jugement du lecteur ». Ensuite, Adrien Abauzit note le « plus grave » : « la SIHAD change sa version des événements de son deuxième texte de réplique ».
Prenons ces deux remarques dans l’ordre :
1° imprécisions.
Voyons quelles elles sont. Là encore, puisque nous avons répondu en 2021, après en avoir déjà parlé en 2018, reprenons notre texte :
P. 40-51. Où nous proposons à Adrien Abauzit, à propos des pièces 26 et 267 du dossier secret, de tenter de considérer que les choses ne sont pas aussi simples qu’il le croit… De « nouveaux éléments de réponse » d’Adrien Abauzit qui méritent commentaires. Reprenons le dossier en reprenant tout d’abord les considérations d’Adrien Abauzit à notre propos. Il a trouvé une micro-faille et il s’y engouffre avec une joie dont nous ne voudrions en aucun cas le priver. Nous avons commis des imprécisions dans notre compte rendu, c’est vrai, et nous l’avons dit. Nous avons parlé « d’enregistrement des pièces » quand nous aurions dû parler de « transmission au ministre », pire même de « récupération par la Bastian » quand nous aurions dû parler « d’écriture par Panizzardi ». Parce que nous avons fait cela, dont nous reconnaissons la faute, la très grande faute, Adrien Abauzit nous accuse de « tronquer la vérité », de « dénaturer la problématique », constate « nos erreurs factuelles » et « nos erreurs de raisonnement ». S’il y trouve son plaisir nous le lui concédons bien volontiers. Ensuite, reprenant la citation d’Henry que nous lui opposions et selon laquelle « les récoltes de la voie ordinaire livraient des pièces datant de “deux à trois jours” », il constate notre incapacité « d’en citer un[e] seule ». Nous ne savions pas qu’il fallait que nous le fassions et à vrai dire nous ne pensions pas avoir à prouver une affirmation d’Henry. Naïvement nous pensions que le témoignage d’Henry – indiscutable, pourtant, le « premier sang français » ! – pouvait suffire. Et nous le pensions d’autant plus que nous y ajoutions les témoignages de Brücker et de la Bastian (qui n’ont pas retenu l’attention d’Adrien Abauzit ; trois témoignages tout de même !) qui parlent, pour le premier – nous étions encore imprécis ou tout au moins pas assez précis – , de livraisons au ministère le jour même, le lendemain et jamais plus de trois jours après la récolte et, pour la seconde, de « trois à quatre » livraisons par semaine, soit, donc, en moyenne, une livraison tous les deux jours. Un dernier témoignage d’ailleurs (« contradictoirement débattu ») de la principale intéressée, qui contredit pour le moins les mensonges de Gonse qu’Adrien Abauzit prend pour argent comptant dans son premier livre (p. 42-43).
2° Changement de version.
La réponse a été donnée en 2021, dans un passage qui n’a pas pas eu plus de chances que les précédents :
Enfin, pour en finir avec ses considérations à notre propos, Adrien Abauzit nous reproche une « variation de dernière minute », à savoir notre proposition, qui ouvrait juste une possibilité, que Lauth eût pu, exceptionnellement, remplacer Henry si Henry ne pouvait rencontrer la Bastian. Écrire que « la SIHAD […] nous apprend que ce ne serait pas Henry, mais peut-être le commandant Lauth qui aurait vu madame Bastian… » n’est pas très honnête et il suffit de voir ce que nous avions écrit et qu’il reproduit en note pour comprendre que nous n’apprenions rien mais que nous envisagions une possibilité (« rien ne nous dit que Lauth n’ait pas pu exceptionnellement remplacer Henry pour aller soulager la Bastian de sa récolte… mais à vrai dire la question importe peu »).
Et redonnons ce premier texte sur lequel s’appuie ici Adrien Abauzit pour voir en quelle mesure il constitue ou non une « variation de dernière minute » :
Mais même si la question nous semble définitivement réglée, n’écartons pas la question des dates. Il est vrai qu’entre une pièce écrite le jeudi 28 mars et transmise au ministre le lundi 1er avril, le délai est très court et ce d’autant plus que selon le témoignage de Cuignet repris par Yves Amiot, « preuve décisive » [sic], Henry n’aurait pas vu la Bastian entre le 23 mars et le 1er avril. Il a bien fallu que les choses fussent telles puisque la preuve est faite pour toute personne de bonne foi que les pièces furent jetées dans le même mouvement et bien évidemment ramassées de même. Adrien Abauzit n’osera pas, pensons-nous, nous dire qu’après avoir déchiré les deux pièces, Schwartzkoppen aurait trié les morceaux nécessairement mélangés, jeté ceux de la première et gardé ceux de la seconde pendant un an avant de les jeter à leur tour !?! Mais revenons à nos dates. Admettons encore qu’on puisse croire Cuignet sur parole même si, comme il a été montré dans un article publié dans un des anciens bulletins de la SIHAD, Cuignet avait indiscutablement menti (et ce n’était pas la première fois ; nous avons le curieux sentiment que la réponse d’Adrien Abauzit à ce papier ne portera que sur ce point) dans la manière qui avait été la sienne de parler de ces pièces dans sa série de L’Éclair de 1906. Déjà, rien ne nous dit que Lauth n’ait pas pu exceptionnellement remplacer Henry pour aller soulager la Bastian de sa récolte… mais à vrai dire la question importe peu. Schwartzkoppen a eu les deux lettres le 28 (elles étaient urgentes comme en témoigne le contenu et avaient été apportées par le domestique de Panizzardi) ; il les lit, les déchire et les jette ; le 29 au matin, la Bastian les récupère ; ce même 29 ou le lendemain 30 mars, elle remet son cornet à Henry (qui n’est pas parti en permission), cornet dont on ne sait s’il était important ou pas mais qui contient quoi qu’il en soit les deux lettres du 28 mars ; Henry, chez lui (29) ou au ministère (30), fait le tri immédiatement, recolle les pièces, et le 30 ou le 1er (laissons-le se reposer le dimanche 31) les donne à enregistrer et à copier, et fait transmettre les documents au ministre. […].
Cela n’est pas changer de version et le soutenir procède d’une curieuse manière d’envisager la discussion et plus encore la vérité. Où changeons-nous ici de version puisque nous soutenons que, Cuignet racontant souvent ce qui l’arrange, Henry n’était pas en permission (second gras dans la citation) ? Nous ouvrions juste une petite parenthèse pour ne pas laisser de côté une possibilité, possibilité à laquelle nous n’attachions que peu d’importance (« la question importe peu »). Adrien Abauzit, qui reproche aux autres les diversions qu’ils ne font pas, se rue cette question dérisoire et ne retient d’une longue démonstration qu’une toute petite phrase, hors propos, à laquelle il prête une attention qu’elle ne mérite pas, une intention qui n’est pas la sienne et une importance qu’elle n’a pas ! Car nous y insistons : Amyot, qu’Abauzit reprend, se trompe et Cuignet, qui est sa source, raconte ici le contraire de ce qu’il dit ailleurs. À la suite de l’extrait que nous venons de donner, nous développions cela, en 2021 :
[T]out ça est sans intérêt puisqu’Adrien Abauzit a la « preuve décisive », l’argument « imparable » qui doit mettre fin à la discussion. Donnons-le ici : Henry – et pas Lauth – n’aurait pu récupérer les documents de la Bastian entre le 28 mars 1895, date d’écriture des pièces retenue par la Cour de cassation, et le 31 mars, veille de la transmission des pièces au ministre, parce qu’Henry était alors en permission. Et là, il n’y a plus rien à dire. De cette affirmation, décisive, imparable, il n’y a aucune autre trace que ce qu’en dit Cuignet (qui la fonde sur les registres de paiements de la SS aujourd’hui perdus) et Adrien Abauzit l’a tirée de son prédécesseur Amyot (qui ne donne pas sa source). Nous avions laissé, lors de notre réponse précédente, cet imparable argument de côté… dont on notera d’ailleurs et au passage qu’il n’est pas de ces pièces « contradictoirement débattu[e]s lors des différentes procédures » et qui du coup, si on devait suivre Adrien Abauzit dans cette curieuse argumentation, ne représentent pas le moindre intérêt : « comme si on pouvait y trouver des arguments nouveaux de première importance, non contradictoirement débattus lors des différentes procédures » (p. 28) !
Comme Adrien Abauzit fréquente peu les sources primaires, il nous a semblé de notre devoir de lui en dire un peu plus sur cette « preuve » et de lui donner les références que ne donne par son prédécesseur… Le témoignage existe bien et, nous le connaissons que trop, a été publié par Cuignet dans L’Éclair du 23 juin 1906 (« Le faux André et le rapport Moras »). Cuignet est particulièrement intéressé dans l’affaire puisqu’il est un des tenants de l’accusation, il n’est pas un témoin des plus fiables mais il a témoigné. Soit… mais une question nous taraude. Dans une première série en mars, dans le même journal, Cuignet avait déjà parlé de ces pièces et avait déjà discuté la question des dates qui sont, aux yeux d’Adrien Abauzit, la clé de toute explication. Il avait alors insisté sur le temps très court entre le 28 mars et le 1er avril pour que les documents passassent de l’ambassade italienne au cabinet du ministre et avait mis en avant un argument qui, s’il n’est pas imparable celui-là, est frappant : « Pour que ces débris parvinssent ensuite [le 29 mars] à Henry, il fallait », entre autres, « qu’Henry et la voie ordinaire se rejoignissent ». C’est d’une logique implacable mais ce n’est pas là qu’est l’intérêt de la chose. Il poursuit :Supposons que toutes ces conditions aient été remplies dans la journée du 29 mars… C’était bien juste, mais enfin, admettons-le… Le 29 mars 1895 au soir, Henry est donc en possession de la pièce du télémètre.
Combien de temps a-t-il pour reconstituer la pièce ? Pour retrouver les fragments disséminés au milieu de cent ou cent cinquante autres fragments appartenant à des pièces différentes ?… Il a exactement à sa disposition une nuit et un jour, ou plutôt un jour, car il ne travaillait pas la nuit.
[…] Henry n’aurait eu à sa disposition que la journée du 30 pour reconstituer la pièce, retrouver ses fragments mélangés avec une multitude d’autres fragments. (« Le Faux André », L’Éclair, 8 mars 1906).Henry est en possession le 29… Il ne dispose que d’un jour… Il n’aurait eu que la journée du 30… Mais alors, si Henry est « en possession » et ne dispose que d’un jour, c’est qu’Henry n’était pas en permission ? Comment expliquer que Cuignet, en juin 1906, pût affirmer qu’Henry était en permission dans la Marne entre le 23 et le 31 mars 1895 et ne pouvait donc pas se voir avec la Bastian, et que, quelques mois plus tôt, il parlait de sa présence à la SS précisément pendant la permission en question, parlait de sa rencontre avec la Bastian, etc. ? Cuignet avait-il oublié cette preuve imparable tout autant que définitive, en mars, lorsqu’il s’évertuait, épluchant le calendrier, à démontrer que les pièces 26 et 267 n’étaient pas arrivées en 1895 mais bien en 1894 ? La chose lui était-elle sortie de l’esprit en mars et revenue, tout à coup, en juin ? Certainement pas puisque, comme il le disait dans l’article du 23 juin, il avait fait part de cette preuve « imparable » et tout autant « définitive », deux ans plus tôt, le 16 mai 1904, lors de son audition devant la Cour de cassation. Un témoignage donné mais qui aurait été caviardé par les magistrats « dreyfusards » et qui de ce fait n’apparaît nulle part… C’est si pratique et bien sûr vrai, puisque Cuignet le dit… Si Adrien Abauzit devait nous répondre – dans deux ans et à condition bien sûr qu’il ne passe pas tout cela sous silence –, il est probable qu’il nous dirait que Cuignet voulait ici démontrer l’impossibilité de la chose, dans l’absolu… Resterait à comprendre pourquoi, alors qu’il possédait une preuve « imparable », mieux même « définitive », il n’en parla pas quand le moment était propice – le moment de la rédaction du travail du rapporteur de la Cour de cassation –, et remplit des colonnes à démontrer l’impossibilité calendaire ? Pourquoi se perdre en discussion et ne pas donner, quand on l’a en mains, l’argument capital ? On conviendra qu’il eût été plus simple, plus logique, plus efficace, de dire, en mars, que la raison pour laquelle la pièce était arrivée en 1894, c’est que si elle était arrivée l’année suivante, entre le 28 mars, date de sa rédaction, et le 1er avril, date de sa transmission au ministre, Henry, en permission dans la Marne, en famille, ne pouvait la récupérer ? Pourquoi attendre que les travaux de la Cour de cassation soient pour ainsi dire achevés pour livrer une « preuve » tout à coup sortie du chapeau et que personne ne pourra voir puisque les vilains – manque de chance – l’ont supprimée ?
Adrien Abauzit nous dira peut-être aussi que ces articles de mars n’ont pas été « contradictoirement débattus lors des différentes procédures »… Mais il ne le fera pas parce que nous lui dirons que ceux de juin ne le furent pas non plus et qu’on est en droit de s’interroger sur la matérialité d’une partie de déposition absente – contrairement à ce qu’affirme Cuignet – du texte autographié de sa déposition devant la Cour de cassation, de la sténographie qui en fut publiée et qui est conforme (la vérification peut se faire en allant aux Archives Nationales). Une preuve si peu « imparable » et si peu « définitive » que même Dutrait-Crozon, qui normalement ramassait tout, a préféré la laisser de côté. Nous savons que pour les antidreyfusards, les magistrats de la Cour de cassation étaient des menteurs et des faussaires, ne faisant pas figurer à la sténographie ce qui gênait l’innocence de Dreyfus et, à en croire Cuignet, faisaient même tenir aux témoins des propos qu’ils n’avaient pas tenus. Mais si telle est la vérité – difficilement recevable, tout de même – il faudra alors qu’Adrien Abauzit réfléchisse à la question de ses sources et parte du principe que par définition tout ce qu’il tire des quelques procédures qu’il a lues, et surtout quand cela concerne l’accusation qui sont les parties qu’il utilise préférablement, n’a aucune valeur puisque les magistrats de la Cour de cassation ont bricolé les textes. Il est pour le moins paradoxal de soutenir d’un côté que seules les procédures ont de la valeur et d’un autre côté que leur sténographie en est falsifiée.
En mars donc, pour Cuignet, Henry n’est pas en permission ; tout à coup il se souvient de la dite permission (du 23 au 31 mars), en parle en juin puis – nous l’ajoutons ici à notre précédente explication – l’oublie à nouveau dans un nouvel article publié dans le même Éclair du 6 juillet 1906 ! (« Henry n’a donc pu recevoir les débris que le 29 au soir » ; « Henry, mis en possession des débris le 29, à la nuit tombée, n’a pu travailler à leur réunion et à la reconstitution de la pièce que le 30 au matin » ; « c’est avant 5 heures du soir [le 30 mars] que la pièce elle-même aurait dû être reconstituée par Henry et recopiée par Gribelin » ; « Ceci étant, le temps matériel faisait défaut à Henry pour opérer la reconstitution dans le peu d’heures dont il disposait »)… Drôle de témoin… Et plus drôle de témoin encore que celui qui, pour prouver ses dires, falsifia les documents dans la version qu’il en donna dans une de ses séries à la presse. La démonstration est longue et nous renvoyons à un article qui le montre : « Le “faux Cuignet” », Bulletin de la SihaD, n° 5, été 1998, p. 11-15.
Nous n’avons donc en rien changé notre version. Nous avons ouvert une parenthèse que nous avons vite refermée, et nous nous sommes longuement interrogés sur les curieux témoignages de Cuignet qui mettent sérieusement en doute la question de la réalité de la permission d’Henry. De tout cela, n’est retenue que la parenthèse pour y voir ce que nous ne faisons pas, à savoir changer de version. Mais quand bien même aurions nous changé de version, que cela ne serait ni un drame, ni un crime. Ce serait juste faire de l’histoire, matière vivante s’il en est. Car faire de l’histoire, c’est ne pas craindre d’envisager les hypothèses, toutes les hypothèses pour trouver l’explication (comme celle par exemple concernant Lauth) ; faire de l’histoire, honnêtement, c’est aussi corriger une formulation quand elle semble ne pas être assez précise et même reconsidérer totalement une hypothèse quand on découvre un fait ou un document, ou quand on lit une démonstration qui vient la contredire et parfois la réduire à néant. C’est la définition même de la science, historique, ou pas, dont le doute et la possible remise en question sont les principes qui la fondent.
• Introduction. Précisions liminaires, p. 16.
Nous en avons déjà parlé. Inutile donc d’y revenir.
Nous arrêtons là pour le moment. Dans quelques temps, la suite…
po