Georges Sorel, dans La Révolution dreyfusienne, écrit que « l’affaire Dreyfus ne mérite vraiment d’être racontée en détail que dans la forme du roman-feuilleton[1] ». Elle s’y prête assurément en ce qu’elle en contient tous les ingrédients : des personnages fortement typés, des héros et des traîtres, des morts énigmatiques, de constants rebondissements, des secrets et des révélations qui ne pouvaient qu’exciter les imaginations. Exciter l’imagination, sans doute, mais aussi le goût de la réclame de quelques-uns qui se fixèrent la mission de nous dire ce que nous ne savons pas et qui à vrai dire ne nous intéresse que rarement. Aux « mystères » qui existent, et qui sont assurément à relativiser, il fallait donc en ajouter d’autres pour découvrir quelques vérités cachées et dire le fin mot de l’histoire. Reprenons donc la lecture de ces trop nombreux ouvrages « du doute et du soupçon », comme le dit très justement Vincent Duclert, « élucubrations les plus futiles proférées du haut de l’érudition la plus revendiquée et la moins solide sur les “mystères cachés” de l’Affaire et de Dreyfus »[2].

 Dans ce qui deviendra une course effrénée à la révélation, celui qui ouvrit la voie fut, dans les années 30, Henri Mazel, poète symboliste, chantre de l’Idéalisme, partisan d’un arisme pré-fasciste et directeur de la revue L’Ermitage au début des années 1890. En 1934, il publia une Histoire et psychologie de l’affaire Dreyfus qui, tout en reprenant à l’antienne un certain nombre de refrains antidreyfusards[3] pour en arriver à dire qu’il n’y avait « rien eu de monstrueux dans l’erreur judiciaire dont le malheureux capitaine a été victime » (p. 205), avait pour but de permettre d’« obtenir définitivement [la] réconciliation » (p. 199 et 207). Sans poser la moindre hypothèse – ce qui est une constante du genre –, il révélait qu’il n’y avait pas eu trahison mais « une très subtile mystification machinée par M. de Schwartzkoppen ». Pourquoi ? Simplement pour « jouer un tour » – et quel tour ! – à Sandherr et à Esterhazy, agent de la Section de statistique, qui avaient tenté à ses dépens une intox… Voilà, c’est tout. Quelles preuves venaient étayer une telle thèse ? Aucune à vrai dire, si ce n’est que pour Mazel, et il en faisait une démonstration peu concluante, il était évident que le bordereau ne pouvait ni émaner d’un espion ni d’un officier français. Une intox, donc, qui pouvait expliquer l’usage du papier pelure, la thèse de la forgerie avancée par la plupart des experts, etc. Rien de plus.
Dans ce qui deviendra une course effrénée à la révélation, celui qui ouvrit la voie fut, dans les années 30, Henri Mazel, poète symboliste, chantre de l’Idéalisme, partisan d’un arisme pré-fasciste et directeur de la revue L’Ermitage au début des années 1890. En 1934, il publia une Histoire et psychologie de l’affaire Dreyfus qui, tout en reprenant à l’antienne un certain nombre de refrains antidreyfusards[3] pour en arriver à dire qu’il n’y avait « rien eu de monstrueux dans l’erreur judiciaire dont le malheureux capitaine a été victime » (p. 205), avait pour but de permettre d’« obtenir définitivement [la] réconciliation » (p. 199 et 207). Sans poser la moindre hypothèse – ce qui est une constante du genre –, il révélait qu’il n’y avait pas eu trahison mais « une très subtile mystification machinée par M. de Schwartzkoppen ». Pourquoi ? Simplement pour « jouer un tour » – et quel tour ! – à Sandherr et à Esterhazy, agent de la Section de statistique, qui avaient tenté à ses dépens une intox… Voilà, c’est tout. Quelles preuves venaient étayer une telle thèse ? Aucune à vrai dire, si ce n’est que pour Mazel, et il en faisait une démonstration peu concluante, il était évident que le bordereau ne pouvait ni émaner d’un espion ni d’un officier français. Une intox, donc, qui pouvait expliquer l’usage du papier pelure, la thèse de la forgerie avancée par la plupart des experts, etc. Rien de plus.
 Le deuxième ouvrage de cette série, Les Côtés mystérieux de l’affaire Dreyfus, parut trois ans plus tard. L’auteur, Armand Charpentier, dreyfusard émérite, y présentait une thèse – qui rencontrera un certain succès – qui devait permettre d’expliquer les fameuses zones d’ombres, à son point de vue nombreuses, de l’Affaire. Comment expliquer que coïncident si parfaitement la date (juillet 1894) à laquelle, selon les dires d’Esterhazy, Sandherr lui avait demandé d’entrer en relation avec les allemands[4] et celle donnée par Schwartzkoppen dans ses Carnets[5] ? Comment expliquer que Schwartzkoppen ait pu soutenir, toujours dans ses Carnets, n’avoir jamais reçu le bordereau ? Pourquoi, après avoir encouragé Picquart, quand il découvrit Esterhazy, à continuer son enquête, Gonse et Boisdeffre lui demandèrent-ils, tout à coup, fin août 1896, de l’abandonner ? Pourquoi les hommes de l’État-major décidèrent-ils, l’année suivante, de venir en aide à Esterhazy et de le protéger ? Pourquoi Boisdeffre avait-il parlé à Judet de la « valeur » des « service rendus » par Esterhazy et lui avait avoué ne pas connaître « le premier mot de l’Affaire » ? Qu’étaient ces preuves inconnues dont avait parlé le même Boisdeffre à Du Paty ? Et qu’étaient ces documents que Sandherr gardait « par devers [lui] » dont Henry avait parlé au procès Zola ? Étaient-ils les mêmes que ceux de ce dossier dont Sandherr avait dit à Du Paty, sans vouloir le lui montrer, qu’il « ne verra[it] jamais le jour[6] » ? Et ne pouvait-on croire Esterhazy qui, les dernières années, avait affirmé à tous et sans se lasser jamais qu’il avait écrit le bordereau sur les ordres et sous la dictée de Sandherr ? Pourquoi, encore, la veuve Henry avait-elle dit à Charpentier qu’elle jugeait « impossible que l’on puisse pour l’Histoire, faire un récit exact [de l’Affaire] avec des éléments trop pauvres et trop insuffisamment exacts[7] » ? Pour Charpentier, la réponse à toutes ces questions se trouvait dans la déposition de Wattinne faite à l’occasion de la seconde révision. Le gendre de Billot avait en effet raconté qu’à la question qu’il avait posée à Henry visant à savoir ce que pouvait avoir Sandherr « contre Dreyfus », il avait reçu pour réponse qu’il existait « quelque chose de particulier qu’[il] n’[avait] jamais connu », « une lettre venant d’Alsace et touchant quelqu’un de sa famille [de la famille de Dreyfus] ou de ses relations »[8]. Pour Charpentier, puisqu’il y avait un dossier dont Sandherr avait parlé à Henry et à Du Paty, cette lettre, perdue ou en tout cas depuis introuvable, devait en faire partie. Mais comment l’avait-il obtenue ? Et de qui ? Pour Charpentier, le correspondant de Sandherr, l’auteur de la « lettre d’Alsace », ne pouvait être qu’un de ses parents. Pourquoi ? Parce qu’ainsi seulement pouvait s’expliquer le secret, « secret qu’il n’eût pas gardé si les documents accusateurs lui avaient été adressés directement par un agent de contre-espionnage dont il n’aurait pas eu à cacher le nom ». Au terme d’une longue enquête en Alsace, Charpentier avait pu découvrir la trace d’un certain René Kullmann qui avait rendu « d’immenses services au 2e Bureau, tant que [son parent] Sandherr en [avait été] le chef ». Le parent était trouvé mais quel rapport avec Dreyfus ? Écoutons Charpentier raconter son histoire. Un jour de 1894, « un quelconque Dreyfus », nom « très répandu en Alsace », « voyageant dans l’Est français », aurait « pris quelques photographies de nos fortifications, en y ajoutant de menues notes » et aurait transmis le tout « à la police de Strasbourg, afin de se concilier les faveurs des autorités allemandes ». « Par une filière difficile à préciser [sic], ces notes, sur lesquelles figure le nom du voyageur Dreyfus, vont entre les mains de René Kullmann qui les envoie au colonel Sandherr. » Sandherr, découvrant cela, aurait cherché son traître et, commettant une erreur, porté ses soupçons sur le pauvre Dreyfus.
Le deuxième ouvrage de cette série, Les Côtés mystérieux de l’affaire Dreyfus, parut trois ans plus tard. L’auteur, Armand Charpentier, dreyfusard émérite, y présentait une thèse – qui rencontrera un certain succès – qui devait permettre d’expliquer les fameuses zones d’ombres, à son point de vue nombreuses, de l’Affaire. Comment expliquer que coïncident si parfaitement la date (juillet 1894) à laquelle, selon les dires d’Esterhazy, Sandherr lui avait demandé d’entrer en relation avec les allemands[4] et celle donnée par Schwartzkoppen dans ses Carnets[5] ? Comment expliquer que Schwartzkoppen ait pu soutenir, toujours dans ses Carnets, n’avoir jamais reçu le bordereau ? Pourquoi, après avoir encouragé Picquart, quand il découvrit Esterhazy, à continuer son enquête, Gonse et Boisdeffre lui demandèrent-ils, tout à coup, fin août 1896, de l’abandonner ? Pourquoi les hommes de l’État-major décidèrent-ils, l’année suivante, de venir en aide à Esterhazy et de le protéger ? Pourquoi Boisdeffre avait-il parlé à Judet de la « valeur » des « service rendus » par Esterhazy et lui avait avoué ne pas connaître « le premier mot de l’Affaire » ? Qu’étaient ces preuves inconnues dont avait parlé le même Boisdeffre à Du Paty ? Et qu’étaient ces documents que Sandherr gardait « par devers [lui] » dont Henry avait parlé au procès Zola ? Étaient-ils les mêmes que ceux de ce dossier dont Sandherr avait dit à Du Paty, sans vouloir le lui montrer, qu’il « ne verra[it] jamais le jour[6] » ? Et ne pouvait-on croire Esterhazy qui, les dernières années, avait affirmé à tous et sans se lasser jamais qu’il avait écrit le bordereau sur les ordres et sous la dictée de Sandherr ? Pourquoi, encore, la veuve Henry avait-elle dit à Charpentier qu’elle jugeait « impossible que l’on puisse pour l’Histoire, faire un récit exact [de l’Affaire] avec des éléments trop pauvres et trop insuffisamment exacts[7] » ? Pour Charpentier, la réponse à toutes ces questions se trouvait dans la déposition de Wattinne faite à l’occasion de la seconde révision. Le gendre de Billot avait en effet raconté qu’à la question qu’il avait posée à Henry visant à savoir ce que pouvait avoir Sandherr « contre Dreyfus », il avait reçu pour réponse qu’il existait « quelque chose de particulier qu’[il] n’[avait] jamais connu », « une lettre venant d’Alsace et touchant quelqu’un de sa famille [de la famille de Dreyfus] ou de ses relations »[8]. Pour Charpentier, puisqu’il y avait un dossier dont Sandherr avait parlé à Henry et à Du Paty, cette lettre, perdue ou en tout cas depuis introuvable, devait en faire partie. Mais comment l’avait-il obtenue ? Et de qui ? Pour Charpentier, le correspondant de Sandherr, l’auteur de la « lettre d’Alsace », ne pouvait être qu’un de ses parents. Pourquoi ? Parce qu’ainsi seulement pouvait s’expliquer le secret, « secret qu’il n’eût pas gardé si les documents accusateurs lui avaient été adressés directement par un agent de contre-espionnage dont il n’aurait pas eu à cacher le nom ». Au terme d’une longue enquête en Alsace, Charpentier avait pu découvrir la trace d’un certain René Kullmann qui avait rendu « d’immenses services au 2e Bureau, tant que [son parent] Sandherr en [avait été] le chef ». Le parent était trouvé mais quel rapport avec Dreyfus ? Écoutons Charpentier raconter son histoire. Un jour de 1894, « un quelconque Dreyfus », nom « très répandu en Alsace », « voyageant dans l’Est français », aurait « pris quelques photographies de nos fortifications, en y ajoutant de menues notes » et aurait transmis le tout « à la police de Strasbourg, afin de se concilier les faveurs des autorités allemandes ». « Par une filière difficile à préciser [sic], ces notes, sur lesquelles figure le nom du voyageur Dreyfus, vont entre les mains de René Kullmann qui les envoie au colonel Sandherr. » Sandherr, découvrant cela, aurait cherché son traître et, commettant une erreur, porté ses soupçons sur le pauvre Dreyfus.
[…] comment le prendre ?… Dire que des documents avaient été volés à la police de Strasbourg ? C’était impossible. Il est bien certain qu’en acceptant les renseignements que celui-ci lui envoyait, Sandherr avait dû s’engager sur l’honneur, non seulement à ne jamais le nommer, mais, même, à ne jamais indiquer la source d’où provenaient les renseignements. […]
Il fallait donc créer une pièce qui, tout en permettant d’arrêter Dreyfus, pût être montrée à l’officier de police judiciaire, à l’officier rapporteur et aux membres du conseil de guerre. Cette pièce fut la lettre-missive ou bordereau.
Et sur la base d’une idée trouvée dans un roman publié en feuilleton par Le Petit Journal de janvier à juillet 1894 – Les Deux frères de Louis Létang[9] –, et dont l’histoire a de curieux points communs avec l’Affaire, Sandherr et son collaborateur Henry auraient bâti tout un scénario dont Esterhazy, qui offrait l’avantage d’avoir une écriture proche de celle de Dreyfus, permettrait la réalisation. Sur les indications de Sandherr, Esterhazy aurait donc écrit le bordereau qui, déposé à l’ambassade d’Allemagne pendant une absence de Schwartzkoppen, aurait été récupéré par la « voie ordinaire ». Voilà donc pourquoi Esterhazy « ne commit aucun acte de trahison » et que, Sandherr mort, Henry s’était retrouvé le seul « détenteur du terrible secret » pour la protection duquel il manœuvra contre Picquart et commit tous ses faux[10].
Quel roman… Pourtant Charpentier ne doute guère et va même un peu plus loin encore :
[…] Évidemment, la version du voyageur n’est qu’une hypothèse et d’autres hypothèses peuvent être formulées. Mais, quelles qu’elles soient, on peut considérer comme certain que, vers la fin du printemps de 1894, Sandherr reçut de René Kullmann des documents sur l’un desquels figurait, vraisemblablement, le nom d’un « Dreyfus ».
D’autre part, il est bien certain que René Kullmann ne signait pas de son nom la correspondance secrète qu’il échangeait avec son cousin. Il avait dû prendre un pseudonyme. Or, […] la grand-mère du colonel Sandherr était une demoiselle Wilhelm. Il ne serait pas impossible que René Kullmann eût adopté ce nom pour signer ses lettres.
S’il en fut ainsi, la légende du fameux bordereau annoté de l’empereur d’Allemagne trouverait une explication plausible.
[…] Sans doute, sur l’annotation divulguée par la presse, le nom de Guillaume était orthographié « Wilhem » au lieu de « Wilhelm ». Mais, comme personne ne vit jamais cette annotation, il est fort probable que le premier journaliste qui en donna le texte commit la faute d’orthographe – qui ne fut peut-être qu’une erreur typographique – laquelle fut naturellement répétée par tous les journaux, puisqu’aucun texte ne permettait une vérification.
Ne cédons pas à l’irionie – facile – et contentons-nous de poser un certain nombre de questions qui demeurent sans réponse et entament considérablement cet ingénieux montage. Que justifie la piste du parent de Sandherr ? Quelle était cette obligation de tenir son nom secret ? Certes, si Charpentier donne quelques exemples d’Alsaciens qui avaient connu quelques ennuis avec les autorités allemandes pour leur activité d’espionnage[11], n’était-il pas possible à Henry et Sandherr d’être discrets, de ne rien révéler et de faire croire qu’elle émanait d’un des divers espions qui émargeaient à la Section de statistique ? N’aurait-il pas même été possible, comme pour le bordereau, de rester flou sur sa provenance dans l’acte d’accusation ? Et puis, surtout, n’était-il pas curieux pour taire cette source de préférer celle de l’ambassade qui constituait pourtant un acte bien plus grave ? Et, puisqu’il est question de l’ambassade, pourquoi se compliquer la vie en l’y déposant pour le récupérer ensuite ? N’était-il pas possible, s’il fallait absolument donner cette provenance, de conserver la pièce et de se contenter d’affirmer qu’elle avait été saisie rue de Lille ? Et pourquoi encore ne pas la signer simplement du nom de Dreyfus pour éviter toute discussion ? De même, si ce fameux dossier des « documents Z » – selon le nom que donne Charpentier au dossier contenant la « lettre d’Alsace » – était si terrible, pourquoi ne pas l’avoir joint au dossier secret de 1894 ? Pourquoi ne pas avoir mis Picquart et Boisdeffre dans la confidence dès le début et avoir laissé le second demander au premier d’enrichir le dossier ? Pourquoi aux premiers soupçons de Picquart ne pas lui avoir dit ce dont il retournait ? Soit par Henry, quand il fut au courant de la découverte de son chef ou par Gonse ou Boisdeffre quand – pour suivre la thèse de Charpentier – ils furent mis au courant par Henry ? Cela aurait évité bien des ennuis et Picquart, comme il l’avait dit au procès Zola, aurait « rempli [s]on devoir d’officier[12] ». De même, comment comprendre cette lettre insupportable qu’avait envoyée Henry à Picquart quand il remplissait sa mission en Tunisie, bien loin et ne risquant plus de gêner ? Quelle drôle d’idée, si la thèse de Charpentier avait été une réalité, de provoquer ainsi le disgracié et de lui donner une bonne raison de faire éclater une affaire qui aurait pu, sans cela, ne jamais voir le jour. Que penser encore de la lettre « Espérance » (et non « Speranza » comme le dit Charpentier p. 163) qu’ils envoyèrent à Esterhazy pour le prévenir ? Une lettre qui le laissait seul face à ses problèmes en lui disant que « c’[était] à [lui] maintenant de défendre [son] nom et l’honneur de [ses] enfants » ? N’aurait-il pas été plus simple, s’il fallait sauver cet ami, d’aller le voir dans sa province, de le mettre au courant de ce qui se tramait et de l’inviter à disparaître au plus vite ? Et pourquoi ne pas avoir mis Du Paty, que sa fantaisie rendait difficilement contrôlable, dans la confidence ? Pourquoi avoir fait écrire Esterhazy à Boisdeffre la lettre « p. de C. » si, comme le dit Charpentier, le chef d’État-major avait été informé par Henry à la fin du mois d’août ? Pourquoi ne pas lui avoir dit que Boisdeffre était au courant du « secret », comme l’indique le fait qu’Esterhazy envoya au chef d’État-major la lettre anonyme du 24 octobre pour vérifier que la protection venait d’en haut ? Et pourquoi lui avoir fait aussi écrire à Félix Faure au risque de tout compromettre ? Pourquoi lui avoir encore fait écrire, le 7 novembre, cette lettre à Picquart qui ne pouvait qu’engager l’ancien chef de la Section de statistique à passer à l’offensive tout en lui apprenant que l’homme qu’il avait soupçonné était au courant de son enquête ? Pourquoi encore n’avoir pas mis Pellieux et Ravary, consciencieusement stylés, au courant du « secret » ?
Nous pourrions ainsi multiplier à l’infini ces questions qui montrent le peu de solidité de la thèse de Charpentier. Mais si elle ne tient guère, cette thèse, qu’en est-il alors de ces fameuses zones d’ombres à l’origine de cet incroyable montage ? Reprenons les principales questions posées par Charpentier et voyons combien elles peuvent trouver aisément leur réponse sans être obligé d’échafauder ce véritable roman. Si la question de la coïncidence des dates entre les dires d’Esterhazy et les souvenirs de Schwartzkoppen peut être vite écartée – c’est bien le 20 juillet qu’eut lieu une première rencontre à laquelle Sandherr ne devait rien –, celle de l’affirmation de Schwartzkoppen selon laquelle il n’avait jamais reçu le bordereau est plus intéressante et assez facile à résoudre. Que vaut le témoignage de Schwartzkoppen à ce sujet ? Ne peut-on penser qu’il le reçut bien mais ne pouvait l’avouer sans reconnaître avoir été bien léger, bien inconséquent en confiant à sa corbeille à papier une lettre d’une telle importance ? Concernant le changement d’attitude de Gonse et de Boisdeffre, la réponse est simple. Mais avant d’y répondre une petite précision s’impose. Charpentier se trompe – à moins qu’il ne force les événements pour coller à sa thèse – quand il écrit : « Certain, désormais, de l’importance de sa découverte, Picquart en parle à de Boisdeffre, puis à Gonse. Ceux-ci le félicitent de façon discrète dont il a conduit son enquête et l’invitent à la poursuivre. Puis, insensiblement, vers la fin d’août, leur attitude se modifie. Gonse recommande à Picquart de ne pas mêler l’Affaire Dreyfus à l’Affaire Esterhazy, alors que le bon sens commanderait au contraire de procéder à une comparaison immédiate des trois écritures en cause. » Et c’est à ce moment, selon lui, qu’Henry, inquiet, informa ses chefs du secret de Sandherr (p. 161-162). Cela expliquant ceci. Charpentier bouleverse ici les événements. Ce fut le 5 août que la première fois Picquart parla à Boisdeffre de sa découverte. Mais il s’était bien gardé, prudent, de parler de sa conviction qu’Esterhazy était le véritable auteur du bordereau. C’est à la fin d’août qu’il la lui révéla et c’est le 3 septembre que pour la première fois il en parla à Gonse qui ne le félicita aucunement mais lui demanda au contraire et dès les premiers mots de distinguer les deux affaires. Il n’y a aucun mystère ici. Gonse ne changea donc aucunement d’avis et s’il lui fit cette demande ce n’était que parce qu’il ne voulait pas d’une enquête qui eût pu amener à la révision du procès Dreyfus. De même, si Henry avait parlé à ce moment à Gonse et Boisdeffre du fameux secret, comme le soutien Charpentier, comment expliquer que pour tenter d’entrer au ministère, démarche qu’il entreprenait depuis avril précédent, Esterhazy se fût adressé à des députés et pas directement à Henry auquel il aurait pu faire valoir – ce qui était bien dans sa manière – de sérieux arguments pour qu’il intervînt et intervînt vite auprès de ses chefs ? Mais Picquart avait commencé son enquête, pourrait répondre Charpentier, et Henry ne devait pas se brûler. Sans doute mais alors Henry n’aurait-il pas eu tout à fait intérêt à prendre contact avec son « ami » et lui demander, au nom de leur cher secret, de s’abstenir d’une démarche pour le moins dangereuse ? Autre question. Pourquoi Henry, Gonse, etc. défendirent-ils Esterhazy et machinèrent-ils ces rendez-vous de roman-feuilleton pour le sauver ? Pourquoi, comme le demande Charpentier, n’ont-ils pas « laissé les événements se dérouler d’eux-mêmes et attendu en toute tranquillité de connaître les faits sur lesquels l’honorable vice-président du Sénat appuierait sa requête » ? Pourquoi une telle inquiétude ? (p. 162-163). Mais tout simplement parce qu’ils étaient compromis, parce qu’une illégalité avait été commise en 1894, parce qu’Henry avait fait un faux témoignage au procès, parce qu’ils avaient promis à Mercier de ne jamais rien dire de ce qui s’était passé… Et pourquoi croire que si Boisdeffre, à Du Paty, Henry, au procès Zola, avait parlé de documents plus importants que le bordereau, ce ne pouvait être que parce que ces documents existaient ? Ne pouvait-il s’agir que de nouveaux mensonges qui avaient tout simplement pour but de faire comprendre que, si le dossier connu n’était guère probant, il existait de vraies, de graves preuves, de trop graves preuves pour les livrer au public ?
Non la thèse de Charpentier est décidément bien fragile. Mais restons encore un peu avec lui. Car en effet il ne s’en tient pas là. Dans la seconde partie de son livre, il développe une autre théorie relative à la mort d’Henry en partant de la juste remarque qu’il « n’avait aucune raison pour se tuer ». Rejetant la thèse du suicide et celle de la mort maquillée et de la fuite d’Henry, dont la presse s’était faite l’écho en 1905[13], il proposait une autre explication : « Ou bien ce fut l’apoplexie foudroyante, ce qui n’est pas impossible. Ou bien, [un] visiteur inconnu [dont il avait découvert l’existence] lui tendit “la boulette” fatale, car il ne fallait pas songer au revolver dont la présence en ses mains n’aurait pu se justifier. » Charpentier « inclin[ait] pour la boulette » en raison du mot incohérent destiné par Henry à sa femme, mot qui avait été retrouvé sur sa table et dans lequel il disait être sur le point d’aller « [s]e baigner dans la Seine ». Le mystérieux visiteur, une fois le poison ingéré, lui aurait tranché la gorge pour faire croire au suicide. Voilà ce qui selon Charpentier pouvait expliquer le fait qu’Henry, droitier, ait été retrouvé le rasoir, et le rasoir fermé, dans la main gauche. Le fait est mystérieux, c’est indéniable. Mais cela dit, il est difficile de suivre Charpentier dans sa théorie du « visiteur » qui ne repose que sur une hypothèse formulée par Esterhazy[14] et dans la raison qu’il donne de ce qu’il faut bien considérer comme un assassinat, à savoir la nécessité de protéger le secret des fameux « documents Z » (p. 288-289). Nous ne savons bien sûr pas ce qui s’est réellement passé ce 31 août 1898 dans la cellule 13 du Mont-Valérien. Mais nous serions assez enclin à préférer une solution que ne propose pas Charpentier, et que nous avons évoquée précédemment, celle du « suicide par suggestion ». Ne peut-on penser en effet que ne pas enlever à Henry son rasoir était en tout comparable au pistolet laissé à disposition de Dreyfus le jour de la dictée ? Nous serions bien là dans les manières de l’État-major… Mais demeure ce mystère du rasoir fermé (ou « à demi fermé », comme le corrigera Walter en 1903[15]) et de sa présence dans la main gauche d’un droitier…
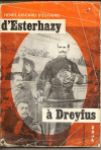 La curiosité suivante qui devait nous dire toute la vérité vit le jour en 1960. D’Esterhazy à Dreyfus,d’Henri Giscard d’Estaing, reprenait la thèse de Paléologue qui, dans son Journal de L’Affaire Dreyfus, avait, sans entrer dans les détails, proposé une « hypothèse constructive » qui expliquait selon lui toute l’affaire. Il n’y aurait pas eu un coupable mais trois : Esterhazy, son ami Weil et « un officier d’un très haut grade, qui, après avoir occupé pendant plusieurs années des fonctions importantes au ministère de la Guerre, exerce aujourd’hui un commandement de troupes » (p. 156). Paléologue, modeste, s’était contenté d’ouvrir la piste. Mais son éditeur, Plon, assurément pour en prolonger la vente – en « parfaire la thèse », comme le dit l’introduction du Giscard[16] –, éditera ce curieux D’Esterhazy à Dreyfus. Reposant sur une méconnaissance assez vertigineuse de l’Affaire, l’auteur expose, sans la moindre précaution, une thèse, exposition de « l’organisme » et non de « la tumeur », qui n’a pour but que de donner le nom que Paléologue avait gardé pour lui et qui permettrait d’établir « les vraies culpabilités de 1894[17] ». Esterhazy serait l’auteur du bordereau et le deuxième homme dont parle Paléologue, l’« officier d’un très haut grade », celui qui lui fournissait les documents et ne pouvait qu’appartenir à l’État-major, ne serait pas le général Rau, comme beaucoup le dirent[18] mais Mercier ! Et bien sûr tout cela n’aurait eu pour but que de protéger la fabrication du canon de 75, première occurrence de ce qui deviendra bientôt une véritable obsession. Critique avisé, Giscard corrigeait toutefois les erreurs du diplomate et entre autres celle de la complicité d’Henry dont Reinach – que Giscard s’obstine à nommer pour une raison que nous nous expliquons mal « Bernard Lazare » – avait fait l’axe de sa lecture de l’Affaire. La démonstration mérite d’être exposée[19]. Jusqu’au procès Zola, les défenseurs de Dreyfus avaient défendu une thèse simple : Dreyfus était innocent et Esterhazy coupable. Mais après la déposition de Pellieux – suffisante pour leur faire changer d’avis (!?) –, déposition qui établissait qu’Esterhazy n’avait pu être en mesure de livrer les documents énumérés au bordereau, ils avaient dû revoir leur copie. Bernard Reinach devait donc reprendre sa thèse et trouver un complice à Esterhazy, un complice qui devait bien sûr appartenir à l’État-major. Henry serait donc ce complice, thèse qui ne pourrait être contredite puisqu’Henry avait avoué son faux et s’était tué. Joseph Lazare en fera son « grand cheval de bataille », comme Zola d’ailleurs qui sur la base de « ce bagage sommaire […] enfla les effets oratoires de sa fameuse lettre “J’accuse” ». A-t-on compris ? En février 1898 (procès Zola), Zola et Reinach – que nous pouvons arrêter de nommer Lazare – portèrent toute la responsabilité sur Henry qui offrait l’avantage d’être mort depuis… sept mois plus tard… Et parce qu’en février 1898, ils avaient pris conscience de cela, Zola pourra en parler dans son « J’Accuse.. ! »… le mois précédent… Quant au petit bleu, il était l’œuvre des amis de Dreyfus… Comme l’écrit Giscard à propos de Charpentier : « Soyons magnanime et arrêtons-là un massacre trop facile…[20] »
La curiosité suivante qui devait nous dire toute la vérité vit le jour en 1960. D’Esterhazy à Dreyfus,d’Henri Giscard d’Estaing, reprenait la thèse de Paléologue qui, dans son Journal de L’Affaire Dreyfus, avait, sans entrer dans les détails, proposé une « hypothèse constructive » qui expliquait selon lui toute l’affaire. Il n’y aurait pas eu un coupable mais trois : Esterhazy, son ami Weil et « un officier d’un très haut grade, qui, après avoir occupé pendant plusieurs années des fonctions importantes au ministère de la Guerre, exerce aujourd’hui un commandement de troupes » (p. 156). Paléologue, modeste, s’était contenté d’ouvrir la piste. Mais son éditeur, Plon, assurément pour en prolonger la vente – en « parfaire la thèse », comme le dit l’introduction du Giscard[16] –, éditera ce curieux D’Esterhazy à Dreyfus. Reposant sur une méconnaissance assez vertigineuse de l’Affaire, l’auteur expose, sans la moindre précaution, une thèse, exposition de « l’organisme » et non de « la tumeur », qui n’a pour but que de donner le nom que Paléologue avait gardé pour lui et qui permettrait d’établir « les vraies culpabilités de 1894[17] ». Esterhazy serait l’auteur du bordereau et le deuxième homme dont parle Paléologue, l’« officier d’un très haut grade », celui qui lui fournissait les documents et ne pouvait qu’appartenir à l’État-major, ne serait pas le général Rau, comme beaucoup le dirent[18] mais Mercier ! Et bien sûr tout cela n’aurait eu pour but que de protéger la fabrication du canon de 75, première occurrence de ce qui deviendra bientôt une véritable obsession. Critique avisé, Giscard corrigeait toutefois les erreurs du diplomate et entre autres celle de la complicité d’Henry dont Reinach – que Giscard s’obstine à nommer pour une raison que nous nous expliquons mal « Bernard Lazare » – avait fait l’axe de sa lecture de l’Affaire. La démonstration mérite d’être exposée[19]. Jusqu’au procès Zola, les défenseurs de Dreyfus avaient défendu une thèse simple : Dreyfus était innocent et Esterhazy coupable. Mais après la déposition de Pellieux – suffisante pour leur faire changer d’avis (!?) –, déposition qui établissait qu’Esterhazy n’avait pu être en mesure de livrer les documents énumérés au bordereau, ils avaient dû revoir leur copie. Bernard Reinach devait donc reprendre sa thèse et trouver un complice à Esterhazy, un complice qui devait bien sûr appartenir à l’État-major. Henry serait donc ce complice, thèse qui ne pourrait être contredite puisqu’Henry avait avoué son faux et s’était tué. Joseph Lazare en fera son « grand cheval de bataille », comme Zola d’ailleurs qui sur la base de « ce bagage sommaire […] enfla les effets oratoires de sa fameuse lettre “J’accuse” ». A-t-on compris ? En février 1898 (procès Zola), Zola et Reinach – que nous pouvons arrêter de nommer Lazare – portèrent toute la responsabilité sur Henry qui offrait l’avantage d’être mort depuis… sept mois plus tard… Et parce qu’en février 1898, ils avaient pris conscience de cela, Zola pourra en parler dans son « J’Accuse.. ! »… le mois précédent… Quant au petit bleu, il était l’œuvre des amis de Dreyfus… Comme l’écrit Giscard à propos de Charpentier : « Soyons magnanime et arrêtons-là un massacre trop facile…[20] »
 En 1962, L’Enigme Esterhazy d’Henri Guillemin nous offrit une nouvelle thèse. Refusant celle de Marcel Thomas, « docilité […] au dogme posé par l’État-Major » (p. 259), il proposait l’hypothèse suivante : Sandherr aurait découvert que Saussier – l’« X » mystérieux de Paléologue, selon lui, – fournissait – sans doute au terme d’un chantage – les documents qu’Esterhazy livrait. Il aurait alors fait écrire à Esterhazy un bordereau reprenant des documents précédemment livrés dans le but que la photographie vînt sous les yeux de Saussier et qu’il comprît que tout étant découvert il lui faudrait à l’avenir « se montrer plus circonspect ». La seule chose qu’il n’avait pas prévue était que le zèle de d’Aboville découvrirait dans ce bordereau, ce faux document de trahison, la main d’un jeune stagiaire qui n’avait vraiment rien à y voir (p. 288-290). Cette hypothèse, cette « rêverie » comme la qualifie Guillemin lui-même (p. 290), reposait sur le fait que Saussier avait toujours été, en 1894, partisan de ne rien faire et qu’il n’avait pas jugé bon de faire arrêter Esterhazy en 1897. Le fait, exact, de 1894, ne prouve pas grand-chose : Hanotaux était du même avis et n’est pas complice pour cela. Mais ce n’est pas exactement de cette manière que le présente Guillemin : il parle, lui, d’une tentative « d’empêcher, en 1894, toute poursuite, toute enquête même, lorsque le bordereau a surgi » (p. 286). Si tel avait été le cas, pourquoi Saussier aurait-il signé l’ordre de mise en jugement ? Pourquoi avoir dit à Casimir-Perier, qui s’étonnait qu’il engageât les poursuites, que les conclusions du rapport ne lui « permettaient pas d’agir autrement » ? La décision lui incombait, à lui seul, et il était libre, s’il l’avait voulu, d’aller contre le rapporteur. La peur de la presse pouvait-elle suffire à expliquer une décision qui risquait de le perdre ? Et quel formidable sang-froid que celui d’un complice qui ajoutait : « d’ailleurs qu’importe ? Le conseil de guerre décidera »[21]. Il est vrai, toutefois, que Saussier ne fit rien en 1897 pour faire arrêter Esterhazy. Mais nous savons que s’il ne le fit pas c’est parce que Billot le refusait[22] ? Saussier avait-il vraiment beaucoup de chance ou Billot était-il aussi complice ?
En 1962, L’Enigme Esterhazy d’Henri Guillemin nous offrit une nouvelle thèse. Refusant celle de Marcel Thomas, « docilité […] au dogme posé par l’État-Major » (p. 259), il proposait l’hypothèse suivante : Sandherr aurait découvert que Saussier – l’« X » mystérieux de Paléologue, selon lui, – fournissait – sans doute au terme d’un chantage – les documents qu’Esterhazy livrait. Il aurait alors fait écrire à Esterhazy un bordereau reprenant des documents précédemment livrés dans le but que la photographie vînt sous les yeux de Saussier et qu’il comprît que tout étant découvert il lui faudrait à l’avenir « se montrer plus circonspect ». La seule chose qu’il n’avait pas prévue était que le zèle de d’Aboville découvrirait dans ce bordereau, ce faux document de trahison, la main d’un jeune stagiaire qui n’avait vraiment rien à y voir (p. 288-290). Cette hypothèse, cette « rêverie » comme la qualifie Guillemin lui-même (p. 290), reposait sur le fait que Saussier avait toujours été, en 1894, partisan de ne rien faire et qu’il n’avait pas jugé bon de faire arrêter Esterhazy en 1897. Le fait, exact, de 1894, ne prouve pas grand-chose : Hanotaux était du même avis et n’est pas complice pour cela. Mais ce n’est pas exactement de cette manière que le présente Guillemin : il parle, lui, d’une tentative « d’empêcher, en 1894, toute poursuite, toute enquête même, lorsque le bordereau a surgi » (p. 286). Si tel avait été le cas, pourquoi Saussier aurait-il signé l’ordre de mise en jugement ? Pourquoi avoir dit à Casimir-Perier, qui s’étonnait qu’il engageât les poursuites, que les conclusions du rapport ne lui « permettaient pas d’agir autrement » ? La décision lui incombait, à lui seul, et il était libre, s’il l’avait voulu, d’aller contre le rapporteur. La peur de la presse pouvait-elle suffire à expliquer une décision qui risquait de le perdre ? Et quel formidable sang-froid que celui d’un complice qui ajoutait : « d’ailleurs qu’importe ? Le conseil de guerre décidera »[21]. Il est vrai, toutefois, que Saussier ne fit rien en 1897 pour faire arrêter Esterhazy. Mais nous savons que s’il ne le fit pas c’est parce que Billot le refusait[22] ? Saussier avait-il vraiment beaucoup de chance ou Billot était-il aussi complice ?
 Il faudra attendre dix ans pour découvrir la nouvelle thèse et lire L’Affaire Dreyfus. La Clé du mystère de Michel de Lombarès[23]. Variation des précédents, il revenait sur la thèse du « troisième homme » qui pour lui, indiscutablement, ne pouvait être que Saussier. Aucune trahison ici, mais, à nouveau, une histoire de renseignements sur fond d’intox qui avait pour but de protéger l’inévitable canon de 75. Pour aider Saussier à en savoir plus sur les avancées de l’artillerie allemande qui développait de son côté un nouveau canon, son ami et ancien ordonnance Weil aurait eu l’idée de faire appel à Esterhazy et de lui faire proposer ses services à Schwartzkoppen. « […] on verrait bien, d’après les questions qui lui seraient posées, où en sont les études de canon à tir rapide en Allemagne. » Saussier n’aurait eu qu’à « donner son accord » et « fournir, de temps en temps, quelques documents, quelques renseignements, qui pourront être périmés ou faux, pourvu qu’ils soient vraisemblables ». Et ce faisant Saussier ne pourrait que « faire œuvre utile en fournissant de tels renseignements dans le cadre de la campagne d’intoxication que commence le directeur de l’Artillerie pour tromper le Grand État-Major allemand sur nos études de canons à long recul » (p. 36-37). A cette nouvelle thèse, Lombarès, sentant qu’il serait difficile d’y faire coïncider le bordereau, venait en ajouter une autre : le fameux document ne serait pas l’œuvre d’Esterhazy mais celui du S.R. allemand qui voulait ainsi vérifier une dénonciation récente au sujet de la manière dont le S.R. français obtenait ses informations et, donc, s’assurer que la corbeille à papiers de Schwartzkoppen n’en était pas la source. Si les renseignements obtenus étaient exacts, le bordereau, imitant l’écriture d’Esterhazy et parlant de documents récemment livrés, parviendrait, « par la voie dénoncée, au S.R. français. Ce service reprochera cette imprudente lettre à Esterhazy. Ce dernier niera en être l’auteur. On ne le croira pas. Au cas, bien improbable, où on le croirait, on comprendrait qu’il est “brûlé” et que, par un juste retour des choses, la corbeille à papiers de Schwartzkoppen est devenue une source d’intoxication. Dans tous les cas, Esterhazy sera tellement surpris qu’il réagira inévitablement, d’une manière ou d’une autre, auprès de Schwartzkoppen. Le contre-espionnage allemand aura ainsi, d’un même coup, vérifiés les renseignements de la [dénonciation] et démontré aux services de l’espionnage que leur prétendu traître n’est qu’un agent du S.R. français » (p. 239).
Il faudra attendre dix ans pour découvrir la nouvelle thèse et lire L’Affaire Dreyfus. La Clé du mystère de Michel de Lombarès[23]. Variation des précédents, il revenait sur la thèse du « troisième homme » qui pour lui, indiscutablement, ne pouvait être que Saussier. Aucune trahison ici, mais, à nouveau, une histoire de renseignements sur fond d’intox qui avait pour but de protéger l’inévitable canon de 75. Pour aider Saussier à en savoir plus sur les avancées de l’artillerie allemande qui développait de son côté un nouveau canon, son ami et ancien ordonnance Weil aurait eu l’idée de faire appel à Esterhazy et de lui faire proposer ses services à Schwartzkoppen. « […] on verrait bien, d’après les questions qui lui seraient posées, où en sont les études de canon à tir rapide en Allemagne. » Saussier n’aurait eu qu’à « donner son accord » et « fournir, de temps en temps, quelques documents, quelques renseignements, qui pourront être périmés ou faux, pourvu qu’ils soient vraisemblables ». Et ce faisant Saussier ne pourrait que « faire œuvre utile en fournissant de tels renseignements dans le cadre de la campagne d’intoxication que commence le directeur de l’Artillerie pour tromper le Grand État-Major allemand sur nos études de canons à long recul » (p. 36-37). A cette nouvelle thèse, Lombarès, sentant qu’il serait difficile d’y faire coïncider le bordereau, venait en ajouter une autre : le fameux document ne serait pas l’œuvre d’Esterhazy mais celui du S.R. allemand qui voulait ainsi vérifier une dénonciation récente au sujet de la manière dont le S.R. français obtenait ses informations et, donc, s’assurer que la corbeille à papiers de Schwartzkoppen n’en était pas la source. Si les renseignements obtenus étaient exacts, le bordereau, imitant l’écriture d’Esterhazy et parlant de documents récemment livrés, parviendrait, « par la voie dénoncée, au S.R. français. Ce service reprochera cette imprudente lettre à Esterhazy. Ce dernier niera en être l’auteur. On ne le croira pas. Au cas, bien improbable, où on le croirait, on comprendrait qu’il est “brûlé” et que, par un juste retour des choses, la corbeille à papiers de Schwartzkoppen est devenue une source d’intoxication. Dans tous les cas, Esterhazy sera tellement surpris qu’il réagira inévitablement, d’une manière ou d’une autre, auprès de Schwartzkoppen. Le contre-espionnage allemand aura ainsi, d’un même coup, vérifiés les renseignements de la [dénonciation] et démontré aux services de l’espionnage que leur prétendu traître n’est qu’un agent du S.R. français » (p. 239).
Le problème est que rien n’étaye une telle thèse. Rien ne dit que l’auteur de la dénonciation, la femme Millescamps, ait parlé du « ramassage de papiers dans la corbeille de l’attaché militaire », comme le soutient avec assurance Lombarès (p. 238). Dans un rapport à Münster de 1896, Schwartzkoppen, revenant sur l’affaire, avait expliqué que la Millescamps avait « racont[é] toutes sortes de choses, d’allure invraisemblable, sur la façon dont l’ambassade d’Allemagne et son personnel étaient observés par des agents secrets français ». Il avait dit cela mais n’en avait pas dit plus. Et toutes les recherches faites à la suite n’avaient rien donné[24]. Peut-être que Schwartzkoppen mentait ici, objecterait Lombarès, ne pouvant dire à Münster avec quelle facilité il était possible de se procurer des documents confidentiels à l’ambassade. Ou peut-être refusait-il d’entendre la vérité et disqualifiait-il (« une allure invraisemblable ») une telle dénonciation dont la réalité serait bien trop extraordinaire. Cela serait vraisemblable mais on comprend mal, dans ce cas, si la Millescamps avait en effet parlé de la corbeille, que l’attaché militaire ait pu continuer à la remplir si consciencieusement de documents qui continueront, bien après le bordereau, à venir garnir les dossiers de la Section de statistique… D’autre part, on comprend mal la « démonstration » de Lombarès. Si Esterhazy était en effet un agent du S.R. français, réagir, prendre contact avec Schwartzkoppen, était le plus sûr moyen d’avouer sa véritable appartenance. Il était clair que, puisque le postulat était que le bordereau mentionnait des pièces déjà livrées, il ne pouvait que s’agir d’une intox. Esterhazy et ses employeurs l’eussent assurément compris et la consigne n’eût pu être que de ne surtout pas se manifester. Et quel danger représentait pour les allemands une telle stratégie si la Millescamps avait menti ou si Esterhazy était un authentique traître et non un agent double. Le S.R. allemand aurait ainsi rendu un fier service à son homologue français en lui révélant un fait d’importance, à savoir qu’il existait un traître dans l’armée française.
Mais le problème ne se posa pas puisque, comme nous le dit Lombarès, la manœuvre échoua : « contrairement à tout ce que le S.R. de Berlin pouvait raisonnablement imaginer, si Esterhazy était bien un agent double, il n’était pas un agent du S.R. » (p. 239). Suivant cette méthode on peut avancer tout et n’importe quoi. Et sur quoi repose donc cette thèse ? Elle ne s’appuie – comme à chaque fois – sur aucun document et n’est qu’une explication censée répondre à une impossibilité : celle de la conception du bordereau par Esterhazy. Pour Lombarès, en effet, le bordereau ne peut en aucun cas être l’œuvre du « uhlan » et ce pour de multiples raisons : son inutilité, sa graphie, son style maladroit, l’état dans lequel il parvint à la Section de statistique, son papier, sa date et son texte (p. 224-232). Voyons cela. Inutile, le bordereau, ne faisant que récapituler des pièces qui y étaient jointes, l’était en effet mais le remarquer ne prouve pas grand-chose et le fait n’est peut-être finalement pas aussi curieux que Lombarès le pense. Il arrive souvent qu’on fasse parvenir à un correspondant un objet, un document quelconque, et que cet envoi soit accompagné d’un mot qui annonce ce que l’ouverture de l’enveloppe indiquerait d’elle-même. Cela s’appelle aussi de la politesse… Le second point – la graphie – est difficile à soutenir tant sont semblables les écritures d’Esterhazy et du bordereau. Et pour y parvenir, il faudrait que Lombarès ait d’autres arguments, moins naïfs dans tous les cas, que celui selon lequel « lorsque se posa la question d’Esterhazy, au procès de cet officier tous les experts consultés ont estimé que l’écriture du bordereau avait les caractères d’une imitation. Tous ! ». La question de la rédaction n’est pas plus convaincante. Esterhazy, cultivé, n’aurait pu commettre les impropriétés de langue, de mots et de tournures du bordereau. Certaines se retrouvent pourtant à l’identique dans sa correspondance. La question du papier est équivalente. Esterhazy possédait ce papier peu courant, comme le révéla l’enquête de la Cour de cassation et comme le sait aussi Lombarès. Alors ? « Un faussaire pouvait se procurer ce papier chez cet officier, ou chez son fournisseur »… Soit. Mais une nouvelle fois avec de tels arguments tout est possible. La date ? Comment, demande Lombarès, une lettre faite – si Esterhazy en était l’auteur – entre le 15 août et le 1er septembre, aurait-elle pu parvenir à la Section de statistique un mois plus tard ? Pourquoi l’agent aurait-il été « assez maladroit pour attendre grand mois avant de la faire parvenir » ? Cela serait douteux en effet. Mais pourquoi Schwartzkoppen, s’il a reçu le bordereau comme nous nous obstinons à le croire, aurait-il dû le jeter dès lecture ? N’aurait-il pu le garder, un jour, deux jours, quelques jours, une semaine, un mois même et le jeter plus tard ? Quant au texte, Lombarès voulait y voir un certain nombre de « véritables impossibilités dans l’hypothèse qui en fait l’œuvre du commandant Esterhazy ». Comment aurait-il pu écrire la première phrase (« Sans nouvelles m’indiquant… ») quand il allait et venait librement à l’ambassade ? Comment pouvait-il écrire « Je vous adresse », indiquant la livraison, et la livraison concomitante, alors que Schwartzkoppen a expliqué dans ses Carnets avoir reçu les documents en mains propres ? Pourquoi Esterhazy aurait-il donné entre parenthèse dans le bordereau la date du manuel de tir alors qu’elle figurait sur l’exemplaire qui lui transmettait ? Pourquoi, toujours à propos du manuel, avoir dire « je le prendrai », indiquant qu’il ne l’avait pas encore pris, alors qu’il le lui adressait ? Enfin, que signifiait la dernière phrase (« Je vais partir en manœuvres ») alors qu’il n’y se rendit pas à cette époque ? Autant d’impossibilités qui n’en sont pas. Aux manœuvres, il n’y alla pas fin août-début septembre 1894. Il n’y alla pas mais affirma à Schwartzkoppen y être allé quand, si on en croit les Carnets de l’attaché militaire, le 1er septembre, il lui avait dit revenir de celles de Sissonne dont il lui promettait la livraison des « observations qu’il y avait faites[25] ». Il n’y alla pas. Nous le savons, mais n’était-ce pas là un moyen, comme le dit Lombarès lui-même, d’« expliquer et valoriser » les observations en question ? N’est-ce pas aussi ainsi que peut s’expliquer la mention de la date du manuel dans le texte du bordereau ? Mais continuons. Comment expliquer la première phrase ? Sans doute qu’Esterhazy ne se gênait pas pour aller à l’ambassade. Mais ayant enfin obtenu l’accord de Schwartzkoppen, le 15 août, ne peut-on imaginer qu’il pouvait attendre que son nouvel employeur lui formulât quelque demande précise ? Comment put-il envoyer des documents avec le bordereau si Schwartzkoppen par ailleurs affirma les avoir reçu des mains d’Esterhazy lors d’une de ses visites ? Nous l’avons dit… et nous le répétons. Schwartzkoppen pouvait-il assumer aux yeux du monde, pour des mémoires qui feraient peut-être un jour l’objet d’une édition, de bien coupables négligences, négligences qui plus est, par la répétition, frôlaient la bêtise ?… Demeure la question du « je le prendrai ». En aucun cas, il ne signifie qu’Esterhazy ne l’avait pas encore, ce qui en effet serait curieux dans une lettre qui disait l’envoyer. Il suffit de lire le texte du bordereau pour comprendre que Lombarès à mal lu… ou a voulu lire ce qui pouvait servir son propos. Rappelons-nous le passage en question : « Ce dernier document est extrêmement difficile à se procurer et je ne puis l’avoir à ma disposition que peu de jours. Le ministère de la Guerre en a envoyé un nombre fixe dans les corps, et ces corps en sont responsables. Chaque officier détenteur doit remettre le sien après les manœuvres. Si donc vous voulez y prendre ce qui vous intéresse et le tenir à ma disposition après. Je le prendrai. A moins que vous ne vouliez que je le fasse copier in extenso et ne vous en adresse la copie. » « Je le prendrai » a ici le sens de « je le récupérerai », une fois, comme le dit la phrase précédente, que son correspondant en aura fini avec le document en question. Et ce dans le cas, Esterhazy devant le rendre le plus vite possible, n’en copier qu’une partie pourrait suffire à l’attaché militaire. Dans le cas où il souhaiterait l’avoir intégralement, Esterhazy lui proposait de le reprendre vite et de s’arranger pour le faire copier… Comment peut-on lire ici autre chose ? Parmi tous ces arguments qui n’en sont pas, le seul qui pourrait êtrelearguments qui n’portent jamais sur le fond et ne résistent pas longtemps à la critique recevable est celui des déchirures. Elles sont en effet curieuses et ne ressemblent que peu à celles des autres documents issus de la voie ordinaire. Mais si cela est, indubitablement, ce n’est guère suffisant pour en faire la preuve qui pourrait expliquer une autre origine au bordereau que la corbeille de l’attaché militaire.
 En 1985, Lombarès réédita son ouvrage sous le titre L’Affaire Dreyfus[26]. La suppression de la seconde partie du titre de la première édition (La Clé du mystère) pouvait laisser espérer plus de mesure comme, dans l’introduction, l’aveu d’erreurs commises (p. 11). Mais il ne fallait pas le lire trop vite. Ces erreurs n’étaient à son point de vue que « de détail » et à bien y réfléchir ce nouveau titre était pire encore qui présentait cette seconde édition comme une histoire ou un essai. En fait, à l’exception de menues corrections, cette édition n’était que la reprise de la précédente, augmentée de trois chapitres qui, affirmait l’auteur avec sérieux, venaient sur la base de publications récentes confirmer son hypothèse, « la seule en accord avec tout ce qu’on savait de cette histoire » (p. 215). Voyons rapidement ce qui pouvait justifier autant d’assurance. Dans ses souvenirs, Mathieu, on s’en souvient, raconte ses expériences avec la voyante Léonie[27]. Lors d’une des séances, elle fit une déclaration dans laquelle Lombarès trouve une confirmation de sa thèse : « Interrogée, poussée par nous, elle déclara que cette pièce [le bordereau] était une copie, un décalque fait à Metz, rapporté par Greber [un agent allemand], dans un but qu’elle ignorait, à l’ambassade allemande à Paris, où elle avait été volée par un agent français.[28] » Et Lombarès, après avoir cité – inexactement –, de commenter : « Cette fois c’était clair, du moins pour nous, car, on le voit, cette phrase écrite dès 1895, résumait parfaitement notre hypothèse. » (p. 197). La preuve est donc une vision de voyante ? Est-ce sérieux ? Et puis si on veut bien prendre le passage entier dont est extraite la citation on verra qu’en aucun cas, comme elle pourrait à elle seule le faire croire, elle ne vient conforter la thèse d’une intox du SR allemand. La citation ne dit pas qui est à l’origine du document et peut faire croire, prise seule, hors de son contexte, que copiée à Metz elle était l’œuvre des Allemands. Mais ce que disait Léonie était tout autre. Citons le passage qui introduit celui sélectionné par Lombarès : « Ainsi elle prétendait que le coupable était un officier du ministère de la Guerre dont elle ne trouvait pas le nom, en relations avec un agent allemand du nom de Greber. Celui-ci apportait à Metz les documents, livrés par cet officier, d’où ils étaient expédiés à Berlin. » Voilà qui ne résume rien et contredit tout… Lombarès ne pouvait trouver meilleure source et meilleure définition de sa manière de travailler. Ce n’est pas de l’histoire que font ces auteurs mais bien de la divination.
En 1985, Lombarès réédita son ouvrage sous le titre L’Affaire Dreyfus[26]. La suppression de la seconde partie du titre de la première édition (La Clé du mystère) pouvait laisser espérer plus de mesure comme, dans l’introduction, l’aveu d’erreurs commises (p. 11). Mais il ne fallait pas le lire trop vite. Ces erreurs n’étaient à son point de vue que « de détail » et à bien y réfléchir ce nouveau titre était pire encore qui présentait cette seconde édition comme une histoire ou un essai. En fait, à l’exception de menues corrections, cette édition n’était que la reprise de la précédente, augmentée de trois chapitres qui, affirmait l’auteur avec sérieux, venaient sur la base de publications récentes confirmer son hypothèse, « la seule en accord avec tout ce qu’on savait de cette histoire » (p. 215). Voyons rapidement ce qui pouvait justifier autant d’assurance. Dans ses souvenirs, Mathieu, on s’en souvient, raconte ses expériences avec la voyante Léonie[27]. Lors d’une des séances, elle fit une déclaration dans laquelle Lombarès trouve une confirmation de sa thèse : « Interrogée, poussée par nous, elle déclara que cette pièce [le bordereau] était une copie, un décalque fait à Metz, rapporté par Greber [un agent allemand], dans un but qu’elle ignorait, à l’ambassade allemande à Paris, où elle avait été volée par un agent français.[28] » Et Lombarès, après avoir cité – inexactement –, de commenter : « Cette fois c’était clair, du moins pour nous, car, on le voit, cette phrase écrite dès 1895, résumait parfaitement notre hypothèse. » (p. 197). La preuve est donc une vision de voyante ? Est-ce sérieux ? Et puis si on veut bien prendre le passage entier dont est extraite la citation on verra qu’en aucun cas, comme elle pourrait à elle seule le faire croire, elle ne vient conforter la thèse d’une intox du SR allemand. La citation ne dit pas qui est à l’origine du document et peut faire croire, prise seule, hors de son contexte, que copiée à Metz elle était l’œuvre des Allemands. Mais ce que disait Léonie était tout autre. Citons le passage qui introduit celui sélectionné par Lombarès : « Ainsi elle prétendait que le coupable était un officier du ministère de la Guerre dont elle ne trouvait pas le nom, en relations avec un agent allemand du nom de Greber. Celui-ci apportait à Metz les documents, livrés par cet officier, d’où ils étaient expédiés à Berlin. » Voilà qui ne résume rien et contredit tout… Lombarès ne pouvait trouver meilleure source et meilleure définition de sa manière de travailler. Ce n’est pas de l’histoire que font ces auteurs mais bien de la divination.
 Entre les deux éditions du Lombarès, parut en 1975 Dreyfus ou l’intolérable vérité de Jean Cherasse et Patrice Boussel[29], reprise et complément du « film-débat » sorti l’année précédente. Parallèlement aux commentaires et déclarations, extraites du documentaire, de François Mitterrand, Michel Debré, Alain Krivine, François Brigneau, Edgar Faure, Jean-Pierre Bloch, Daniel Mayer, Marcel Thomas et Henri Guillemin, Jean Chérasse, agrégé d’histoire, ancien élève de l’ENS, y proposait une « hypothèse originale » déjà présente dans son film. Selon lui, l’affaire Dreyfus était un « téléscopage » entre deux affaires : une affaire française et une affaire allemande. Du côté français, elle était une machination antisémite montée par le commandant Biot, journaliste de La Libre Parole et un des promoteurs de la campagne de 1892 contre la présence des juifs dans l’armée. Une machination qui avait pour but de « non seulement porter atteinte à la politique républicaine des Juifs, mais aussi et surtout discréditer le régime de la Troisième République avec un scandale touchant à la Défense nationale et à ce mythe de la “revanche” qui traumatisait littéralement les Français ». L’idée était « de trouver un officier juif alsacien […] et promis à un très bel avenir (c’est-à-dire un saint-cyrien ou un polytechnicien) ; d’observer attentivement son comportement s’il accédait à un des plus hauts niveaux du ministère de la Guerre (état-major de l’armée par exemple) : et de lui “coller une vilaine affaire d’espionnage sur le dos” ». C’est ainsi qu’aurait été choisi Dreyfus. Mais pour que son plan pût réussir, il fallait « disposer au ministère ou à l’état-major des “hautes oreilles favorables” sinon des complicités de premier ordre ». Mercier fut le premier conquis, contre la promesse du soutien de la presse de droite, puis Gonse, Henry, Lauth, Boisdeffre et « probablement bien d’autres ». Sur la base du roman de Louis Létang – encore une fois –, ils machinèrent donc l’affaire et il ne restait plus qu’à piéger la victime choisie, ce dont fut chargé d’Aboville, ami de Biot avec lequel « il allait souvent à la chasse ». Mais Esterhazy ? Et c’est là que commençait la seconde affaire, l’affaire « allemande ». Et Chérasse, pour l’expliquer, de reprendre la thèse de Lombarès (p. 193-200). Il n’est assurément pas nécessaire de commenter cette nouvelle variation de ce que Vincent Duclert appelle drôlement l’« histoire-canon[30] ». Juste deux remarques toutefois. Chérasse, pour expliquer l’affaire « française », affirme que « la “conquête” de Mercier » est un « fait historique ». Dommage que, suivant le procédé de tous ses prédécesseurs et suiveurs, il se contenta de cette simple affirmation. Il eût été intéressant de savoir à quoi il pouvait bien penser et sur quoi pouvait reposer une telle certitude… D’autre part, à propos du « télescopage », on ne peut s’empêcher de noter quelle fut la chance des bourreaux de Dreyfus. Si les allemands n’avaient pas eu la formidable idée d’intoxiquer le S.R. français, Biot et ses amis auraient sans doute pu attendre encore longtemps pour mettre leur plan à exécution…ry, Lauth, Boisdeffre et « e
Entre les deux éditions du Lombarès, parut en 1975 Dreyfus ou l’intolérable vérité de Jean Cherasse et Patrice Boussel[29], reprise et complément du « film-débat » sorti l’année précédente. Parallèlement aux commentaires et déclarations, extraites du documentaire, de François Mitterrand, Michel Debré, Alain Krivine, François Brigneau, Edgar Faure, Jean-Pierre Bloch, Daniel Mayer, Marcel Thomas et Henri Guillemin, Jean Chérasse, agrégé d’histoire, ancien élève de l’ENS, y proposait une « hypothèse originale » déjà présente dans son film. Selon lui, l’affaire Dreyfus était un « téléscopage » entre deux affaires : une affaire française et une affaire allemande. Du côté français, elle était une machination antisémite montée par le commandant Biot, journaliste de La Libre Parole et un des promoteurs de la campagne de 1892 contre la présence des juifs dans l’armée. Une machination qui avait pour but de « non seulement porter atteinte à la politique républicaine des Juifs, mais aussi et surtout discréditer le régime de la Troisième République avec un scandale touchant à la Défense nationale et à ce mythe de la “revanche” qui traumatisait littéralement les Français ». L’idée était « de trouver un officier juif alsacien […] et promis à un très bel avenir (c’est-à-dire un saint-cyrien ou un polytechnicien) ; d’observer attentivement son comportement s’il accédait à un des plus hauts niveaux du ministère de la Guerre (état-major de l’armée par exemple) : et de lui “coller une vilaine affaire d’espionnage sur le dos” ». C’est ainsi qu’aurait été choisi Dreyfus. Mais pour que son plan pût réussir, il fallait « disposer au ministère ou à l’état-major des “hautes oreilles favorables” sinon des complicités de premier ordre ». Mercier fut le premier conquis, contre la promesse du soutien de la presse de droite, puis Gonse, Henry, Lauth, Boisdeffre et « probablement bien d’autres ». Sur la base du roman de Louis Létang – encore une fois –, ils machinèrent donc l’affaire et il ne restait plus qu’à piéger la victime choisie, ce dont fut chargé d’Aboville, ami de Biot avec lequel « il allait souvent à la chasse ». Mais Esterhazy ? Et c’est là que commençait la seconde affaire, l’affaire « allemande ». Et Chérasse, pour l’expliquer, de reprendre la thèse de Lombarès (p. 193-200). Il n’est assurément pas nécessaire de commenter cette nouvelle variation de ce que Vincent Duclert appelle drôlement l’« histoire-canon[30] ». Juste deux remarques toutefois. Chérasse, pour expliquer l’affaire « française », affirme que « la “conquête” de Mercier » est un « fait historique ». Dommage que, suivant le procédé de tous ses prédécesseurs et suiveurs, il se contenta de cette simple affirmation. Il eût été intéressant de savoir à quoi il pouvait bien penser et sur quoi pouvait reposer une telle certitude… D’autre part, à propos du « télescopage », on ne peut s’empêcher de noter quelle fut la chance des bourreaux de Dreyfus. Si les allemands n’avaient pas eu la formidable idée d’intoxiquer le S.R. français, Biot et ses amis auraient sans doute pu attendre encore longtemps pour mettre leur plan à exécution…ry, Lauth, Boisdeffre et « e
 En 1988, parut, plus confidentielle, une nouvelle thèse due à Max Guermann, « La “terrible” verité », publiée dans Les Cahiers naturalistes[31]. L’auteur y développe la thèse d’un montage de la Section de statistique dans le but de se débarrasser de Schwartzkoppen et de l’officine d’espionnage qu’il avait fait de l’ambassade d’Allemagne. Dans cette nouvelle thèse, Dreyfus n’aurait été ainsi que la victime, finalement pratique, de la ressemblance de son écriture avec celle du bordereau, découverte qui contraria l’ingénieux montage. Admettons et pour l’admettre faisons confiance à Esterhazy sur les déclarations duquel repose l’essentiel de l’argumentation. Mais ce faisant regrettons que l’auteur ne nous dise rien de la manière dont la création et la révélation du bordereau eût pu permettre d’atteindre son but si en Dreyfus n’avait pas été reconnu dans le bordereau le scripteur qu’il n’était pas. Sa découverte « a bouleversé le scénario original ». Certes, mais quel était-il ce scénario ? Qu’aurait permis d’obtenir cette pièce qui, comme le dit l’auteur lui-même, « précarité d[e la] combinaison », était pour le moins « un document douteux, ni daté, ni signé, sans destinataire désigné » (p. 53) ? Rien ne nous en est dit. S’il s’agissait de se débarrasser de l’attaché militaire, n’était-il pas plus simple de sortir sa correspondance intime, celle avec Panizzardi, dont la Section de statistique avait quelques pièces pour le moins édifiantes plutôt que d’échafauder ce plan compliqué, incomplet et tellement risqué ?
En 1988, parut, plus confidentielle, une nouvelle thèse due à Max Guermann, « La “terrible” verité », publiée dans Les Cahiers naturalistes[31]. L’auteur y développe la thèse d’un montage de la Section de statistique dans le but de se débarrasser de Schwartzkoppen et de l’officine d’espionnage qu’il avait fait de l’ambassade d’Allemagne. Dans cette nouvelle thèse, Dreyfus n’aurait été ainsi que la victime, finalement pratique, de la ressemblance de son écriture avec celle du bordereau, découverte qui contraria l’ingénieux montage. Admettons et pour l’admettre faisons confiance à Esterhazy sur les déclarations duquel repose l’essentiel de l’argumentation. Mais ce faisant regrettons que l’auteur ne nous dise rien de la manière dont la création et la révélation du bordereau eût pu permettre d’atteindre son but si en Dreyfus n’avait pas été reconnu dans le bordereau le scripteur qu’il n’était pas. Sa découverte « a bouleversé le scénario original ». Certes, mais quel était-il ce scénario ? Qu’aurait permis d’obtenir cette pièce qui, comme le dit l’auteur lui-même, « précarité d[e la] combinaison », était pour le moins « un document douteux, ni daté, ni signé, sans destinataire désigné » (p. 53) ? Rien ne nous en est dit. S’il s’agissait de se débarrasser de l’attaché militaire, n’était-il pas plus simple de sortir sa correspondance intime, celle avec Panizzardi, dont la Section de statistique avait quelques pièces pour le moins édifiantes plutôt que d’échafauder ce plan compliqué, incomplet et tellement risqué ?
 Après quelques années d’accalmie, le virus reparut. Les commémorations à venir relancèrent une machine qu’on avait pu espérer avoir disparu. En 1993, Ida-Marie Frandon publia un curieux ouvrage qui offrait de faire le point sur la lassante question du canon de 75 : L’Affaire et le grand secret. Le Capitaine Dreyfus ou l’épopée du 75[32]. La thèse est connue : pour protéger le formidable canon Esterhazy aurait été envoyé par la Section de statistique à Schwartzkoppen pour lui donner de faux renseignements et l’engager sur la voie du canon de 120. Aucun argument n’étant avancé, il n’y guère plus à dire, à part toutefois une vraie nouveauté, pas plus soutenue, selon laquelle Dreyfus, « courageux, patriote, prisonnier d’apparences ambiguës », aurait accepté une « culpabilité temporaire » (p. 52-53). Cette dernière thèse, qui sera développée en 2000 par Jean-François Deniau, ne nécessite guère d’autre réponse que celle que nous avons donnée ailleurs[33] – et que nous reprendrons à la suite – et qui permet de comprendre la manière de procéder et l’ordre de preuves douteuses convoqué pour servir cette impossible thèse.
Après quelques années d’accalmie, le virus reparut. Les commémorations à venir relancèrent une machine qu’on avait pu espérer avoir disparu. En 1993, Ida-Marie Frandon publia un curieux ouvrage qui offrait de faire le point sur la lassante question du canon de 75 : L’Affaire et le grand secret. Le Capitaine Dreyfus ou l’épopée du 75[32]. La thèse est connue : pour protéger le formidable canon Esterhazy aurait été envoyé par la Section de statistique à Schwartzkoppen pour lui donner de faux renseignements et l’engager sur la voie du canon de 120. Aucun argument n’étant avancé, il n’y guère plus à dire, à part toutefois une vraie nouveauté, pas plus soutenue, selon laquelle Dreyfus, « courageux, patriote, prisonnier d’apparences ambiguës », aurait accepté une « culpabilité temporaire » (p. 52-53). Cette dernière thèse, qui sera développée en 2000 par Jean-François Deniau, ne nécessite guère d’autre réponse que celle que nous avons donnée ailleurs[33] – et que nous reprendrons à la suite – et qui permet de comprendre la manière de procéder et l’ordre de preuves douteuses convoqué pour servir cette impossible thèse.
 En 1994, en annonce au centenaire du début de l’affaire Dreyfus, parut Un secret bien gardé. Histoire militaire de l’affaire Dreyfus par Jean Doise[34], livre tout à fait impressionnant sur les questions relative à la chose militaire et dont on peut juste regretter que son auteur ait cru bon y mêler l’Affaire. Variation de la plupart des ouvrages que nous venons de voir et plus particulièrement du Charpentier, dont il reprend tous les arguments (p. 44-46), il repose sur le postulat de la lettre d’Alsace qu’il entremêle avec la question de l’intox montée pour protéger le 75. Sandherr ayant reçu des informations en provenance d’Alsace sur la trahison d’un nommé Dreyfus, aurait décidé de mettre hors d’état de nuire le stagiaire ainsi nommé et, confiant le travail à Henry, aurait fait fabriquer pour cela le bordereau pour lequel Esterhazy aurait prêté son écriture. Coup double, le bordereau permettait de se débarrasser du traître et de crédibiliser l’informateur Esterhazy. Coup double et même coup triple dans la mesure où la mention du 120 dans le bordereau devait permettre de concentrer l’attention des allemands sur le 120 qui y était mentionné (p. 46, 55-57). Pour Mercier, tout à ses préoccupations relatives au nouveau canon, peu importait finalement que Dreyfus ait trahi. S’il fallait, à tout prix, l’arrêter, le faire juger et condamner, c’était à ses yeux pour le mettre hors d’état de nuire et l’empêcher de parler un jour du 75. Ainsi s’explique pour Doise l’empressement et le peu de souci de la légalité qui furent ceux de Mercier dans le traitement de l’affaire naissante (p. 63-64 et 179). Le montage est ingénieux et à vrai dire plus convaincant et mieux fondé que les précédents. Seulement, il ne repose sur rien et Doise n’avance pas la moindre preuve qui permette de fonder une thèse qui n’est qu’une suite d’affirmations et se heurte à toutes les objections que nous avons déjà soulevées au sujet des ouvrages de ses prédécesseurs. Page 44, l’auteur regrette que la « lettre d’Alsace » ait été « niée ou négligée par la plupart des dreyfusologues », expliquant ainsi pourquoi « ils ont mal interprétés la suite ». Mais comment ne pas négliger – et ne pas nier – une lettre que rien n’atteste, que personne n’a vue, qui aurait disparu si tant est qu’elle ait existé et dont la seule mention un peu tangible est due à Charpentier dans un travail dont nous avons vu ce qu’on pouvait en attendre ? L’histoire ne peut se faire sur d’uniques hypothèses, des spéculations, sur l’absence d’archives et le parti pris de ne pas les consulter, sur une bibliographie étique et discutable et, plus largement, sur une vision tout autant myope qu’astigmate de l’événement qui ne pourrait être compris qu’à la lumière des questions militaires et plus particulièrement de celle liées à l’artillerie[35].
En 1994, en annonce au centenaire du début de l’affaire Dreyfus, parut Un secret bien gardé. Histoire militaire de l’affaire Dreyfus par Jean Doise[34], livre tout à fait impressionnant sur les questions relative à la chose militaire et dont on peut juste regretter que son auteur ait cru bon y mêler l’Affaire. Variation de la plupart des ouvrages que nous venons de voir et plus particulièrement du Charpentier, dont il reprend tous les arguments (p. 44-46), il repose sur le postulat de la lettre d’Alsace qu’il entremêle avec la question de l’intox montée pour protéger le 75. Sandherr ayant reçu des informations en provenance d’Alsace sur la trahison d’un nommé Dreyfus, aurait décidé de mettre hors d’état de nuire le stagiaire ainsi nommé et, confiant le travail à Henry, aurait fait fabriquer pour cela le bordereau pour lequel Esterhazy aurait prêté son écriture. Coup double, le bordereau permettait de se débarrasser du traître et de crédibiliser l’informateur Esterhazy. Coup double et même coup triple dans la mesure où la mention du 120 dans le bordereau devait permettre de concentrer l’attention des allemands sur le 120 qui y était mentionné (p. 46, 55-57). Pour Mercier, tout à ses préoccupations relatives au nouveau canon, peu importait finalement que Dreyfus ait trahi. S’il fallait, à tout prix, l’arrêter, le faire juger et condamner, c’était à ses yeux pour le mettre hors d’état de nuire et l’empêcher de parler un jour du 75. Ainsi s’explique pour Doise l’empressement et le peu de souci de la légalité qui furent ceux de Mercier dans le traitement de l’affaire naissante (p. 63-64 et 179). Le montage est ingénieux et à vrai dire plus convaincant et mieux fondé que les précédents. Seulement, il ne repose sur rien et Doise n’avance pas la moindre preuve qui permette de fonder une thèse qui n’est qu’une suite d’affirmations et se heurte à toutes les objections que nous avons déjà soulevées au sujet des ouvrages de ses prédécesseurs. Page 44, l’auteur regrette que la « lettre d’Alsace » ait été « niée ou négligée par la plupart des dreyfusologues », expliquant ainsi pourquoi « ils ont mal interprétés la suite ». Mais comment ne pas négliger – et ne pas nier – une lettre que rien n’atteste, que personne n’a vue, qui aurait disparu si tant est qu’elle ait existé et dont la seule mention un peu tangible est due à Charpentier dans un travail dont nous avons vu ce qu’on pouvait en attendre ? L’histoire ne peut se faire sur d’uniques hypothèses, des spéculations, sur l’absence d’archives et le parti pris de ne pas les consulter, sur une bibliographie étique et discutable et, plus largement, sur une vision tout autant myope qu’astigmate de l’événement qui ne pourrait être compris qu’à la lumière des questions militaires et plus particulièrement de celle liées à l’artillerie[35].
 L’année 2000 fut riche en suprises. Deux volumes parurent, celui d’Armand Israël, dont il sera question à la suite, et le chapitre de Jean-François Deniau dans Le Bureau des secrets perdus[36]. Dans ce livre, l’ancien ministre, académicien-rameur, développa une thèse selon laquelle toute l’Affaire s’expliquerait par la nécessité pour le SR français de « cacher aux Allemands que nous sommes peut-être en train de découvrir l’arme absolue en matière d’artillerie de campagne », à savoir le prodigieux 75 (p. 23). Mais ce que n’avaient pas prévus les responsables de l’intox – Mercier, Saussier, Deloye –, c’est qu’apparaîtrait un jour un bordereau – oeuvre du SR allemand (p. 52-53) – qui les obligerait à agir pour ne pas éveiller les soupçons des Allemands. Mais là où la thèse est originale – quoi qu’empruntée à Frandon –, c’est que selon notre auteur, Dreyfus aurait été mis dans la confidence et, patriote, aurait accepté de se sacrifier pour le pays (p. 42). « Il n’est pas seulement un innocent injustement condamné : c’est désormais un officier français en service commandé » (p. 43). Ainsi s’explique le « détachement » (!!!???) du capitaine (p. 43), sa certitude que l’Affaire serait réglée dans quelques années (p. 42). Mais l’ultime preuve, le « témoignage aussi poignant qu’irrécusable », est ce « pacte » dont le capitaine parla souvent et qui le liait à Casimir-Perier. Et de citer, en argument définitif à sa démonstration, un extrait d’une de ses lettres au président de la République, qui dit : « C’est pourquoi dans ma dernière lettre, je vous disais, Monsieur le Président, que pour moi, s’il fallait une victime innocente, sacrifiée sur l’autel de la patrie, oh ! que je le sois, que l’on fasse vite, mais que l’on sache pourquoi je succombe… » (p. 57). Qu’on remette cette citation dans son contexte pour voir qu’il s’agit de tout autre chose :
L’année 2000 fut riche en suprises. Deux volumes parurent, celui d’Armand Israël, dont il sera question à la suite, et le chapitre de Jean-François Deniau dans Le Bureau des secrets perdus[36]. Dans ce livre, l’ancien ministre, académicien-rameur, développa une thèse selon laquelle toute l’Affaire s’expliquerait par la nécessité pour le SR français de « cacher aux Allemands que nous sommes peut-être en train de découvrir l’arme absolue en matière d’artillerie de campagne », à savoir le prodigieux 75 (p. 23). Mais ce que n’avaient pas prévus les responsables de l’intox – Mercier, Saussier, Deloye –, c’est qu’apparaîtrait un jour un bordereau – oeuvre du SR allemand (p. 52-53) – qui les obligerait à agir pour ne pas éveiller les soupçons des Allemands. Mais là où la thèse est originale – quoi qu’empruntée à Frandon –, c’est que selon notre auteur, Dreyfus aurait été mis dans la confidence et, patriote, aurait accepté de se sacrifier pour le pays (p. 42). « Il n’est pas seulement un innocent injustement condamné : c’est désormais un officier français en service commandé » (p. 43). Ainsi s’explique le « détachement » (!!!???) du capitaine (p. 43), sa certitude que l’Affaire serait réglée dans quelques années (p. 42). Mais l’ultime preuve, le « témoignage aussi poignant qu’irrécusable », est ce « pacte » dont le capitaine parla souvent et qui le liait à Casimir-Perier. Et de citer, en argument définitif à sa démonstration, un extrait d’une de ses lettres au président de la République, qui dit : « C’est pourquoi dans ma dernière lettre, je vous disais, Monsieur le Président, que pour moi, s’il fallait une victime innocente, sacrifiée sur l’autel de la patrie, oh ! que je le sois, que l’on fasse vite, mais que l’on sache pourquoi je succombe… » (p. 57). Qu’on remette cette citation dans son contexte pour voir qu’il s’agit de tout autre chose :
Le martyre devient trop grand, Monsieur le Président, car non seulement je suis innocent de ce crime abominable, mais contre vents et marées, dans les pires supplices, je n’ai jamais oublié aucun de mes devoirs, devoirs si multiples, tant vis-à-vis de ma famille, que je devais soutenir de mon inébranlable volonté, que vis-a-vis de la patrie.
Oui, Monsieur le Président, j’ai voulu la lumière, je la veux, je veux la vérité de toutes les forces de mon âme, de toutes les forces d’un cœur horriblement mutilé et blessé, je la veux par tous les moyens, mais pour la patrie et par la patrie.
Et alors, Monsieur le Président, il vous est impossible de vous figurer l’horrible détresse de mon âme quand, avec la conscience sûre d’avoir toujours et partout rempli tous mes devoirs, et je défie qui que ce soit d’en apporter une preuve contraire, je vois chaque mois arriver de nouvelles mesures de sûreté, qui donnent lieu, je le vois, je le sens, étant donné la situation, aux hypothèses les plus atroces, les plus infamantes.
C’est pourquoi dans ma dernière lettre, je vous disais, Monsieur le Président, que pour moi, s’il fallait une victime innocente, sacrifiée sur l’autel de la patrie, oh ! que je le sois, que l’on fasse vite, mais que l’on sache pourquoi je succombe…
Si je suis encore debout, dans une situation aussi atroce, supportée depuis longtemps, sous un pareil climat, le cerveau halluciné, le cœur malade, c’est pour ma chère femme, c’est pour mes pauvres enfants, mes pauvres petits martyrs, qui grandissent déshonorés[37]…
Il n’est bien question ici que de la double promesse faite, en premier lieu, au président de taire l’origine du bordereau et, en second lieu, à sa famille de vivre jusqu’à la réhabilitation. Et pour comprendre le sens exact de la phrase qui ne peut en aucun cas permettre l’interprétation forcée qu’en fait Deniau, « s’il fallait une victime innocente, sacrifiée sur l’autel de la patrie, oh ! que je le sois, que l’on fasse vite, mais que l’on sache pourquoi je succombe… », rien n’était plus simple que de se référer à la lettre précédente, ainsi que le capitaine lui-même nous invite à le faire. Dans cette supplique du 8 juillet 1897, il écrivait :
Ma vie, Monsieur le Président, je n’en parlerai pas. Aujourd’hui comme hier, elle appartient à mon pays. Ce que je lui demande simplement comme une faveur suprême, c’est de la prendre vite, de ne pas me laisser succomber aussi lentement par une agonie atroce, sous tant de supplices infamants que je n’ai pas mérités, que je ne mérite pas.
Mais ce que je demande aussi à mon pays, c’est de faire faire la lumière pleine et entière sur cet horrible drame ; car mon honneur ne lui appartient pas, c’est le patrimoine de mes enfants, c’est le bien propre de deux familles[38].
 Mais le chef d’œuvre dans le domaine est assurément le second volume de cette année 2000, Les Vérités cachées de l’affaire Dreyfus, publié par Armand Israël[39]. En dehors de ce titre qui à lui seul est une promesse, le livre d’Armand Israël semble offrir toutes les garanties de la scientificité : un éditeur prestigieux, un préfacier directeur des Archives de la Préfecture de Police et une recherche menée, sous la direction de l’auteur, par « une équipe de chercheurs » et reposant sur « l’exploitation de fonds d’archives jusqu’alors inaccessibles » (quatrième de couverture). Pourtant, on est rapidement frappé par le nombre d’erreur de faits, de noms, de dates, de contradictions d’une page à l’autre qui en font une véritable moulinette de l’approximation. Sous la forme d’une histoire de l’événement, il aborde, pour les corriger, trois points essentiels : le bordereau, son origine et son histoire, la mort d’Henry dont il a en toute simplicité découvert l’identité de l’assassin et le pacte secret passé à l’époque du procès de Rennes entre la famille Dreyfus et le gouvernement. Commençons par le bordereau. Deloye, Boisdeffre et Gonse auraient mis au point un projet visant à protéger les secrets de conception du… nouveau 75. Pour ce faire, Gonse, aurait convoqué Sandherr qui, avec l’aide d’Henry et d’Esterhazy, auraient conçu un plan complexe dans le but d’intoxiquer les allemands. « La découverte d’une affaire d’espionnage d’une telle importance », auraient pensé Gonse et ses comparses, n’aurait pu que faire « du bruit et il suffira à l’État-major français de feindre une grande inquiétude pour que l’information présentée par le bordereau prenne une importance capitale aux yeux de l’Allemagne. Pendant que celle-ci se préoccupera du frein du 120, la France aura le champ libre pour fabriquer sa véritable arme secrète : le canon de 75 » (p. 80). Sandherr aurait donc envoyé Esterhazy chez Schwartzkoppen. Seulement, un problème de taille se serait rapidement posé. Comment en effet, nous explique l’auteur, un simple officier de troupes pouvait-il livrer des informations d’une telle importance (p. 83) ? Les attachés militaires, « au fil du temps » (un peu moins de deux mois !?), commençant à s’interroger, il devenait nécessaire, pour que l’intox se fît, de faire taire leurs soupçons. C’est pour cela que Gonse, Henry, Deloye, demandèrent à Esterhazy « d’écrire sous leur dictée une offre de renseignements (le bordereau) […], laissant entendre que ses informations proviennent de l’État-Major par l’intermédiaire d’un officier félon infiltré dans les lieux » (p. 83-84). Et qui mieux que Dreyfus, alsacien, artilleur, juif, pourra incarner ce fournisseur (p. 84) ? Esterhazy se plia donc à la demande de ses chefs mais « Henry a exigé qu’[il] en recopie une deuxième afin d’en conserver le double, “pour mémoire”. » Pour ce faire, « Esterhazy utilise une technique habituelle à l’époque : un papier calque, aussi appelé papier pelure. C’est en fait ce double qui servira à la machination, et c’est son original, conservé par Henry, que l’on tiendra pour le bordereau annoté (faussement annoté) par Guillaume II, encore désigné sous les termes de « document libérateur » ou « bordereau impérial ». « Esterhazy était si intimement convaincu de la protection inconditionnelle de ses chefs, explique l’auteur, qu’il n’a même pas cherché à dissimuler son écriture de ce deuxième bordereau. Il est cependant très probable qu’il a contrefait son écriture sur le premier bordereau, croyant que seul ce dernier document – non sa copie – serait utilisé, et dans le secret des chancelleries uniquement » (p. 85). La chose est pour le moins bien compliquée et pose une véritable question. Comment cela aurait-il pu être possible puisqu’à en croire l’auteur le bordereau ne serait jamais parvenu à Schwartzkoppen, comme l’indique l’absence d’enveloppe, le fait qu’il n’ait pas été froissé, les déchirures pour le moins curieuses et, surtout, le fait que l’attaché militaire ait dit dans ses souvenirs ne pas l’avoir reçu (p. 86-87) ? Si le bordereau ne lui est pas parvenu, comment Schwartzkoppen aurait-il pu être intoxiqué ? Ce ne put donc être que le 10 novembre 1896, quand Schwartzkoppen découvrit Le Matin et le fac-simile du bordereau, que commença l’intox ? Et de même comment aurait-il pu être rassuré sur la provenance des informations d’Esterhazy ? Pour que cela fût, Esterhazy se devait absolument d’en informer Schwartzkoppen. Il est clair que lui rendant visite le 3 novembre 1894, après la diffusion de la nouvelle de l’arrestation d’un traître à l’État-major, il n’aurait certainement pas laissé passer cette occasion de « faire taire les soupçons ». Pourquoi alors Schwartzkoppen n’en dit-il pas le moindre mot dans ses Carnets ? Pourquoi n’y évoque-t-il pas les soupçons que lui prête M. Israël ? Comment put-il se contenter de noter « qu’interrogé sur l’arrestation de Dreyfus [Esterhazy] n’a pu m’en donner aucune explication[40] ». Mais la principale objection n’est pas là. Comment peut-on imaginer que Sandherr et Henry aient pu imaginer un stratagème si compliqué qui ne pouvait que les desservir et réellement, cette fois, discréditer Esterhazy ? Certes, Esterhazy avait donc un informateur infiltré à l’État-Major… mais il ne l’avait plus… il avait été arrêté, incarcéré et attendait son jugement… A moins, bien sûr, que toute cette mise en scène bien compliquée n’ait eu pour but que de faire passer le seul bordereau. Mais, et nous en revenons au point de départ, encore eût-il fallu que ce fameux bordereau arrivât entre les mains de Schwartzkoppen. Et cela M. Israël le conteste. Passons au « bordereau annoté ». Le montage est ingénieux mais ne tient pas plus. Sans s’attarder sur le « document libérateur » qui ne fut jamais le « bordereau annoté », il est difficile de croire à la possibilité d’un tel stratagème. Quelle complication et quelle épaisse bêtise que celle d’hommes qui voulant perdre Dreyfus gardent le document à l’écriture contrefaite (qui doit sans doute imiter son écriture) et livrent celle qui est de l’écriture « naturelle » d’Esterhazy !!! Et quelle drôle d’idée que d’utiliser du papier pelure dans le but de « doubler le plus précisément possible ce document » pour finalement ne pas le faire…
Mais le chef d’œuvre dans le domaine est assurément le second volume de cette année 2000, Les Vérités cachées de l’affaire Dreyfus, publié par Armand Israël[39]. En dehors de ce titre qui à lui seul est une promesse, le livre d’Armand Israël semble offrir toutes les garanties de la scientificité : un éditeur prestigieux, un préfacier directeur des Archives de la Préfecture de Police et une recherche menée, sous la direction de l’auteur, par « une équipe de chercheurs » et reposant sur « l’exploitation de fonds d’archives jusqu’alors inaccessibles » (quatrième de couverture). Pourtant, on est rapidement frappé par le nombre d’erreur de faits, de noms, de dates, de contradictions d’une page à l’autre qui en font une véritable moulinette de l’approximation. Sous la forme d’une histoire de l’événement, il aborde, pour les corriger, trois points essentiels : le bordereau, son origine et son histoire, la mort d’Henry dont il a en toute simplicité découvert l’identité de l’assassin et le pacte secret passé à l’époque du procès de Rennes entre la famille Dreyfus et le gouvernement. Commençons par le bordereau. Deloye, Boisdeffre et Gonse auraient mis au point un projet visant à protéger les secrets de conception du… nouveau 75. Pour ce faire, Gonse, aurait convoqué Sandherr qui, avec l’aide d’Henry et d’Esterhazy, auraient conçu un plan complexe dans le but d’intoxiquer les allemands. « La découverte d’une affaire d’espionnage d’une telle importance », auraient pensé Gonse et ses comparses, n’aurait pu que faire « du bruit et il suffira à l’État-major français de feindre une grande inquiétude pour que l’information présentée par le bordereau prenne une importance capitale aux yeux de l’Allemagne. Pendant que celle-ci se préoccupera du frein du 120, la France aura le champ libre pour fabriquer sa véritable arme secrète : le canon de 75 » (p. 80). Sandherr aurait donc envoyé Esterhazy chez Schwartzkoppen. Seulement, un problème de taille se serait rapidement posé. Comment en effet, nous explique l’auteur, un simple officier de troupes pouvait-il livrer des informations d’une telle importance (p. 83) ? Les attachés militaires, « au fil du temps » (un peu moins de deux mois !?), commençant à s’interroger, il devenait nécessaire, pour que l’intox se fît, de faire taire leurs soupçons. C’est pour cela que Gonse, Henry, Deloye, demandèrent à Esterhazy « d’écrire sous leur dictée une offre de renseignements (le bordereau) […], laissant entendre que ses informations proviennent de l’État-Major par l’intermédiaire d’un officier félon infiltré dans les lieux » (p. 83-84). Et qui mieux que Dreyfus, alsacien, artilleur, juif, pourra incarner ce fournisseur (p. 84) ? Esterhazy se plia donc à la demande de ses chefs mais « Henry a exigé qu’[il] en recopie une deuxième afin d’en conserver le double, “pour mémoire”. » Pour ce faire, « Esterhazy utilise une technique habituelle à l’époque : un papier calque, aussi appelé papier pelure. C’est en fait ce double qui servira à la machination, et c’est son original, conservé par Henry, que l’on tiendra pour le bordereau annoté (faussement annoté) par Guillaume II, encore désigné sous les termes de « document libérateur » ou « bordereau impérial ». « Esterhazy était si intimement convaincu de la protection inconditionnelle de ses chefs, explique l’auteur, qu’il n’a même pas cherché à dissimuler son écriture de ce deuxième bordereau. Il est cependant très probable qu’il a contrefait son écriture sur le premier bordereau, croyant que seul ce dernier document – non sa copie – serait utilisé, et dans le secret des chancelleries uniquement » (p. 85). La chose est pour le moins bien compliquée et pose une véritable question. Comment cela aurait-il pu être possible puisqu’à en croire l’auteur le bordereau ne serait jamais parvenu à Schwartzkoppen, comme l’indique l’absence d’enveloppe, le fait qu’il n’ait pas été froissé, les déchirures pour le moins curieuses et, surtout, le fait que l’attaché militaire ait dit dans ses souvenirs ne pas l’avoir reçu (p. 86-87) ? Si le bordereau ne lui est pas parvenu, comment Schwartzkoppen aurait-il pu être intoxiqué ? Ce ne put donc être que le 10 novembre 1896, quand Schwartzkoppen découvrit Le Matin et le fac-simile du bordereau, que commença l’intox ? Et de même comment aurait-il pu être rassuré sur la provenance des informations d’Esterhazy ? Pour que cela fût, Esterhazy se devait absolument d’en informer Schwartzkoppen. Il est clair que lui rendant visite le 3 novembre 1894, après la diffusion de la nouvelle de l’arrestation d’un traître à l’État-major, il n’aurait certainement pas laissé passer cette occasion de « faire taire les soupçons ». Pourquoi alors Schwartzkoppen n’en dit-il pas le moindre mot dans ses Carnets ? Pourquoi n’y évoque-t-il pas les soupçons que lui prête M. Israël ? Comment put-il se contenter de noter « qu’interrogé sur l’arrestation de Dreyfus [Esterhazy] n’a pu m’en donner aucune explication[40] ». Mais la principale objection n’est pas là. Comment peut-on imaginer que Sandherr et Henry aient pu imaginer un stratagème si compliqué qui ne pouvait que les desservir et réellement, cette fois, discréditer Esterhazy ? Certes, Esterhazy avait donc un informateur infiltré à l’État-Major… mais il ne l’avait plus… il avait été arrêté, incarcéré et attendait son jugement… A moins, bien sûr, que toute cette mise en scène bien compliquée n’ait eu pour but que de faire passer le seul bordereau. Mais, et nous en revenons au point de départ, encore eût-il fallu que ce fameux bordereau arrivât entre les mains de Schwartzkoppen. Et cela M. Israël le conteste. Passons au « bordereau annoté ». Le montage est ingénieux mais ne tient pas plus. Sans s’attarder sur le « document libérateur » qui ne fut jamais le « bordereau annoté », il est difficile de croire à la possibilité d’un tel stratagème. Quelle complication et quelle épaisse bêtise que celle d’hommes qui voulant perdre Dreyfus gardent le document à l’écriture contrefaite (qui doit sans doute imiter son écriture) et livrent celle qui est de l’écriture « naturelle » d’Esterhazy !!! Et quelle drôle d’idée que d’utiliser du papier pelure dans le but de « doubler le plus précisément possible ce document » pour finalement ne pas le faire…
Tout cela est ridicule, certes. Mais voyons quand même les preuves avancées par l’auteur. La première tient au vocabulaire et n’a que pour but de prouver qu’Henry en est le scripteur. Lisons : « Seul un homme peu cultivé comme Henry a pu commettre ces incorrections. C’est notamment le signe que Sandherr, homme de lettres brillant [ce qui mériterait une explication], n’a pas participé à la rédaction même s’il l’a inspirée. Sans doute s’est-il contenté de préparer le texte dicté par Henry, sans en corriger le vocabulaire qui, pensait-il, ne choquerait pas de la part d’un Alsacien comme Dreyfus. » (p. 86-87) Nous touchons là au comique. Les Alsaciens, à l’époque comme aujourd’hui, parlent parfaitement français et cela surtout quand ils sont polytechniciens. Il est douteux, d’autre part, que Sandherr, lui-même Alsacien – et pourtant présenté comme un « homme de lettres brillant » –, ait pu se dire une chose pareille. Mais passons. La deuxième et la troisième preuves sont sérieuses, qualifiées d’« indiscutables » (p. 92). Henry ayant découvert le bordereau en premier et connaissant Esterhazy depuis vingt ans, il aurait pu, reconnaissant l’écriture de son ami, le détruire. Sans doute, mais à condition que les deux anciens collègues soient restés en relations après 1880, ce qui reste à prouver. L’autre preuve, tout aussi « indiscutable », est plus sérieuse et nous permet de comprendre la méthode. M. Israël cite un rapport de police signé de l’agent Flor qui précise que « Le seul traître de l’État-Major était Henry ayant pour agent Esterhazy et Lemercier-Picard, chargés des communications avec Schwartzkoppen. […] le bordereau fut écrit par Esterhazy agissant par intermédiaire […] sous ordre de Sandherr » (p. 92). Nous savons ce que valent les rapports de police et qu’il faut toujours les prendre avec précaution. Mais surtout, si on veut leur donner quelque crédit, encore faut-il les lire avec attention et les citer en en respectant le texte. En effet, quand on regarde l’original – reproduit en fac-similé ! –, on lit :
Observer assure seul traître état major fut Henry ayant pour agent Esterhazy et Lemercier-Picard chargés des communications avec Schwartzkoppen Bordereau accompagne pièces livrées par Esterhazy il fut écrit par Esterhazy, agissant par intermédiaire et trouvé chez Schwarzkoppen par un agent français qui le porta à commandant Cordier sous ordre de Sandherr. (p. 92)
Passons sur la mauvaise transcription pour nous intéresser aux coupures opérées dans le texte. Le premier mot, « Observer », manque. Il est le titre du périodique anglais. Voilà déjà qui écroule la preuve : le rapport révélateur n’est qu’une vulgaire note de lecture… De plus, la seconde coupe donne un tout autre sens au texte. Disparaît non seulement le fait qu’il fut « trouvé chez Schwartzkoppen », ce qui contredirait la thèse du bordereau jamais sorti de la Section de Statistique, mais encore la phrase relative à Cordier, qui, dans l’original indique juste que Cordier était sous les ordres directs de Sandherr (« qui le porta à commandant Cordier sous ordre de Sandherr »), devient ici la preuve de la participation de Sandherr au complot (« le bordereau fut écrit par Esterhazy agissant par intermédiaire […] sous ordre de Sandherr »).
Concernant le deuxième point, la mort d’Henry, l’auteur a trouvé son assassin : Cesti, que nous avons rencontré auparavant. L’auteur a retrouvé aux archives de la Préfecture de Police un rapport selon lequel un tout à fait obscur régisseur de théâtre affirmait « avoir les preuves que le lieutenant-colonel Henry a été assassiné par Lionel de Cesti » (p. 256 et 257). La preuve est maigre et nous savons, quitte à nous répéter, ce que vaut ce genre de document. Si on devait en croire les rapports de police, Dreyfus aurait été joueur, aurait collectionné les maîtresses, aurait fréquenté des officiers allemands en Belgique, le Syndicat dirigé d’Allemagne aurait existé et distribué des millions à poignées, les dreyfusards auraient été les salariés d’une cause à laquelle ils ne croyaient pas, ou, pour citer un rapport qui se trouve aux Archives nationales, Picquart descendrait « d’un juif du Palatinat nommé Spitzer (traduction : qui pique) », Bernard Lazare serait « un ancien rabbin de Koenigsberg », Zola descendrait « d’un juif dalmate, émigré à Venise »[41], etc. Que Cesti soit mentionné dans un rapport de police ne prouve donc pas grand-chose. Qu’il fut un escroc, qu’il eut des rapports avec Drumont, qu’il fut interrogé par Laurent-Atthalin et que son dossier à la Préfecture de Police soit curieusement vide entre 1898 et 1917 (p. 257-270) n’y ajoute rien. Pourtant il y avait bien une solution pour être définitivement fixé. L’auteur nous la révèle : « […] il nous manquait malgré tout un maillon pour reconstituer la chaîne de nos déductions : il fallait rechercher si une quelconque relation avait pu exister entre Cesti et les grands acteurs de l’Affaire […]. » Et il ajoute : « Cette démarche nous a semblé vouée à l’échec jusqu’à ce que nous découvrions un interrogatoire mené par le général de Pellieux, chargé de l’enquête sur Esterhazy, dans lequel Cesti raconte qu’il a tenté de piéger Mathieu Dreyfus sur ordre de la Section de Statistique » (p. 270). Cesti agent d’Henry… Et l’auteur souligne et donne en note une référence : « Cassation V. II, p. 101, interrogatoire du 25 novembre 1897 ». Et un peu plus loin : « […] Selon Esterhazy, c’est Henry lui-même qui a envoyé Cesti dans la famille Dreyfus » ; et en note une nouvelle référence : Reinach V. III, p. 103. » Et de conclure : « […] Cesti, homme de main de l’État-Major, de la Section de Statistique et de tous ceux qui le payaient, a, sur ordre, assassiné Henry et tenté de maquiller le crime en suicide. » (p. 270). Reconstituons la méthode. Si nous ouvrons le Reinach aux références données, nous pouvons lire que « […] c’était Henry qui avait envoyé cet aventurier [Cesti] aux Dreyfus ». En note, une référence : « Voir t. II, p. 183 ». Si on s’y reporte, on peut lire que « Mathieu avait supposé que Cesti lui était envoyé, par le bureau des Renseignements, pour lui tendre quelque piège ». Ici une nouvelle note qui dit que « Cesti raconta sa tentative à Henry, qui en informa Esterhazy ; celui-ci en parla à Pellieux ». (cass., II, 101, interrogatoire du 25 novembre 1897) ». L’auteur peut donc écrire avoir découvert « un interrogatoire mené par le général Pellieux, chargé de l’enquête sur Esterhazy, dans lequel Cesti raconte qu’il a tenté de piéger Mathieu Dreyfus sur ordre de la Section de Statistique » et, sans vérification, reproduire la note de Reinach. Et c’est là qu’apparaît le problème de méthode qui fait de ce livre, dont les bonnes intentions sont incontestables, un bien curieux travail. Si l’auteur était allé à la source qu’il indique, la source Pellieux, il aurait pu lire : « […] l’un des agents les plus actifs dans les bas-fonds du syndicat, est le nommé Cesti, compromis dans les affaires Lebaudy. […] Il a eu, il y a quelques temps, un dossier Dreyfus entre les mains, qu’il a fait copier, à la machine à écrire, par une dactylographe, dont je saurai bientôt le nom. Il a eu aussi, entre les mains, une série de lettres soi-disant à moi adressées par une espionne, de différents points de la frontière. » La déposition n’est donc pas de Cesti, mais d’Esterhazy et, surtout, Cesti y est présenté non comme un « agent de la Section de Statistique » mais comme un allié des Dreyfus. Et quant à l’instruction Pellieux, consultable aux Archives nationales, elle ne contient pas la moindre déposition de Cesti… et pour cause… La boucle que l’auteur annonçait « bouclée » se déboucle.
Quant au troisième point, le pacte entre le gouvernement et la famille Dreyfus, il est le suivant. Pour satisfaire l’armée et permettre à l’innocent de ne pas rester en prison, Waldeck-Rousseau va « convaincre Alfred Dreyfus de se reconnaître coupable en échange de sa grâce » (p. 318).
Alfred Dreyfus, d’abord réticent à cette idée, n’a accepté cette solution que pour sauver l’Armée. A ses yeux, l’honneur de l’Armée française compte plus que le sien.
Par dévouement à sa patrie, Alfred Dreyfus taira même toute sa vie l’existence de ce pacte, sans jamais répondre à ceux qui trouvaient inacceptable son silence. (p. 321).
Pour soutenir l’insoutenable, l’auteur se fonde sur les « archives de Maître Labori », intitulées en note : “Notes manuscrites” de Labori, recueillies par sa femme Marguerite » (p. 322) et données dans la section « Les archives » de la bibliographie (p. 489). On n’aura compris qu’il ne s’agit pas d’archives, ici, mais de l’ouvrage de Marguerite-Fernand Labori[42] qui, curieusement, manque dans la partie « Sources bibliographiques ». Ce sont sans doute là « les fonds d’archives jusqu’alors inaccessibles » annoncés par le quatrième de couverture[43]… Est-il nécessaire de préciser les problèmes que posent l’ouvrage de Marguerite-Fernand Labori[44] et donc sur la thèse qu’il défend et qui est reprise ici, en toute tranquillité, sans recul ni esprit critique ?
 En 2008, ce fut au tour de Franck Ferrand de nous donner son point de vue sur l’Affaire dans son Histoire interdite. Révélations sur l’histoire de France[45]. En 30 pages qui accumulent les approximations, les erreurs et les naïvetés (on notera le superbe : « cette pièce prendra le nom de faux Henry, ce qui nous en dit long, déjà, sur son authenticité…), il reprenait la thèse du troisième homme, occasion de fustiger la « vulgate » de « l’histoire officielle ». Passons.
En 2008, ce fut au tour de Franck Ferrand de nous donner son point de vue sur l’Affaire dans son Histoire interdite. Révélations sur l’histoire de France[45]. En 30 pages qui accumulent les approximations, les erreurs et les naïvetés (on notera le superbe : « cette pièce prendra le nom de faux Henry, ce qui nous en dit long, déjà, sur son authenticité…), il reprenait la thèse du troisième homme, occasion de fustiger la « vulgate » de « l’histoire officielle ». Passons.
Tous ces ouvrages, qui procèdent – nous voulons le croire – de louables intentions, posent toutefois de sérieux problèmes. Le premier, on l’a vu, est un problème de méthode. Le recours aux sources secondaires, voire aux sources de seconde main, ne peut permettre d’avoir une lecture claire, et surtout une lecture exacte, de l’Affaire et ouvre la porte à toutes les interprétations dont le principal défaut est de ne reposer sur rien d’autre que sur la capacité d’imagination de celui qui écrit. On ne peut travailler sur l’Affaire en faisant l’économie d’un sérieux travail archivistique et sans avoir au moins lu la totalité des procédures au cours desquelles les différents acteurs s’exprimèrent, se contredirent, se corrigèrent, etc. Le deuxième problème est un problème de parti pris qui dépasse très largement la question historienne stricto sensu. Le ton péremptoire qui caractérise tous ces travaux, la grille de lecture mise en place et dans laquelle tout doit entrer, quitte à en étirer ce qui est trop court, à en couper ce qui dépasse – une manière d’écrire l’histoire comme Procuste concevait l’hospitalité qu’il offrait à ceux qu’il rencontrait sur son chemin –, relève d’une simple question d’honnêteté intellectuelle. Enfin, le troisième problème, qui est plus sérieux celui-là, est que cette nécessité de trouver d’autres raisons que le simple engrenage fatal de l’erreur devenu crime pour ne pas se dédire, que cette manie de l’intox, du sacrifice volontaire, etc., constitue une manière de légitimation de la politique de l’État-major[46], pire même une proclamation d’innocence qui n’est jamais qu’une nouvelle forme, d’une manière douce et recevable dans le propos, de la défense antidreyfusarde de la raison d’État. On ne remet plus en question l’innocence de Dreyfus mais on continue d’excuser le crime dont il fut victime par des « raisons supérieures » face auxquelles les libertés individuelles ne pouvaient, ne peuvent et ne pourront jamais avoir de poids.
Philippe oriol
[1] Georges Sorel, La Révolution dreyfusienne, Paris, Librairie des sciences politiques et sociales Marcel Rivière, 1909, p. 9.
[2] Vincent Duclert, Alfred Dreyfus. L’honneur d’un patriote, Paris, Fayard, 2006, p. 999.
[3] A propos de l’arrêt de 1906 : « En fuyant les débats, Dreyfus semblait, une seconde fois, se reconnaître coupable ! » (p. 197).
[4] Lettre d’Esterhazy à Carrière du 6 août 1899 publiée dans La Révision du Procès de Rennes. Enquête de la Chambre criminelle de la Cour de cassation (5 mars 1904-19 novembre 1904), 3 vol., Paris, Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen, 1908, t. III, p. 681.
[5] Les Carnets de Schwartzkoppen (la vérité sur Dreyfus), Paris, Rieder, 1930, p. 5.
[6] Déposition Du Paty à l’occasion de la seconde révision dans La Révision du Procès de Rennes. Enquête de la Chambre criminelle de la Cour de cassation (5 mars 1904-19 novembre 1904), op. cit., t. II, p. 720-721.
[7] Lettre de Berthe Henry à Charpentier du 15 décembre 1935 citée dans Armand Charpentier, Les Côtés mystérieux de l’affaire Dreyfus, op. cit., p. 139. Voir aussi la lettre du 2 juin, p. 136.
[8] Déposition Wattinne dans La Révision du Procès de Rennes. Enquête de la Chambre criminelle de la Cour de cassation (5 mars 1904-19 novembre 1904), op. cit., t. II, p. 605-606.
[9] Publié l’année suivante chez Calmann-Lévy.
[10] Armand Charpentier, Les Côtés mystérieux de l’affaire Dreyfus, op. cit., p. 180-214.
[11] Ibid., p. 207, note 1.
[12] Déposition Picquart dans L’Affaire Dreyfus. Le Procès Zola devant la Cour d’Assises de la Seine et la Cour de Cassation (7 février-23 février – 31 mars-2 avril 1898. Compte rendu sténographique « in extenso », Paris, Stock, 1998, p. 346-347.
[13] Articles reproduits p. 267-271 du livre de Charpentier.
[14] « La Déposition d’Esterhazy devant le Consul général de France à Londres. Texte publié par “L’Indépendance belge” » dans Commandant Esterhazy. Dépositions et explications complètes, Bruxelles, G. Fischlin, 1901, p. 101.
[15] « Note » de Walter du 7 mai 1903, AN BB19 75.
[16] Il enseignant de voir sur les rabats de la jaquette un argus du livre de Paléologue…
[17] Maurice Paléologue, Journal de l’affaire Dreyfus,Paris, Plon, 1955, p. 271.
[18] Est-ce à lui que pensait Paléologue, comme nous l’indiquerait Legrand-Girarde (Un quart de siècle au service de la France, Paris, Presses Littéraires de France, 1954, p. 461) qui note en 1904 cette conviction des Affaire étrangères ? Une conviction qu’il qualifie de « haut délire, ou alors… » Ou pensait-il à Saussier, comme l’aurait confirmé son « hréritière » (Michel de Lombarès, L’Affaire Dreyfus. La Clé du mystère, Paris, Robert Laffont, Les ombres de l’histoire, 1972, p. 12-13).
[19] On la trouve aux pages 67-69.
[20] P. 113.
[21] Maurice Paléologue, Journal de l’Affaire Dreyfus, op. cit., p. 29.
[22] Sur ce fait, peu connu, voir notre Histoire de l’Affaire Dreyfus à paraître en 2013 aux Belles Lettres.
[23] Michel de Lombarès, L’Affaire Dreyfus. La Clé du mystère, Paris, Robert Laffont, Les ombres de l’histoire, 1972. La thèse exposée dans ce livre était la reprise très largement augmentée d’un article, « L’Affaire Dreyfus. Aperçu général. Aperçus nouveaux », publié dans la Revue de Défense nationale, juillet 1969, p. 1125-1143.
[24] Maurice Baumont, Aux sources de l’Affaire Dreyfus. L’Affaire Dreyfus d’après les archives diplomatiques, Paris, Les Productions de Paris, 1959, p. 22-23.
[25] Les Carnets de Schwartzkoppen (la vérité sur Dreyfus), op. cit., p. 19.
[26] Michel de Lombarès, L’Affaire Dreyfus, Paris/Limoges, Lavauzelle, 1985.
[27] Cf. supra, p. ???????????
[28] Mathieu Dreyfus, L’Affaire telle que je l’ai vécue, Paris, Grasset, 1978, p. 50.
[29] Jean Cherasse et Patrice Boussel, Dreyfus ou l’intolérable vérité, Paris, Pygmalion, 1975.
[30] Vincent Duclert, Dreyfus au Panthéon. Voyage au cœur de la République, op. cit., p. 275.
[31] Max Guermann, « La “terrible” vérité », Les Cahiers naturalistes, n° 62, 1988, p. 35-57.
[32] Ida-Marie Frandon, L’Affaire et le grand secret. Le Capitaine Dreyfus ou l’épopée du 75, Fontainebleau, L’Auteur, 1993.
[33] Dans notre Histoire de l’affaire Dreyfus, op. cit., p. 301-303.
[34] Jean Doise, Un secret bien gardé. Histoire militaire de l’affaire Dreyfus, Paris, Seuil, 1994.
[35] Voir à ce sujet l’excellent et salutaire article de Vincent Duclert, « L’Affaire Dreyfus et le tournant critique », Annales. Histoire, Sciences sociales, 50e année, n° 3, 1995, p. 563-578.
[36] Jean-François Deniau, Le Bureau des secrets perdus, Paris, Odile Jacob, 2000, p. 17-72.
[37] Lettre de Dreyfus au Président de la République du 5 octobre 1897 (lettre dont une copie figurait sous le numéro 106 dans le dossier secret : « Dossier secret Dreyfus », AN BB19 118 et MAHJ, 97.17.61.1. Il en existe aussi une copie dans les papiers Esterhazy conservées à la BNF, n.a.fr. 16464).
[38] Lettre de Dreyfus au Président de la République du 8 juillet 1897, dans Alfred Dreyfus, Cinq années de ma vie, op. cit., p. 228. Citée dans La Révision du procès Dreyfus. Débats de la Cour de cassation, op. cit., p. 324. Sur cette question du « pacte », voir notre Histoire de l’affaire Dreyfus, op. cit., p. 298-308.
[39] Armand Israël, Les Vérités cachées de l’affaire Dreyfus, Paris, Albin Michel, 2000.
[40] Les Carnets de Schwartzkoppen (la vérité sur Dreyfus), op. cit., p. 127.
[41] « Information du 20 février 1898 », AN BB19 114.
[42] Marguerite-Fernand Labori, Labori. Ses notes manuscrites. Sa vie, Paris/Neuchatel, Éditions Victor Attinger, 1947.
[43] Encore les « Archives juives » qui sont la revue du même nom publiée par Liana Lévi.
[44] Nous reviendrons longuement sur cette question dans notre Histoire à paraître.
[45] Franck Ferrand, L’Histoire interdite. Révélations sur l’histoire de France, Paris, Tallandier, 2008.
[46] Vincent Duclert, « L’Affaire Dreyfus et le tournant critique », Annales. Histoire, Sciences sociales, 50e année, n° 3, 1995, p. 563-578.
Ping : Réplique au historiens dreyfusards d'Adrien Abauzit, auteur de L'Affaire Dreyfus entre farces et grosses ficelles et Réponse à sa réponse | L'affaire Dreyfus
http://affaire-dreyfus.com/2018/12/01/replique-au-historiens-dreyfusards-dadrien-abauzit-auteur-de-laffaire-dreyfus-entre-farces-et-grosses-ficelles-et-reponse-a-sa-reponse/
Ping : L'histoire interdite de Franck Ferrand | L'affaire Dreyfus
Ping : L'affaire Dreyfus de Serge Pacaud | L'affaire Dreyfus