Sur Gallica : on clique ici
3Des images trouvées il y deux ou trois ans sur un site de vente en ligne…
Inédites et tout à fait étonnantes…
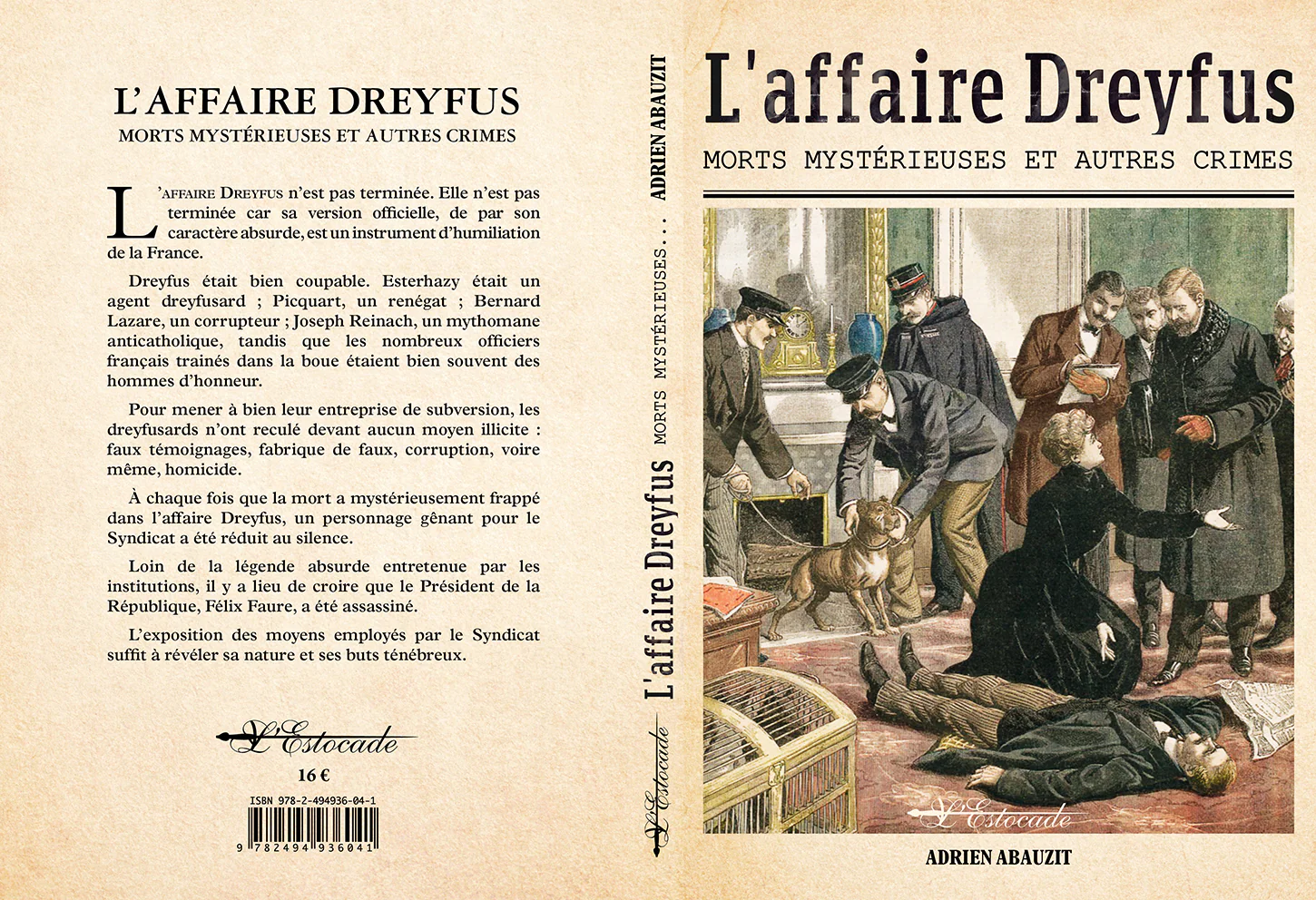 Adrien Abauzit, après un premier ouvrage pour le moins incertain (voir ici), et un deuxième, réponse pour le moins hypermétrope à nos critiques (voir ici, ici puis ici), nous en donne un troisième : L’affaire Dreyfus. Morts mystérieuses et autres crimes, en partie inspiré par Les Morts mystérieuses du petit antisémite Albert Monniot, ouvrage publié en 1918 puis à nouveau en 1934. La réponse une nouvelle fois sera longue non seulement parce qu’il y a beaucoup à dire mais encore parce que la structure du livre passe, de partie en partie et de chapitre en chapitre, d’un sujet à l’autre et que tout y mérite commentaire.
Adrien Abauzit, après un premier ouvrage pour le moins incertain (voir ici), et un deuxième, réponse pour le moins hypermétrope à nos critiques (voir ici, ici puis ici), nous en donne un troisième : L’affaire Dreyfus. Morts mystérieuses et autres crimes, en partie inspiré par Les Morts mystérieuses du petit antisémite Albert Monniot, ouvrage publié en 1918 puis à nouveau en 1934. La réponse une nouvelle fois sera longue non seulement parce qu’il y a beaucoup à dire mais encore parce que la structure du livre passe, de partie en partie et de chapitre en chapitre, d’un sujet à l’autre et que tout y mérite commentaire.
Avant de commencer à passer en revue dans l’ordre ce nouvel opus et d’y apporter nos commentaires, précisions et nécessaires et très nombreuses corrections, extrayons un exemple qui se place à la fin du déroulé et qui nous semble représentatif de l’habituelle méthode ici pratiquée. Adrien Abauzit connaît un peu, juste un peu, son sujet mais ses cruelles insuffisances ne l’empêchent aucunement non seulement de se poser en fin connaisseur mais surtout de porter des jugements sur tout et tous, et ce, invariablement, au petit bonheur. Dans sa défense habituelle de l’inénarrable Bertillon (voir ici) et ses attaques répétée contre Joseph Reinach, Adrien Abauzit se perd tout à fait. Il ne sait pas, affirme, accuse, essaie de se donner l’apparence de la scientificité et tout cela avec un ton qui se veut ironique et cinglant et qui n’est ni l’un ni l’autre. Ainsi, Adrien Abauzit croit porter l’estocade en nous disant que Reinach est un menteur inventant les faits de « toutes pièces ». Citons :
« La graphologie, c’est de l’astrologie. »
Voici la phrase que Reinach prête à Alphonse Bertillon, chef du service judicaire d’anthropométrie [sic], qu’il cherche à faire passer pour fou tout au long de sa fable. D’où Reinach tient-il cette phrase de Bertillon ? À nouveau, examinons la note de bas de page au soutien de laquelle le polémiste se moque de l’expert, si tant est bien entendu que cette note existe. Le lecteur ne sera pas surpris : il n’y a aucune note de bas de page.
Reinach, pour plaider sa cause, en est réduit à inventer des paroles à des acteurs de l’Affaire.
L’affaire Dreyfus est décidément indissociable des farces et grosses ficelles reinachiennes.
Si Adrien Abauzit avait un peu plus travaillé, s’il connaissait un peu la période et le sujet dont il parle, il aurait évité de se perdre comme il le fait ici. Et non ! Reinach n’a pas mis de note de bas de page… Et s’il ne l’a pas fait, ce n’est pas parce qu’il ment mais peut-être parce que la note en question n’était d’aucune nécessité… S’il ne l’a pas fait c’est parce que que tout le monde se souvenait, en 1901, date de la sortie en librairie de son volume, de cette sortie tonitruante de la fin de 1897 et que depuis, hilares, s’amusaient à reprendre les dreyfusards. Car bien évidemment qu’il a prononcé cette phrase, l’ahurissant Bertillon ! Comment Adrien Abauzit, qui a enfin lu la presse, et même s’il l’a lue un peu, un tout petit peu, a-t-il pu passer à côté ? On la trouve dans Le Temps, Le Figaro, Le Gaulois, Le Soleil, Le Petit Marseillais du 17 novembre, dans La Patrie, La Gazette de France, Le Moniteur universel, La Petite République du 18 novembre… et nous ne donnons ici qu’une infime sélection de la reprise de cette sortie fameuse…
Voilà toute la méthode, et le reste sera à l’avenant… Allons-y, donc, comme disait l’autre et commençons notre revue de détail, dans l’ordre exact des chapitres.
En introduction, Adrien Abauzit parle de nous et, une nouvelle fois, se satisfait de ce que nous lui ayons consacré de nombreuses pages. Nous aurions en effet « jugé opportun de lui livrer bataille » et ce faisant nous l’aurions « valid[é] […] comme un contradicteur crédible ». Nous n’avons pas jugé opportun de lui livrer bataille pour la simple raison que nous ne le considérons pas comme un adversaire. Tout d’abord, nous avons parlé de ses ouvrages comme nous parlons de tous ceux qui paraissent sur l’Affaire. Ensuite, comme nous le lui avons déjà expliqué, et qu’il a déjà oublié, nous n’avons fait, en nous intéressant à ses publications, que remplir le rôle que nous nous sommes assignés en 1994 aux termes de l’article 2 de nos statuts : « Cette association, à vocation scientifique, se veut animée par un esprit de vigilance à l’égard de la vérité historique. » Et puisqu’il la tord, cette vérité historique, nous venons la redresser. Si, aux termes de très nombreuses pages, en effet, qui montrent ce que nous pensons de son travail, Adrien Abauzit a le sentiment de se sentir crédibilisé, grand bien lui en fasse. Il suffit de lire ces nombreuses pages pour voir que si nous en parlons, puisqu’il est indiscutable qu’Adrien Abauzit existe et que ses livres aussi, nous n’accordons aucun crédit à des « démonstrations » qui montrent avant tout qu’il ne connaît que peu le sujet dont il parle et qu’il fait de l’histoire comme Procuste faisait du brigandage, en coupant ce qui gêne parce qu’il dépasse du cadre. Et le petit dernier dont il est ici question ne nous démentira pas, tant il semble gravir encore un degré d’une échelle qui semble sans fin…. Et libre enfin à Adrien Abauzit de croire que nos critiques se sont retournées contre nous, comme il l’écrit sur cette même page. La cécité n’est qu’inconvénients mais offre au moins la consolation d’imaginer la réalité telle qu’on aimerait la voir et de la voir telle qu’on se l’imagine…
L’interrogatoire de Dreyfus
Ainsi est titré le premier chapitre, ou plus exactement le chapitre 0, matérialisé par un tout à fait idoine o barré (Ø), symbole de l’ensemble vide. Adrien Abauzit donne ici le premier interrogatoire de Dreyfus à Rennes dans lequel, en un commentaire liminaire et quelques notes, il nous dit que « Dreyfus refuse de s’expliquer », que le « laconisme de ses réponses est pour le moins suspect », qu’il ment éhontément, élude les questions en ayant recours à des sophismes (un mot qu’affectionne particulièrement Adrien Abauzit), etc. Il faudrait lire ce passage (qu’on peut trouver ici) pour que chacun se fasse son idée. Nous, nous y voyons au contraire la volonté de Dreyfus de répondre le plus exactement possible, de toujours être précis, de retrouver la chronologie d’événements vieux de cinq ans (et coupés par « l’intermède » de l’île du Diable), de reconnaître ce qui est vrai et de contester ce qui est faux, de corriger aussi les imprécisions de son interlocuteur (corrections qui ne constituent aucunement des « sophismes » mais des précisions), etc.
Il est stupéfiant de voir Adrien Abauzit, et surtout parce qu’il est avocat, accuser systématiquement Dreyfus de mensonge quand il conteste un fait qu’on lui reproche et ce parce qu’un témoin de l’accusation a dit le contraire… Si la justice devait se rendre de telle manière, si l’accusation devait systématiquement dire la vérité et le prévenu mentir, les avocats ne serviraient à rien, Adrien Abauzit serait au chômage et ce serait sans doute dommage. Et c’est pourtant Adrien Abauzit, qui, p. 143 de ce livre, écrit, pour écarter le témoignage de Bruyerre, coupable de dreyfusisme : « il y a lieu de s’interroger sur la valeur probante du témoignage d’un individu de parti pris »… Passons… ce qui est valable pour les uns ne doit pas l’être pour les autres… et revenons à notre question, et à l’interrogatoire de Dreyfus. Nous ne donnerons qu’un exemple qui, encore une fois, montre la méthode (ou l’absence d’icelle) d’Adrien Abauzit. Véritable obsession, il revient sur l’histoire de la dictée dont nous avons montré déjà le peu de valeur (voir ici et ici, ctrl F : dictée) et reprend la même pauvre « preuve » qui n’en est pas une. Il a beau changer ses mots (« changer » pour « modifier »), la chose demeure la même. Dreyfus n’a pas, comme l’écrit Adrien Abauzit, « reconn[u] lui-même qu’il a[vait] changé son écriture pendant la rédaction du texte » mais, ce qui est fort différent, que son écriture avait changé. Donnons, pour une meilleure compréhension, le passage en question.
LE PRESIDENT. — Un jour, le commandant du Paty de Clam vous à fait venir au ministère sous prétexte de passer l’inspection générale. Il vous à fait écrire une lettre commençant par des choses insignifiantes, puis à un moment donné il vous a dicté, ou à peu près, le contenu du bordereau. Le commencement de cette lettre est de votre écriture ordinaire, mais à partir de l’endroit ou l’on parle du canon de 120 court, votre écriture change de caractère, elle est moins nette et moins ferme.
LE CAPITAINE DREYFUS. — Elle n’a jamais changé, mon colonel.
LE PRESIDENT. — Lorsqu’on jette un coup d’œil sur cette lettre dont voici une photographie, on constate facilement que l’écriture depuis les mots : « 1° une note sur le frein hydraulique » jusqu’à la fin est beaucoup plus grande et plus large qu’au commencement. (Le Président présente la photographie en question au capitaine Dreyfus).
LE CAPITAINE DREYFUS. — L’écriture est plus large, mon colonel.
LE PRESIDENT. — Elle change, elle est plus large, moins bien formée ; cela peut s’expliquer par une émotion…
LE CAPITAINE DREYFUS. — D’abord, je vous ferai remarquer que l’élargissement des lettres commence à « je me [sic] rappelle »; or, « je me [sic] rappelle » n’a rien qui se rapporte au bordereau.
Comme nous l’écrivions dans une précédente réponse :
Dreyfus n’a aucunement reconnu ici avoir « modifié son écriture », ce qui entend une action volontaire, moins encore d’avoir « tent[é] de modifier son écriture », ce qui aggrave la question de l’acte volontaire ! Il a reconnu qu’à tel endroit – qui d’ailleurs n’est ni celui que voit Jouaust ni celui que voit Adrien Abauzit, qui a chaussé les lunettes de Dutrait-Crozon –, non que la disposition de ses mots était différente mais que son écriture était « plus large », juste « plus large »…
Et quand bien même cette réalité – qui ne nous saute pas aux yeux – serait, en quoi cette modification dans la graphie pourrait-elle constituer « une nouvelle preuve de sa culpabilité » ? Adrien Abauzit nous le dit : « puisque cela signifie qu’il connaissait le contenu du bordereau ». Si une preuve pouvait être établie sur de telles bases, les prisons seraient pleines, elles seraient pleines d’innocents et Adrien Abauzit serait toujours au chômage…
L’assassinat de Félix Faure
Adrien Abauzit a découvert un ancien livre d’André Galabru, il l’a lu celui-là, et a été convaincu : Félix Faure a été assassiné par les dreyfusards. Syndicat d’espionnage et de trahison, syndicat d’évasion et… syndicat du crime ! Nous sommes en plein délire… Mais ne l’écartons pas ce délire, comme il mériterait de l’être d’un simple revers de main… discutons-le un peu. Avant de commencer, il est amusant de voir Adrien Abauzit qui, dans son premier volume, disqualifiait l’expert Crépieux-Jamin au motif qu’il était dentiste, foncer tête baissée dans la littérature de Galabru, ancien militaire, professeur de philosophie, employé dans l’industrie pharmaceutique et chanteur à ses heures. Adrien Abauzit a trouvé le livre de notre professeur/chanteur/marchand de médicaments « prudent et on ne peut plus rigoureux » et « particulièrement bien documenté » puisqu’il repose sur le travail qu’Adrien Abauzit n’a pas fait et ne fera pas, celui d’aller consulter les archives : « les Archives nationales, les Archives de police de la Préfecture de Paris et […] diverses archives privées ». La « démonstration » d’Adrien Abauzit, qui n’est que celle du « prudent » Galabru qu’il se contente de résumer, est la suivante : le président de la République a été empoisonné par sa maîtresse, Marguerite Steinheil, à la demande de ses amis dreyfusards et tout particulièrement de Scheurer-Kestner, et cela non seulement « en raison de son engagement antidreyfusard » mais aussi parce qu’il préparait un coup d’État avec Déroulède. Les preuves ? La thèse officielle de l’apoplexie quand les premiers soins apportés seraient ceux que l’on prodigue dans les cas d’empoisonnement, l’absence d’autopsie et l’embaumement hâtif et la présence d’une cellule d’espionnage dreyfusarde à l’Élysée !
Déjà, il faut dire pour commencer que Félix Faure ne s’est jamais « engag[é] » du côté antidreyfusard. Il ne s’est pas engagé parce que, président de la République, il ne le pouvait pas et demeura toujours, comme l’exigeait sa charge, au-dessus des partis. On sait en revanche que s’il fut longtemps convaincu de la culpabilité de Dreyfus et l’était peut-être encore à la veille de sa mort (nous l’ignorons et rien ne nous permettra de le savoir), il était, comme en témoignera à plusieurs reprises son Directeur de cabinet, Le Gall, partisan de « la révision prompte et complète ». Quant à cette histoire de coup d’État, elle ne repose que sur le témoignage d’un anonyme (et très complotiste) Quisait qui, nous dit Adrien Abauzit, était « probablement parlementaire ». Adrien Abauzit se targue, dans les premières pages de ce livre, d’avoir – enfin – utilisé la presse… Il aurait dû le faire, vraiment (trois clics sur Google), et ne pas se contenter de reprendre en les extrapolant les références fausses ou approximatives de Galabru qui parle d’un « ancien homme politique, député ou sénateur ». Quisait ne fut jamais un parlementaire mais un journaliste de L’Intransigeant (ou plus exactement une signature omnibus ; on la retrouve dans L’Intransigeant de 1905 à 1919) qui était allé voir, pour recueillir ses paroles, « un solitaire que l’on ne voit jamais aux premières ; qui paraît deux fois par an à la Chambre, les jours où il espère que le tigre dévorera le dompteur, mais qui n’en suit pas moins, d’un œil attentif, la marche de la politique et qui en connaît maints dessous » (« Le roman rouge de l’impasse Ronsin racontée par un témoin », L’Intransigeant, 18 décembre 1908). Ce solitaire – que rien ne nous présente donc comme un député ou sénateur, ancien ou probable – avait échafaudé toute une histoire, rapportée par Quisait, reprise par Galabru, et ici par Adrien Abauzit, selon laquelle Déroulède serait venu voir Faure au début de février 1899 pour lui proposer, « pendant un interrègne, [de faire] une proclamation mettant le pays en demeure de se prononcer entre l’armée nationale et ses détracteurs et une dissolution de la Chambre ». Le président aurait demandé à réfléchir et le 13 février aurait invité Déroulède à venir le revoir le 17… Faure aurait finalement accepté la proposition et aurait pour cela rédigé une proclamation (« Le roman rouge de l’impasse Ronsin racontée par un témoin », L’Intransigeant, 19 décembre 1908). Avant d’aller au fond du sujet, une petite question : ne trouvez-vous pas, Adrien Abauzit, qu’il est difficile de fonder toute la preuve sur un article de journal, de surcroît un article sous pseudonyme, et un pseudonyme omnibus, qui donne la parole à un mystérieux informateur dont personne ne saura jamais rien, ni le nom, ni la qualité ?… Un article de journal et de quel journal ? De L’Intransigeant qui, sous Rochefort ou sous Bailby, ne s’est jamais embarrassé avec la vérité ! Mais peu importe parce qu’Adrien Abauzit (ou plus exactement André Galabru) a une autre « preuve » : enfin… un autre article, plutôt, issu cette fois de L’Espérance du Peuple (de Nantes), qui parle aussi de cette proclamation, proclamation qui aurait été volée à Félix Faure (?) et dont il avait si souvent entretenu sa maîtresse. Qu’est cet article ? Un article qui contient une soi-disant lettre de Félix Faure à Marguerite Steinheil. Une lettre étonnante et qui, si elle était vraie, montrerait la légèreté, l’inconscience d’un président qui, rédigeant des proclamations de coup d’État, en entretient longuement sa maîtresse, ce qui déjà en soi serait formidable et l’est plus encore quand on sait que la maîtresse en question était liée à la famille Scheurer-Kestner… mais admettons… le cœur a ses raisons… une lettre étonnante, donc, mais surtout une lettre dont personne n’a jamais vu l’original et qui est (l’article le dit) sans signature !!! Quand on se souvient de tout ce qu’a développé Adrien Abauzit au sujet du petit bleu parce qu’il était non signé, quand on se souvient de son « coup » de la lettre à Macron dont il s’est montré si fier (voir nos précédentes réponses précitées), la chose devient plus qu’amusante… Une lettre étonnante, une lettre pour le moins douteuse mais qui a aussi, pour Adrien Abauzit, une autre importance puisqu’elle révèle qu’on avait « fait pression sur lui [Félix Faure] pour lui faire « sanctionner » une trahison ». Si Adrien Abauzit était allé vraiment voir la presse, comme il dit l’avoir fait et l’a fait un peu, un tout petit peu, il n’aurait pas fait confiance à L’Intransigeant, qu’il cite ici, et qui disait cela dans son numéro du 12 décembre. Il serait allé voir, en ligne, le numéro de L’Espérance du Peuple qui en était à l’origine, et que l’Intransigeant « résumait », et y aurait non seulement vu qu’il s’agissait d’une autre lettre (il y en a deux) que celle dont il parle (L’Espérance du Peuple du 13 décembre 1908) mais surtout que la lettre en question, la première, ne disait absolument pas ce qu’il avait appris dans L’Intransigeant, indiquant bien, si c’était nécessaire, le peu de crédit qu’il faut porter à ce journal. En effet, dans le numéro de L’Espérance du peuple du 11 décembre, on ne lit absolument pas qu’on a « fait pression sur lui [Félix Faure] pour lui faire « sanctionner » une trahison » mais, dans cette lettre extraordinairement suspecte que le journal citait en partie, que Félix Faure avait besoin de voir sa maîtresse « pour oublier quelques instants auprès de [son] petit cœur aimant cette pieuvre de la trahison dont les tentacules m’enserrent de tous les côtés et changent mes nuits en cauchemars ». Voilà qui est pour le moins bien différent…
Mais laissons la méthode qui demeure invariablement la même et venons-en au fond. Félix Faure aurait donc répondu aux instances de Déroulède et préparé un coup d’État… Tout cela est très sympathique mais n’est attesté par rien, rien d’autre que par les souvenirs d’un « témoin » demeuré inconnu et par une lettre non signée, dont l’original n’a jamais été vu par qui que ce soit, et dont l’auteur de l’article qui la citait était si peu sûr qu’il la donnait « sous toutes réserves »… Qu’en est-il alors donc ? Nous savons que Déroulède avait approché Faure une ou deux fois mais nous n’avons aucune date et rien, vraiment rien, ne nous dit que ce fût juste avant sa mort. Nous savons aussi qu’à chaque fois le président avait opposé un refus à son interlocuteur comme il l’avait fait fin 1897 quand Robert Mitchell était venu le voir, au nom de ses amis Drumont, Déroulède, Habert, Judet, Delahaye, etc., pour présenter aux législatives à venir des hommes réunis sous le drapeau plébiscitaire présidentiel afin de le faire élire président à vie. Dans son Journal, publié il y a quelques années par Bertrand Joly, Faure raconte cette entrevue et sa réponse qui fut un unique : « C’est intéressant ». Et à la suite, Faure notait :
Ces gens-là se figurent toujours qu’il est possible à un républicain de trahir la République. Ce sera peut-être une occasion de montrer au pays ce que valent les soi-disant patriotes et d’en finir une bonne fois. Pour cela il convient de les laisser marcher et il faut rester attentif à leurs agissements, mais sans se confier à personne.
Félix Faure aurait-il donc radicalement changé d’idées et de principes, entre fin 1897 et début 1899 ? Peut-être… mais ce ne sont pas les « preuves » du « prudent » André Galabru reprises par Adrien Abauzit qui nous permettront d’en être convaincus. Mais quoi qu’il en soit, nous voyons mal Faure trahir la République dont il était le représentant et la Loi dont il était le garant ; « Ma règle de conduite, c’est la Loi – Personne ne m’en fera sortir » avait-il écrit à Le Gall – de l’intérêt, encore une fois, Adrien Abauzit, de faire le travail d’archives – en septembre 1898 (lettre du 24 septembre 1898, AN 460/AP 10).
Une « preuve », Adrien Abauzit – ou encore plus exactement André Galabru – en a encore une autre, sur un autre point, relatif à cette menace qui aurait plané sur Félix Faure : une « taupe dreyfusarde » se serait introduite à l’Élysée, comme en témoigne un « document des plus intéressants » découvert par André Galabru aux Archives nationales et que, nous dit Adrien Abauzit qui affirme d’autant plus qu’il en sait moins, « les historiens dreyfusards ont préféré ne pas commenter » ! À défaut d’être dreyfusards, comme nous n’avons de cesse de le lui répéter (voir les réponses précitées), nous l’avons commenté ce fameux papier, et à deux reprises : Eric Cahm l’a fait en 1998 et Philippe Oriol en 2014 ! Adrien Abauzit n’a pas lu les « historiens dreyfusards » (qui n’ont jamais été que des historiens) et peut soutenir ce qu’il ignore non seulement parce que que personne n’ira vérifier mais encore parce que dans sa vision et sa lecture du monde les choses doivent être telles. Mais bon, passons encore et toujours et revenons au document « des plus intéressants » en question. Quel est-il ? Il s’agit d’une dépêche télégraphique signée d’un certain Sphere, en date du 18 décembre 1897 à 11h30 du matin, de Londres, et adressée à un certain Shan, demeurant à l’hôtel Burton, rue Duphot. Un document pour le moins curieux puisqu’il est sur un papier à en-tête du Service télégraphique de la Présidence et porte une seconde date, celle de son expédition, ce même 18 décembre mais à 2h25 minutes. Une dépêche qui dit :
Présidence de la
République Française
Service télégraphique
n° 162/996/45240
Expédié le 18
à 2 h 25 minutesLondres le 18 Xbre 1897
11 h 30 du matinShan, hôtel Burton
rue Duphot, Paris.Voyez Zola immédiatement. Dites-lui éditeur World assure payement de la somme qu’il demanderait, quelle qu’elle soit, s’il veut aller à la Guyane et s’assurer par lui-même de la situation du capitaine.
World croit publicité seule peut amener mise en liberté et que Zola est le seul homme pouvant accomplir ce fait.
World paiera les dépenses d’une publicité qui sera universelle : succès presque certain.
Accusez réception par télégramme de ce message. Faites connaître au plus tôt également la réponse de Zola à TUOHY, Warwick gardens.
Que lit ici Adrien Abauzit (ou plus exactement le « prudent » André Galabru) ? Citons :
Il est clair qu’une offre financière est faite à Zola par un agent dreyfusard, probablement pour qu’il publie son futur torchon, J’Accuse. Le payeur serait un éditeur anglais, « World ». Il y avait donc une taupe dreyfusarde à l’Élysée et Félix Faure avait raison de se sentir épié.
Quel scoop ! Et quelle démonstration de ce qu’on peut arriver à faire dire à un document quand on a besoin qu’il serve le propos… Soyons sérieux et interrogeons-nous sur ce qu’est réellement ce « document des plus intéressants » et, comme se le demande Adrien Abauzit, après nous avoir infligé avec assurance et sans le moindre début de preuve son histoire d’« agent dreyfusard » et de financement du « J’Accuse… ! » :
Qui est Sphère ? Qui est World ? Qui est TOUHY [sic] ? Quel est le rôle, s’il en a un de Sphère dans les événements de février 1899 [ la mort de Félix Faure] ?
Aidons donc Adrien Abauzit qui, à vrai dire, s’il travaillait un peu plus, aurait pu trouver seul ce que nous allons lui expliquer. Déjà, il est extraordinaire que, suivant docilement le « prudent » Galabru, il ne se pose aucune question, ne s’interroge aucunement sur un papier à double entête (Présidence de la République et Londres) et portant deux dates (18 décembre 1897 11h30 et 18 décembre 1897 2h25). C’est pour le moins curieux, pourtant… Cette anomalie aurait dû normalement l’intriguer et l’inviter à réfléchir. Elle aurait peut-être même pu lui faire comprendre non seulement de quoi il s’agissait mais surtout que son prédécesseur sombrait dans le grotesque et qu’il aurait eu intérêt à l’y laisser. Mais à quoi bon réfléchir puisque Galabru l’a fait pour lui et que le résultat auquel il arrive sert le refrain qu’il a envie d’entendre et de reprendre. Si Adrien Abauzit avait lu les historiens « dreyfusards » (qui n’ont jamais été que des historiens) que nous évoquions, s’il avait lu Maurice Baumont, qui évoque la question World, peut-être aurait-il pu éviter le ridicule dans lequel, à son tour, il s’enfonce ici avec des airs de triomphe. Mais s’il les avait lu, il n’en aurait rien tiré puisque par définition, aux yeux d’Adrien Abauzit, les historiens « dreyfusards » mentent puisqu’ils sont les pions du grrrand complot républicain et anti-français. À défaut de lire, Adrien Abauzit aurait gagné, aussi, à se concentrer sur le texte qu’il cite et à en essayer d’en comprendre ce qu’il dit et non ce qu’il avait envie – et besoin – d’y trouver. Expliquons-nous… et expliquons lui. Pour commencer, le World, ou New York World, n’a jamais été un éditeur anglais… Il suffit d’interroger Google pour le savoir. Le World est un journal américain, un journal de la presse dite « jaune », qui appartenait au célèbre Joseph Pulitzer. Situé à New York, ce World avait aussi des bureaux sur le vieux continent, à Londres, et plus précisément à South Kensington, au 47, Warwick Gardens (tiens, tiens), Dans sa course effrénée à la publicité pour supplanter son concurrent, le New York Journal de Hearst, le New York World eut en effet le projet de faire interviewer Dreyfus à l’île du Diable et c’est pour cela, comme le dit le texte – la chose y est dite en toutes lettres ! ; comment peut-on y lire autre chose ? – qu’il avait pensé à Zola et qu’il était prêt pour cela – et non pour qu’il écrive son « J’Accuse… ! » (allons donc !) – à payer ce que demanderait l’auteur de Germinal. À en croire le World lui-même, Zola refusa la proposition. En effet, le World, dans son numéro du 16 janvier, publia un : « France refuses to allow Zola to see Dreyfus for the World », qui explique toute l’histoire (nous le donnons en traduction ; on trouvera le texte original dans Eric Cahm, « L’affaire Dreyfus dans la « presse jaune » américaine en janvier 1898 : deux interviews, avec Zola et Lucie Dreyfus », Bulletin de la SihaD, n° 4, hiver 1997-1998, p. 25-26) :
Le gouvernement français a refusé au World d’envoyer un de ses correspondants – un homme de renommée internationale – en Guyane pour voir Dreyfus.
La défense par Émile Zola du condamné de l’Île du Diable a fait de lui l’homme dont on parle le plus en Europe. C’est dans son interview au World en novembre que Zola a lancé un défi au gouvernement français de rendre publiques les preuves sur la base desquelles le capitaine Dreyfus a été condamné. Cette interview, retransmise à Paris par le World, a irrité le gouvernement français contre Zola. Zola est devenu le champion français de la « Publicité » – le mot d’ordre du World– contre les secrets officiels et l’étouffement militaire.
Le World a alors demandé au gouvernement français d’envoyer un journaliste [interviewer] Dreyfus sur l’île du Diable, en Guyane française, pour obtenir sa propre histoire. Le gouvernement, craignant la publicité, a refusé. M. Zola fut alors invité à se rendre en Guyane comme envoyé spécial du World. Sa réponse fut : « Je suis profondément redevable au World. Il défend les opprimés du monde entier, mais je mènerai plus efficacement la lutte à Paris. Personne ne peut approcher Dreyfus avec les restrictions actuelles. Voir Dreyfus serait impossible… Il est trop bien gardé, et d’ailleurs ce n’est pas nécessaire, la bataille sera gagnée ici. »
Une histoire toute simple et bien loin des fantasmes du « prudent » André Galabru que reprend Adrien Abauzit. Mais continuons. Le même Galabru écrit :
[…] tout cela fut suffisamment peu avouable pour nécessiter des prudences de Sioux, comme l’utilisation de noms de codes (Shan, Tuohy, « Sphère » dont on n’aurait pas usé s’il n’y avait pas eu « montage ».
Adrien Abauzit s’est contenté d’en rester là, prenant pour parole d’évangile les insuffisances et le délire de son « prudent » prédécesseur. Nous connaissions le World mais nous ne connaissions pas Tuohy qu’il nous a fallu à peu près 10 secondes et un unique clic sur Google pour le retrouver. James Mark Tuohy (1857-1923), journaliste irlandais, était le directeur européen du World (il l’était depuis le début de 1897 et le sera jusqu’à 1923) et donc le locataire du 47, Warwick Gardens. 10 seconde pour le retrouver et trouver même une photographie le représentant :
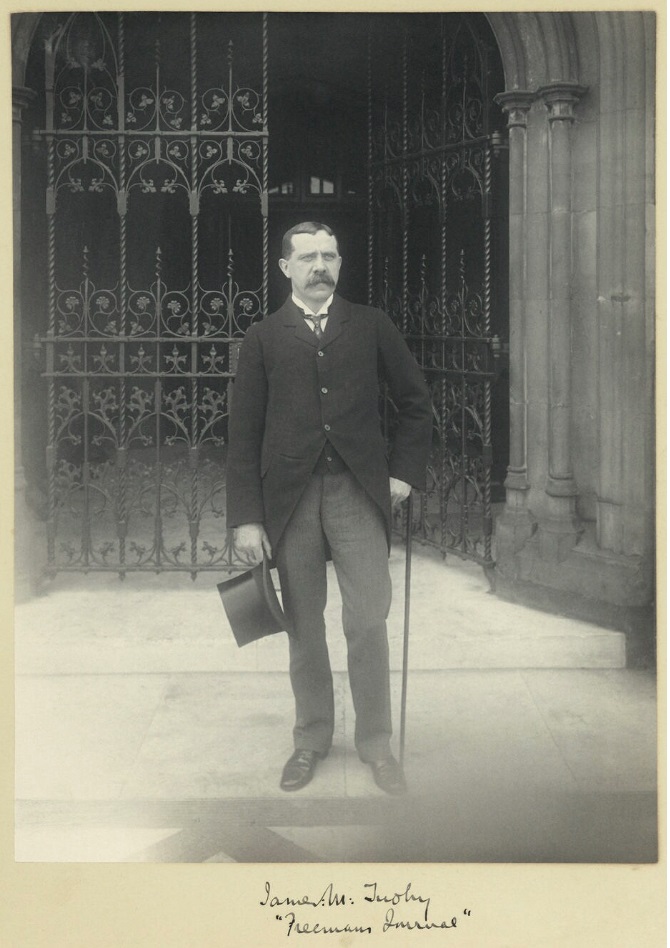
Shaun maintenant. Si Adrien Abauzit était allé voir aux AN le document au lieu de se contenter de le reprendre de Galabru, il aurait pu déjà constater que la cote qu’il reprend de Galabru est fausse, que l’heure y figurant n’est pas « 11h30 du matin » mais « 11h50 du m[atin] » mais surtout il aurait lu Shaw et non Shaun. Plus parfait pseudonyme encore ? Non. Shaw a bien existé, il se prénommait Stanley et signera en 1913 une biographie de Guillaume II. En 1897, il était correspondant en France de divers journaux américain, dont le World et l’Anglo-american annual, aux bureaux parisiens duquel il faisait habituellement adresser son courrier (on le verra à la suite), 26, rue Cambon. Sphere, lui, nous demeure inconnu mais il n’est pas douteux qu’il était un administratif du World à Londres….
Cela dit, il demeure une question, la question que n’a pas pensé à se poser Adrien Abauzit : comment une dépêche envoyée de Londres tel jour à « 11h50 du matin » peut-elle se retrouver sur un papier à entête du Service télégraphique de la Présidence et donnée comme ayant été envoyé à « 2h25 minutes » ? Cette question Adrien Abauzit n’a pas eu besoin de se la poser puisque le « prudent » Galabru (dans un autre ouvrage, Variations sur l’Affaire, qu’Adrien Abauzit ne mentionne pas) en a la réponse :
L’heure du télégramme, 2h25, laisse supposer que l’auteur a dû attendre d’être seul et à l’abri des regards pour envoyer son message. Cela signifie qu’il craignait d’être surpris par l’entourage du Président.
Passons sur le fait absolument extraordinaire qui serait que cette hypothétique « taupe » de l’Élysée, ayant un message pour le moins compromettant à envoyer (l’embauchage de Zola, tout de même !), l’aurait fait du service télégraphique de l’Élysée et pas de n’importe quel bureau de poste ? Impossible ! nous dirait Adrien Abauzit puisque les bureaux de poste sont fermés à 2h25… en pleine nuit ! Entendu… Admettons que notre « taupe » ait été pressée et que s’imposait à elle l’absolue nécessité d’envoyer sa dépêche à l’heure où dort le bourgeois… Admettons cela… Mais pourquoi ce 2h25 serait-il le matin ? Contrairement à ce que semble croire Adrien Abauzit – qui nous prouve un peu plus à chaque page qu’il connaît bien peu la période dont il parle –, 2h25 minutes peut tout aussi bien être le matin que l’après-midi. Si Adrien Abauzit s’était un peu renseigné, il saurait que personne à l’époque n’utilisait le système horaire sur 24 heures comme nous le faisons aujourd’hui. À la fin du XIXe siècle, quand on donnait l’heure, on le faisait comme le font les cadrans des montres et des horloges, de 1 à 12 pour le matin et de 1 à 12 pour l’après-midi. Personne ne disait à l’époque 14h25 ; on disait 2h25 (ou 2h25 de l’après-midi ou, plus souvent encore, du soir) ! Mais de toute façon la chose importe peu puisque ce 2h25 de l’après-midi s’impose par la logique et il suffit de réfléchir dix secondes pour s’en apercevoir. Comment, sinon, expliquer qu’une dépêche datée du 18 décembre à « 11h50 du matin » ait pu être envoyée (ou réceptionnée, on le verra) à « 2h25 minutes » ce même matin, soit 9 heures avant ? Il est évident qu’elle a été envoyée (ou réceptionnée, on le verra), de la Présidence, à « 2h25 minutes » de l’après-midi, soit 3 heures après son envoi de Londres et donc à un moment où tout le monde était présent, à un moment où si son auteur avait été la « taupe » imaginaire du couple Galabru/Adrien Abauzit, elle se serait pour le moins « grillée ». Mais si nous nous amusons ici à discuter pour montrer comment celui qui veut voir ce qu’il veut voir arrive à le voir, il suffit de revenir au document pour clore la question. Si Adrien Abauzit ne se contentait pas de compiler et travaillait sur les archives, comme l’historien qu’il prétend être, il aurait pu – il aurait dû – aller aux Archives Nationales et consulter le document en question. Il aurait pu voir que le « rigoureux » Galabru ne s’est pas trompé uniquement sur la cote, sur l’heure, sur le nom de Shaw mais qu’il a aussi oublié le détail qui importe à propos de cette question précise. Il n’y est pas écrit « 2h25 minutes » mais « 2h25 minutes du s[oir]» [la consultation étant soumise à autorisation spéciale des ayants-droit, la publication n’est pas permise, raison pour laquelle nous ne le donnons pas en reproduction]. De même, si Adrien Abauzit travaillait comme doit le faire celui qui prétend faire de l’histoire et allait voir les documents au lieu de les emprunter sans vérification aux autres, il aurait aussi pu consulter la liasse F7/12473 aux mêmes Archives nationales. Il aurait pu y retrouver le fameux document sous sa forme première :
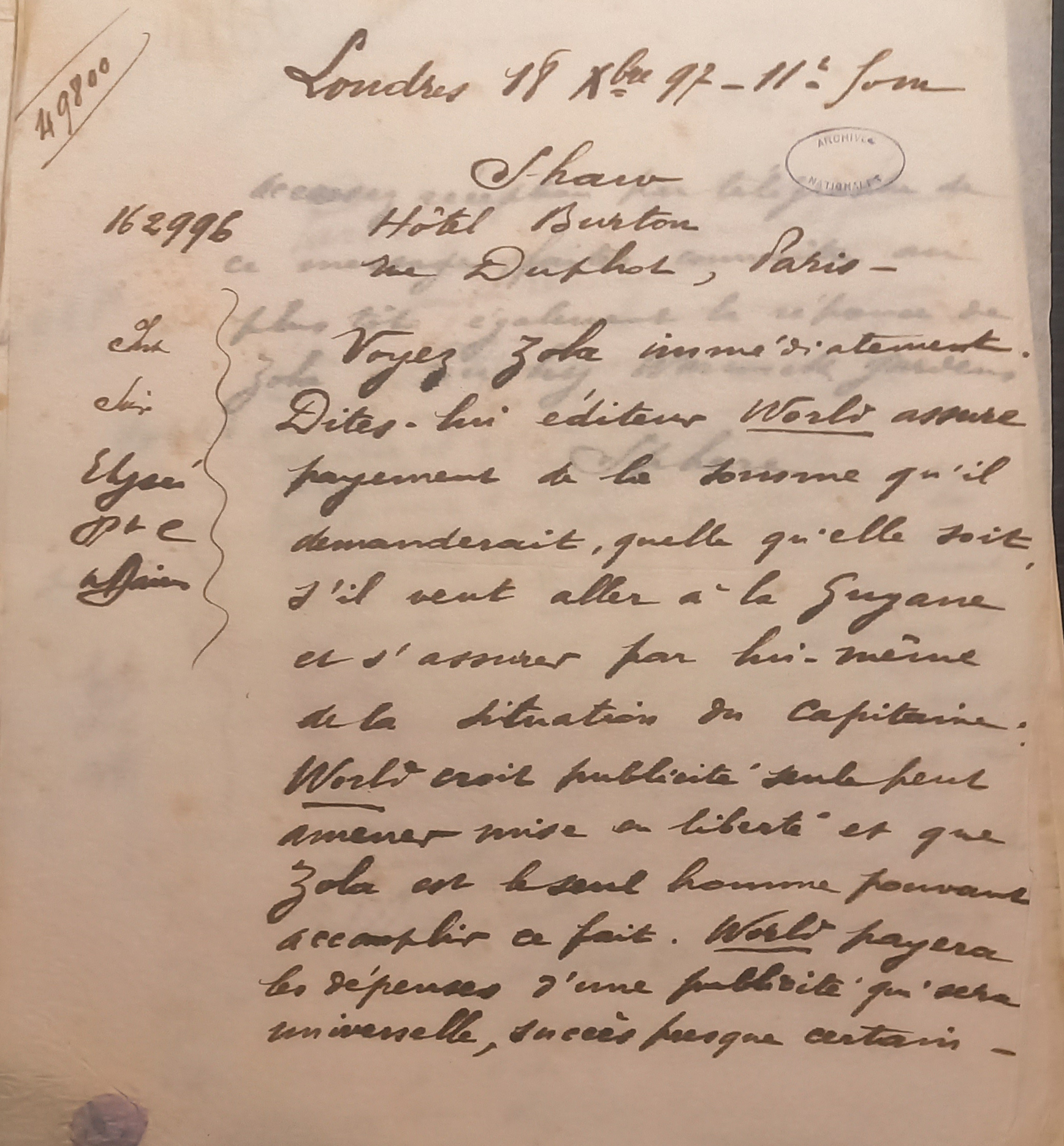
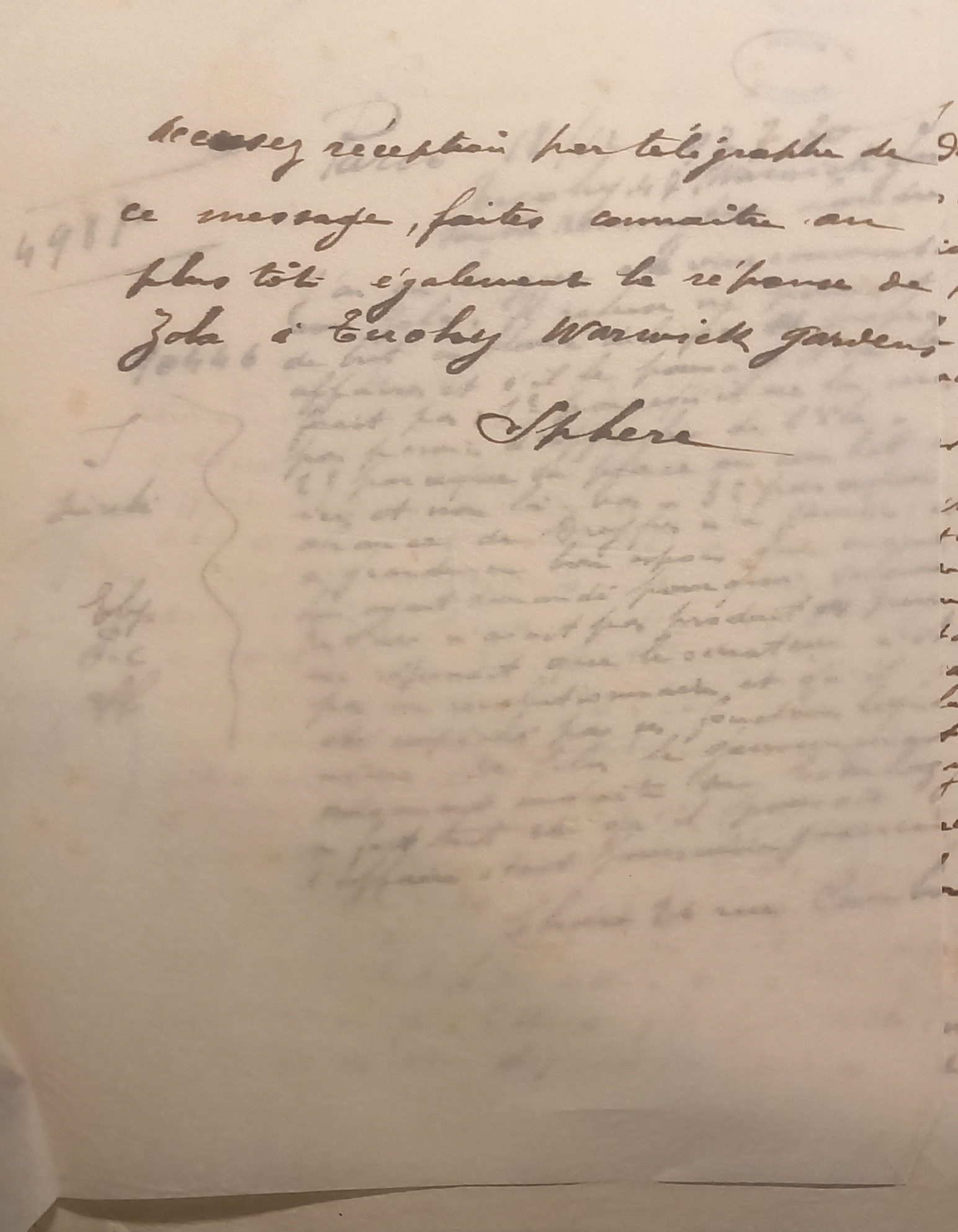
Ainsi, il aurait pu y voir le n° d’ordre de la dépêche (162996 ; repris sur la dépêche à entête de la Présidence) et y voir, en annotation marginale, les copies envoyées (dont l’Élysée)… Car si Adrien Abauzit, qui se targue aussi d’avoir lu les procédures, les avait vraiment lues, ou jusqu’au bout, il aurait compris ce qu’expliquait Chamoin à l’occasion de la seconde révision :
[…] suivant les habitudes encore, on en envoyait une copie ou un décalque à chacune des administrations que cela pouvait intéresser. Cela se fait pour tous les télégrammes intéressant soit la sûreté de l’État, soit des personnages diplomatiques un peu importants ; cela se fait pour beaucoup de télégrammes de la presse. C’est ainsi que vous voyez arriver au Ministère de l’intérieur d’abord la plus grande partie de ces télégrammes, et d’autres à l’Elysée dont l’officier de service prend connaissance et qu’il signale au Président de la République.
Tout devient simple : une dépêche a été envoyée de Londres, à 11h du matin, par un certain Sphere, probablement administratif au World, à Stanley Shaw, correspondant parisien du journal, dans l’hôtel où il était descendu. Un télégramme qui l’invitait à prendre contact avec Zola pour lui proposer de partir pour la Guyane interviewer Dreyfus et, ensuite, à contacter le directeur européen du journal à Londres pour lui donner la réponse de l’écrivain. Les Postes et Télégraphes ont alors, suivant les habitudes, envoyé une copie à l’Intérieur, à la Sûreté et à la Présidence et ce à 2h25 de l’après-midi. À la présidence, le papier à entête habituel a été utilisé pour transmission au Président, papier sur lequel a été remplie la partie imprimée servant à marquer l’expédition (« expédié le ………. / à …. h. …… minutes du …. ») qui ici permettait de noter l’heure de réception. C’est cette copie que nous connaissons et qu’Adrien Abauzit a exhumé en la récupérant, sans la moindre vérification, chez le « prudent » André Galabru.
Toutefois – et continuons à faire le travail que ne fait pas Adrien Abauzit –, on peut se demander les raisons pour lesquelles cette dépêche a été transmise à la Présidence ? Si, encore une fois, Adrien Abauzit avait un peu plus travaillé, il aurait pu, aux ANOM cette fois, découvrir une correspondance qui lui aurait donné une réponse raisonnable… une réponse qu’il aurait même pu trouver – puisqu’il semble qu’il n’aime pas aller travailler sur les sources premières et préfère les sources secondaires – en lisant un tout petit peu, juste quelques lignes d’une page du livre de Maurice Baumont. Voici l’histoire : quelques jours avant cette dépêche, le 7 décembre, les Colonies avaient communiqué auprès des Affaires étrangères pour qu’ils se renseignassent à propos d’un certain Bastillac qu’un rapport de police du 26 novembre, le présentant comme ayant appartenu « au journal juif […] The World », donnait comme étant la cheville ouvrière d’un projet d’enlèvement de Dreyfus initié par « le directeur juif du « World » ». Lisant cela, Adrien Abauzit aurait sans doute été heureux mais, s’il ne s’était pas contenté de cela, aurait été finalement déçu en découvrant, quelques feuillets plus loin, un rapport du 18 décembre de Charpentier, gérant du Consulat général de France à New York, qui pouvait certifier qu’il s’agissait d’une fausse information, que Bastillac était « tout à fait inconnu au « World » », qu’il n’y avait « jamais collaboré », ni à New York ni comme correspondant à l’étranger. Et quant à cette histoire d’enlèvement, le Charpentier en question pouvait certifier, le tenant d’une « personne » sûre, que tout cela n’était que fantasme. Nous avons notre explication : branle-bas de combat autour du World et de ce projet imaginaire d’évasion et il est clair que tout ce que la France comptait de services susceptibles de renseigner colligeait tout ce qui avait trait au journal américain et que fut, dans cette optique, intercepté et transmis, comme en voulait l’usage, à diverses administration dont la Présidence le document « passionnant » évoqué, et ce le jour même où arrivait un rapport qui dégageait le World de toutes les responsabilités dans lesquelles l’avaient engagé les bavardages du dénommé Bastillac (qui semble d’ailleurs s’être appelé de Bastiac)…
Maintenant, continuons encore à faire le travail que ne fait pas Adrien Abauzit et poussons la question pour nous demander ce qu’il en fut de cette proposition faite à Zola. Si Adrien Abauzit essayait d’adopter les méthodes des historiens, et s’il avait voulu aller au bout de son sujet, il aurait trouvé, dans la presse qu’il affirme pourtant avoir dépouillée, cette interview de Robert Sherard à La Libre Parole du 5 février dans laquelle cet antidreyfusard anglais, antisémite bon teint, salarié du New York journal concurrent, certifiait que Zola n’avait jamais été contacté par le World et que tout cela n’était qu’une invention du « journal du Juif Pulitzer » ? Et pourtant… Retournons aux AN voir la liasse précédemment évoquée et lisons deux documents, eux vraiment passionnants. Le premier est la réponse de Stanley Shaw à Sphere, nouvelle dépêche interceptée par les Postes et Télégraphes et transmise à la Sûreté (pas à l’Élysée cette fois) :
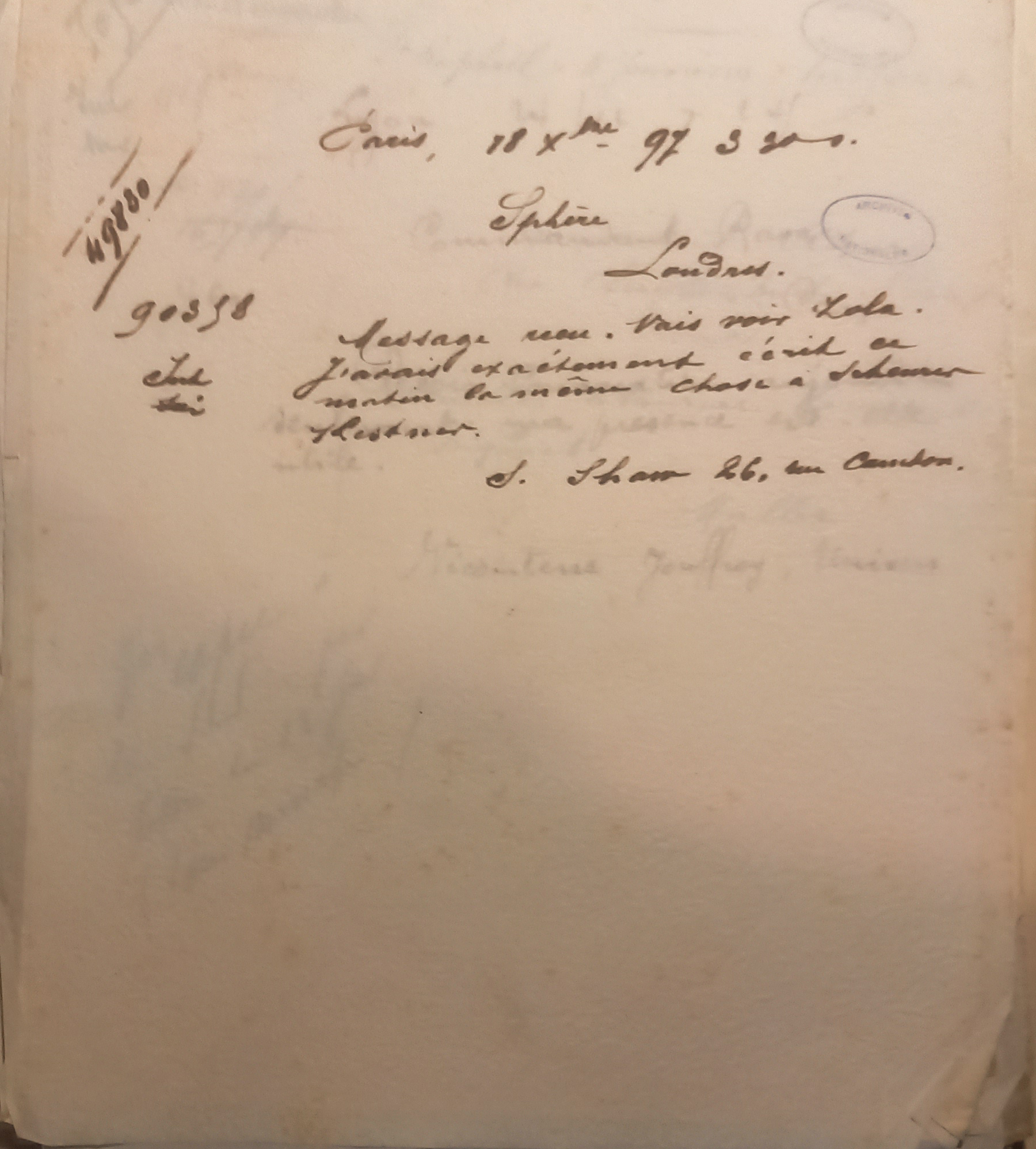
Paris, 18bre 97 3 30 / Sphere / Londres Message reçu. Vais voir Zola. J’avais exactement écrit ce matin la même chose à Scheurer. / S. Shaw, 26 rue Cambon
La seconde est plus intéressante encore et nous en donnerons à la suite (non en légende) la transcription.
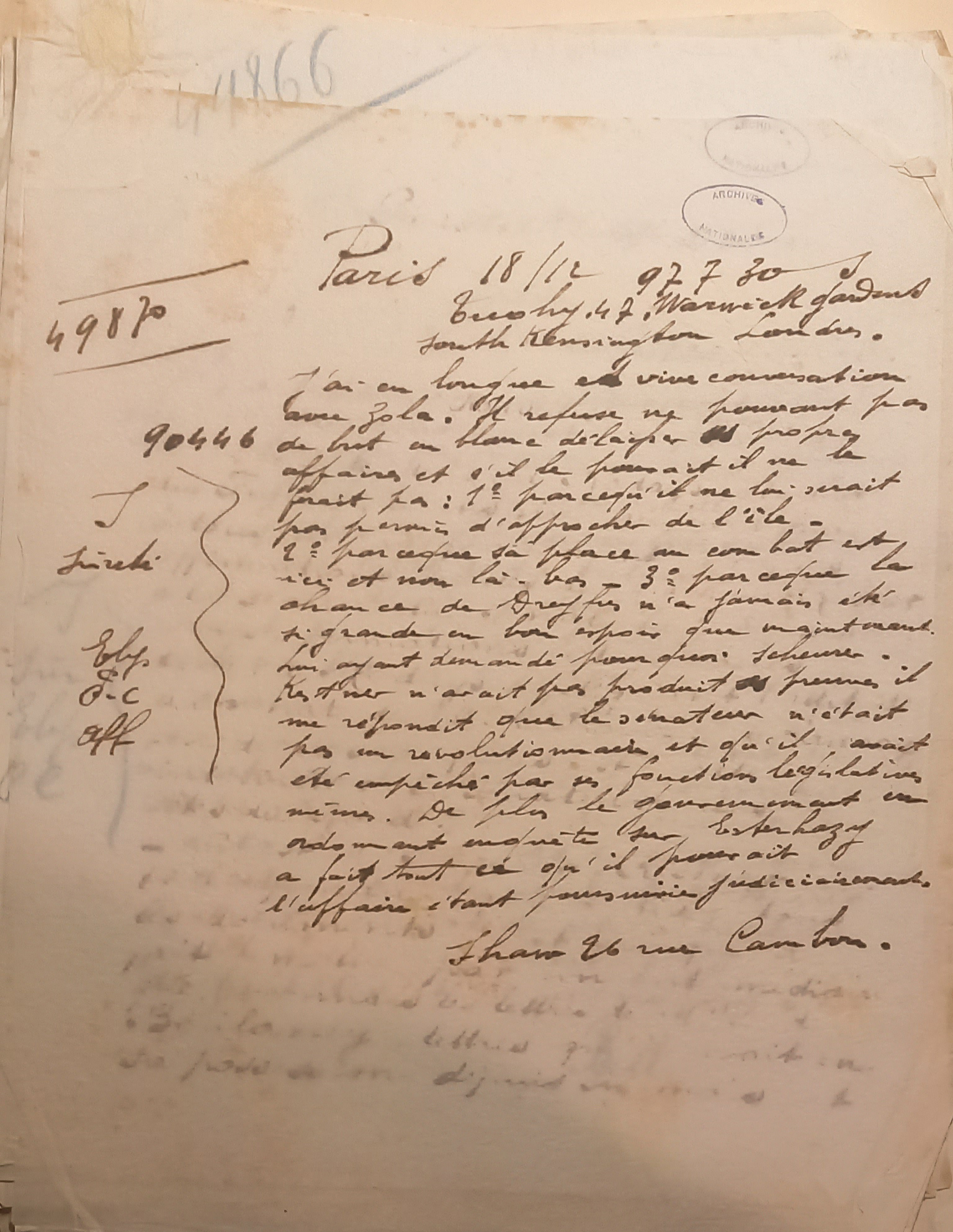
Paris 18/12 97 7 30
Tuohy, 47, Warwick gardens south Kensington Londres.
J’ai eu une longue et vive conversation avec Zola. Il refuse ne pouvant pas de but en blanc délaisser ses propres affaires et s’il le pouvait il ne le ferait pas : 1° parce qu’il ne lui serait pas permis d’approcher de l’île –
2° parce que sa place au combat est ici et non là-bas – 3° parce que la chance de Dreyfus n’a jamais été si grande en bon espoir que maintenant.
Lui ayant demandé pourquoi Scheurer-Kestner n’avait pas produit ses preuves, il me répondit que le sénateur n’était pas un révolutionnaire et qu’il avait été empêché par ses fonctions législatives mêmes. De plus, le gouvernement en ordonnant enquête sur Esterhazy a fait tout ce qu’il pouvait l’affaire étant poursuivie judiciairement.
Shaw, 26 rue Cambon.
Ce que Sherard avait dit à La Libre Parole, il le fera imprimer dans le New York journal. C’est pour cela que quelques jours après, Stanley Shaw écrira à Zola pour lui demander de le soutenir. Citons cette lettre qu’Adrien Abauzit aurait pu voir, de chez lui (puisqu’il ne semble pas aimer se déplacer), en allant sur CORREZ – Édition des lettres internationales adressées à Émile Zola :
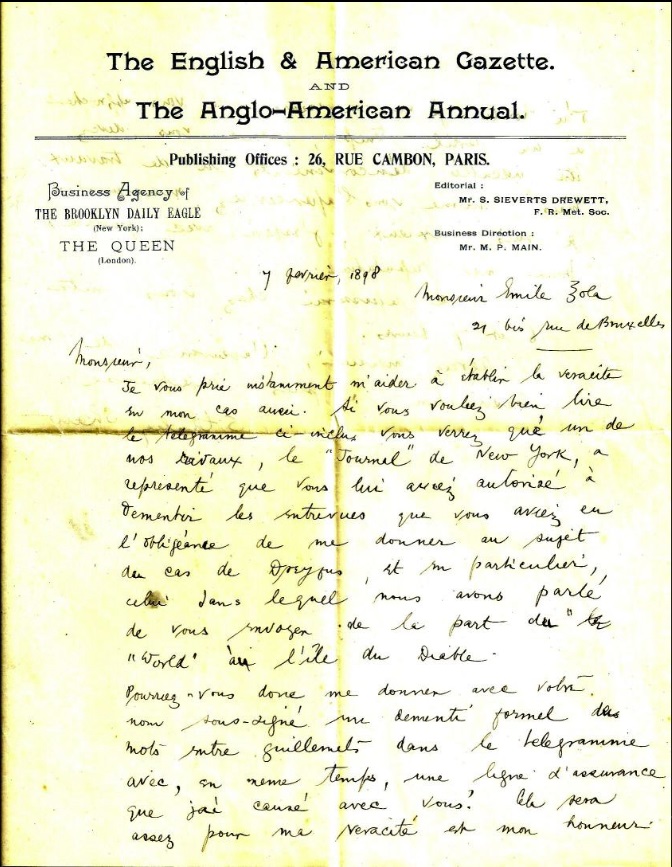
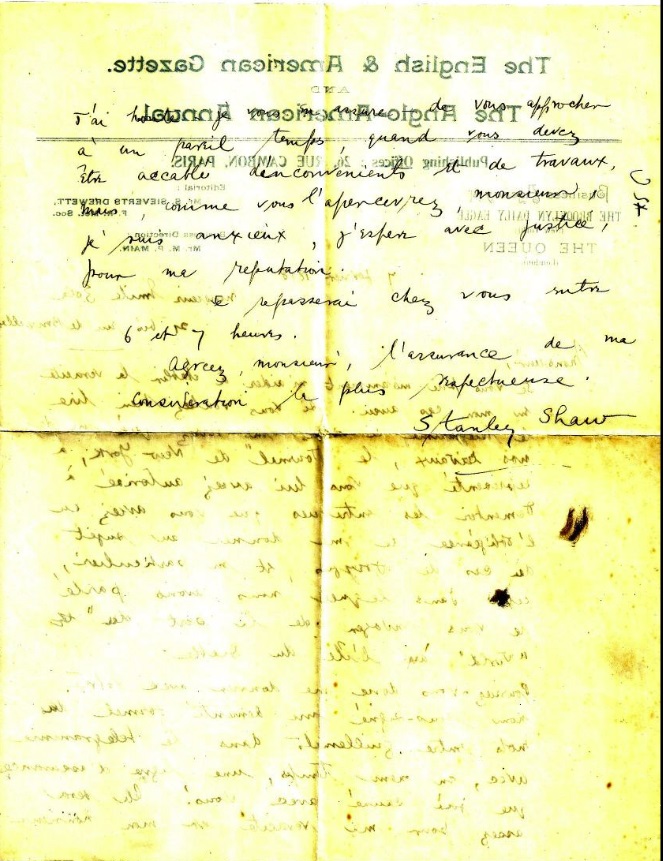
Quel crédit peut-on accorder aux travaux d’Adrien Abauzit après cette petite démonstration de ce qu’est le travail d’un historien ? Car étonnante est cette méthode de nos « historiens » antidreyfusards (parce que si nous ne sommes pas des historiens dreyfusards eux, en nous désignant comme tels, affirment leur anachronique antidreyfusisme) qui nous montre bien comment on peut faire dire n’importe quoi à n’importe quoi, contre toute évidence, contre toute logique, et cela en jouant sur l’ignorance des lecteurs qui prendront pour argent comptant les montages fumeux nécessaires non à l’histoire, qui n’est plus convoquée ici si tant est qu’elle l’ait un jour été, mais à la cause à défendre…
Si toutes les « preuves » d’Adrien Abauzit (ou d’André Galabru) s’écroulent les unes après les autres, demeurent toutefois la question de la mort de Félix Faure et celle des soins qui lui furent prodigués, soins inadéquats dans les cas d’apoplexie et particulièrement recommandés dans ceux d’empoisonnement. La chose serait à vérifier mais nous ne le ferons pas, la lecture des traités de médecine nous rebutant tout à fait. Mais si cela est vrai, si en effet les soins apportés à Félix Faure étaient de ceux que l’on pratiquait habituellement dans les cas d’empoisonnement, ne peut-on tenter une simple explication ? Faure, la chose est connue, pour stimuler et satisfaire ses insatiables appétits prenait de la cantharide, aphrodisiaque réputé puissant et qui ne semble jamais l’avoir été mais dont la surdose est mortelle… N’a-t-il pas simplement, ce fameux jour, abusé de son « remède d’amour » ? Et on comprendrait alors bien pourquoi on parla officiellement d’apoplexie, façon convenable d’expliquer la mort subite d’un président de la République, et plus convenable en tout cas qu’une overdose causée par un proto-viagra !
Pour faire passer l’idée que le fameux Syndicat fut aussi celui du crime, il faudra d’autres preuves que ces coupures de presse, ces témoignages anonymes, ses lettres suspectes et anonymes que personne n’a jamais vues, ces dépêches télégraphiques montées en épingle quand elles ne sont rien du tout, ces erreurs de lecture et de compréhension… et il faudra plus aussi qu’un autre témoignage, celui du « prudent » André Galabru, obtenu d’une arrière-petite-fille de Félix Faure qui le tenait de son père qui le tenait de Maurice Martin-du-Gard qui semblait le tenir d’un quelconque allemand qui avait mis la main sur les archives d’une loge maçonnique… Et il faudra plus enfin que l’avis, qui n’engageait que lui, du général Estienne, qui avait confié sa conviction en 1920 à un monsieur, qui avant de disparaître l’avait confié à son fils, qui l’avait confié à André Galabru…. L’homme qui a vu l’homme qui a vu l’homme qui a vu l’ours…
Les Cinq morts mystérieuses
Il est vrai que les décès de Laurenceau, de d’Attel, de Lemercier-Picard, de Chaulin-Servinière et de Syveton sont, dans leurs circonstances, extraordinaires. Mais de là à en faire des assassinats dreyfusards… et de là à le faire avec aucun commencement de début de preuves, juste sur une hypothèse et sur la base d’un pauvre système : leur mort est mystérieuse, ils sont antidreyfusards, donc ils ont été assassinés… Et s’ils le sont, extraordinaires, ces décès, ils le sont tout autant que ceux d’Henry, du commandant Bayle ou de Zola qui ne furent certainement pas assassinés par les dreyfusards même si l’inénarrable – quoique prudent – Galabru, dans son second ouvrage (Variations sur l’Affaire), nous explique, semble-t-il en y croyant, que Zola fut assassiné par « ceux qui, étant au pouvoir, avaient le plus à craindre d’un témoin au courant de pas mal de choses touchant l’Affaire et la mort de Félix Faure » !!!! En termes de prudence on a vu plus prudent…
Nous n’allons pas prendre ici ces décès un à un ; la démonstration serait longue, fastidieuse et à vrai dire d’un intérêt relatif. Nous n’en prendrons qu’un : celui de d’Attel. On se souvient que ce témoin des pseudo-aveux fut retrouvé mort, dans un compartiment de train, en octobre 1895. Les dreyfusards l’auraient donc assassiné et ce qui est extraordinaire c’est qu’ils l’auraient assassiné à un moment où ils n’existaient pas. Car en effet, qui était dreyfusard en 1895 ? La famille Dreyfus, Forzinetti et Bernard Lazare. C’est tout ! et il serait extraordinaire qu’un de ceux-là aient tué un « témoin » des soi-disant « aveux » à un moment où les soi-disant « aveux » ne représentaient rien du tout. L’affaire des « aveux » était sortie au lendemain de la dégradation et s’était aussitôt évanouie dans l’air. Ce n’est qu’à partir d’octobre 1897 que les aveux deviendront un des fondements de l’accusation ! Faut-il, pour rappeler à Adrien Abauzit ce qu’il oublie, ou lui expliquer ce qu’il ignore, dire ce que furent ces fameux aveux dont les quelques rapports rédigés immédiatement après la dégradation sont pour le moins troublants ? Faut-il rappeler celui de Lebrun Renaud (qui s’écrit bien comme ça et non comme l’écrit Adrien Abauzit en corrigeant avec assurance ce qu’il croit être une faute ; voir note 58, p. 66), qui, consignant son service, les heures d’arrivée et de fin, se contenta, dans la colonne « observations », de porter un simple : « Rien à signaler » ? Curieux, après avoir reçu des aveux… Faut-il rappeler celui du commandant Guérin, qui avait été mis à disposition du général Darras pour la parade, et qui faisant à son tour son rapport au général Saussier, se contenta d’écrire dans son télégramme : « Parade terminée, Dreyfus a protesté de son innocence et a crié : Vive la France ! Pas d’autre incident » ? Curieux encore… Faut-il rappeler l’état signalétique de Dreyfus, repris par Le Matin daté du 5, et qui concluait toute l’affaire d’un simple : « Dreyfus n’a exprimé aucun regret, fait aucun aveu, malgré les preuves irrécusables de sa trahison ; en conséquence il doit être traité comme un malfaiteur endurci tout à fait indigne de pitié » ?
Quant à dire que la mort de Chaulin-Servinière, lui aussi vecteur des fameux aveux, permettait de se débarrasser d’un témoin gênant tout en envoyant « au passage un message aux membres de la classe politique susceptibles de vouloir s’engager du mauvais côté », c’est aller bien vite en besogne et prendre ses rêves pour la réalité. Sur les 581 députés de 1898, il y avait en tout et pour tout un dreyfusard déclaré : Joseph Reinach… Du coup, si l’idée était de passer un message, il semble qu’il ne fut guère entendu ! Il en restait encore 579 à assassiner ! Quant à l’empoisonnement de Krantz, il est tout aussi extraordinaire. Officiellement, l’utilisation d’une casserole mal rétamée avait été à l’origine du malaise qui avait frappé le ministre et sa famille et les avait obligés à garder la chambre quelques jours. S’il s’était agi d’un empoisonnement de l’extraordinaire syndicat du crime, il eût été bien mal venu de le faire à ce moment-là. Krantz n’était plus ministre et ne le serait plus puisqu’on savait depuis quelques jours qu’il avait refusé les propositions qui lui avaient été faites. Pourquoi, s’il avait existé, ce syndicat du crime, aurait-il alors tenté de se débarrasser d’un homme précisément à un moment où il n’avait plus aucun pouvoir ? Et si Krantz était en effet agacé par la campagne dreyfusarde, s’il croyait probablement Dreyfus coupable, s’il n’était pas partisan de la révision, il était aussi convaincu de la lourde responsabilité des grands chefs et avait peu avant fait incarcérer Du Paty et avait sanctionné Cuignet… Pour La Libre Parole, il n’était que « l’extraordinaire ministre de la Guerre qui n’a de sympathies que pour les insulteurs de l’armée » (Drumont, « Récit succinct mais exact de ce qui s’est passé à Grenoble », 22 mai 1899)… Qui aurait donc eu le plus intérêt à se débarrasser de lui, dans ce monde criminel que se plaît à rêver Adrien Abauzit ?
Et je me demande bien pourquoi Adrien Abauzit n’a pas ajouté dans sa liste le lieutenant-colonel Henry ? Mais non bien sûr puisque les dreyfusards n’auraient pu le tuer dans sa cellule. Elle est bien mystérieuse, pourtant, la mort de ce lampiste, retrouvé sans vie dans sa cellule, la gorge tranchée, un rasoir fermé dans sa main gauche, lui qui était droitier ?
La dépêche Panizzardi
Nous doutons que le lecteur non averti puisse comprendre quelque chose au propos que développe ici, en l’embrouillant à loisir, Adrien Abauzit. Nous n’allons pas tout reprendre, ce qui nous entraînerait trop loin, et nous allons nous contenter d’aller à l’essentiel sur cette question intéressante et qui prouve l’exact contraire de ce qu’Adrien Abauzit essaie d’y voir. Le 2 novembre 1894, deux jours après la révélation de l’arrestation d’Alfred Dreyfus, les Postes et Télégraphes interceptaient une dépêche chiffrée émanant de l’ambassade d’Italie et destinée à Marselli, commandant en second de l’état-major italien. Le texte en était le suivant :
Commando stato maggiore Roma
913 44 7836 527 3 88 706 6458 71 18 0288 5715 3716 7567 7943 2107 0018 7606 4891 6165
Panizzardi.
Le Baravelli, clé de lecture, permettait de le décrypter ainsi :
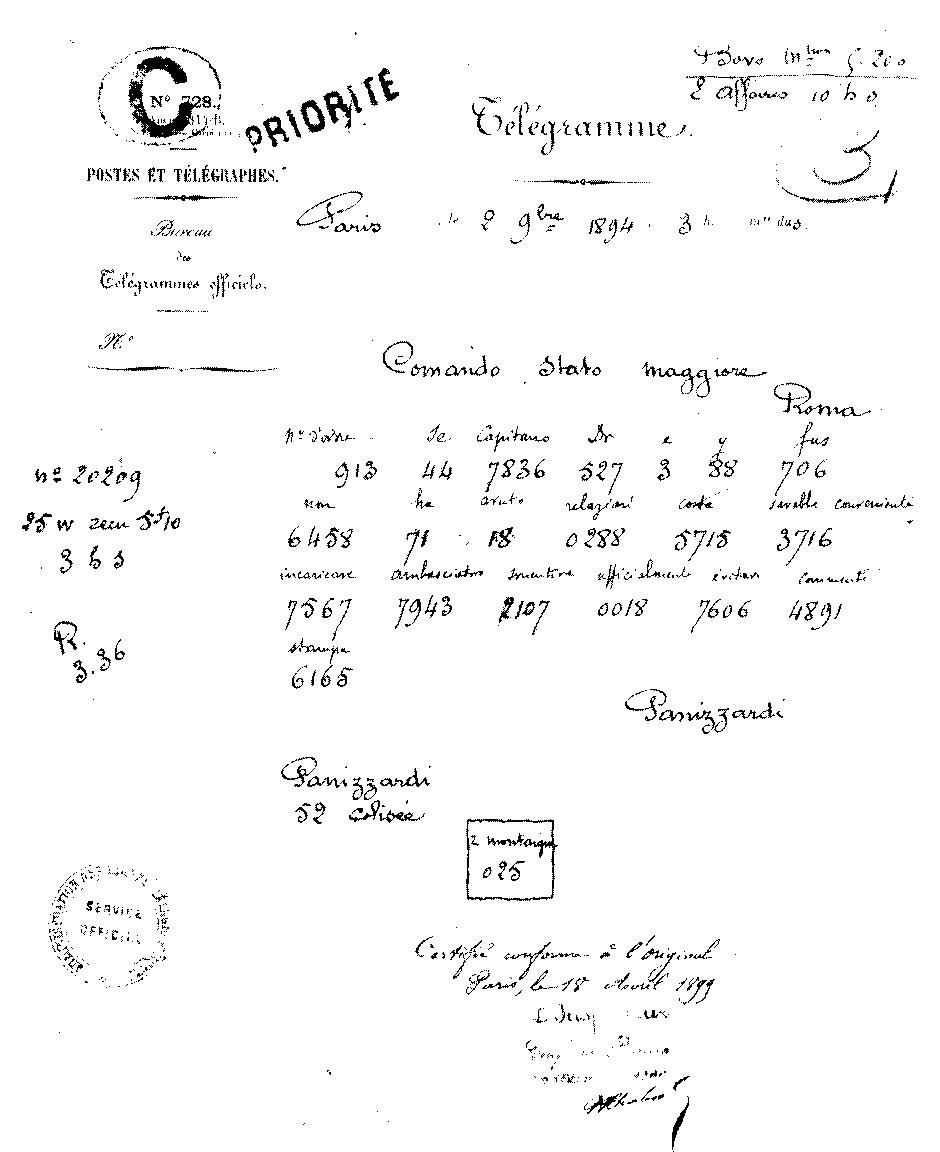
Autrement dit, et en traduction :
Si le capitaine Dreyfus n’a pas eu de relations avec vous, il conviendrait de charger l’ambassadeur de publier un démenti officiel, afin d’éviter les commentaires de la presse.
Toutefois une première version, quelques jours plus tôt, avait été transmise au ministre Mercier qui, lors de sa déposition devant la Cour de cassation, le 20 janvier 1899, en parlera en ces termes :
24 ou 48 heures après la décision prise en conseil de cabinet de déférer Dreyfus à la justice militaire, on m’apporta de la part du ministère des Affaires étrangères la traduction d’un télégramme adressé par B à son chef hiérarchique ; cette traduction était-à peu près conçue ainsi : « Dreyfus arrêté, précautions prises ; prévenu (ou prévenez) émissaire ». On me donna en même temps avis que la traduction de la fin de ce télégramme était incertaine ; un ou deux jours après, je reçus du ministère des Affaires étrangères une nouvelle version de cette traduction, à peu près ainsi conçue : Dreyfus arrêté, si vous n’avez pas relations, démentez officiellement pour éviter polémiques. » En conséquence, je donnai l’ordre de ne tenir aucun compte de ce télégramme et de n’en faire aucun usage dans le cours du procès : cet ordre fut exécuté.
Un fait est donc indiscutable : la fameuse dépêche ne fut pas retenue ; ni dans sa première version, douteuse [ajout du 4 janvier 2026 : (qui ne chargeait pas Dreyfus et n’était pas le texte que donnait ici Mercier ; voir la partie III de nos commentaires en réponse au quatrième volume d’Adrien Abauzit, bientôt en ligne], ni dans sa seconde qui déchargeait Dreyfus de tout rapport avec l’Italie, document qui n’aurait guère été utile, voire tout à fait contreproductif, à l’accusation en 1894. Quand il s’est agi, en 1898, de corser le dossier, ces deux traductions n’ayant pas été conservées (et certainement pas du fait de Picquart, comme l’affirme avec aplomb et sans le début du commencement d’une preuve Adrien Abauzit, mais probablement de celui de Sandherr, comme le pensait Gonse – voir la citation un peu plus bas), on demanda à Du Paty de Clam de retrouver le texte de la dépêche… À trois ans et demi de distance, Du Paty put citer de mémoire ce document qu’il n’avait que peu vu et en donner le texte suivant, tel qu’il fut consigné au dossier secret :
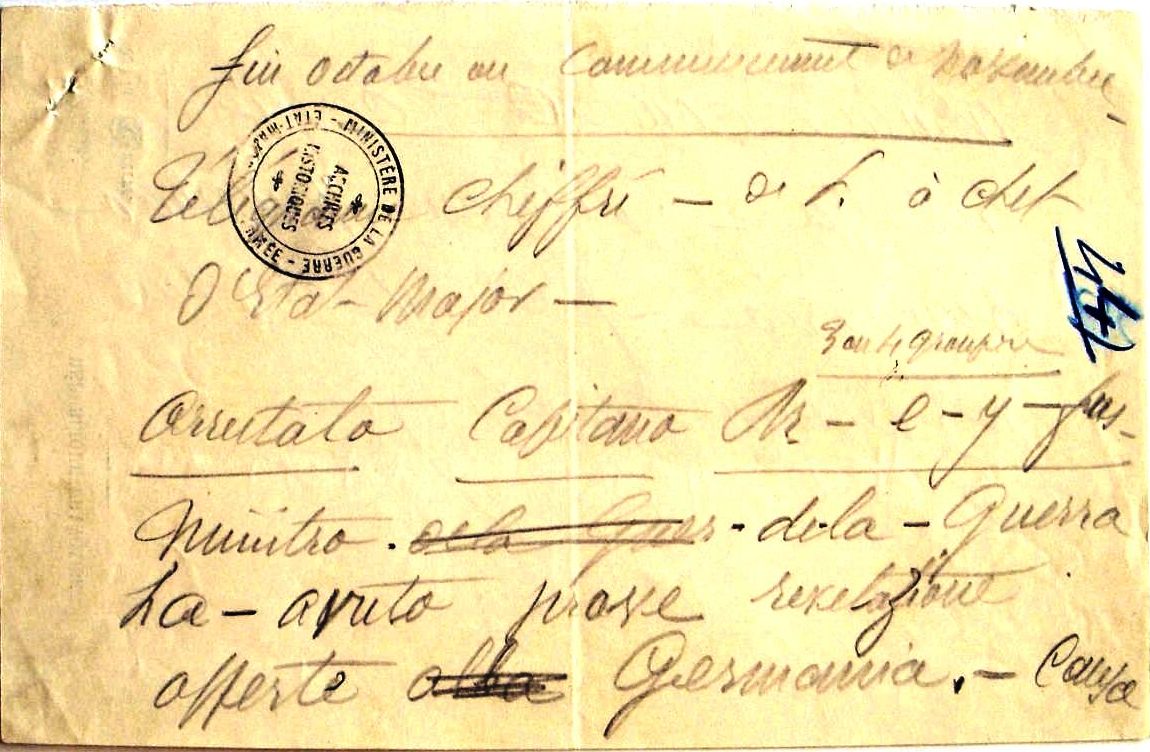
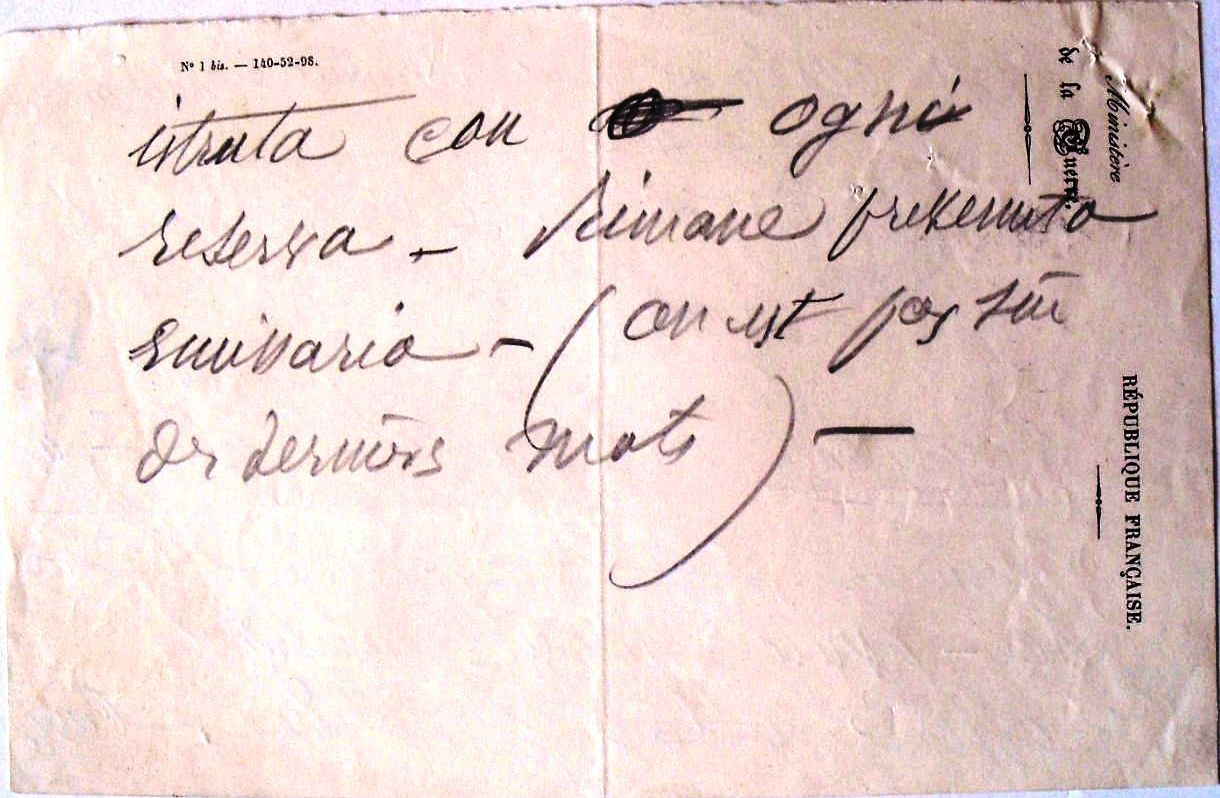
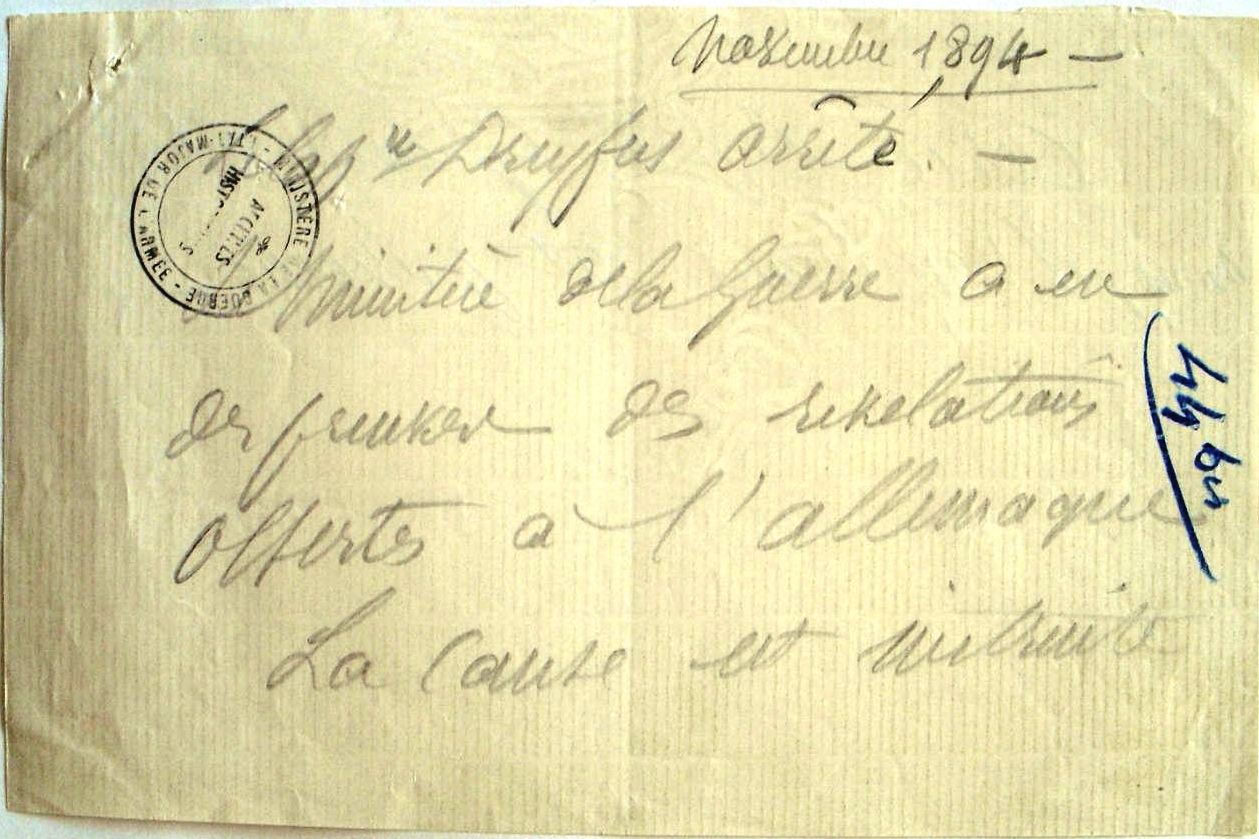
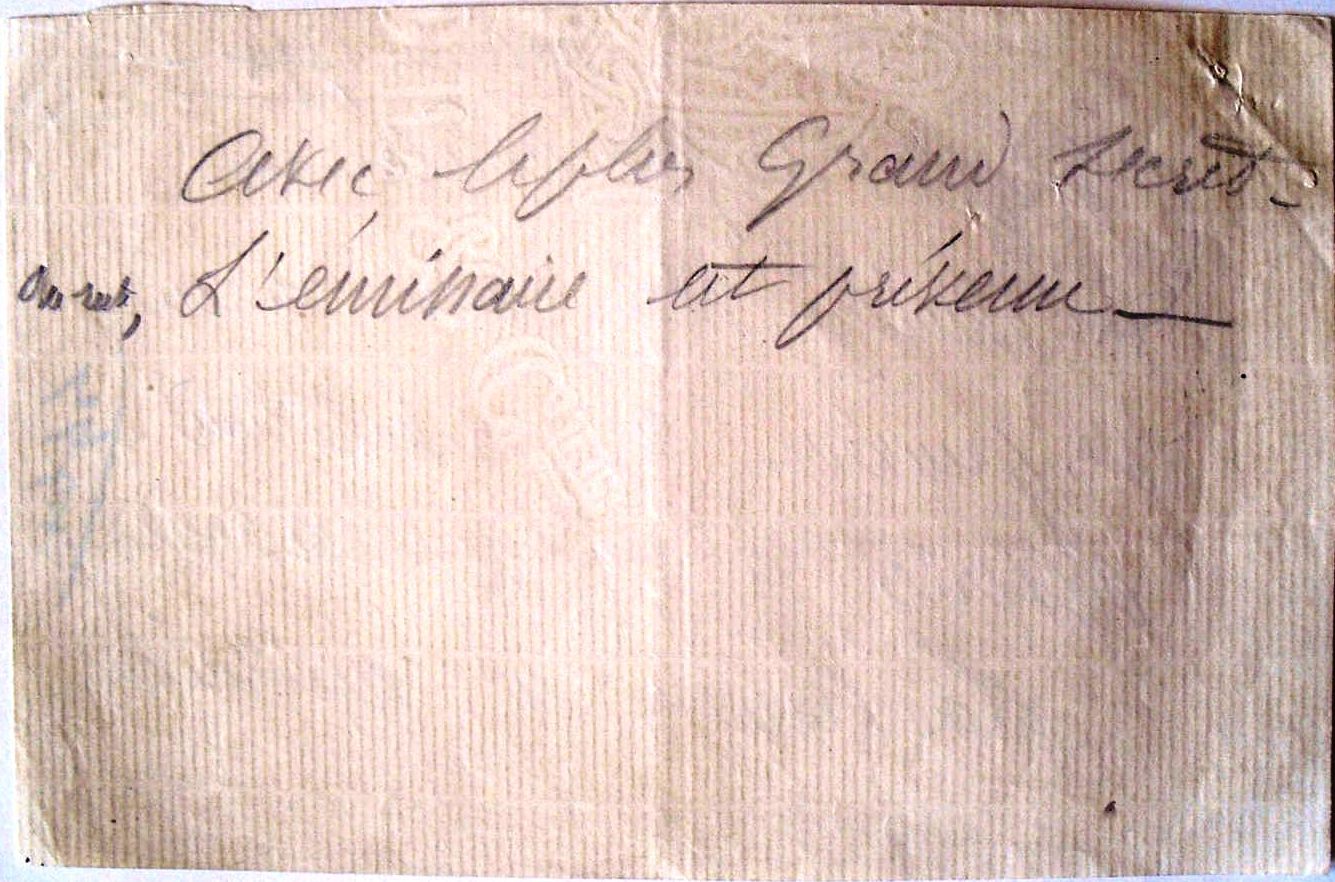
Un autre texte mais qui en fait ne disait rien du tout de la culpabilité de Dreyfus. Car quoi d’étonnant, en effet, que venant d’apprendre l’arrestation d’un officier traître au sein de l’armée française, l’attaché militaire écrivît à son chef d’état-major :
Capitaine Dreyfus arrêté. Le ministère de la Guerre a eu les preuves des révélations offertes à l’Allemagne.
La cause est instruite avec le plus grand secret.
Un propos (le capitaine Dreyfus vient d’être arrêté, il est accusé d’avoir trahi au profit de l’Allemagne ; l’enquête demeure secrète) qui ne disait rien d’une quelconque culpabilité et n’était que celui de la presse aux premiers jours de la révélation de l’arrestation de Dreyfus. C’était, pour seul exemple, exactement ce que disait L’Intransigeant du 2 novembre 1894. Il est vrai que manque ici le dernier segment, problématique indiscutablement, seule notation qui pouvait indiquer quelque chose : « Du reste, l’émissaire est prévenu ». Mais qu’on regarde le document reproduit au-dessus (folio 2) et nous verrons que la traduction du segment concerné est donnée, entre parenthèse, comme incertaine ! Importante précision, n’est-ce pas ?, et que se garde bien, comme à son habitude, de nous donner Adrien Abauzit ! Et une précision qui a son poids puisque, nous le répétons, ce n’est que ce segment qui pouvait en effet laisser entendre la culpabilité de Dreyfus ! Après ce petit bricolage avec la vérité, Adrien Abauzit accuse Picquart d’avoir étouffé les deux versions pour sauver Dreyfus au service duquel, dans la narration habituelle depuis Dutrait-Crozon, il est censé être. Cette accusation, même les hommes de l’État-major n’avaient pas osé la porter ! Pour un Gonse, il était clair que si les télégrammes, écartés en 1894, avaient disparu c’est que Sandherr lui-même, chef de la Section de statistique à l’époque, ne les avait pas conservés. C’est ce qu’il dira lors de l’enquête de la Cour de cassation :
Au mois de mai 1898, le ministre de la Guerre, M. le général Billot, prescrivit de réunir, en un dossier unique, tous les documents, tous les renseignements, toutes les pièces, en un mot, secrètes ou autres, que le Service des renseignements pouvait posséder au sujet de l’affaire Dreyfus. En faisant ce travail, la dépêche dont il vient d’être question me revint à la mémoire, et j’en demandai le texte au colonel Henry. Il me dit ne plus l’avoir ; le colonel Sandherr n’en n’avait pas laissé de traces ;
Un Gonse d’ailleurs qui, à la différence d’Adrien Abauzit, avait su se montrer plus que prudent au sujet de la traduction de Du Paty :
les officiers du Service des renseignements ne pouvaient pas davantage reconstituer ce texte ; j’eus l’idée d’en parler au colonel Du Paty, qui venait quelquefois dans mon bureau ; celui-ci, recueillant ses souvenirs, me donna, de mémoire, un texte qui se rapprochait sensiblement du premier texte communiqué au colonel Sandherr par les Affaires étrangères. Je l’écrivis sous sa dictée, mais je ne considérais ce texte, à aucun titre, comme authentique ; un texte, écrit ainsi de mémoire, à distance des événements, n’avait à mes yeux qu’une valeur absolument inférieure.
… et tellement prudent même qu’il enverra plus tard Henry à Paléologue pour en récupérer le texte original.
S’il l’avait su, Adrien Abauzit aurait aussi pu nous dire autre chose. Il aurait pu nous raconter qu’une fois cette nouvelle traduction, due à la prodigieuse mémoire de Du Paty, récupérée, elle avait été jointe par Gonse au dossier secret (rapport Wattinne). Pourtant, au moment de la clôture du rapport et avant de le transmettre au ministre, Gonse décida, bien maladroitement et en un superbe aveu, d’en biffer la mention (« copie d’un télégramme chiffré adressé par Panizzardi au chef d’État major à Rome ») pour la remplacer par une plus prudente : « Remplacé par une note spéciale ». Une note spéciale qui était une note signée d’Henry, tout juste écrite, note dans laquelle la dépêche était devenue pour le moins accessoire. Henry y « certifi[ait] » que Sandherr lui avait rendu, « le 15 ou le 16 » décembre 1894, les « documents relatifs aux affaires d’espionnage, qui [lui] avaient été demandés au mois de novembre précédent, à propos du procès Dreyfus » et lui avait déclaré à cette occasion posséder un dossier « plus important » dont il ne lui avait montré qu’une pièce qu’il « gard[ait] par devers [lui] », comptant s’en « serv[ir] si besoin est ». Voilà bien une nouvelle confirmation du peu de crédit que Gonse accordait à cette traduction de Du Paty. Une prudence qui n’était pas que de l’honnêteté mais était aussi, sans doute, nécessaire pour éviter de se faire opposer un démenti. Paléologue, qui se souvenait du texte et l’avait donné à Henry à plusieurs reprises (« au mois de septembre ou d’octobre », le 17 novembre et à « diverses reprises » encore « pendant l’hiver 1897-1898 »), aurait pu trouver curieuse cette autre traduction, sortie d’un chapeau ?
Pour démontrer l’indémontrable, Adrien Abauzit bricole et oublie tout ce qui va contre sa démonstration et qui pourtant émane des hommes de l’État-major. Ainsi aurait-il dû lire ce qu’en dit le chef-d’escadron Matton, ancien de la Section de statistique et non suspect de dreyfusisme, et qui savait de quoi il parlait puisqu’il avait été un de ceux qui avaient travaillé au déchiffrement de la fameuse dépêche ? Devant la Cour de cassation, en 1904, il n’aura de cesse de répéter que cette première traduction, telle que l’avait restituée de mémoire Du Paty, n’existait pas, pas autrement que dans sa débordante et obéissante imagination :
M. Le Procureur général : La première traduction qu’on avait faite au Ministère de la Guerre, pour la porter au Ministères des Affaire étrangères, était-elle relative à Dreyfus ?
Le témoin [Matton] : Non, il n’y était en aucune façon question de Dreyfus. C’était excessivement vague… […]
M. Le Procureur général : On ne pouvait pas en conclure qu’il s’agissait du capitaine Dreyfus ?
Le témoin [Matton] : On ne pouvait rien en tirer du tout à mon avis.
M. Le Procureur général : Même avec la traduction qu’on avait apportée ?
Le témoin [Matton] : Non.
M. Le Procureur général : C’est que vous savez que le colonel Du Paty de Clam a prétendu que cette première traduction qu’on a portée au Ministère de la Guerre portait ces mots :
« Arrestation capitano Dreyfus… »
Est-ce cela ?
Le témoin [Matton] : Non, du tout. Cela n’avait rien à voir avec cela.
[…]
Le témoin [Matton] : je répète que cette traduction n’a aucune espèce de valeur.
M. Le Procureur général : Et en aucun cas on ne peut en tirer quoi que ce soit contre le capitaine Dreyfus ?
Le témoin [Matton] : Absolument pas ; même avec la traduction qu’on avait apportée tout d’abord et qui n’était pas du tout certaine, parce que, je le répète, il y avait aux mots plusieurs sens différents.
M. Le Procureur général : Et quant à celle que je viens de vous lire, vous n’en avez jamais eu connaissance ?
Le témoin [Matton] : Non.
Une déposition qui clôt la fable de Du Paty et à propos de laquelle on ne peut que se demander comment il est possible qu’Adrien Abauzit, puisqu’il affirme avoir lu les procédures, ait pu passer à côté… Mais le plus beau – parce qu’il peut y avoir encore plus beau –, dans ce chapitre, est le document qu’exhume Adrien Abauzit et qu’il n’a pas trouvé chez André Galabru, cette fois, mais chez un autre moderne antidreyfusard, Yves Amiot. Donnons-en le texte :
Cher ami,
Je crois que l’arrestation du capitaine Dreyfus cause ici un peu d’émotion. Avant-hier, le colonel Pannizardi [sic] est arrivé à sept heures le soir et tout bouleversé, puis il s’est entretenu secrètement avec l’ambassadeur. […] L’ambassadeur tient sans doute à ce que j’ignore la trahison de Dreyfus car, depuis hier, il cache soigneusement ses journaux. Je ne vois pas autre chose à vous signaler […].
Avant tout, contrairement à ce que dit encore et toujours Adrien Abauzit, qui une nouvelle fois nous accuse d’avoir dissimulé ce document, il faut lui apprendre qu’il a été intégralement cité et commenté par un historien au moins : on le trouve en effet dans le livre d’Oriol, en 2014. Mais que dit ce document ? Selon Adrien Abauzit, cette pièce prouve que Dreyfus « était connu à l’ambassade italienne. Et il ne pouvait l’être que pour fait d’espionnage ». Déjà, cette pièce n’est pas du 31 octobre, comme le dit Adrien Abauzit, mais du 2 novembre. Mais peu importe ici… La vraie question est de savoir ce qui peut permettre à Adrien Abauzit de dire que si Panizzardi était bouleversé à la nouvelle de l’arrestation de Dreyfus, c’est parce qu’il le connaissait ? Rien ! Si Panizardi était bouleversé, c’était plutôt parce quand avait été donné le nom du « traître », le 31, par Le Soir, les Italiens avaient dû être pour le moins stupéfaits et inquiets. Qui était ce Dreyfus dont ils ignoraient tout et que pourtant de nombreux articles donnaient comme trahissant à leur profit ? On serait bouleversé à moins… et c’est pour cela que Panizzardi était allé voir son ambassadeur et, sans doute après la discussion qu’il avait eue avec lui, avait écrit au général Marselli la fameuse dépêche dont il a été précédemment question pour dire qu’il ignorait tout de ce Dreyfus et que, si on ne le connaissait pas à Rome, s’imposait un démenti. Un Panizzardi tellement bouleversé même, que cette dépêche du 2 venait reprendre et insister les propos qui avaient été les siens, la veille, dans un rapport au même, rapport bien connu qu’Adrien Abauzit a, encore et toujours, oublié :
L’arrestation du capitaine Dreyfus a produit, ainsi qu’il était facile de le supposer, une grande émotion.
Je m’empresse de vous assurer que cet individu n’a jamais rien eu à faire avec moi.
Les journaux d’aujourd’hui disent, en général, que Dreyfus avait des rapports avec l’Italie ; trois seulement disent, d’autre part, qu’il était aux gages de l’Allemagne. Aucun journal ne fait allusion aux attachés militaires. Mon collègue allemand n’en sait rien, de même que moi.
J’ignore si Dreyfus avait des relations avec le commandement de l’État-Major.
Quand on a toutes les pièces et qu’on se contente de lire ce qu’il y a d’écrit, on arrive, curieusement, à des résultats bien différents…
Les témoignages confondants
Voici convoqués les témoins de l’inénarrable Quesnay de Beaurepaire. Cela semble une blague… Les commenter n’aurait d’autre intérêt que de montrer comment Adrien Abauzit arrive à faire de la prestidigitation avec leurs contradictions. Il suffit de renvoyer au mémoire de Mornard qui, pour chacun et l’un après l’autre, a montré la vacuité de leurs fameuses révélations. On lira ici les chapitres qui nous intéressent.
Tentatives de corruption
Lazare, tout d’abord, qui, selon l’extrait de la déposition de Rochefort devant la Cour de cassation que cite Adrien Abauzit, serait venu, avec Forzinetti, le voir et lui aurait laissé entendre à mots à peine couverts qu’il pourrait être grassement payé s’il se mettait à la tête de la campagne. Puisqu’il est avocat, Adrien Abauzit, aurait pu laisser la parole à la défense et écouter Lazare qui racontera ainsi cette fameuse entrevue :
Je me décidai à aller voir Rochefort, j’avais pensé au Journal, à l’Écho de Paris, mais je préférais m’adresser à l’Intransigeant. Quand ma visite fut décidée, Mathieu qui m’avait souvent parlé de Forzinetti et qui m’avait dit quelle avait été sa conduite me demanda si je voulais que Forzinetti m’accompagna [sic]. J’acceptai et vis pour la première fois Forzinetti, le matin d’Octobre 96 où il vint avec moi chez Rochefort. Je vis Rochefort, causai avec lui, lui demandai s’il voulait voir Forzinetti que j’avais laissé dans la voiture qui attendait devant la porte. Rochefort reçut très bien Forzinetti, écouta tout avec grand intérêt. Je ne trouvai chez lui qu’une résistance médiocre. Toute sa croyance en la culpabilité de Dreyfus reposait sur les racontars [jeu, femmes, etc.] qu’on lui avait rapportés. Il était cependant assez disposé à croire que Charles Dupuy avait commis d’abominables gredineries. Somme toute il se demandait intérieurement de quel côté il polémiquerait. Il me promit cependant qu’un compte rendu impartial de ma brochure serait fait dans l’Intransigeant. J’ai su depuis qu’un homme avait empêché Rochefort de marcher contre les bourreaux de Dreyfus : c’est Vaughan qui lui conseilla de ne pas défendre le condamné. L’Intransigeant aussi publia une analyse plutôt malveillante. Cependant Rochefort n’était pas convaincu de la culpabilité de Dreyfus. Quelques jours après la publication de ma brochure je le vis à la réunion du Comité pour Cuba libre dont je faisais partie et qu’il présidait. À la fin de la séance Bauer [sic] et Cipriani qui étaient là me dirent toute leur sympathie pour moi et pour la cause que je défendais. Bauer [sic] interpella Rochefort et celui-ci dit qu’il trouvait très courageux de ma part d’avoir marché, mais ajouta-t-il : « jamais on ne remontera ce courant » et comme Bauer [sic] insistait, il s’éclipsa très gêné.
Il est clair qu’un des deux ment et ment effrontément. Pourtant, nous voudrions poser une question qui ne nous semble pas sans intérêt. Pourquoi Rochefort, s’il disait vrai, ne parla-t-il de cette tentative d’embauchage pour la première fois qu’en 1904 ? Pourquoi, en novembre 1897, quand il parla la première fois de la visite de Forzinetti, ne pipa-t-il pas mot de la démarche tentée et ne cita pas même le nom de Lazare ? Citons ce texte de Rochefort, qu’ignore encore Adrien Abauzit :
De là ces démarches dont j’ai été moi-même l’objet dans de rares conditions d’insistance et de ténacité. Oui, j’ai reçu, un jour, à mon excessif étonnement, la visite de qui ? Vous ne le devineriez jamais : du directeur de la prison du Cherche-Midi, où Dreyfus avait été en prévention ; il venait, au nom de tous les parents du condamné, me supplier de m’associer à la campagne qui se préparait en faveur de la révision du procès.
Par quels arguments avait-on ouvert les yeux de ce chef de bataillon ? Je n’ai pas à le rechercher, et je ne mentionnerais pas son intervention, quelque étrange qu’elle m’ait paru, si ce défenseur d’un homme qu’il était chargé de garder, n’avait pas été révoqué dernièrement de ses fonctions, qu’il exerçait si singulièrement.
J’éconduisis ce solliciteur, non sans lui avoir adressé cette observation : « Puisque vous croyez à son innocence, pourquoi, lorsqu’il était entre vos mains, ne l’avez-vous pas fait évader ? »
À quoi il riposta, avec l’accent d’un homme qui connaît la puissance de la juiverie, sous notre ploutocratie républicaine :
« J’avais la conviction qu’il serait acquitté. » (« Un bail de trois ans », L’Intransigeant, 1er novembre 1897).
Imagine-t-on Rochefort laisser passer ainsi l’occasion d’édifier ses lecteurs sur les mœurs du « syndicat » et de donner un exemple précis, pour varier les couplets qu’il aimait tant, « de la puissance de la juiverie » ? Encore et toujours, passons…
Oublions, à la suite, le ridicule Mertian de Muller et l’improbable Teyssonnières et attardons-nous pendant quelques lignes sur le cas Sandherr. Adrien Abauzit reproduit le rapport de Sandherr sur la tentative de corruption dont il aurait été l’objet de la part des frères de Dreyfus. Adrien Abauzit aurait pu, s’il les connaissait et pour agrémenter son propos, ajouter les « témoignages » de la veuve de Sandherr et de quelques amis (Stackler, Thesmas). Il aurait même pu citer un autre ami, Penot, qui ira jusqu’à se souvenir du montant proposé – 150 000 francs – pour « étouffer » l’affaire ! Cordier, à qui Sandherr en avait parlé, démentira absolument qu’il se fût agi d’une tentative de corruption… Mais Cordier n’est pas recevable pour Adrien Abauzit puisqu’il eut le grand tort de devenir dreyfusard. Pourtant, son témoignage sera confirmé, à Rennes, et le sera par un homme dont Adrien Abauzit ne remettra pas en question la parole : le général Mercier :
Je dois à la vérité de dire que je suis d’accord, avec le colonel Cordier. Je me rappelle que le jour où cet entretien a eu lieu, le colonel Sandherr est venu m’en rendre compte et je lui ai demandé quelle était l’impression générale qui était résultée pour lui de son entrevue avec Mathieu Dreyfus. Il m’a répondu: « Mon Dieu, il m’a fait l’effet d’un brave homme disposé à tous les sacrifices pour sauver son frère ».
Intimidation de témoins
Nous ne parlerons pas des cas Paumier et Depert-Durlin, ici présentés, et qui ne représentent aucun intérêt. Nous noterons juste que, concernant le premier cas, soutenir que la Préfecture fut au service des dreyfusards est un doux rêve complotiste et, concernant le second, qu’est pour le moins problématique de n’avoir pour unique source que les souvenirs du greffier Ménard, souvenirs qui ne sont qu’une succession de délires. Comment donner une quelconque valeur au témoignage du greffier quand on sait qu’il y raconte, par exemple, qu’en octobre 1898, René Waldeck-Rousseau, futur président du Conseil, serait venu le voir, lui, greffier, pour lui « parler de l’affaire Dreyfus, dont vous allez avoir à vous occuper » : « Ce n’est pas que Dreyfus nous intéresse, lui aurait-il dit, mais nous voulons profiter de cette circonstance pour faire une armée républicaine et démolir l’État-major qui n’est composé que de cléricaux, de jésuites et de réactionnaires. Nous sommes sûrs de réussir, ceux qui seront avec nous auront ce qu’ils voudront, tant pis pour les autres. » Et on pourrait ainsi citer chaque page ou presque de ces souvenirs pour voir à quel degré d’incohérence était arrivé le fameux greffier.
Marcel Thomas
Là encore, et non pas uniquement parce que l’exercice auquel nous nous livrons commence sérieusement à nous lasser, nous irons vite sur ce chapitre. Voir Adrien Abauzit se permettre d’ainsi insulter Marcel Thomas est rigoureusement intolérable… et d’autant plus intolérable que pour se permettre d’ainsi critiquer le travail d’un tel historien, il faut avoir une envergure qui n’est pas celle d’Adrien Abauzit. Quelle bassesse, quelle facilité que d’ainsi insulter un homme qui n’est plus là pour répondre (Marcel Thomas nous a quitté en 2017).
Sur quelques pages, Adrien Abauzit s’essaie à prendre les arguments de Marcel Thomas sur les pièces énumérées au bordereau et à les retourner. Il s’y essaie et s’y essouffle… Et il accuse, avec sérieux, l’historien d’être un sophiste (encore) et vient couper un pauvre petit cheveu en quatre en un style triomphant, de micro-Léon Daudet, qui vacille entre le risible et le pathétique. Prenons un exemple, et un seul exemple, qui suffira amplement : le premier, celui au sujet du 120. Adrien Abauzit reproche, sans doute en y croyant, à Marcel Thomas, sa « construction purement artificielle, sans apparence de crédibilité », ses « grossiers sophismes et inventions », d’être « obligé de quitter la réalité et d’inventer une véritable fiction », de « distord[re] le réel », « d’invent[er] […] des faits pour plaider sa cause » et de faire « preuve d’une grave incompétence »… Pourquoi ? Pour deux raisons : la première est liée au témoignage de Bruyerre – disqualifié pour Adrien Abauzit parce que dreyfusard, démissionnaire de l’armée, sans doute antimilitariste et depuis devenu auteur dramatique – la seconde à celui de Carvallo. Non seulement, explique Marcel Thomas, le canon 120 avait été vu en action en mai à Châlons (Bruyerre) mais encore une description complète était entre les mains d’officiers subalternes depuis le 7 avril (Carvallo) ; Esterhazy, présent à Châlons en mai, aurait ainsi pu se la procurer. Mensonge !, s’écrie Adrien Abauzit. Impossible ! Non seulement Carvallo témoignait de ce qui s’était passé dans son régiment, qui était à Poitiers, et ce qui est à Poitiers n’est pas Châlons mais encore le bordereau étant de fin août, son auteur ne pouvait y parler des essais de mai mais nécessairement de ceux de la mi-août : « le bon sens nous indique que l’espion a transmis des informations sur les derniers tirs en date. » Bah non ! le bon sens nous indique que l’espion a pu parler de ce qu’il avait à dire, et en l’occurrence des essais de mai auquel il avait assisté s’il n’avait pu assister à ceux d’août (ce qui est le cas d’Esterhazy, parti de Châlons juste avant les essais en question), comme le bon sens nous indique que l’auteur du bordereau aurait pu se procurer un exemplaire de la description complète du frein, distribuée à Poitiers ou nous ne savons où et l’avoir avec soi au camp de Châlons… nous ne savons où, écrivons-nous parce que les fameux 300 exemplaires du 7 avril n’avaient pas été seulement distribués à Poitiers, bien évidemment. Ils l’avaient été partout et justement dans la perspective des écoles à feu de mai, écoles à feu dont était Châlons. Le général Deloye l’avait dit, clairement, lors de sa déposition devant la Cour de cassation (encore un témoignage à côté duquel Adrien Abauzit est passé) :
Le 7 avril 1894, 300 exemplaires d’un nouveau projet de règlement provisoire imprimés par l’Imprimerie nationale ont été répartis dans certains corps de troupe pour servir aux essais à faire aux écoles à feu de 1894.
Et tout le reste est à l’avenant : de petits pinaillages, décorés d’insultes, sur des détails infimes qui reposent tous sur des arguments de la faiblesse de ceux que nous venons de voir… et quand Adrien Abauzit s’aventure sur le fond, c’est pour opposer un témoignage à un autre, sans recul ni esprit critique, et ne retenir que celui qui correspond au postulat de départ : seuls les témoins de l’accusation disent la vérité…
L’altercation Picquart-Esterhazy
Puisque nous venons de parler d’argumentation faible, en voici un nouvel exemple. Pour parler de cet incident sans intérêt qui n’est qu’un tout petit épisode de l’Affaire, Adrien Abauzit met en regard deux articles, un de la presse dreyfusarde et un de la presse antidreyfusarde et constate, avec une rare lucidité qui pourtant semble l’étonner, que les versions sont différentes. Plutôt que de comprendre que la presse dit la plupart du temps n’importe quoi – ce qui lui aurait permis de ne pas aller se perdre sur la question Félix Faure –, il se contente de dire que « cela n’a aucune espèce d’importance » puisque Picquart et Esterhazy étaient de mèche ! Adrien Abauzit y voit même précisément la confirmation de cette certitude ! Nous n’allons pas nous étendre sur cette question après un tel argument. Pourtant nous pourrions revenir, comme nous l’avons fait précédemment (voir ici) sur la question de la dénonciation de Picquart par Esterhazy dans l’article Dixi… mais à quoi bon ?
Peguy/Reinach
Passons les petites considérations philosophico-mystico-politiques sur Péguy, catholique « très particulier », « vivant en état de péché mortel » puisque concubin (il était marié mais civilement uniquement), n’allant pas à l’église et n’ayant pas fait baptiser ses enfants, et intéressons-nous au dernier chapitre consacré à Reinach. On se doute de ce qu’on y trouve, dans ce chapitre qui, au final, ne fait que reprendre et développer quelques pages de son premier. Reinach, nous dit celui qui croit au syndicat et à une vaste entreprise de la République qui « a besoin que la France soit coupable » (et pourrait donc méditer Matthieu, VII,3), était un complotiste ; il était aussi un anticatholique et tout son travail sur l’Affaire repose sur une « argumentation victimaire » : l’antisémitisme. Et Reinach va tellement loin sur ce dernier point, nous apprend Adrien Abauzit, que personne n’y échappa, pas même « les juifs ou les personnes d’origine juive ». Rendez-vous compte, Meyer et Pollonnais, « deux hommes de presse juifs, sont eux aussi qualifiés d’antisémites par Reinach » ! On ne peut quand même pas, Adrien Abauzit, reprocher à Reinach de dire que sont antisémites des antisémites… Reinach les présente comme tels parce qu’ils furent tels. Et c’est à la suite que se place la petite sortie sur Bertillon et l’imaginaire mensonge de Reinach que nous citions au début.
Il n’est que temps de conclure. Nous avons conscience, comme pour nos précédentes critiques et réponses, qu’Adrien Abauzit ne changera pas de point de vue. Mais peu nous importe parce qu’il est bien évident que ce n’est pas pour lui que nous écrivons ces pages. Nous les écrivons pour ceux qui, l’esprit ouvert et de bonne foi, connaissant peu la question, pourraient se laisser berner par ces « vérités » assénées à grand coups d’interprétations forcées, de documents oubliés, par quelqu’un qui se pose en fin connaisseur, ayant beaucoup travaillé, sur un sujet qu’en réalité il connaît à peine. Adrien Abauzit est dans la droite ligne de quelques-uns de ses pères, qui savaient se montrer plus retors toutefois : un Maurras, par exemple qui, le 14 juillet 1906, deux jours après la réhabilitation de Dreyfus, pouvait écrire à Maurice Barrès : « combien cette affaire était et est vitale pour nous ? […] Nous allons la réviser, n’est-ce pas ? » La révision continue mais peut-être serait-il bon que nos révisionnistes s’aperçoivent que procédant comme ils procèdent, il ne font, quand la chose est démontrée, que renforcer une vérité qui est la vérité judiciaire, mieux même la vérité historique et qui ne fait guère de doute pour qui sait lire : l’innocence de Dreyfus, la culpabilité d’Esterhazy et la complicité de l’état-major…
po
Et pour prolonger, une émission à propos de ce livre, commentée et corrigée : ici.
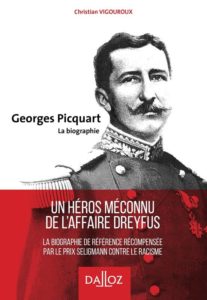 Ce livre, qui, en une même composition, vient d’être réédité dix ans après sa sortie, est un livre important ne serait-ce que parce qu’il est la première biographie de Picquart et le premier ouvrage à nous donner des renseignements sur ce que furent sa jeunesse, le début de sa carrière, son activité d’auteur pour divers périodiques et revues dont il prend un à un les articles en en offrant une claire synthèse, ses réseaux et son activité de ministre… Pour tout cela ce livre est indispensable…
Ce livre, qui, en une même composition, vient d’être réédité dix ans après sa sortie, est un livre important ne serait-ce que parce qu’il est la première biographie de Picquart et le premier ouvrage à nous donner des renseignements sur ce que furent sa jeunesse, le début de sa carrière, son activité d’auteur pour divers périodiques et revues dont il prend un à un les articles en en offrant une claire synthèse, ses réseaux et son activité de ministre… Pour tout cela ce livre est indispensable…
Si un certain nombre de procédures de l’Affaire ont été publiées pendant l’Affaire et sont aujourd’hui disponibles (voir ici), quelques-unes ne le furent jamais et demeurent inédites. C’est le cas des procédures Pellieux et Ravary, des deux enquêtes Tavernier relatives à Picquart et Du Paty et enfin de l’enquête Duchesne sur de Pellieux. Nous les publierons ici en commençant aujourd’hui avec les deux enquêtes Pellieux (conservées aux AN, BB19 108 et 123) de novembre-décembre 1897, suite à la dénonciation d’Esterhazy par Mathieu Dreyfus le 15 novembre.
Philippe Oriol
Notons toutefois que les trois dépositions Esterhazy avaient seules fait l’objet d’une publication dans le volume d’annexes de l’enquête de la première cassation (La Révision du procès Dreyfus. Enquête de la Cour de cassation, t. II : Instruction de la chambre criminelle, Paris, Stock, 1899, p. 90-105).
Ici nous regrouperons, sous ce titre de « Musée des Horreurs » (des erreurs ? des errances ?), les petites hallucinations de quelques complotistes très dérisoires.
Après Makow (que nous donnions ici), voici Josh, qui le jour où sera décerné le prix de l’absolu n’importe quoi devra être classé hors-concours, personne ne pouvant lui ravir sa place. Erreurs à chaque date, inventions ahurissantes (la citation qui n’a jamais existé de Cinq années de ma vie), citations truquées (l’histoire du 45° : Dreyfus n’écrit pas « plus de » mais « au moins », ce qui change tout), ignorance crasse (le 2e bureau, la loi de 1848 qui est de 1850 et la confusion entre loi et constitution, l’ignorance des retouches photos si courantes à l’époque et bien visibles avec les moyens dont on disposait alors), assertions hallucinées (la déportation à l’île du Diable serait une invention et n’aurait jamais eu lieu !!!), démonstrations exaltées, etc.
Donnons à la suite ce long délire, tellement énorme qu’il pourrait laisser penser qu’il s’agit d’un canular ou d’une expérience d’écriture sous peyotl, assez souvent inquiétant mais qui pourra agrémenter un soir d’ennui :
Depuis 120 ans, l’affaire Dreyfus a fait l’objet d’un nombre incalculable de compte-rendus. Des dizaines de livres et des centaines d’articles académiques ont été écrits sur le sujet. Cette bibliographie exhaustive répertorie plus de 5000 articles écrits depuis la fin de l’affaire. Si on devait estimer le nombre d’articles de journaux publiés uniquement à l’époque de l’affaire, il se chiffrerait à une centaine de mille. Comme les journaux imprimaient de multiples éditions quotidiennes pour tenir les gens informés des nouveaux développements, l’affaire Dreyfus reçut au 19ème siècle l’équivalent d’une couverture de 24 heures non-stop. Ce fut vraiment le procès d’OJ Simpson de son époque.[Simpson est un joueur de football américain accusé d’un double meurtre, celui de son ancienne femme et de l’ami de celle-ci. Miles révèle que le meurtre et le procès étaient bidon] Comme l’a noté Adam Gopnik dans son article du New Yorker en 2009 sur l’affaire Dreyfus :
« Le mélodrame typique des médias modernes nécessite une salle d’audience: de Scopes à JO, l’avant-scène dramatique d’un procès donne une structure au spectacle de la vie moderne. L’affaire Dreyfus, le premier à certains égards de ces drames, a tenu la France envoûtée… »
Ceux parmi vous qui ont lu les papiers de Miles Mathis sur le procès de la famille Manson, celui de Patty Hearst, de Scopes, des sorcières de Salem et de JO, pourront réaliser que Gopnik nous dit la vérité, déguisée en métaphore. Ces procès sont des drames, dans le sens où ils sont écrits à l’avance. Et ils structurent réellement la vie moderne, car ils servent à construire et consacrer notre réalité fabriquée, ainsi qu’à manipuler nos peurs et nos passions de manière à servir les intérêts de ceux qui nous gouvernent. Et l’affaire Dreyfus fut l’un des premiers, l’un des plus élaborés et des plus réussis de ces drames de salle d’audience fabriqués. En fait, il a comporté plusieurs affaires judiciaires réparties sur une douzaine d’années, ainsi que d’innombrables rebondissements et intrigues, ce qui a fait dire à un chercheur qu' »Un romancier ou un auteur dramatique qui écrirait une telle histoire serait taxé d’exagération. »
L’incessante apparition de livres, documents, films et mini-séries, émissions spéciales TV et sites web, tous dédiés à reprendre l’affaire Dreyfus et à la solenniser, a recouvert au fil des ans les événements d’un canevas complexe de plusieurs couches superposées. (Je suppose que ce qu’ils disent est vrai, car si vous répétez un mensonge assez souvent, il devient la vérité.) Mon but ici est de démêler et dérouler les fils de ce canevas pour vous montrer que la chose n’était autre qu’un canular fabriqué. On pourrait penser avec ces événements ressassés et critiqués des milliers de fois que quelqu’un d’autre aurait pu déduire cette possibilité. Mais en dehors d’une exception notable [Markow], il n’y a personne. La crédulité des humains est sans limite. Je ne peux vraiment pas les en blâmer, malgré tout. Jusqu’à une date récente, je n’aurais pas remis en question non plus cet événement. Mais aujourd’hui après une étude en profondeur, je peux vous assurer que ce fut un canular géant. Dreyfusards et anti-Dreyfusards jouaient tous dans la même équipe, ils faisaient tous partie de la conspiration. Dreyfus compris. Il n’a jamais passé une seule journée sur l’île du Diable. Cela peut paraître absurde. Je vous suggère de lire les articles de Miles Mathis dont j’ai posté les liens ci-dessus. Vous serez alors en mesure de bien mieux juger ma thèse.
Avant d’exposer mes éléments de preuve et mon argumentation, permettez-moi de vous dire comment je me suis intéressé à ce sujet : quand Miles a publié mon article sur Gandhi, j’ai reçu des messages de quelques-uns de ses lecteurs. L’ un d’eux écrivait: « S’il y a une chose que j’ai apprise en 62 ans, c’est que les BANKSTERS, l’élite dirigeante … comme vous voudrez les nommer … les BANKSTERS, contrôlent TOUJOURS les deux côtés, et créent TOUJOURS leur propre opposition ! » Pour finir, j’avais récemment lu l’article Saturday Night live de Kevin, où Miles dit à propos d’Arthur Miller: « On m’a dit que Miller fulminait contre les Juifs, mais nous avons découvert dans mes récents articles que c’est un thème récurrent. Ça s’appelle ‘créer sa propre opposition’ pour remplacer la véritable opposition et la véritable critique. » J’avais donc en tête cette idée de l’antisémitisme comme étant une opposition contrôlée en lisant les fondements du sionisme politique moderne à la fin du 19 e siècle, en réponse à la montée de l’antisémitisme européen, comme en témoigne l’affaire Dreyfus. Cela a déclenché une sonnette d’alarme, et j’ai pensé, « Hum … l’affaire Dreyfus. C’était donc ça aussi ? » Alors je suis allé sur Wikipédia pour me rafraîchir les idées et bingo ! Je vais donc vous rapporter maintenant ce que j’ai trouvé.
Je vais commencer en faisant un bref rappel de l’affaire. Si vous êtes comme moi, vous en avez probablement besoin. Nous passerons ensuite en détail à l’essentiel, je démontrerai la fraude en démasquant quelques-uns des acteurs-clé, et finirai par une discussion sur le contexte de l’affaire en vous disant ce qu’il en était vraiment selon moi.
Pour vous rafraîchir la mémoire, permettez-moi de vous présenter une longue citation de Wikipédia [la version anglo-saxonne, bien entendu, de Wiki, qui montre comme à l’accoutumée des différences notables avec la version française] :
Le scandale démarra en décembre 1894, avec la condamnation pour trahison du capitaine Alfred Dreyfus, un jeune officier d’artillerie française d’origine alsacienne et juif. Condamné à la réclusion à perpétuité pour avoir prétendument communiqué des secrets militaires concernant la France à l’ambassade d’ Allemagne à Paris, Dreyfus fut emprisonné sur l’île du Diable en Guyane française, où il passa près de cinq ans.
C’est en 1896, principalement grâce à une enquête initiée par Georges Picquart, chef du contre-espionnage, que la preuve fut faite du vrai coupable, un officier de l’armée française nommé Ferdinand Walsin Esterhazy. Après la suppression de la récente preuve par des officiers de haut rang, le tribunal militaire acquitta à l’unanimité Esterhazy après deux jours de procès. L’armée accusa alors Dreyfus de nouvelles charges sur la base de documents falsifiés. Une rumeur faisant état d’un coup monté contre Dreyfus par le tribunal militaire et d’une tentative de camouflage commença à se répandre, surtout grâce au « J’accuse », une véhémente lettre ouverte du célèbre écrivain Émile Zola, publiée dans un journal parisien en Janvier 1898. Les défenseurs de Dreyfus firent pression sur le gouvernement pour une réouverture du dossier.
En 1899, Dreyfus fut ramené en France pour un autre procès. Le scandale politique et judiciaire intense qui s’ensuivit divisa la société française en deux camps : ceux qui soutenaient Dreyfus (appelés aujourd’hui « dreyfusards »), parmi lesquels Sarah Bernhardt, Anatole France, Henri Poincaré et Georges Clémenceau et ceux qui le condamnaient (« anti-dreyfusards »), tels que Drumont, directeur et éditeur du journal antisémite La Libre Parole. Le nouveau procès donna lieu à une autre condamnation et à une peine de 10 ans, mais Dreyfus obtint un pardon et fut remis en liberté.
Toutes les accusations portées contre Dreyfus furent finalement démontrées comme sans fondement. En 1906, Dreyfus fut innocenté et rétabli en tant qu’officier de l’armée française. Il servit pendant toute la première guerre mondiale en terminant avec le grade de lieutenant-colonel. Il mourut en 1935.
Entre 1894 et 1906, l’affaire divisa profondément et durablement la France en deux camps opposés: les « anti-dreyfusards » pro-armée, pour la plupart catholiques et les « dreyfusards » pro-républicains et anticléricaux. Ce qui aigrit la politique française et encouragea une radicalisation.
ALFRED DREYFUS
Commençons par le début: Alfred Dreyfus. La toute première chose que vous entendrez toujours dire de lui, c’est qu’il était officier d’artillerie. C’est important pour eux de le marteler pour être sûr que vous ne le contestiez pas. La raison est que la lettre, nommée « le bordereau », trouvée dans une corbeille à papier à l’ambassade d’Allemagne et utilisée comme preuve contre Dreyfus, offrait de vendre une information à laquelle un officier d’artillerie aurait eu accès. Et il est vrai qu’il avait gravi les échelons dans un régiment d’artillerie, étant nommé capitaine et ayant stationné dans un arsenal d’artillerie. C’était en 1889. Mais en 1891, il entra à l’école militaire de Saint-Cyr. Il en sortit diplômé en 1893 et rejoignit l’état-major.
L’armée avait été réorganisée après la défaite de la France dans la guerre franco-prussienne. La réorganisation de l’armée impliquait la création d’un état-major avec quatre départements: le deuxième (connu sous le nom de ‘Deuxième Bureau’) était le Renseignement militaire, qui, au moment de l’affaire se composait de 20 ou 30 officiers, dont la tâche était la centralisation et l’analyse pour le Renseignement.
A l’intérieur du Deuxième Bureau existait une petite unité responsable du contre-espionnage, à qui on avait donné le nom trompeusement anodin de Section Statistique, comprenant 3-4 officiers. L’une des caractéristiques notables de cette section était qu’elle se situait en dehors de la chaîne de commandement militaire: le chef de la section faisait ses rapports au ministre de la guerre, dont il prenait aussi les ordres, et non au chef du Deuxième Bureau. La Section Statistique était ainsi sous contrôle civil direct, ce qui en faisait une sorte de taupe politique souterraine dans l’armée française.
Selon Wikipédia, « le chef de la Section Statistique était en 1894 le lieutenant-colonel [notez le rang] Jean Sandherr : diplômé de Saint-Cyr, cet alsacien de Mulhouse était un anti-sémite convaincu. Sa mission militaire était claire: récupérer des informations sur de potentiels ennemis de la France et les abreuver d’informations fausses. » Devinez qui d’autre était alsacien ? Dreyfus. Oh, et si vous ne le saviez pas, ils étaient tous deux de la même ville: Mulhouse. Serait-ce un hasard ? Nous verrons que la plupart des acteurs étaient originaires d’Alsace et certains d’entre eux de Mulhouse. Mais je suppose que si Wikipédia nous dit que Sandherr était anti-sémite, ils n’auraient pu jouer dans la même équipe, n’est-ce pas ?
Voici un assez récent article de Tablet sur l’affaire Dreyfus :
« Fondée en 1871, après la désastreuse défaite de la France dans la guerre franco-prussienne, l’agence de contre-espionnage français… était un groupe cinglé d’assassins, d’espions, et de clairvoyants bons à falsifier documents et preuves en cour martiale et autres auditions juridiques. Rappelant les anciens agents de la CIA du président Richard Nixon spécialistes des coups tordus, ils étaient les plombiers de leur époque. Après qu’on ait surpris les plombiers à pénétrer dans le quartier général des adversaires démocrates de Nixon, l’hôtel Watergate, le président fut contraint de démissionner et ses agents furent condamnés pour leurs crimes. Mais imaginez un scénario différent. Et si les plombiers avaient réussi leurs sales combines? Et si l’armée américaine s’était alignée derrière eux et si les tribunaux avaient commencé à condamner les gens sur de fausses preuves, en les envoyant en prison pour la vie? Et si les plombiers avaient pendant douze ans fait régner la terreur contre les Juifs et autres personnes inscrites sur la « liste des ennemis » de Nixon ? Lorsque le pays a finalement réalisé ce qui se passait et tenté de se remettre de ce traumatisme, les gens ont senti que quelque chose avait terriblement mal tourné avec le système judiciaire et que le gouvernement avait échoué à les protéger. Tel fut l’effet de l’affaire Dreyfus. »
Pris pour argent comptant, comme le récit officiel nous y invite, rien de tout ceci ne semble délibéré. Mais tout comme nous ne pouvons plus prendre les plombiers pour argent comptant, nous ne pouvons pas plus prendre l’affaire Dreyfus pour argent comptant. Le fait que certaines voix, valeurs, coalitions et centres de pouvoir soient sortis de l’affaire discrédités, délégitimés, dispersés et désemparés n’était pas le fruit du hasard.
Revenons à Dreyfus. Voici quelques dates-clés: il a été nommé à l’état-major le 1er janvier 1893. Le ‘bordereau’ fut intercepté en septembre 1894 (certains récits parlent de l’été). On a dit qu’il a été trouvé déchiré dans une corbeille à l’ambassade d’Allemagne par une femme de chambre française (une alsacienne), instrument du contre-espionnage français. Le 5 octobre, le major Armand du Paty de Clam, qui avait été chargé de l’enquête, en est venu à soupçonner Dreyfus. Le 13 octobre, Dreyfus reçut un avis à comparaître au bureau des officiers. Il fut arrêté le 15 octobre, et la nouvelle de son arrestation fut divulguée le 31 octobre. Son procès (à huis clos) débuta le 19 décembre, se termina le 22, et condamna Dreyfus à l’exil permanent, à être dépouillé de son grade, et à une cérémonie de dégradation militaire. Celle-ci eut lieu le 1er janvier 1895, date inscrite sur la photo signalétique de Dreyfus ci-dessus. (La France, en passant, est à l’origine des photos anthropométriques.)
Les personnes nommées par l’état-major passaient leurs deux premières années par roulement dans chacun des quatre départements – 6 mois dans chaque – avant d’obtenir leur première affectation « réelle ». Ce site dit, selon l’historien Vincent Duclert, qui a écrit une étude faisant autorité sur l’affaire, que les « nominations successives de Dreyfus inclurent le premier bureau pour la rédaction de l’ordre de bataille des armées, le quatrième bureau pour le service ferroviaire permettant la concentration des troupes, le deuxième bureau pour l’étude de l’artillerie allemande, et enfin le troisième bureau pour la signature des registres d’approvisionnement des troupes de couverture. »
Ainsi selon Duclert, Dreyfus travaillait dans le 3ème bureau au moment de son arrestation. Je n’ai pas lu le travail de Duclert, et je ne sais pas quelles sont ses sources. Mais j’ai une bonne source qui le contredit : Alfred Dreyfus. Ses mémoires de prison, qui couvrent les années 1894 à 1899 et intitulées à juste titre Cinq années de ma vie, furent publiées en 1901 en français et en anglais. Nous parlons donc ici d’une source primitive directe, publiée très peu de temps après l’affaire.
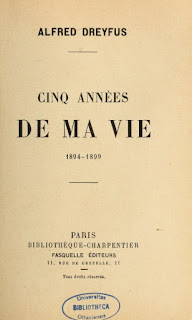
Dans ses mémoires, Dreyfus écrit qu’il a travaillé pour le Renseignement militaire (Deuxième Bureau) pendant tout le temps passé à l’état-major. Vous avez bien compris: Dreyfus n’était pas officier d’artillerie. Il appartenait au Renseignement militaire . Vous ne trouverez nulle part cette petite pépite de vérité sous les masses de conneries écrites sur l’affaire, même si elle est juste sous les yeux des historiens depuis 1901.
Il se trouve que le 1er octobre 1895 – deux semaines avant son arrestation – Dreyfus a été réaffecté et qu’il s’est retrouvé en poste avec un régiment d’infanterie à Paris. (Voyons voir, qui d’autre avons-nous vu quitter le Renseignement deux semaines avant de reparaître dans une énorme PSYOP ? Hum… ah d’accord, le père de Sharon Tate.) Rappelons qu’ils ont commencé à soupçonner Dreyfus le 5 octobre (nous dit-on). Ce qui est absurde pour de nombreuses raisons, car le Bordereau, découvert en septembre, parlait de secrets d’artillerie militaire. On dit que le soupçon est tombé sur lui puisqu’il était officier d’artillerie. Mais cela n’a pas de sens parce qu’il n’était plus dans l’artillerie depuis 1890 en entrant à Saint-Cyr et, qu’après son diplôme, il est entré dans le Renseignement militaire en 1893. Vous pourriez me dire que son rôle dans le régiment d’infanterie impliquait probablement l’artillerie, mais il n’était pas à ce poste lorsque le bordereau fut découvert, et il n’y était que depuis quelques jours quand il fut soupçonné. Le bordereau précise que l’auteur de la lettre n’a eu le manuel d’artillerie de campagne en sa possession que pendant quelques jours quand il était « en manœuvre ». Il dit qu’il « part en manœuvre. » Mais rappelons que lorsque la note a été écrite, Dreyfus travaillait au Deuxième Bureau, il ne serait donc pas parti en manœuvre d’artillerie.
Maintenant, si c’était l’histoire officielle, on pourrait dire que tout ceci est une preuve supplémentaire que Dreyfus a été mis en place par de méchants revanchistes antisémites de l’armée, comme le capitaine (puis lieutenant-colonel) du Paty de Clam et son infâme homme de main, le capitaine (puis lieutenant-colonel) Henry. Mais non. Ces contradictions flagrantes sont à mon avis le signe que cette affaire a été fabriquée, d‘autant plus que ces faits auraient été connus de ceux qui l’ont accusé et condamné – qu’ils aient ou non pensé à faire concorder l’écriture de Dreyfus et celle du Bordereau.
Voici une autre incohérence flagrante : on peut lire dans le journal de Dreyfus en prison sa note du 4 novembre 1895 : « Chaleur terrible, plus de 45° ». Comment aurait-il pu connaître la température? Lui a-t-on donné un thermomètre sur l’île du Diable ? Pourquoi pas aussi un baromètre, pour qu’il puisse installer sa petite station météo personnelle ? À l’époque bien sûr, les gens ne savaient pas grand-chose du climat en Guyane et n’avaient pas vraiment les moyens de le découvrir. Mais ils savaient qu’il y fait chaud, et 45° est sacrément chaud. Pauvre homme! Mais de nos jours, nous avons une petite chose appelée Internet, et des « faits » de ce genre peuvent être vérifiés. Selon Weather Underground, la température la plus élevée en Guyane française a été enregistrée le 3 novembre 2015. Il y a fait 37.9°. C’est 7° en dessous de ce qu’a rapporté Dreyfus. On ne sait pas depuis combien de temps existe l’enregistrement des températures, mais si nous sommes censés croire au réchauffement climatique, il est supposé faire plus chaud aujourd’hui qu’à l’époque. Le climat de Guyane française est tropical avec une faible variation saisonnière de la température. La température maximale moyenne est de 29° et la minimale moyenne de 23°, alors qu’en juin la moyenne maximum est de 31° avec un minimum de 23°. Alors, non, Alfred, je suis désolé, mais il n’a jamais fait 45° sur votre petite île. Je suppose que votre thermomètre était cassé. Ou… peut-être avez-vous tout inventé ?
Certains récits nous disent qu’il a passé ses 5 ans enfermé dans une cellule et qu’ils ont construit un mur pour qu’il ne soit pas en mesure de voir la mer. Mais dans ces mémoires, il peut sortir de sa cellule et se promener à l’extérieur. Les journaux sont écrits dans le style mièvre du « pauvre de moi! » qui parait saugrenu. Comme Albert Lindemann l’écrit dans Le Juif accusé, « Celui qui lit les mémoires de Dreyfus ou les lettres à sa femme ne peut guère éviter le sentiment de lire un mauvais roman, rempli de mièvreries et d’autosatisfaction. » Oui, il se lit comme un mauvais roman. Une grande partie est du remplissage où il ne fait qu’écrire pour se plaindre de l’attente du courrier. Si Samuel Beckett avait écrit une pièce de théâtre sur les années de Dreyfus en prison, il l’aurait appelée En attendant le courrier [parodiant la pièce, En attendant Godot].
Vous pourriez vous demander comment un officier de l’armée accusé de haute trahison et passé en cour martiale a pu échapper à la peine de mort. Selon Wikipédia, ce fut un tollé général à ce sujet: « Jean Jaurès [homme politique « socialiste »] regrettait la mansuétude de la peine dans une adresse à la Chambre et il écrivit: « Un soldat a été condamné à mort et exécuté pour avoir jeté un bouton au visage de son caporal. Alors pourquoi laisser en vie ce misérable traître ? » Oui, pourquoi en effet? Tout ce que nous avons, c’est un tas de diversions où on l’accuse de crime politique et l’abolition de la peine de mort pour de tels crimes en 1848. Je n’ai pu trouver cette loi de 1848 [exact, l’Assemblée de 1848 écarte la peine de mort en matière politique mais les partisans de l’abolition totale, conduits par Victor Hugo, ne pourront faire triompher leurs vues], ni une source claire à ce sujet. Il y a eu une loi adoptée en 1886 définissant l’espionnage comme un crime politique mais qui interdisait la peine de mort. Il aurait été condamné en vertu de cette loi. Le problème est que le maximum de peine pour espionnage en vertu de cette loi était de 5 ans de prison. Mais Dreyfus a été condamné à la prison à vie en exil. S’ils n’avaient pas été obligés de se conformer à la loi sur l’espionnage, ils auraient pu le condamner à mort, comme ils le faisaient apparemment régulièrement pour des crimes moins graves. Bien entendu, ils ne pouvaient pas le faire disparaître pour de bon à ce moment-là, puisque sa réhabilitation finale faisait partie du plan. Il fallait juste le cacher pendant quelques années. Pas difficile.
Une autre incohérence concerne l’idée que le capitaine du Paty de Clam (chef de l’enquête) « a tenté de suggérer un suicide en plaçant un revolver devant Dreyfus, mais que ce dernier a refusé de mettre fin à sa vie en disant qu’il ‘voulait vivre pour établir son innocence.' » Mais dans ses mémoires, Dreyfus dit qu’après le test de l’écriture, « du Paty se leva, et en posant sa main sur mon épaule, cria d’une voix forte: « Au nom de la loi, je vous arrête; vous êtes accusé du crime de haute trahison. » Parce que c’est apparemment la façon dont les gens parlaient à l’époque. On pourrait penser que si Du Paty avait mis un revolver devant lui en l’encourageant à se suicider, Dreyfus l’aurait mentionné. Rappelez-vous que ce livre a été publié alors que Dreyfus essayait de prouver son innocence, car un nuage de suspicion s’accrochait encore à lui, ayant été reconnu coupable lors de son second procès, mais gracié par le Président. Il ne fut totalement innocenté que quelques années plus tard.
Je vous encourage à prendre un moment pour regarder le court-métrage réalisé par Georges Méliès sur l’affaire Dreyfus, qui est sorti peu après le nouveau procès de Dreyfus à Rennes en 1899. Vous y verrez que le moment dramatique avec le revolver est inclus dans le scénario. Je suppose qu’ils avaient un autre comité de ‘nègres’ pour écrire les mémoires. Une autre société cinématographique de l’époque, Biograph (concurrent de la société de films Edison), a filmé Dreyfus sortant de sa cellule de prison à Rennes pour prendre de l’exercice, mais il remarque « soudain » la caméra et retourne à l’intérieur. On veut nous faire croire que c’est pris sur le vif, mais ce n’est que du théâtre. Dans les années 1890, les caméras étaient énormes, bruyantes et pesaient une demi-tonne. Il n’y avait pas moyen de mettre en place secrètement ou discrètement une caméra comme le font les paparazzi aujourd’hui. Voilà encore une autre indication que Dreyfus jouait une scène. D’ailleurs un film réalisé par la même compagnie, qui montre le célèbre duel entre Émile Zola et Henri Rochefort, est présenté comme la reconstitution d’un événement réel. Mais il est aujourd’hui admis que le duel n’a pas réellement eu lieu, ce qui fournit encore un autre exemple d’une fiction qu’on fait passer pour un fait historique grâce à la magie du cinéma.
Une dernière incohérence (parmi beaucoup d’autres) que je tiens à souligner dans les mémoires de Dreyfus est ce qu’écrit l’éditeur du livre dans la préface : que le bordereau a été trouvé par la femme de chambre dans la poche du manteau de l’attaché militaire allemand (autrement dit le chef du bureau du Renseignement), le comte (et colonel) Maximilien von Schwartzkoppen. On peut aussi trouver cette version des événements dans le film de Méliès dont lien donné plus haut. Mais les récits suivants vont vous dire que le bordereau a été trouvé déchiré dans la corbeille à papier de von Schwartzkoppen. Détail mineur, mais la contradiction est révélatrice. Comme nous l’avons vu dans de nombreux autres cas, cela signe un canular.
La correspondance entre von Schwartzkoppen et l’attaché italien de l’époque, Panizzardi, a été divulguée plus tard et montre que tous deux poursuivaient une relation homosexuelle. Les courriers étaient censés faire partie du « dossier secret » de preuves présenté aux juges, mais pas à l’avocat de la défense (pour des raisons de sécurité nationale, naturellement). Il est maintenant reconnu que la plupart des documents du dossier secret étaient des « faux » ajoutés au dossier après le premier procès de Dreyfus, et on ne sait pas quels documents ont été vus par ces juges. Bien sûr, dire que quelques-uns des documents étaient des faux implique que certains étaient authentiques, mais gardez à l’ esprit que s’ils ont falsifié certains documents, ils ont pu tous les falsifier.
2e partie :
(…) Maintenant, que serait un canular fabriqué sans photos truquées ? Voici quelques photos de la famille Dreyfus :
Les deux premières sont de Getty, la troisième vient de Wikipédia. La première et la troisième photo sont des montages et elles ont été fortement retouchées à la main. La deuxième ressemble à une photographie réelle, bien qu’on puisse facilement dire que Dreyfus et son fils y ont été collés (ils font penser à des découpages en carton et l’éclairage est tout à fait différent). Le fond (bizarre) y a également été collé. Question : Si une photo réelle existe (la numéro 2), alors pourquoi auraient-ils eu besoin de retoucher sur la photo de Wikipédia sa femme et sa fille avec tant d’insistance qu’on les dirait presque dessinées à la main? Voici mon idée: la photo de Wikipédia est datée de 1905. Dans ses mémoires, Dreyfus dit que le jour de son arrestation, son fils Pierre avait 3 ans et demi. C’était en 1894. Sa fille Jeanne est née le 22 février 1893. Elle est donc censée avoir 10 ans sur la photo. Elle n’a pas 10 ans sur la photo Getty (n° 2). Elle ressemble plus à une enfant de 7 ou 8 ans. Peut-être l’ont-ils fortement retouchée sur d’autres photos pour la rendre plus âgée et ainsi la faire coller à la chronologie ?
Voici une photo datée de 1900 lors d’une réunion de famille dans la propriété de la sœur de Dreyfus à Carpentras. (Dreyfus venait d’une famille fortunée d’industriels du textile, bien sûr, et il épousa la fille d’un riche marchand de diamants :

Le gars du milieu semble ajouté à en juger par la ligne blanche autour de lui. La femme de Dreyfus et son fils sont un peu plus flous que le reste, mais c’est peut-être parce qu’ils ont bougé pendant la prise. Mais c’est un peu bizarre de faire une réunion de famille en l’honneur d’Alfred sans le pauvre Alfred, ne pensez-vous pas ? Voici une « réunion de famille » où Dreyfus a été rajouté, ainsi que beaucoup d’autres choses étranges :

Il semble tout à fait réjoui d’être de retour dans sa famille, non ? Il est difficile de savoir par où commencer avec cette photo-ci. La première chose qui saute aux yeux, c’est le gros pâté de peinture (?) blanche sur son visage, qui recouvre même une partie de sa moustache. Je suppose qu’ils ont essayé d’éclaircir son visage. Regardez aussi les ombres sous son menton. Elles sont juste un peu plus sombres que les ombres sous le menton des autres. Sa tête semble collée à son corps. La mise au point n’est pas non plus la même que celle des autres, ce qui est difficile à remarquer sans faire de zoom. Et remarquez comme sa tête est petite et mince. Ils lui ont écrasé le visage. Peut-être pour faire penser qu’il était en train de mourir de faim sur une petite île d’Amérique du Sud. Ou pour faire correspondre la tête ajoutée au corps. Je ne sais pas. Son chapeau semble ajouté aussi, et on peut se demander pourquoi il ne projette pas une ombre beaucoup plus grande sur son visage, car la lumière vient d’en haut. Et c’est quoi ce chapeau ridicule ? Serait-ce un souvenir ramené de l’île du Diable? Pourquoi ne pas le montrer avec un sombrero, une sarape [cape mexicaine] et quelques maracas pendant qu’on y est ?
Mais Dreyfus n’est pas la seule chose bizarre dans cette photo : regardez par exemple son beau-frère à droite, qui semble avoir été collé devant la personne dont il cache la vue (ou bien ils ont embauché un très mauvais photographe). Son visage est de plusieurs tons plus sombre celui des autres, et celui de la fille d’Alfred à ses côtés est un poil plus sombre que celui des autres, mais quand même plus clair que le sien. Et remarquez la mystérieuse femme qui a passé son bras autour de Pierre, le fils d’Alfred. Soit son bras est très court soit elle l’a passé d’une manière non naturelle et inconfortable. En fait, plus je regarde cette photo, plus je me demande s’il existe un seul élément qui ne soit pas du collage.
Une autre chose bizarre sur la première photo de famille, c’est l’homme debout au milieu à l’arrière, étiqueté comme Mathieu Dreyfus, le frère aîné d’Alfred. Mais voici une autre photo d’Alfred et de Mathieu ensemble, datée de fin 1899-début 1900, donnée comme au même endroit que sur les photos du regroupement familial. C’est l’une des rares photos de Dreyfus que j’ai pu trouver qui m’apparaisse non retouchée.

Mathieu est à gauche. Il a l’air beaucoup plus vieux que dans la photo ci-dessus, d’accord ? Ce qui est logique puisqu’il est le frère aîné d’Alfred. Notez également qu’Alfred semble un peu plus « gros » sur cette photo. Voici une autre photo d’Alfred lors de cette même « réunion »:

Un autre collage manifeste (photomontage). Il suffit de zoomer et de regarder la zone au-dessus de sa tête. Ils ne se sont vraiment pas foulés. Toute cette drôle d’histoire de photo est tout simplement déconcertante. Si Dreyfus était une vraie personne avec une vraie famille, quel besoin de tous ces collages et retouches ? Dreyfus n’était-il qu’un personnage inventé qu’on a inséré dans ce drame? Quelle part de sa vie est-elle réelle et quelle part est-elle une fiction? Nous ne le saurons peut-être jamais. Et qu’en est-il des autres comédiens ?
FERDINAND WALSIN-ESTERHAZY
Sa tête de profil est assez plate et se rétrécit vers le nez en grand bec de vautour. Sa moustache est épaisse et effilée à ses extrémités. Ses yeux sont ronds et protubérants : non naturels, ceux d’un fou, comme des billes de verre enfoncées dans le crâne d’un squelette d’une école de médecine.
Robert Harris, Officier et espion
Esterhazy est l’un des personnages les plus colorés de ce ridicule mélodrame. Un ignoble méchant qui a le don du spectaculaire. Ce n’est pas pour rien que Joseph Reinach, le premier « historien » de l’affaire (qui y joue un rôle-clé), a écrit que « la frénésie communicative de cet étonnant cabotin exerçait une fascination sans fin. » Un cabotin, en effet. Eszterhazy est le gars qu’on a finalement dénoncé comme l’auteur du bordereau.Autrement dit, c’est lui le supposé véritable traître qui a échappé aux soupçons au départ pendant qu’on condamnait Dreyfus pour un crime qu’il n’avait pas commis. Grâce à une série de coïncidences fortuites et à l’admirable courage de l’honorable nouveau chef de la Section Statistique, le colonel Piquart, Esterhazy fut finalement soupçonné.
On nous dit qu’Esterhazy a exigé d’être entendu en cour martiale pour prouver son innocence. Est-ce ainsi que les choses fonctionnent ? Je ne savais pas qu’un passage en cour martiale se faisait à la demande. « Le passage en cour martiale d’Esterhazy fut précédé d’un dédale d’intrigues qui évoquait pour moitié un roman de Gaboriau et pour moitié un opéra burlesque » (extrait de La tragédie de Dreyfus). Plutôt que de se laisser entraîner dans les tenants et aboutissants de ces multiples diversions, examinons plutôt quelques petites choses que nous ne sommes pas invités à remarquer concernant Walsin-Esterhazy.
Tout d’abord, son nom de famille: Esterhazy. Les Esterhazy étaient une famille de la noblesse incroyablement riche, originaire d’Autriche et de Hongrie. Esterhazy était-il lui-même juif ? On dit que la lignée Esterhazy descend du clan du roi Salomon de Hongrie qui n’aurait pas eu d’héritiers et aurait été détrôné par son oncle et ses neveux. Il épousa Judith. Le roi Salomon et la reine Judith pourraient-ils paraître plus juifs si vous les appeliez Shlomo et Yehudit ? Quel est le lien précis de ce roi avec les Esterhazy, je n’ai pas pu le découvrir. On dit qu’ils tirent leur origine du roi Salomon de Hongrie au 11ème siècle, mais la généalogie que j’ai pu trouver ne remonte qu’au 13ème siècle, avec le nom de famille Salomon. Ce nom s’éteint au 15 e siècle avec Miklos Salamon de Salamon-Watha, dont les enfants (pour des raisons inconnues) prennent un nom de famille différent. Son fils, Balazs Szerhas des Szerhashaz est à l’origine du nom Esterhazy. Les Esterhazy sont également connus pour s’être montrés très bons envers les Juifs, et beaucoup de Juifs vinrent s’installer sur leurs terres, même durant les périodes où on les expulsait d’autres régions. La ville d’Eisenstadt, où ils avaient un palais, est aussi un nom de famille juif courant.
Ferdinand Walsin-Esterhazy était le fils du général Louis Joseph Ferdinand Walsin-Esterhazy, à son tour fils de Joseph Marie Auguste Walsin-Esterhazy de Ginestous, fils bâtard de Marie Anne Esterhazy de Galántha et de Jean André César de Ginestous. Ce couple n’a pas été marié et on nous dit que leur bâtard fut officiellement adopté par le Dr Walsin, médecin français de la famille royale austro-hongroise (selon la page Wikipédia en français sur notre Ferdinand). L’arrière-grand-mère de Ferdinand, qui était extrêmement riche, s’appelait Marie-Anne Esterhazy, elle était l’arrière-arrière-petite-fille de Nikolaus Esterhazy (1583-1645), et c’est à cette période que la famille Esterhazy acquit sa notoriété. Du côté maternel, son grand-père était Isaac de Lautal de Roquan, mais aucun des autres membres de la famille n’a de nom typiquement juif.
Ce n’était pas seulement la famille Esterhazy qui était amie des Juifs. Ferdinand l’était personnellement :
« … concernant l’histoire d’Esterhazy, cette canaille shakespearienne, comme l’appelait William James, elle fournit une matière intéressante sans fin. Par exemple… si, dans les années précédant l’affaire Dreyfus vous étiez un officier juif dans l’armée qui avait été insulté dans la presse par un professionnel anti-sémite, disons Drumont, la chose à faire était de défier votre insulteur en duel. Ah, mais c’était difficile. Il fallait trouver quelqu’un pour vous assister pendant le duel – pas si facile, et de préférence un non-Juif prêt à se porter garant de votre honneur. Eh bien, il s’est avéré qu’il y avait un homme qui y concédait; on pouvait l’embaucher pour servir d’assistant aux officiers juifs dont l’honneur avait été mis en doute dans la presse, remis en question dans la presse, bafoué dans la presse. Ce gars-là, cet homme qui concédait à aider les officiers juifs pour la défense de leur honneur, n’était nul autre qu’Esterhazy, le futur méchant de l’affaire. Et, par ailleurs, l’homme qui vous mettait en contact avec Esterhazy, si vous étiez juif – car comment le trouver ? – eh bien c’était Zadoc Kahn, le Grand Rabbin de Paris, qui disait ‘je peux vous mettre en contact avec l’homme qui vous aidera dans cette situation embarrassante’. On peut donc penser que dès, dirons-nous, 1890, si vous étiez un officier juif dont l’honneur avait été bafoué, l’homme qui vous aiderait à défendre votre honneur serait Esterhazy, le futur méchant de l’affaire. »
Selon Wikipédia, « Par l’intermédiaire de Zadoc Kahn, le grand Rabbin de France, Esterhazy obtint une aide des Rothschild (juin 1894). À la même époque, il était en bons termes avec les rédacteurs du journal antisémite, La Libre Parole, auquel il fournissait des informations. » Donc, n’était-il qu’un opportuniste jouant su rles deux tableaux ? Ou était-ce l’indication d’un lien entre Drumont et les Rothschild ? Esterhazy, d’un autre côté, n’avait pas besoin de Zadoc Kahn : il était en bons termes avec les Rothschild, ayant fréquenté Edmond au lycée (D’après Le retour des Rothschild, pp 116-17.) :
« En 1892, suite à une campagne de La Libre Parole contre les juifs de l’armée, Édouard Drumont fut défié par l’un d’entre eux, le capitaine Ernest Crémieu-Foa. Esterhazy accepta d’assister le capitaine juif… et ce dépensier d’Esterhazy se débrouilla pour s’attirer les bonnes grâces de Drumont ainsi que celles des Rothschild. En Juin 1894 – quatre mois avant le message secret à l’ambassade allemande – Esterhazy écrivit à Alphonse de Rothschild et à son plus jeune frère, Edmond (qui avait été son camarade de classe au lycée). Il avait un besoin désespéré de fonds, disait-il; comme on le considérait comme un ami des Juifs, ses beaux-parents refusaient de l’aider, et il ne pouvait plus s’occuper de sa femme souffrante et de ses petites filles… Les Rothschild décidèrent d’aider cet homme impossible – parce qu’il semblait être l’ami du capitaine Crémieu-Foa, et qu’il avait bien sûr été un camarade de classe d’Edmond (qui l’avait dépanné plus d’une fois)… Peu après avoir écrit aux Rothschild, le commandant Esterhazy rendit sa première visite à l’attaché militaire allemand à Paris. Pour empêcher sa femme et ses enfants de mourir de faim, disait-il, il souhaitait vendre des secrets militaires aux Allemands. »
On nous dit qu’Esterhazy a vendu des secrets aux Allemands parce qu’il avait besoin d’argent. Je n’en suis pas convaincu. Nous avons vu qu’il descendait d’une noblesse fortunée et que son père était général. Sa sœur et lui avaient reçu une généreuse pension du gouvernement après la mort de leur père. On nous dit qu’il était joueur et dépensier pour rendre l’histoire plausible. Mais nous les avons vu maintes fois faire croire que les riches étaient fauchés, et nous pouvons être sûrs que les problèmes d’argent d’Esterhazy étaient du faux-semblant. En effet, Wikipédia nous dit qu’après le procès, « L’armée déclara le commandant Esterhazy inapte au service. Pour éviter des risques personnels, il s’exila en Angleterre, où il vécut confortablement et termina ses jours dans les années 1920. Esterhazy bénéficia d’un traitement spécial de la part des échelons supérieurs de l’armée, ce qui était inexplicable sauf si l’état-major désirait étouffer toute velléité de contester le verdict de la cour martiale qui avait condamné le capitaine Dreyfus en 1894. »
Serait-ce la seule explication? Essayez celle-ci pour voir : ce fils de général, agent du Renseignement, descendant de la royauté et condisciple de Rothschild a été protégé toute sa vie et récompensé pour son rôle dans l’affaire Dreyfus. S’il avait été un joueur invétéré et dépensier au point de devoir vendre des secrets d’état pour nourrir sa famille, comment a-t-il fait pour finir confortablement ses jours en Angleterre ? Et si les Rothschild ont décidé de l’aider, pourquoi s’est-il dépêché de vendre les secrets qu’il avait écrits, à moins qu’il n’ait agi sur ordre? Comme d’ habitude, l’histoire se contredit sur la même page et ces contradictions sont ignorées par la suite.
Une dernière chose qui m’a fait tiquer dans l’histoire d’Esterhazy et qui vaut le coup d’être explorée, à partir de sa page Wikipédia :
« L’historien français Jean Doise adhérait à l’hypothèse révisionniste selon laquelle Esterhazy aurait pu être un agent double français se faisant passer pour un traître afin de transmettre de fausses informations à l’armée allemande. Doise n’a pas été le premier auteur à explorer l’hypothèse d’un Esterhazy agent double: des écrits plus anciens de Michel de Lombarès et d’Henri Giscard d’Estaing, bien que différents dans les détails, présentaient également cette argumentation. »
Esterhazy ayant lui-même avoué plus tard dans un journal britannique qu’il était bel et bien l’auteur du bordereau et l’avait fait passer aux Allemands en tant que désinformation, c’est une hypothèse à peine surprenante. Le problème, si cela est vrai, est que cela étale toute l’affaire au grand jour. Et il y a une très bonne raison de croire que ce soit vrai, en dehors de la confession d’Esterhazy. L’auteur du bordereau laisse entendre qu’il divulgue des informations sur des canons de 120 long en France [« frein hydraulique de 120 »], même si à cette époque les canons de 120 avaient été soit abandonnés (selon wiki) ou supprimés progressivement en faveur du nouveau canon de 75 à tir rapide :
« Doise faisait valoir qu’Esterhazy était un agent double déguisé en traître, chargé d’infiltrer de la désinformation. Il a diffusé des « secrets » sur le canon de 120 technologiquement obsolète, que l’armée française était sur le point de remplacer. Vendre les secrets d’un canon révolu et piéger Dreyfus pour faire paraître importante cette information était une ruse conçue pour empêcher les Allemands de découvrir le vrai secret militaire de la France, la conception d’un nouveau canon de campagne de 75 à tir rapide. Le 75 était techniquement en avance sur son temps. Les Allemands et les Américains ne produisirent des canons aux performances équivalentes que 20 ans plus tard, à la veille de la Première Guerre mondiale. En 1918, l’armée américaine s’est en fait simplement accaparé le 75 et a commencé à en construire sous licence américaine. Doise argumentait que le bordereau d’Esterhazy n’était que l’un des nombreux stratagèmes destinés à garder les Allemands dans l’obscurité. Dreyfus a été sacrifié pour raisons d’état ou, comme on dit aujourd’hui, pour la sécurité nationale. »
Stop ! Pas si vite. Voyez-vous le problème ici? Cette histoire que Doise colporte serait qu’ils voulaient dénoncer le traître pour faire paraître crédibles les informations qu’il offrait aux Allemands sur le canon de 120 et ainsi les mener sur une fausse piste. Mais Esterhazy a pris ses ordres du lieutenant-colonel Sandherr, le même gars qui a nommé du Paty de Clam responsable de l’enquête. Pourquoi devoir monter une enquête juste pour piéger quelqu’un? Et doit-on croire que Sandherr a vraiment sacrifié Dreyfus, l’a traité sans ménagement, et l’a envoyé en exil à l’Ile du Diable, le tout pour les besoins de cette ruse? N’aurait-il pas été plus logique de faire comme s’il était passé en cour martiale, exilé, etc.? Plus encore, rappelons que le nouveau chef du contre-espionnage, le lieutenant-colonel Picquart, aurait risqué sa carrière et son honneur pour aider à rétablir le nom de Dreyfus (son ancien élève à Saint-Cyr) et faire comparaitre Esterhazy en justice.
Sommes-nous censés croire que le nouveau chef du contre-espionnage n’était pas au courant du plan de désinformation? Sinon, pourquoi avoir fait tout cela? Ce qui contredit aussi l’histoire de la vente de la lettre pour de l’argent. Rien de tout cela n’a de sens, comme d’habitude, noyé dans les rumeurs et les diversions avec des détails contradictoires pour nous faire inlassablement tourner en rond en essayant de comprendre ce qui a bien pu se passer. L’ensemble sent le canular fabriqué à plein nez. Toutes ces théories alternatives du complot ne servent qu’à envoyer sur de fausses pistes, comme avec JFK [traduit sur le BBB]. Je les compare aux tactiques militaires des leurres et des brouillages. Notre travail consiste à accéder à la vérité derrière les leurres. La question alors est : pourquoi ont-ils fabriqué ce canular? J’y viendrai plus loin.
Pour finir, vous avez sans doute remarqué sur les photos le numéro 74 sur le képi d’Esterhazy. C’est censé être le numéro de son régiment. Mais ce que vous n’apprendrez sûrement pas en lisant les récits sur l’affaire Dreyfus est qu’Esterhazy avait auparavant travaillé à la Section Statistique. En d’autres termes, il faisait aussi partie du Renseignement. (extrait du livre, Le retour des Rothschild.) En fait, si vous lisez sa biographie, il pue l’agent secret.
EMILE ZOLA
Débrouiller le cas Zola vient naturellement après celui d’Esterhazy, parce que Zola a écrit sa fameuse lettre ouverte au président Félix Faure [publiée sur le journal L’Aurore, le 13 janvier 1898], « J’accuse! » pour tenter de disculper Esterhazy. Cet essai, qui se révéla un tournant dans l’affaire, fut publié dans le journal où son ami Georges Clemenceau, qui devint plus tard ministre de l’Intérieur et président du conseil, y compris pendant la Première Guerre mondiale, y était rédacteur. Clemenceau, sortait bien sûr d’un milieu fortuné et il était très courant à l’époque d’avoir de riches hommes politiques rédacteurs de journaux. (Rappelez-vous ce que disait Edward Bernays : « La propagande est le bras exécutif du gouvernement invisible ») Clemenceau était le chef du Parti radical, mais c’était bien sûr une étiquette pratique sans réelle signification – il s’est retourné contre les travailleurs qui se révoltaient pendant la Commune de Paris et il fut impliqué plus tard dans le scandale de Panama. Si Clemenceau n’était pas juif, il était certainement allié aux projets que l’élite juive gérait en France au 19ème siècle, affaire Dreyfus comprise.
Mais je m’attarde sur Zola surtout pour ce qu’il représente. Le style d’écriture de Zola, surnommé « naturalisme », était une sorte de précurseur du modernisme, qu’on pourrait commenter comme le triomphe de la « théorie » sur l’esthétique. La lutte pour l’âme de l’art et l’importance de la création a débuté bien avant le 20ème siècle. (La controverse sur la construction concomitante de la Tour Eiffel et de son antithèse, le Sacré-Cœur, est l’archétype même de cette lutte.) Même si Zola était célèbre, son œuvre ne fut pas très bien reçue à l’époque. Son succès est dû en grande partie à du battage et son engagement envers les dreyfusards triomphants lui valut une reconnaissance bien supérieure à celle qu’il aurait obtenu grâce à sa seule littérature. Extraits de Le Juif Accusé (Albert Lindemann, 1992, page 114):
« Zola était l’écrivain le plus célèbre de France à cette époque. Il était plus qu’un écrivain de romans populaires; il était aussi devenu un personnage public, un symbole. Pour la droite catholique française, Zola personnifiait le courant moderniste qui offensa tellement les sensibilités religieuses traditionnelles. Ses très lucratifs romans à succès furent jugés sensationnalistes, de mauvais goût et même obscènes, certainement inférieurs moralement parlant aux œuvres de Drumont. En bref, c’était pour les traditionalistes de France des produits typiques de la culture laïque avilie qui avait grandi sous la République, la « gueuse ». On apprenait aux enfants des familles conservatrices à appeler leurs pots de chambre des Zolas. »
Compte-tenu de sa réputation et de la qualité de son écriture et sa défense de Dreyfus, il semble alors un peu étrange que:
« Comme beaucoup d’intellectuels français, de droite et de gauche, Zola s’alarma pour la rapide ascension des Juifs en France, non seulement dans le domaine économique, mais encore plus dans la vie culturelle. Son principal souci en rédigeant J’accuse! n’était pas d’exprimer sa sympathie pour les Juifs ou même de les défendre en justice; c’était plutôt pour contrer ceux qu’il croyait réactionnaires, jésuites et conspirationnistes militaristes, au sujet desquels il nourrissait des fantasmes qui ressemblaient étonnamment à ceux que nourrissait Drumont à l’égard du Syndicat juif. Tout comme pour beaucoup de français, il leur suffisait d’apprendre que Zola soutenait Dreyfus pour qu’ils décident de se joindre aux antidreyfusards, ainsi en était-il pour Zola: il n’avait qu’à voir qui étaient les ennemis de Dreyfus afin de lui venir en aide. » (Ibid. p. 116)
Bien sûr, l’ennemi de mon ennemi est mon ami. Donc, si les ennemis de Zola étaient les ennemis des riches juifs français, alors implicitement Zola était leur ami. Je n’ai franchement pas l’énergie ni la patience de retracer sa généalogie ou ses réseaux d’amis, mais Zola semble carrément de leur côté, travaillant à miner l’influence de l’église catholique et de l’aristocratie traditionnelle, ainsi que certains éléments récalcitrants de l’armée, sous la bannière de la République. C’est ce que visait en partie l’affaire Dreyfus. Mais à cette époque on blâmait, la plupart du temps à juste titre, les riches industriels et marchands juifs, de nuire aux artisans traditionnels et aux commerçants locaux (la petite bourgeoisie) avec des articles produits en masse vendus moins cher dans de plus grands magasins. Leur origine juive pouvait être accessoire par rapport à leurs pratiques commerciales, mais le fait qu’ils étaient juifs a certainement contribué à ce que la société française traditionnelle et l’aristocratie aient le sentiment d’être assiégés.
Si vous voulez des preuves d’une connexion de Zola au Renseignement, ne cherchez pas plus loin que son procès. Son « J’accuse » a incriminé et mis en cause des dirigeants politiques français au pouvoir par une fabrication délibérée de documents pour piéger Dreyfus et une opération de dissimulation pour cacher leurs actions. Il a été jugé pour diffamation. Wikipédia nous dit qu’il « a été condamné le 23 février et qu’on lui a retiré sa Légion d’Honneur. Plutôt que d’aller en prison, Zola s’est enfui en Angleterre. Sans même avoir eu le temps d’emballer quelques vêtements, il a débarqué à la gare Victoria le 19 Juillet. Après son bref et malheureux séjour à Londres (à Upper Norwood) d’octobre 1898 à juin 1899, il fut autorisé à rentrer en France, à temps pour assister à la chute du gouvernement. » C’est quoi ce truc ? Les accusés reconnus coupables ne sont-ils pas immédiatement mis en prison à la sortie du tribunal? Comment Zola a-t-il été en mesure d’y échapper? On ne nous le dit pas. Mais il n’y a pas de faute de frappe sur Wikipédia : selon l’histoire officielle , il a déambulé dans Paris pendant cinq mois avant de « fuir » à Londres » sans même avoir le temps d’emballer quelques vêtements. » Que faisait la police française pendant tout ce temps ? Pourquoi n’a-t-il pas été mis en prison? Ont-ils mis l’inspecteur Clouseau [celui de la Panthère rose] sur l’affaire ? Il serait revenu en France « après que Dreyfus ait été gracié », le 19 septembre 1899. Mais c’est Dreyfus qui a été gracié, pas Zola. Sa condamnation restait toujours d’actualité, qu’un nouveau gouvernement soit ou non élu. Nous avons vu dans de nombreux articles de Miles que le seul genre de personne qui peut se promener librement après avoir été reconnu coupable, « fuir » les autorités et pouvoir revenir en France comme un fugitif vis à vis de la justice et continuer à vivre comme si de rien n’était, est un agent du Renseignement.
En 1899, Émile Zola écrivit un article de journal intitulé « Le cinquième acte »: « Quelqu’un a-t-il remarqué que cette affaire Dreyfus, ce drame gigantesque qui a passionné l’univers, semble avoir été mis en scène par un sublime dramaturge, déterminé à en faire un chef-d’œuvre incomparable? » C’est vrai, Émile, personne n’a remarqué. Pas même quand vous le leur avez dit en face. Mais savez-vous ? La réalité est plus étrange que la fiction. C’est ce qu’on dit. Je suppose que répandre ce mensonge les a aidé à faire passer ces histoires absurdes comme réelles. Si vous vous demandez qui fut le scénariste derrière cette magistrale opération psychologique, je pense que nous avons trouvé notre homme. Ou au moins l’un d’entre eux. L’image du toujours honorable Dreyfus condamné dans une prison sur une île, puis ramené et rédimé, semble avoir emprunté des éléments du Cyrano de Bergerac et du Comte de Monte-Cristo, entre autres. En d’autres termes, si le drame Dreyfus semble avoir largement emprunté des éléments et des thèmes de la littérature française de l’époque, c’est parce que ce fut le cas.
Le procès de Zola se révéla un tournant dans l’affaire, car il s’est marqué d’une forte augmentation du sentiment anti-sémite et a déclenché une vague d’émeutes anti-juive dans toute la France. Je me contenterai ici de citer trois passages du Juif Accusé pour vous donner une idée de l’ambiance à l’époque.
« Mais il semble assez clair que l’objectif de Zola n’était pas d’obtenir gain de cause au tribunal. C’était plutôt de ranimer les arguments contre l’armée, et dans ce but, il y a très certainement réussi, bien au-delà de ce qu’il espérait. Ce faisant, il a persuadé nombre de ceux qui affichaient jusque-là une neutralité que les dreyfusards étaient de dangereux destructeurs et des calomniateurs irresponsables, ne cherchant que des bénéfices politiques en attaquant des militaires de premier plan et en dénigrant l’armée, sans imaginer une seule seconde qu’ils pouvaient mettre la nation en péril. » (P.115)
« Les accusations contre Zola puis son procès, où il fut reconnu coupable de diffamation, suscitèrent l’intérêt de milliers de gens, jusque-là indifférents, pour l’Affaire. Des émeutes anti-juives se répandirent dans 70 villes de France; la foule criait ‘Mort aux Juifs’ et attaquait des synagogues, des magasins juifs, et des juifs dans la rue. La police semblait souvent inefficace, manifestant peut-être même de la sympathie pour les émeutiers. » (P.116)
« Au cours des semaines et des mois suivants des boycotts anti-juifs furent organisés, et les ligues antisémites reprirent vie, gagnant un suivi sans précédent. Les dirigeants juifs convaincus qu’une publicité sensationnelle pourrait être dangereuse, en eurent une douloureuse confirmation. Facilement excitable, la France semblait être au bord d’un soulèvement populaire total contre les Juifs. En bref, Zola a non seulement réussi à ranimer la campagne pour la libération de Dreyfus, mais il a même relancé avec force le mouvement antisémite qui avait précédemment échoué à la fin des années 1880 et au début des années 1890. « (P.116)
3e partie :
ÉDOUARD-ADOLPHE DRUMONT
La dernière figure importante que nous allons étudier en profondeur est Édouard-Adolphe Drumont, appelé parfois « le pape de l’ antisémitisme. » Drumont s’occupait d’un journal nommé La Libre Parole. Selon Wikipédia, « avec l’émergence de l’affaire Dreyfus, La Libre Parole connut un vif succès, devenant l’organe principal de l’antisémitisme parisien. » Drumont avait également écrit un livre antisémite virulent, publié en 1886, intitulé La France juive. L’ouvrage de 1200 pages en deux volumes aurait été imprimé à plus de 100.000 exemplaires la première année, avec un million d’exemplaires vendus en 25 ans. Nous savons bien sûr que ces chiffres ont pu être inventés, et nous pouvons spéculer qu’ils l’ont été, en partie pour affermir le profil de Drumont et renforcer son importance.
Dans Le Juif Accusé, Lindemann décrit le livre de Drumont comme:
« … de l’antisémitisme à coups de copié-collés, assemblés avec un mépris presque comique pour la cohérence et la pertinence. La France Juive était un ouvrage en deux volumes, qui regorgeait de marques d’érudition, mais Drumont était tout sauf un vrai érudit, et on ne pouvait comparer ses gribouillages avec ceux de Toussenel (auquel il a fait d’amples emprunts) ou d’autres écrivains plus talentueux et respectables comme Barrès et Wagner. Les ouvrages de Drumont étaient un ramassis mal digéré, naïf et sans originalité de journaliste.
Une seule considération semblait l’intéresser : introduire tout le négatif possible au sujet des Juifs, tout et n’importe quoi, le plus scandaleux possible, même si un énoncé contredisait totalement le suivant. Des compte-rendus d’assassinats rituels du Moyen- Âge voisinaient avec des études factuelles (tout aussi naïves) sur le pouvoir politique et économique juif. Drumont empruntait au moderne et à l’ancien, à la droite et à la gauche, au catholique et au laïque, du relativement sérieux et factuel ou du risible et de l’absurde, un pot-pourri d’anecdotes, de légendes, de rumeurs et de grasses plaisanteries antisémites. »
Il serait tout à fait remarquable, alors, de découvrir que Drumont – le pape de l’antisémitisme, était juif ou collaborait avec les Juifs. S’il l’était, cela semble une indication claire qu’il jouait son rôle dans cette opération psychologique et que son supposé antisémitisme faisait partie de l’arnaque – placé là comme le gars qui tombe à pic pour discréditer la critique sur l’influence juive en France. Comme on va le voir, beaucoup d’éléments indiquent que Drumont était juif. Pour commencer, nous avons cet article sur lui dans l’Encyclopédie juive :
« Auteur antisémite français et ancien député d’Algérie; né à Paris le 3 mai 1844. Les ascendants de Drumont ne sont pas juifs, comme on l’a parfois affirmé… En 1886, Drumont se retire de l’équipe de « La Liberté » (appartenant à Péreire, un Juif), affirmant que les journaux étaient indûment contrôlés par des Juifs. Il publia ensuite son célèbre ouvrage en deux volumes, » La France juive », livre qu’on peut considérer comme le début du mouvement antisémite en France. »
En lisant ceci la première fois, j’ai pensé, « n’est-ce pas un peu étrange que sa biographie débute en déclarant qu’il n’est pas juif ? » Sentez-vous quand on cherche à vous égarer ? L’une des raisons qui m’a semblé étrange de démarrer une bio par un tel démenti est de n’avoir vu personne affirmer ou même insinuer que Drumont pourrait être juif dans tout ce que j’ai lu. J’ai donc fait une recherche Google sur ‘Édouard Drumont juif’ et ‘Drumont est-il juif » et autres permutations. Mais comme il est le pape de l’antisémitisme, ces recherches dans l’encyclopédie ne mènent nulle part quant à savoir s’il est juif. Et puis j’ai réalisé quelque chose: L’Encyclopédie juive est la copie intégrale en ligne non modifiée d’une encyclopédie publiée en 1906. Cela signifie qu’à l’époque, beaucoup plus proche de l’événement, les gens affirmaient que Drumont était juif – au point qu’ils ont estimé important de le nier dans sa bio. Intéressant. Maintenant, pourquoi auraient -ils affirmé une telle chose ?
Eh bien, cela pourrait correspondre au fait, également mentionné dans l’article de l’Encyclopédie, qu’avant de publier ce livre furieusement antisémite, il a travaillé pour un journal dirigé par les frères Péreire, de riches financiers juifs qu’on disait rivaux des Rothschild (même si les frères avaient déjà investi dans l’une des compagnies ferroviaires des Rothschild, suggérant que leur rivalité a pu être exagérée). En 1875, Drumont fit l’éloge funèbre de Jacob Péreire, qu’il comparait (en positif) à Napoléon. Il fit en 1880 un très flatteur éloge funèbre pour le frère de Jacob, Isaac. Selon l’article de l’encyclopédie (et ailleurs), nous devons croire qu’il a quitté son emploi au journal en 1886 après avoir (soudain) réalisé que les journaux étaient par trop contrôlés par des Juifs. Mais voici autre chose : même si le livre n’a été publié qu’en 1886, on dit que Drumont à commencé à y travailler dès 1880. Il l’aurait fait grâce aux encouragements d’un prêtre jésuite, le Père Stanislas Du Lac, qu’il avait rencontré en 1879. Ce prêtre a également financé son journal, qui fut lancé le 20 avril 1892. Cette page de généalogie dit que du Lac l’a « converti » au catholicisme. Il est dit la même chose sur la page Wikipédia en français pour Drumont et ailleurs aussi. Mais ils ne disent pas de quelle religion il s’est converti. Dans certains endroits, comme sur sa page wiki en roumain , il se serait « re-)converti » au catholicisme. C’est une façon bizarre de l’exprimer, n’est-ce pas ? Avez-vous déjà entendu dire que quelqu’un s’était converti à sa propre religion?
Ils voudraient donc nous faire croire que Drumont a fait l’éloge d’Isaac Péreire l’année même où il a commencé à travailler sur son chef-d’œuvre antisémite et qu’il est tombé un an après sous l’influence de Du Lac. D’accord.
Quelques mots sur Du Lac. C’était un noble français, recteur de l’école Sainte-Geneviève et prêtre jésuite, qui a fait son noviciat dans l’ordre jésuite d’Issenheim en Alsace. Je mentionne l’endroit, car c’est à seulement 20 km environ de Mulhouse, la ville natale de Dreyfus. Tout à fait une coïncidence. Rappelons que dans l’article de Miles sur Napoléon, il cite le personnage d’un roman de Disraëli disant que les premiers jésuites étaient juifs. Et si vous recherchez sur le web, vous trouverez de nombreuses références à Loyola comme étant un marrane, c’est à dire un Juif contraint de se convertir mais qui conserve la foi juive en secret. Autrement dit, un crypto-Juif.
Vous rappelez-vous plus haut l’entrée de l’Encyclopédie juive où il est dit que Drumont a étudié au Lycée? Mais on ne dit pas lequel. Bon, devinez quoi ? Il est allé au Lycée Condorcet, celui qu’ont fréquenté Esterhazy et Edmond de Rothschild. Selon la page Wikipédia sur Condorcet, les anciens notables élèves incluent (avec Drumont, né en 1844), Jacob (Jacques) de Reinach (né en 1840) et ses 3 fils, Ferdinand Walsin-Esterhazy, ainsi que deux Rothschild. Comme Drumont est né en 1844 et Edmond de Rothschild en 1845, on peut supposer qu’ils se sont fréquentés, mais ils ont pu ne pas avoir été condisciples. La page web du Lycée Condorcet nous dit : « En acceptant depuis le milieu du XIXe siècle un grand nombre d’étudiants protestants et juifs, l’école a joué un rôle de premier plan dans l’émergence du ‘franco-judaïsme’ [et] dans la création du réseau Dreyfus. »
La plupart des sources affirment qu’il a abandonné ses études à 17 ans quand il a « perdu son père », comme le dit Wikipédia. Ce qui aurait eu lieu en 1861. Son père n’est pas mort en 1861, mais placé à l’hôpital psychiatrique de Charenton pour « dépression mélancolique », nous dit-on. Drumont aurait été forcé de se débrouiller par lui-même dès ce moment-là. Il serait devenu vagabond, dormant dans des abris et vivant dans les bas quartiers. De toute évidence, rien de tout cela n’a empêché ses grandes réalisations et au cours des années 1870, il s’est mis à fréquenter des cercles littéraires parisiens réputés et comptait Victor Hugo et Émile Zola comme amis, parmi autres. On peut supposer que son histoire est encore un autre mythe de l’homme parti de rien.
En dernière indication d’un Drumont juif, nous avons ceci, à la page 85 du Juif Accusé :
« Le plus surprenant admirateur de Drumont peut-être, était Théodore Herzl, qui était le correspondant à Paris de la Neue Freie Presse [Nouvelle Presse Libre] de Vienne au début des années 1890. Il écrivit dans son journal : ‘Je dois beaucoup à Drumont pour ma liberté actuelle de création, parce que c’est un artiste.’ L’admiration était réciproque: quand le Judenstaat (« l’État juif », sa description d’un état national futur pour les Juifs) de Herzl parut en 1896, il reçut ce que Herzl décrit lui-même comme une « critique très flatteuse » dans l’article publié par Drumont. Herzl fut auparavant l’invité régulier du salon littéraire d’Alphonse Daudet, un autre intellectuel qui attirait les Juifs – celui qui acceptait Herzl, ainsi que Marcel Proust [juif par sa mère], comme étant un Juif « exceptionnel » charmant – chez qui il rencontra Drumont. »
Oui, Théodore Herzl admirait le pape de l’antisémitisme. Et le sentiment était réciproque.Où trouver une once de bon sens ici ? On va nous démontrer que Drumont n’était là que pour l’argent et la publicité. Mais ça ne colle pas avec l’histoire de sa conversion et l’influence que du Lac a eu sur lui. Ce serait pourtant logique, si Herzl et Drumont travaillaient pour la même équipe. Et Herzl nous procure une bonne transition pour parler de ce qui suit :
QUEL ÉTAIT LE BUT DE L’AFFAIRE DREYFUS ?
Pour autant que je sache, l’affaire Dreyfus avait plusieurs objectifs. On peut lire la plupart d’entre eux dans l’entrée Wikipédia sur l’affaire Dreyfus, sous les conséquences de l’affaire. Mais alors que les historiens décrivent ces conséquences comme non voulues et accidentelles, le fait que l’affaire était un canular fabriqué indique qu’il l’a été pour atteindre ces buts. Nous allons donc les passer en revue un par un, en commençant par Herzl. Je vais citer longuement Wikipédia:
« Le journaliste austro-hongrois Théodore Herzl apparut profondément ému par l’affaire Dreyfus, qui suivit ses débuts en tant que correspondant pour la Neue Freie Press de Vienne et qui fut présent à la dégradation de Dreyfus en 1895. « L’affaire… agit comme un catalyseur dans la conversion de Herzl ». Avant la vague d’antisémitisme qui accompagna la dégradation, Herzl était ‘convaincu de la nécessité de résoudre la question juive’, qui devint ‘une obsession pour lui.’ Dans Der Judenstaat (l’État des Juifs), il estimait que :Si la France – bastion de l’émancipation, du progrès et du socialisme universel – peut se laisser entraîner dans le maelström de l’antisémitisme et laisser la foule parisienne chanter ‘Tuez les Juifs!’, où peuvent-ils être en sécurité encore une fois – sinon dans leur propre pays ? L’assimilation ne résout pas le problème parce que le monde des Gentils ne le permettra pas, comme l’affaire Dreyfus l’a clairement démontré… » »Ayant vécu sa jeunesse en Autriche, pays antisémite, le choc fut beaucoup plus fort, et Herzl fit le choix de vivre en France pour l’image humaniste qu’elle affichait en se prétendant un refuge contre les excès extrémistes. Il fut au départ un partisan fanatique de l’assimilation des juifs dans la société européenne des Gentils. L’affaire Dreyfus ébranla l’opinion de Herzl sur le monde, et il se retrouva complètement embrigadé dans un tout petit mouvement appelant à la restauration d’un état juif en Israël, le pays d’origine biblique. Herzl prit rapidement la direction du mouvement. »
« Le 29 Août 1897, il organisa le premier congrès sioniste de Bâle et on le considère comme « l’inventeur du sionisme en tant que véritable mouvement politique. » Théodore Herzl écrivit dans son journal (le 1erseptembre 1897) :
Si je devais résumer le Congrès de Bâle en un mot – ce que je me garderai de prononcer publiquement – ce serait ceci : à Bâle, j’ai fondé l’état juif. Si je le déclarais haut et clair aujourd’hui, je serais accueilli par un rire universel. Peut-être que dans cinq ans, et très certainement dans cinquante ans, tout le monde le reconnaîtra. »
« Le 29 novembre 1947, un peu plus de cinquante ans après le premier Congrès Sioniste, les Nations Unies votèrent en faveur d’un partage de la Palestine pour créer un état juif. L’année suivante, l’état d’Israël fut créé. Par conséquent, l’affaire Dreyfus est considérée comme un tournant dans l’histoire juive et comme le début du mouvement sioniste dans les temps modernes ».
Nous pouvons voir d’après ce récit que l’affaire Dreyfus a servi d’étincelle pour déclencher le mouvement sioniste. Pour ce faire, il fallait attiser les flammes de l’antisémitisme, sinon les Juifs n’auraient pas eu assez peur pour quitter la riche Europe et se retrouver dans une Palestine en voie de développement. La meilleure façon de lancer la machine n’était-elle pas d’accuser faussement un officier juif de trahison et de rendre la foule frénétique par toutes sortes de propagandes antisémites diffusées par, entre autres, le journal de Drumont ? Bien sûr, la seule affaire Dreyfus ne suffisait pas pour atteindre cet objectif. Mais elle semble avoir lancé un plan plus large qui prendrait un demi-siècle à se concrétiser. Ou comme l’a dit Hannah Arendt : « Les principaux acteurs de l’affaire Dreyfus semblent parfois mettre en scène une grande répétition générale pour un spectacle qui devait être reporté trente ans plus tard. » Des acteurs mettant en scène une répétition générale, en effet. N’était-ce pas ce que je disais en début d’article en parlant de vérité déguisée en métaphore…?
Posez-vous cette question : si je suis juif, pourquoi écrire cela? Cela ne me dérange-t-il pas? Comment me situer par rapport à cet antisémitisme? Eh bien, je ne suis pas une personne très tribale par nature. À mon avis, il est tout aussi mauvais pour moi de me sentir relié aux juifs comme s’ils étaient une sorte de bloc indifférencié ou une race ou une religion, comme il est tout aussi mauvais pour les autres de condamner « les Juifs » comme une sorte de bloc indifférencié ou une race ou une religion. Je ne tomberai pas dans la dichotomie manichéenne artificielle qui considère toute critique des Juifs comme de l’antisémitisme pur et simple.
Dans tous les cas, je ne pense pas que pointer du doigt cette élite juive manifeste de l’antisémitisme, parce qu’ils ne montrent aucun scrupule à traiter horriblement les autres Juifs. En fait, d’après ce que j’ai vu, ils se fichent complètement des autres. [dans ce passage, Josh emploie un langage beaucoup moins châtié que le mien] On pourrait même dire que cette critique est pro–sémite, puisqu’elle vise la petite minorité de Juifs qui a arnaqué et escroqué la grande majorité des autres Juifs (ainsi que tout le monde, sauf les riches Gentils qui étaient prêt à jouer le jeu et ne se sont pas fait doubler). L’histoire des Juifs d’Europe est celle d’une grande et sanglante persécution, mais même les récits officiels disent que cette persécution provenait généralement d’une colère contre les usuriers. Donc, même cette terrible histoire (en supposant qu’elle soit plus ou moins vraie) est celle où des gens se sont emportés contre la petite minorité des prêteurs d’argent juifs (probablement pour de bonnes raisons, si on se fie à l’histoire récente), mais tous les Juifs ont dû porter le chapeau et payer le prix avec leurs larmes et leur sang. En fait, je suppose que cette élite juive n’a jamais vraiment payé le prix. Ils se sont juste tournés vers d’autres nouvelles victimes.
Et n’oublions pas ce qu’ils ont fait pour obliger autant de Juifs que possible à se regrouper dans l’état d’Israël, et les amener à continuer le sacrifice volontaire de leurs fils et de leurs filles dans d’innombrables guerres et conflits, sans parler des immenses douleurs et pertes des Palestiniens. Il ne faut pas perdre de vue que, malgré l’antisémitisme généralisé de l’époque (aussi bien réel que fabriqué), la plupart des Juifs ne voulaient pas partir en Israël, et les grandes idées de Herzl rencontrèrent (au départ) une grande critique dans les communautés juives d’Europe. Les sionistes n’arrêtaient pas de vouloir envoyer les Juifs en Israël, mais ils eurent toutes les peines du monde pour les y faire aller et y rester. Pendant et après la seconde guerre mondiale beaucoup ne voulurent pas aller en Palestine, ils fallut alors fermer du mieux possible les portes de l’Amérique et celles d’autres destinations. Mais cela ne suffisait toujours pas. Ils leur fallait encore faire émigrer un tas de Juifs originaires du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord et il existe en fait quelques « false flags » documentés perpétrés par le Mossad, pour les inciter à bouger. Les Juifs d’Israël subissent toujours un lavage de cerveau; il commence très tôt et se fait très en profondeur.
Tout en restant sur le thème de l’antisémitisme, nous pouvons parler d’un autre objectif de l’opération psychologique de l’affaire Dreyfus, peut-être son objectif principal : délégitimer toute critique sur le comportement des Juifs fortunés, assimilée à de « l’anti-sémitisme ». La manière de faire est de jeter une opprobre légitime sur les histoires de religion, les absurdités consistant à boire le sang de bébés chrétiens, la pureté raciale, etc. Ce que nous avons vu en fait ci-dessus avec le livre de Drumont : il suffit de prendre n’importe quoi, même si c’est farfelu, et de l’ajouter à la critique légitime. Puis de taxer tout cela à la va-vite « d’anti-sémitisme », même si le terme « sémite » fait référence à une conception spécifique des Juifs comme appartenant à une race sémite, différente de celle des Européens. (strictement parlant alors, l’anti-sémitisme est vraiment un fragment particulier de la doctrine anti-juive basée sur les théories raciales.)
Ensuite accuser et condamner Dreyfus comme espion juif pour attiser les flammes de l’antisémitisme, en y amalgamant de nouveau toutes les critiques. Puis montrer que Dreyfus était en fait innocent et accuser l’antisémitisme de maltraitance par certains milieux de l’armée et par le gouvernement. Ce qui va servir un objectif secondaire : mettre en situation de faiblesse les catholiques et les autres éléments traditionnels et monarchistes de l’armée et du gouvernement qui pouvaient bloquer la montée en puissance de l’élite juive, ou qui étaient au moins considérés comme des rivaux. (Et pendant tout ce temps on imprime à tour de bras des journaux et des livres qui se vendent comme des petits pains, parce que tout le monde veut absolument suivre les tenants et les aboutissants de l’affaire sans même se demander ce qu’il y a de vrai dedans.) Nous avons juste à nous tourner vers Wikipédia pour constater que ce fut un des aboutissements de l’affaire :
« L’Affaire fit se confronter les deux partis français. Selon une majorité d’historiens, cette opposition servit malgré tout l’ordre républicain. Il y eut en effet un renforcement de la démocratie parlementaire et un échec des forces réactionnaires et monarchistes. »
Que ces factions et idéologies se manifestent en une telle dichotomie n’est pas un hasard. Cela fait partie de ce qui est parfois appelé « dialectique hégélienne » dans les milieux du complot. Mais au lieu de l’utilisation typique de ce terme pour signifier « problème, réaction, solution », la dialectique hégélienne dans ce contexte se décrit plus précisément comme un moyen de faire cadrer des événements et des situations en termes binaires. On fabrique ces événements et on pousse ensuite les gens vers l’une des deux incompatibles visions. Si vous êtes en faveur du progrès, de la liberté, de la raison éclairée, de la modernité, alors vous ne pouvez pas récriminer contre les Juifs. Et si vous le faites, alors vous devez être rétrograde, de droite, nationaliste, etc. C’est, par ailleurs, une excellente façon de diviser les gens.
On peut voir ceci se jouer sous nos yeux avec le conflit (fabriqué) de la crise des migrants : soit vous êtes un suprémaciste blanc, un partisan stupide du Brexit, soit vous êtes un supporter, non-bigot et compatissant des droits de l’homme et de l’égalité. (Ou d’un autre point de vue, soit vous êtes clairement un patriote soit un velléitaire, un stupide humaniste prêt à laisser votre pays descendre en flammes.) Et tout comme l’affaire Dreyfus était un canular fabriqué visant à approfondir la division, la crise fabriquée et surfaite des migrants avec les faux rapports de viols et les canulars d’attentats terroristes sert à affiner et augmenter la division entre nous, pendant que les gars en haut ricanent et empochent la monnaie.
Ce qui est exaspérant, c’est qu’ils sont tellement efficaces à faire avancer leurs intérêts au nom du progrès et sous le couvert d’intérêts universels. Après tout, les Juifs avaient spécialement tout à gagner de la République et des idéaux qu’elle prônait. Ce qui impliquait en tout premier lieu de traiter les personnes sur un pied d’égalité sans distinction de religion. Elle prônait aussi le progrès, la raison éclairée et la modernité. Donc, critiquer l’influence juive était aussi se montrer rétrograde et borné. Elle autorisait également les Juifs fortunés à un accès plus direct au pouvoir politique et à un prétexte pour discréditer les sources existantes de pouvoir (l’église, l’aristocratie). Je vais maintenant citer longuement « Le Juif accusé » :
« La Troisième République émergea progressivement et timidement des ruines du Second Empire au début des années 1870. Bien que les Juifs n’aient que peu à voir avec sa fondation [ou y auraient-ils peut-être joué un rôle ?], elle se prouva un environnement favorable aux aspirations juives les décennies suivantes… Le gouvernement républicain ne fut pas populaire au départ auprès de la plupart des Français, en particulier dans les campagnes, où prévalaient les sympathies monarchistes. Mais on n’établit pas de monarchie car, après des années de querelles, les factions monarchistes rivales n’avaient pu surmonter leurs différences. Une république avec une constitution conservatrice était, selon les mots d’un homme d’État français, finalement acceptable, en tant que forme de gouvernement qui diviserait le moins les Français. Mais la plupart des monarchistes persistaient à considérer la république comme un expédient temporaire en attendant de pouvoir rétablir la monarchie, et la constitution le prévoyait en filigrane pour faciliter cette transition le moment venu. » (P.63)
« La droite française, et de manière plus générale le ‘parti de l’ordre’, traditionaliste, monarchiste et catholique, fut perçue par la plupart des Juifs français comme hostile à leurs aspirations, bien que quelques très riches Juifs privilégiés, comme les Rothschild, continuèrent de se manifester dans les milieux de droite, ainsi que quelques artistes et intellectuels juifs. » (P.64)
« Au grand désarroi des monarchistes, la Troisième République, simple expédient temporaire dans leur esprit, commença peu à peu à gagner le soutien populaire. De même, les républicains remplacèrent progressivement les monarchistes vieillissants et les cadres bonapartistes dans la fonction publique et la bureaucratie. Ce remplacement causa des changements de classe sociale, de l’aristocratie vers la bourgeoisie, et sur le plan religieux des catholiques vers les protestants ou les non-croyants – ou vers les Juifs. En bref, une nouvelle classe dirigeante commença à arriver au pouvoir en France. De nombreux monarchistes de la fonction publique se retirèrent dans leurs maisons de campagne, dégoûtés ou mécontents. Certains monarchistes se tournèrent cependant vers l’un des principaux secteurs d’emploi d’état qui leur restait ouvert, l’armée – conséquence pas si anodine dans l’affaire Dreyfus. » (P. 64)
« L’importance politique croissante des Juifs de la classe moyenne dans le nouvel état républicain n’était pas de même nature que les liens passés contractés dans la première partie du siècle par les Rothschild et autres financiers juifs avec les rois et les empereurs. Mais comme la république gagnait en popularité à la fin des années 1870 et au début des années 1880, ses ennemis déclarèrent voir un lien entre le pouvoir de longue date des Rothschild et celui des Juifs fraîchement influents … des nouveaux riches pour la plupart. Ceux enclins à croire à un complot se plaignaient avec une mauvaise humeur croissante du ‘Syndicat juif’, une supposée organisation clandestine travaillant en sous-main avec l’Alliance Israélite Universelle. Les ennemis de la République furent tout aussi enclins à voir la montée du pouvoir juif comme une influence étrangère croissante – et menaçante – pour la France… » Délires [?] à part, les Rothschild avaient indéniablement construit un imposant empire financier en France, en Allemagne, en Autriche et en Grande-Bretagne… Une bonne part de ce qu’avaient accompli les Rothschild, et la façon dont ils l’avaient fait, était en vérité resté caché du public. La vie privée, le secret, et la conservation du pouvoir au sein de la famille étaient presque une obsession chez eux. Mais ils recherchaient aussi avec empressement les honneurs publics et les titres de noblesse. L’achat de l’Hôtel Talleyrand, qui donnait sur la place de la Concorde à Paris, par les Rothschild, fut pour certains un symbole insupportable de l’argent étranger juif, d’une montée juive au pouvoir et d’une respectabilité factice, qui reléguaient les anciennes élites véritablement françaises au cœur de la capitale. Il est vrai aussi que l’Alliance Israélite Universelle opérait parfois clandestinement. Les allégations d’anti-sémites français à propos des cachotteries juives se basaient sur les véritables cachotteries de certains Juifs haut placés et influents. Ce que les anti-sémites soupçonnaient à cet égard n’était pas tant un fantasme qu’une malveillante exagération [ou peut-être pas]. » (P. 64-5)
« Même l’armée française incorpora dans les années 1870 et 1880 un nombre étonnamment élevé d’officiers juifs (le chiffre de trois cents a souvent été mentionné au début des années 1890, dont dix généraux), alors qu’en Allemagne, le corps des officiers était un domaine où les Juifs étaient strictement tenus à l’écart, de même qu’en Russie, à l’exception des médecins-officiers. En fait, malgré la réputation de l’armée française comme un havre pour les nationalistes de droite et les monarchistes, le pourcentage de Juifs parmi les officiers réguliers se maintint à environ 3 pour cent entre les années 1860 jusqu’à la veille de la 1ère guerre mondiale. Comme les Juifs constituaient ces années-là entre 0,1 et 0,2 pour cent de la population totale, cela signifiait qu’ils étaient surreprésentés de trente à soixante fois. (p. 60) [Soit dit en passant, Dreyfus ne fut pas le premier Juif à servir à l’état-major : le colonel Abraham Samuel s’occupa de l’agence du Renseignement de l’état-major tout au long des années 1870, et prit sa retraite honorablement en 1880.] »
« De 1879 à 1886, un très controversé corps de loi, connu sous le nom de loi Ferry, fut introduit. Cette loi cherchait à établir un contrôle laïque sur l’enseignement primaire et à élargir la portée de cette éducation, conformément aux objectifs libéraux-laïcistes de l’Europe. En ôtant l’enseignement primaire au contrôle de l’Église catholique, la loi Ferry était conçue pour moderniser les campagnes, en « libérant », si l’on peut dire, l’esprit des paysans, en leur fournissant une éducation laïque républicaine, de nouveau en conformité avec les principes libéraux-démocratiques du continent. » (P.66)
« Bien que la campagne en faveur de cette loi n’envisageait pas vraiment les dimensions de la célèbre Kulturkampf de Bismarck [« combat pour la civilisation », campagne menée par les Allemands contre l’église catholique], qui divisa tellement les Allemands quelques années plus tôt, les thèmes et les forces politiques impliquées étaient globalement similaires. Une de ces similitudes était que les Juifs français, tout comme les Juifs allemands, furent parmi les plus ardents et les plus cohérents défenseurs d’une élimination du contrôle de l’Église catholique dans l’éducation publique. » (P.67)
« Les catholiques français qui estimaient que la France, nation depuis longtemps catholique, devait le rester, se sentirent naturellement bientôt comme assaillis sous la IIIe République. Elle était, pensaient-ils, de plus en plus dominée par les athées, les laïcs, les protestants et les Juifs, qui cherchaient tous à dé-christianiser la France. Cette croyance recélait des éléments d’exagération et de dramatisation, mais, encore une fois, on ne peut pas vraiment la taxer de délire. La plupart des dirigeants de la Troisième République avaient explicitement décidé de lutter contre l’Église catholique, qu’ils considéraient comme une ennemie dangereuse, intransigeante et fourbe, qui empoisonnait l’esprit de la jeunesse. C’étaient des luttes réelles, impliquant des problèmes réels avec des implications très concrètes dans le monde réel – l’emploi, le pouvoir politique, le soutien populaire. « (P. 68)
« Plus contestable, bien que correspondant aussi à la réalité dans un certain nombre de cas notoires, était la croyance des catholiques traditionnels que les dirigeants de la République étaient à la solde des Juifs. Une croyance s’y rattachant était que les Juifs accédaient illégalement à de hautes fonctions politiques en achetant des positions de pouvoir au sein de l’état et de l’armée… Une rumeur disait aussi en 1882 que « les préfectures de 47 des 80 départements étaient aux mains des Juifs. » Quinze ans plus tard, l’Union nationale, une organisation catholique française, affirma qu’il y avait 49 préfets et sous-préfets sous contrôle juif, et 19 Juifs au Conseil d’État. Ces chiffres sont extrêmement douteux [note de l’éditeur : ou peut-être pas] et on peut les considérer comme des exemples sur la façon dont les faits et les chiffres ont été manipulés pour coller aux buts de leurs partisans. Pourtant, il y a peu de doute que les Juifs, qui représentaient environ le dixième du 1 % de la population totale, ont été fortement surreprésentés dans ces domaines. Et dans un état aussi centralisé que celui de la France, de tels postes dans la haute administration ont sans aucun doute représenté une influence considérable. Il est également hors de doute que les catholiques avaient une bonne raison de se sentir mis à l’écart par une nouvelle classe politique, au sein de laquelle il y avait de nombreux Juifs. « (pp.68-69)
« Comme ce fut le cas en Allemagne et en Autriche dans les années 1870, les scandales financiers des années 1880 en France impliquaient indéniablement une culpabilité des Juifs, dont beaucoup étaient d’origine allemande, autrichienne ou polonaise. L’un des scandales les plus célèbres et les plus influents impliquait l’Union Générale, une banque fondée par des financiers catholiques dans le but explicite de permettre aux investisseurs catholiques d’éviter les institutions juives et protestantes qui dominaient alors la finance en France. Après un début prometteur, la nouvelle entreprise s’effondra en 1882, ruinant de nombreux petits investisseurs catholiques. » (P. 70)
« Il a été largement admis que l’Union Générale avait été liquidée par les Rothschild, avec qui elle était depuis un certain temps en concurrence féroce. Les quotidiens exploitèrent l’affaire, et sans surprise, les administrateurs de la banque furent prompts à blâmer les Juifs pour dissimuler leur mauvaise gestion. Peu doutaient que les Rothschild, comme tous ceux de la haute finance, pouvaient être impitoyables si nécessaire. » (P. 70)
« Il est certain que beaucoup de Français furent enclins à rendre les Juifs responsables de problèmes dont les Juifs n’étaient pas responsables, d’en faire des boucs émissaires, et donc d’ignorer dans quelle mesure ces problèmes avaient des racines plus profondes et plus larges. Néanmoins, que des observateurs étrangers, Juifs compris, les blâment aussi, met le doigt sur des problèmes qui étaient plus que de simples délires antisémites. Que la grande majorité des Juifs respectueux des lois françaises, qui n’avaient rien à voir avec la haute finance ou les scandales politiques, soient impliqués dans une nasse de soupçon, souligne la confusion et l’embarras auxquels ils furent confrontés dans ce pays de liberté, égalité et fraternité. » (P. 71)
Ah oui, liberté, égalité, fraternité. Qui pourrait être contre cela? N’ai-je pas dit qu’ils étaient champions pour faire avancer leurs propres intérêts sous prétexte d’intérêts universels et de progrès? Prenez par exemple l’application des lois. En théorie, c’est parfait. C’est censé empêcher les monarques d’être des tyrans, parce que tout le monde est censé être égal devant la loi. Qui pourrait contester cela? Mais l’application des lois a été complètement pervertie en faveur des gens qui écrivent les lois, des gens qui font appliquer les lois, des gens qui interprètent les lois, des gens qui décident quand la loi s’applique ou non, et des gens qui peuvent se payer les meilleurs avocats. Je ne suis pas contre l’égalité, la fraternité ou la laïcité, ni toutes ces choses. C’est de voir ces idéaux bafoués pour servir les intérêts de quelques-uns, que je conteste. Et la réponse n’est pas de prendre le contrepied dans les choix binaires qu’ils nous ont fournis, mais de sauver ces principes de ceux qui les ont détournés.
C’est ce que nous dit une annonce qui circule actuellement :

 Ce texte est celui d’une communication faite à la journée d’études co-organisée par l’Association œcuménique Charles-Péguy, l’Amitié Charles Péguy et l’Amitié Judéo-Chrétienne de France, à Strasbourg le 23 novembre dernier (voir ici) :
Ce texte est celui d’une communication faite à la journée d’études co-organisée par l’Association œcuménique Charles-Péguy, l’Amitié Charles Péguy et l’Amitié Judéo-Chrétienne de France, à Strasbourg le 23 novembre dernier (voir ici) :
Ce post regroupe et remplace l’ensemble des posts précédents et disséminés en y ajoutant les derniers échanges non signalés ici. J’arrête de faire vivre le forum de Pierre Gervais parce que toute discussion est avec lui vaine et impossible. Développer un propos est systématiquement empêché par des diversions sur un mot, sur une date, qui viennent parasiter la question et tout argument contraire qui repose sur une source qu’il ignore parce qu’elle est inédite ou qu’il n’ pas voulu retenir malgré tout l’intérêt qu’elle peut représenter est écarté au motif que la source qui permet de le développer est sans doute mensongère.
Il me semble toutefois important de garder trace de cet échange et de l’archiver ici. Il est en effet un formidable matériau pour réfléchir sur ce qu’est la méthode historique et pourrait servir sur la question d’exemple à travailler avec des étudiants. Il est aussi une parfaite illustration, une parfaite confirmation de tout ce que nous reprochons à ce travail sur Dreyfus, le dossier secret et la question homosexuelle. Il nous permet de comprendre de quelle manière un des auteurs, tout au moins – les autres n’apparaissant pas –, procède et, à travers sa manière d’entendre la discussion, conçoit le travail d’historien.
Le livre de nos auteurs défend une thèse. Toute thèse, et surtout quand elle vient bouleverser un siècle de recherche, est par définition la bienvenue. Le problème qu’elle nous pose est que pour nous convaincre il faut plus que des affirmations péremptoires sur ce que peuvent être les faits ou sur un siècle d’historiographie qui n’aurait pas fait son travail. Et quand il apparaît que ce travail développe un argumentaire qui repose soit sur des citations décontextualisées et dont le sens devient forcé soit sur un tri qui ne retient que ce qui peut servir le propos et écarte ce qui le contrarie – en l’arguant de faux ou en n’en parlant tout simplement pas –, notre devoir, à la SIHAD, est de le dénoncer.
Les travaux de Pierre Gervais et de ses trois coauteurs inaugurent une nouvelle manière. Nous ne sommes pas là dans la lignée des ouvrages du « doute et du soupçon » que nous avons analysés dans un précédent post et qui s’inscrivent dans le plus large courant de la littérature conspirationniste. Mais il les rejoint en ce que, comme eux, il veut nous révéler des « vérités cachées » et que pour cela il repose sur une documentation incomplète et forcée.
Peut-être, pour en revenir à leur thèse, que la correspondance homosexuelle – en plus des pièces que nous savons avoir été comprise par le dossier – fut jointe au dossier de 94 et que les petits numéros rouges en seraient le témoignage. mais les arguments qui en contrarient la thèse sont si nombreux qu’il est bien difficile de la retenir en l’état. Pour les principaux.
– pas de n° 1
– des numéros manquant dans la suite, qui auraient été biffés et que, sous les biffures, l’oeil extérieur a du mal à voir avec autant de netteté que celui des auteurs.
– La lettre Davignon pas numérotée et une explication donnée de cette absence de numéro qui résiste peu à l’examen.
– Le témoignage avancé de Cuignet irrecevable parce que sorti d’un contexte aisément restituable qui l’infirme.
– La mise à l’écart (après avoir été argué de faux) du seul document contemporain et qui donne précisément le contenu du dossier.
– La mise à l’écart du témoignage de Du Paty sur la question de la numérotation des pièces et des usages y afférant à la SS
– le rejet de tout témoignage des acteurs militaires au motif qu’ayant menti ils ne peuvent que mentir encore quand il est contraire à la thèse soutenue et accepté (Cuignet) quand il peut la servir.
Voilà pour l’essentiel.
Il n’en demeure pas moins qu’un vrai travail serait à faire sur le dossier secret. Non pas tant sur ce qu’il contenait en 94 – la question est close tant qu’il n’aura pas été prouvé que le brouillon du commentaire de Du Paty ne peut être retenu – mais sur la manière dont il évolua et que l’ouvrage des 3 auteurs n’aborde pas : préciser ce que contenaient les relevés d’octobre 97 à mai 98 et dont il ne subsiste que les courts résumés de Targe.
Mais à vrai dire cette question est plus qu’accessoire. Ce qui compte avant tout c’est de savoir que le dossier secret prit de l’ampleur au fil du temps, que les faux y furent nombreux et qu’il y eut bien une entente à l’état-major pour perdre un innocent et empêcher par tous les moyens que se fît une réhabilitation qui eût été sa défaite. Et ça, nous le savons.
Voici donc l’échange en question :
Pierre Gervais :
L’entretien avec le général Mercier du 17 novembre 1894 :
essai d’histoire méthodique.
Comme les lecteurs de notre livre le savent, nous pensons que la position du ministre de la Guerre Auguste Mercier par rapport à la culpabilité de Dreyfus a changé plusieurs fois au cours du mois de novembre 1894, alors que le capitaine était arrêté, au secret, et soumis à une enquête judiciaire systématiquement à charge.
L’un des éléments qui nous permettent d’étayer cette affirmation est une comparaison entre deux entretiens donnés par le général Mercier, l’un paru dans le journal Le Matin le 17 novembre 1894, l’autre paru dans Le Figaro le 28 novembre 1894. Le premier entretien est au mieux flou sur la culpabilité de Dreyfus, le second est au contraire violemment accusateur, ce qui tend à indiquer une évolution de la position du ministre entre ces deux dates.
Or, dans un billet au ton peu modéré, posté sur son blog il y a quelques semaines, Philippe Oriol, un auteur ayant publié sur l’Affaire et généralement hostile à nos thèses, nous reproche de « ne pas savoir lire », au motif que nous lui ferions une critique infondée en soulignant l’absence dans un article du Matin en date du 17 novembre 1894 du mot « certitude », qui n’est pas prononcé par Mercier. Ce mot est bien présent dans l’article du Journal que je cite dans mes travaux, dit Philippe Oriol, et nous autres, les auteurs du Dossier secret de l’Affaire Dreyfus ne l’aurions pas lu, cet article, puisque nous nions que le mot « certitude » y est. Philippe Oriol en conclut au manque de sérieux des auteurs du « Dossier secret de l’affaire Dreyfus. »
Il s’agit d’une lecture incorrecte de notre texte, de la part de Philippe Oriol. En effet, nous ne disions pas que le mot « certitude » n’était pas présent dans le Journal; nous disions, et maintenons, que ledit mot « certitude » n’était pas dans Le Matin. Voici la citation incriminée, qui est en réalité une note dans notre ouvrage, appelée au terme de notre analyse de l’article du Matin:
« Philippe Oriol (L’histoire de l’affaire Dreyfus, vol. 1 : L’affaire du capitaine Dreyfus – 1894-1897, Stock, 2008, p. 94) affirme que Mercier fait part de sa « certitude » de la culpabilité de Dreyfus dans une autre version de ce même entretien, accordé au Journal. Ni le mot « certitude », ni une quelconque paraphrase de ce terme n’apparaissent cependant dans l’article du Matin, ou dans la version quasi identique (à une phrase près) publiée le lendemain par L’Intransigeant. »
De son côté, Philippe Oriol a écrit, comme chacun peut le vérifier p. 94 de l’édition électronique de son livre, et p. 118 de l’édition papier (nous avons utilisé la première), que « dans une interview qu’il donnera au Journal et au Matin du 17 novembre […] [Mercier] affirmait sa « certitude » de la culpabilité du capitaine Dreyfus ». Notre note attirait l’attention sur la contradiction entre notre lecture tirée de l’entretien du Matin et celle proposée par cet auteur d’après, pensions-nous, le Journal. Dans le cas du Matin, les propos attribués à Mercier, comme nous l’expliquons dans le livre, étaient en effet extrêmement prudents, faisant allusion à une possible innocence de Dreyfus, et n’affirment à aucun moment la certitude de sa culpabilité.
Il ne nous était d’ailleurs pas venu à l’idée de faire ce que notre critique nous reproche si vivement de faire, remettre sa lecture de l’entretien du Journal en cause, et nous l’avions effectivement cru sur parole, sans aller vérifier dans l’article d’origine. Nous avions tort, chacun pourra le constater en relisant les entretiens visés, du Matin daté du 17 novembre, du Journal daté du même jour (non numérisé par la BNF, nous fournissons une transcription sur notre site ), et pour comparaison du Figaro daté du 28 novembre.
Dans l’entretien du Journal invoqué par Philippe Oriol, le ministre explique que (c’est nous qui soulignons) :
« Des incidents […] ont mis entre mes mains des notes qui émanaient d’un officier et qui prouvaient qu’il avait communiqué à une puissance étrangère des renseignements dont il avait pris connaissance en raison de ses fonctions à l’état-major de l’armée. Dès que j’ai eu la certitude que cet officier était le capitaine Dreyfus, j’ai donné l’ordre de l’arrêter. »
Affirmation d’une certitude de culpabilité ? En apparence, mais voici ce qu’ajoute Mercier à la ligne suivante (c’est nous qui soulignons) :
« Il était de mon devoir de m’assurer de lui, d’abord pour l’empêcher de faire de nouvelles communications, ensuite pour établir sa culpabilité et rechercher si d’autres actes de même nature ne pouvaient lui être imputés, car nous étions en droit de supposer, ou du moins de craindre, que celui dont nous étions saisis ne fût pas le seul. J’avais prescrit de conduire l’enquête préalable dans le plus grand mystère, tant pour ne pas déshonorer un officier qui était peut-être innocent, que pour découvrir ses complices s’il était coupable. Une indiscrétion a tout révélé. »
Au moment de son arrestation, la culpabilité n’était pas établie (puisqu’il fallait l’établir) et Dreyfus était peut-être innocent. Un lecteur attentif aurait compris que le ministre affirme sa certitude que Dreyfus est à l’origine d’une fuite, implique qu’il est coupable d’espionnage, mais refuse fermement d’employer le terme, et au contraire précise dans les phrases suivantes que la culpabilité n’était pas établie, contrairement à ce que sa première phrase pouvait laisser penser. Mercier n’affirme donc pas tellement plus sa certitude de la culpabilité de Dreyfus dans la version de son entretien du 17 novembre donnée au Journal que dans celle reproduite par le Matin.
Le journaliste signant l’article du Journal, un chroniqueur militaire du nom de H. Barthélémy, pose d’ailleurs presque tout de suite après la question qui s’impose :
« La preuve est-elle faite en ce moment ? »
A quoi Mercier répond :
« Oh, ici, nous sortirions du secret de l’instruction, et je dois être le premier à le respecter, puisqu’en ma qualité de chef de l’armée, et par conséquent de chef de la justice militaire, je dois en imposer le respect. »
Mercier refuse explicitement cette fois d’affirmer la culpabilité de Dreyfus, et se retranche derrière le secret de l’instruction.
Dans l’ensemble, si la phrase introduisant Dreyfus semblait contenir une affirmation de culpabilité, d’ailleurs contournée, cette affirmation est très soigneusement qualifiée au point de ne plus avoir valeur d’affirmation, à deux reprises dans les lignes suivantes, et implicitement dans tout le reste de l’entretien.
Le reste des réponses du ministre est en effet à l’avenant. Mercier informe son interlocuteur que Dreyfus se proclame innocent, que les expertises sont en cours (donc qu’elles n’ont pas conclu), qu’aucune pièce n’a été volée au ministère, et que Dreyfus « n’a pas possédé de documents réellement précieux ». Mercier ajoute tout de même ensuite qu’il « ne sait rien sur le nombre et la nature des pièces qu[e Dreyfus] a pu copier et livrer, en-dehors de celles que nous avons saisies », ce qui inclut bien, à nouveau, une accusation d’espionnage implicite ; mais lui et Barthélémy concluent leur échange immédiatement après sur la question du chef d’accusation à retenir, et Mercier adopte comme son interlocuteur le conditionnel. La dernière phrase de Mercier, « s’il est condamné ce serait à la déportation dans une enceinte fortifiée » pose implicitement la possibilité d’un acquittement, et, du point de vue formel, combine une proposition conditionnelle et un verbe au conditionnel. Que de certitudes !
Barthélémy ne s’y trompera pas. « Toutes les suppositions, toutes les hypothèses restent [d’ailleurs] admissibles sur l’étendue du crime dont le capitaine Dreyfus est accusé », conclut-il, ce qui le conduit à souhaiter que « les débats n’eussent pas lieu à huis-clos. Ce serait en tout cas à désirer, il faut que la lumière se fasse complètement ». Ce chroniqueur pourtant militaire semble bien mettre ici en cause implicitement la justice militaire, à laquelle il ne fait plus tout-à-fait confiance. Il reviendra à la charge le lendemain, puis huit jours plus tard, dans deux entrefilets certes hostiles à Dreyfus, mais dans lesquels la culpabilité de ce dernier reste mise au conditionnel.
La lecture des entretiens du 17 novembre par Philippe Oriol est donc incorrecte : Mercier n’affirme que très mollement sa « certitude » de la responsabilité de Dreyfus dans le Journal, sans même oser employer le mot « culpabilité », et bat en retraite aussitôt après, impliquant à plusieurs reprises que Dreyfus peut être innocent. De plus, la version de cet entretien donnée dans le Matin, est encore moins affirmative à cet égard — peut-être parce que Le Matin était moins violemment hostile à Dreyfus que le Journal. Les deux versions de l’entretien justifient en tout cas pleinement notre jugement d’ensemble : Mercier a considérablement changé d’attitude entre le 17 et le 28 novembre 1894, pour des raisons qui restent malheureusement inconnues — mais peut-être peut-on placer dans cet intervalle l’apparition du dossier secret — : le 17 novembre il se refuse à affirmer sa certitude de la culpabilité de Dreyfus, alors que le 28 novembre il n’hésite absolument pas à condamner Dreyfus avant tout jugement.
Les auteurs du Dossier secret de l’affaire Dreyfus
Philippe Oriol :
Passons du temps sur quelques lignes. C’est intellectuellement stimulant et fait partie des joies de la controverse historienne.
C’est vrai que j’aurais dû dire que l’article du Matin était légèrement différent du celui du Journal et expliquer que je ne parlais que du second. La maladresse sera corrigée dans la nouvelle édition de mon livre à paraître en avril aux Belles lettres et je remercie les auteurs de cette occasion de précision et aussi de publicité. Mais passons.
Ne nous occupons que du Journal. Mercier y prononce donc bien le mot « culpabilité » et affirme, nos auteurs le concèdent et le citent, qu’il n’a donné l’ordre de l’arrestation que quand il « eu[t] la certitude que cet officier [l’officier traître] était le capitaine Dreyfus ». La chose est dite. Seulement voilà, nos auteurs nous l’expliquent, cette affirmation, nette, précise, indiscutable, est atténuée, contrebalancée, niée finalement par la suite immédiate de l’entretien. Je re-cite : « Il était de mon devoir de m’assurer de lui, d’abord pour l’empêcher de faire de nouvelles communications, ensuite pour établir sa culpabilité et rechercher si d’autres actes de même nature ne pouvaient lui être imputés, car nous étions en droit de supposer, ou du moins de craindre, que celui dont nous étions saisis ne fût pas le seul. J’avais prescrit de conduire l’enquête préalable dans le plus grand mystère, tant pour ne pas déshonorer un officier qui était peut-être innocent, que pour découvrir ses complices s’il était coupable. Une indiscrétion a tout révélé. » Que prouve cette phrase, et tout particulièrement à la suite de l’affirmation nette qui précède ? Que Mercier était conscient qu’il dépassait-là les bornes et qu’outrepassant les droits qui étaient les siens – il était allé trop loin – il corrigeait sa première affirmation. Car en effet (et ne disons rien de la valeur historique d’une interview dans la presse, de la manière dont un journaliste peut retranscrire les paroles de l’interviewé, etc.) tout prouve que cette certitude était un fait et que Mercier faisait là ce que par anachronisme nous pourrions nommer de « la com ». Qu’est ce ministre qui pour établir une culpabilité ou laver le suspect de toute accusation l’arrête ? Le mettre hors d’état de nuire, s’il était coupable ? Continuer l’enquête pour découvrir ses possibles complices ? Certes et il le dit… Mais ne comprend-on pas là toute l’aberration de la chose. Si il s’agissait d’établir sa culpabilité, s’il s’agissait de trouver de possibles complices, n’eût-il pas été plus judicieux de le laisser libre de lui appliquer une consciencieuse surveillance ? Sandherr le proposera à Mercier et Mercier ne le voudra pas. Pourquoi ? Parce qu’il fallait que Dreyfus fût coupable. Il le fallait parce qu’il n’y avait personne d’autre et que de cette arrestation dépendait sa carrière.
Maintenant reprenons la citation de Mercier qui selon nos auteurs annule la précédente. Mercier parle au passé. Un passé qui qualifie la période comprise entre fin septembre (arrivée du bordereau) et le 15 octobre (arrestation du capitaine). Il ne parle pas là de son sentiment du moment mais de celui du mois précédent. Nous y reviendrons. Je l’ai arrêté, dit-il (donc un mois et demi plus tôt) pour pouvoir établir sa culpabilité, pour trouver ses complices… Et l’enquête préalable, celle menée dans le plus grand secret (donc des premiers jours d’octobre au 14 de ce même mois), avait été prescrite « pour ne pas déshonorer un officier qui était peut-être innocent ». Où est-il question ici de son sentiment du 17 novembre, jour de publication de l’interview ? Mercier, ce 17 novembre, ne se refuse pas à affirmer sa certitude de la culpabilité, il le fait : j’ai arrêté Dreyfus le 15 octobre parce que j’avais la certitude de sa culpabilité. J’ai mené une enquête avant (l’enquête préalable) pour ne pas déshonorer quelqu’un qui était peut-être innocent et si je l’ai arrêté c’est donc bien parce que j’avais acquis la certitude de sa culpabilité. La correction n’infirme pas, elle confirme. Et que dit-il à la suite ? Qu’une « indiscrétion a tout révélé »… Et alors ? Bel aveu de l’impasse dans laquelle il se trouvait et dont il ne pouvait plus sortir sans s’obstiner…
Maintenant je n’oublie pas que Mercier dit aussi, dans cette fameuse interview, qu’il a arrêté Dreyfus « pour établir sa culpabilité ». Mais il n’y a pas de place laissé au doute ici… D’autres actes ne pouvaient-ils lui être imputés ? Ainsi disant il était bien coupable de l’acte qui avait motivé son arrestation… Affirmation de culpabilité. N’était-il pas le seul ? Ainsi disant il en était un parmi peut-être plusieurs… Affirmation de culpabilité.
Mercier pouvait bien à la suite parler de la présomption d’innocence, du secret de l’instruction et de s’en poser comme le garant, il ne le faisait que pour tenter de se montrer présentable et, tout en le disant, adopter l’attitude contraire. Précisément ce que nous disons en cette fameuse p. 114….
Je continuerai donc à dire, et ce faisant en en apportant une nouvelle preuve, que nos auteurs ne savent pas lire…
Philippe Oriol :
J’ai rédigé la réponse précédente loin de chez moi et revenu parmi mes papiers et ayant relu l’article il me faut absolument ajouter quelques mots…
Nos auteurs citent aussi cette petite phrase de Mercier, à la suite, extraite de l’interview, phrase qui vient encore ajouter à ce que je dis : « je ne sais rien sur le nombre et la nature des pièces qu[e Dreyfus] a pu copier et livrer, en-dehors de celles que nous avons saisies ». Belle certitude en effet. Dreyfus a copié, livré. Et ce n’est pas une impression mais une certitude. Il en a la preuve puisqu’il a saisi des pièces. A cela, nos auteurs expliquent que « lui et Barthélémy concluent leur échange immédiatement après sur la question du chef d’accusation à retenir, et Mercier adopte comme son interlocuteur le conditionnel. La dernière phrase de Mercier, « s’il est condamné ce serait à la déportation dans une enceinte fortifiée » pose implicitement la possibilité d’un acquittement, et, du point de vue formel, combine une proposition conditionnelle et un verbe au conditionnel. Que de certitudes ! » Mais enfin, est-ce sérieux ? Est-ce de la naïveté, un vrai problème de lecture ou de la mauvaise foi ? Après avoir parlé de présomption d’innocence, de respect de la procédure, Mercier pouvait-il tout à coup annoncer une condamnation ? Et plus simplement pouvait-il annoncer une condamnation qui n’était pas de son ressort ? Des juges devaient se réunir pour juger le cas et le ministre n’avait rien à y faire… à moins de reconnaître que le jugement à venir serait une condamnation par ordre. Parler au futur aurait été au pire le plus terrible des aveux, au mieux de la pure voyance. Imagine-t-on le ministre dire, « il sera condamné » ?… Enfin… nous plaisantons, là, je suppose…
Et c’est là où est la « subtilité » de Mercier. Il montre bonne figure, se pose en garant et en défenseur du droit et, entre les lignes, affirme pour l’édification des lecteurs, sa certitude. Celle que Dreyfus était le traître et c’est pour cela qu’il l’a fait arrêter… une certitude qu’il tenait de preuves : les pièces saisies qui étaient de sa main. Tous les conditionnels du monde ne peuvent atténuer de telles affirmations… Mercier ne dit qu’une chose ; Dreyfus sera peut-être acquitté mais moi je sais qu’il est coupable puisque j’en ai les preuves.
Sinon, elle est intéressante cette discussion. Et la réponse qui m’est faite est une synecdoque de la manière de travailler de nos auteurs. Je ne suis pas « généralement hostile à [leurs] thèses ». Je dis juste que pour convaincre les spécialistes du sujet de la validité d’une thèse qui n’est pas inintéressante en soi, il faudra (faudrait ?) d’autres arguments et une autre manière de concevoir ce qu’est la méthode historique… Les textes ne disent jamais que ce qu’ils disent, pas ce qu’on veut y lire…
Pierre Gervais :
La réponse de Philippe Oriol à nos remarques sur l’entretien du général Mercier accordé à H. Barthélémy le 17 novembre appelle à son tour à mes yeux une réponse, d’autant qu’elle réitère les accusations habituelles de mauvaise méthode et de mauvaise lecture. Compte tenu de ce dernier élément, je serai moins diplomate que je l’ai été jusqu’à présent.
Au passage, le lecteur qui veut former sa propre opinion trouvera les articles dont il sera question dans ce billet
ici (Journal daté du 17 novembre), ici (Matin daté du 17 novembre), et ici (Figaro daté du 28 novembre).
Pour commencer l’article du Matin du 17 novembre, utilisé par nous, n’est pas « légèrement différent », il confirme notre thèse et justifie ce que nous avons écrit. Philippe Oriol ne l’inclut toujours pas dans son analyse, ce qui est surprenant, et de plus confirme implicitement par son silence à cet égard que les accusations de départ portées contre nous sur son blog étaient sans fondement. Comme il le dit lui-même: passons.
Sur le fonds du débat actuel, maintenant: le contenu de l’article du Journal du 17 novembre. Au cours de cet entretien, le général Mercier REFUSE de se prononcer sur le fait de savoir si la culpabilité de Dreyfus est prouvée ou non, et conclut par la formule « si [Dreyfus] est condamné ». Il précise bien que Dreyfus « était peut-être innocent » au moment où il avait ordonné l’arrestation. La conclusion du journaliste est également que l’on ne peut rien conclure. Impossible, se récrie Philippe Oriol, une aberration, c’est incohérent, donc Mercier… dit autre chose que ce qu’il dit, ou ne le pense pas vraiment, et donc il n’y a pas à en tenir compte, nous sommes des naïfs de le faire, il s’agit de « subtilité », de « com' », qu’il convient d’ignorer. Là encore, il est certainement plus commode de soutenir une thèse si tout ce qui s’y oppose dans un texte est considéré comme nul et non avenu.
Non content d’écarter de cette manière, par pétition de principe, certains passages de l’article, Philippe Oriol développe de surcroît une argumentation qui repose sur au moins une erreur de lecture, et plusieurs déformations majeures de la lettre du texte.
a) Erreur de lecture: non, le passé évoqué par Mercier ne date pas d’avant l’arrestation, qui a eu lieu un mois plus tôt (et non un mois et demi), et l' »enquête préalable » n’est pas celle menée en septembre-octobre. Mercier dit très explicitement que cette enquête, et le silence qui l’accompagne, motivé entre autres par la possible innocence de Dreyfus, s’est étendue jusqu’à l' »indiscrétion [qui] a tout révélé », c’est-à-dire la fuite de la fin octobre. C’est donc bien de l’enquête préliminaire de Du Paty sur Dreyfus qu’il s’agit. Au passage, la seule enquête pouvant déshonorer Dreyfus était celle portant sur Dreyfus… donc celle qui eut lieu une fois Dreyfus identifié!
En tout état de cause, si le silence s’imposait encore quand l' »indiscrétion » a eu lieu (fin octobre donc), c’est que les raisons de ce silence étaient toujours valides à ce moment-là, et donc que Dreyfus pouvait toujours être innocent. Philippe Oriol interprète d’ailleurs le dernier membre de phrase mentionnant « l’indiscrétion » comme un « aveu de l’impasse dans laquelle [Mercier] se trouvait », formule qui n’a rien à voir avec ce que le texte dit.
b) Déformation du texte: Mercier ne dit pas « j’ai arrêté Dreyfus le 15 octobre parce que j’avais la certitude de sa culpabilité » ni qu’il « eut la certitude que cet officier [l’officier traître] était le capitaine Dreyfus ». Il ne parle absolument pas de « traître », un ajout de Philippe Oriol que rien dans le texte ne justifie; et il n’emploie pas « culpabilité » à cet endroit-là. Mercier dit, mot pour mot: dès que j’ai eu la certitude que l’officier qui avait communiqué à une puissance étrangère des renseignements dont il avait pris connaissance en raison de ses fonctions à l’état-major de l’armée était Dreyfus, je l’ai fait arrêter. Ce n’est pas « une affirmation, nette, précise, indiscutable »; c’est au contraire une formule contournée. Dreyfus a communiqué « des renseignements dont il avait pris connaissance en raison de ses fonctions ». Trahison et espionnage? Imprudence et bavardage? La formule ne le dit pas. A part ses convictions personnelles, rien n’autorise Philippe Oriol à remplacer ce que Mercier dit effectivement par les formules qu’il préfèrerait le voir employer. Si Mercier avait voulu utiliser le mot « traître », ou affirmer explicitement la « culpabilité » de Dreyfus, il l’aurait fait. Il ne l’a pas fait.
c) Deuxième déformation du texte, plus mineure et en post-scriptum: « Dreyfus a copié, livré ». Non. « Dreyfus A PU copier, livrer », et ce n’est pas tout-à-fait pareil: la phrase ne dit même pas clairement que les pièces saisies ont été livrées et/ou copiées par Dreyfus, elle se contente de l’impliquer. Mais l’emploi du potentiel a aussi son importance. Au passage, nous avions nous-même souligné que cette phrase était accusatrice, et remarqué que l’accusation restait cependant implicite. Philippe Oriol n’avait donc nullement besoin de relire quoi que ce soit, contrairement à ce qu’il dit, si ce n’est notre propre texte; tous les éléments s’y trouvaient, y compris ceux qui compliquaient notre thèse.
d) Enfin, également en post-scriptum, Philippe Oriol modifie considérablement le contenu et la portée des déclarations de Mercier, sans mentionner qu’il s’agit d’interprétation et non de citation. Mercier ne dit nulle part qu' »il a la preuve puisqu’il a saisi des pièces », il dit qu’il a saisi des pièces, et ne parle pas de preuve. Si les pièces saisies étaient des preuves, d’ailleurs, il n’y aurait eu nul besoin d' »établir la culpabilité » de Dreyfus, toute établie, et la discussion serait sans objet. Le statut de ces pièces saisies, déjà abordé dans la première phrase accusatrice de manière tout aussi peu concluante, n’autorise aucune certitude sur la culpabilité de Dreyfus.
Il est également abusif d’affirmer que le texte présente « une certitude qu[e Mercier] tenait de preuves: les pièces saisies qui étaient de sa main [celle de Dreyfus] ». Le mot « certitude » est tiré du passage accusateur principal et n’apparaît pas à cet endroit; le mot « preuve » n’apparaît nulle part dans la bouche de Mercier, qui refuse fermement de déclarer que la preuve est faite, justement; les « pièces saisies » viennent d’un autre passage et encore une fois ne sont pas décrites et absolument pas présentées comme des preuves; et « étaient de sa main » est également un ajout, au mieux une interprétation du membre de phrase spécifiant que Dreyfus « a pu » copier, et en tout cas sûrement pas ce que Mercier dit.
Quelle importance, nous répondra-t-on: la version de Philippe Oriol correspond certainement à une interprétation possible des propos de Mercier, et sans doute à celle que ce dernier souhaite que le lecteur adopte? Certes, mais entre interprétation du lecteur (sur laquelle il peut y avoir, et il y a, désaccord entre nous et Philippe Oriol) et affirmation du locuteur, il y a une marge. Philippe Oriol écrit en effet que « tous les conditionnels du monde ne pourront atténuer de telles affirmations ». Ce serait vrai si ces affirmations étaient le fait de Mercier. Mais rendons à César ce qui est à César: les conditionnels sont de Mercier, les affirmations de Philippe Oriol. Ce que dit Mercier implicitement par endroit n’autorise nullement à ignorer tous les autres endroits où Mercier dit autre chose également implicitement, ainsi que tous les conditionnels du texte, très explicites, eux.
Bref, nous ne plaisantons pas quand nous affirmons que Mercier se garde bien d’affirmer, justement, et que cette prudence est remarquable. Il suffit d’ailleurs de comparer cette présentation du 17 novembre aux formules utilisées par le même Mercier le 28 novembre dans Le Figaro, et que Philippe Oriol ne mentionne pas non plus :
« J’ai soumis à M. le président du Conseil et à mes collègues, me disait récemment le général Mercier, les rapports accablants qui m’avaient été communiqués, et, sans aucun retard, l’arrestation du capitaine Dreyfus a été ordonnée. On a écrit, à ce sujet, beaucoup d’inexactitudes ; on a dit, notamment, que le capitaine Dreyfus avait offert des documents secrets au gouvernement italien. C’est une erreur. Il ne m’est pas permis d’en dire davantage puisque l’instruction n’est pas close. Tout ce que l’on peut répéter, c’est que la culpabilité de cet officier est absolument certaine et qu’il a eu des complices civils. »
« rapports accablants » communiqués AVANT l’arrestation de Dreyfus, « culpabilité absolument certaine » AVANT la fin de l’instruction. Voilà un paragraphe autrement plus net, précis, indiscutable, que toutes les formules que nous venons de discuter… De plus, ce paragraphe fait fi de toutes ces bonnes raisons que Philippe Oriol accumule pour expliquer que Mercier ne pense pas ce qu’il a tout l’air de dire. Si toutes ces raisons sont valables le 17 novembre, pourquoi ne le sont-elles plus le 28???
Comparons l’extrait du Figaro du 28 que nous venons de donner avec un extrait de l’article du Journal du 17, incluant l’une des deux phrases sur lesquelles s’appuie Philippe Oriol, et dont il tire toute une série d’affirmations mises ensuite dans la bouche de Mercier:
« – Enfin, monsieur le ministre, tout en nous tenant sur les alentours de cette affaire, pourriez-vous me dire si des documents ont été réellement pris par le capitaine Dreyfus?
– Il ne manque aucune pièce dans les dossiers des bureaux où il a fait son stage.
D’ailleurs, on ne peut en distraire aucune, car chaque colonel chef de bureau a tous ses documents dans un coffre-fort; il les sort quand il doit s’en servir et il les rentre toujours avant de s’absenter.
Les fonctions du capitaine Dreyfus étaient secondaires, puisqu’il ne servait à l’état-major que comme stagiaire. Son rôle était, de même que pour ses collègues, celui d’un expéditionnaire d’un rang plus élevé que le rang ordinaire de cet emploi. Il n’a donc pas possédé de documents réellement précieux. Mais je ne sais rien sur le nombre et la nature des pièces qu’il a pu copier et livrer, en-dehors de celles que nous avons saisies. »
Quand nous disons que l’éventuelle affirmation de la culpabilité de Dreyfus reste au mieux hésitante, et s’accompagne de précautions remarquables, nous pensons respecter au plus près le sens du texte.
Pour conclure: nous ne « concédons » rien du tout. Les accusations portées par Philippe Oriol sur son blog au départ était infondées; il n’en parle plus, si ce n’est pour admettre une « maladresse ». Le texte qu’il invoquait ne justifie pas sa position: il en tord le sens, garde ce qui l’arrange (et que nous avions soigneusement cité) et invalide les passages qu’il ne peut modifier, exclusivement sur la base de sa conviction intime qu’il s’agit de « com' », de pure rhétorique. Le texte du Matin confirme notre position: il l’élide. J’avoue que j’ai de plus en plus de mal à accepter sans broncher des leçons de méthodes de la part de quelqu’un qui ne me semble pas respecter ici les règles élémentaires de la méthode historique, que soit dit en passant j’ai autant de titres que lui à pratiquer. L’invocation rituelle du statut de spécialiste ne suffit pas, ne suffit plus, et la mise en cause répétitive et systématiquement insultante de nos lectures, étayées et respectueuses du contenu du texte, au profit de lectures tantôt erronées, tantôt incomplètes, finit par être lassante.
D’autant que sur le fonds, je ne comprends même pas vraiment sur quoi il y a controverse. Philippe Oriol veut-il vraiment soutenir que les articles citant Mercier le 17 novembre et le 28 novembre ont le même contenu? Et le même sens? Que les formules sont les mêmes? Qu’il n’y a pas de changement notable de ton? Ce serait le comble…
Pierre Gervais
Philippe Oriol :
Pierre Gervais me fait rajeunir et je l’en remercie. Il me ramène quatre ans en arrière à l’époque où nous avions soutenu semblable controverse sur le blog de Pierre Assouline. Une controverse que j’avais abandonnée au bout de quelques semaines ne pouvant discuter avec quelqu’un qui faisait semblant de ne pas comprendre et s’accrochait à quelques détails pour éviter d’aborder le fond. J’ai le sentiment que cette petite histoire va bientôt se répéter… Mais dans l’attente, puisque je suis en avance dans mes corrections de copies et que mon amie est bienveillante, je vais encore y consacrer une partie de la soirée qui commence.
Prenons la réponse de Pierre Gervais paragraphe par paragraphe et répondons-y au fur et à mesure de la lecture.
Paragraphe 3. Les articles du Matin et du Journal. Nous traiterons cette question plus tard ou dans une autre réponse. La bienveillance de mon amie a des limites.
Paragraphes 4 et 5. Pierre Gervais me corrige et revient sur sa « certitude » : « Mercier REFUSE de se prononcer sur le fait de savoir si la culpabilité de Dreyfus est prouvée ou non, et conclut par la formule “si [Dreyfus] est condamné”. Il précise bien, ajoute Pierre Gervais, que Dreyfus “était peut-être bien innocent” au moment où il avait ordonné l’arrestation. » C’est vrai, Mercier le dit. Mais il dit aussi que « dès qu[’ il a] eu la certitude que [l’] officier [“qui avait communiqué à une puissance étrangère des renseignements dont il avait pris connaissance en raison de ses fonctions à l’état-major de l’armée”] était le capitaine Dreyfus, [il avait] donné l’ordre de l’arrêter ». Lisant cette phrase, je ne vois pas pourquoi on discute… Mais faisons un effort. Cette phrase existe et on ne peut l’oublier parce que Mercier à la suite parle d’une condamnation au conditionnel, REFUSE de prononcer le mot « coupable », le mot « traître », « espion », etc. Il ne le dit pas mais le laisse entendre. Dreyfus était selon lui, il en a la certitude, celui qui avait communiqué des pièces à une puissance étrangère. En disant cela dit-il autre chose que Dreyfus est selon lui, il en a la certitude, un coupable, un traître, un espion ?
Cela dit il faut répondre à Pierre Gervais qui demande pourquoi Mercier n’est pas plus clair, n’affirme pas plus clairement, REFUSE de se prononcer quand la question lui est posée. Mais il ne le fait pas parce qu’il parle à un journaliste, qu’il sait que ses propos seront publiés, que la France entière les lira et que le droit lui interdit de ne pas respecter l’indépendance du tribunal peut-être amené à se réunir (un conseil de guerre, composé de ses subordonnés), comme il lui interdit de ne pas respecter la présomption d’innocence. Mercier est plus habile que cela, il ne dit rien, il refuse d’être clair sur la question mais l’affirme sans détour à celui qui sait lire entre les lignes. Le tout est de savoir lire entre les lignes… Ce n’est donc pas une question de « commod[ité] » qui me fait expliquer cela, de, comme le dit Pierre Gervais, « soutenir une thèse » en considérant « comme nul et non avenu » « tout ce qui s’y oppose dans un texte ». Je n’écarte pas, par « pétition de principe », certains passages, je leur donne leur vrai sens. Nous sommes face à une interview, pas une lettre ou une note privée. Les propos de Mercier seront répercutés dans un journal à l’important tirage et Mercier ne peut pas y dire tout ce qu’il veut, franchement, clairement. Il peut, en revanche, fidèle à sa manière, montrer un visage de défenseur du droit et subtilement distiller son venin. Ne comptez pas sur moi pour ne pas respecter le droit mais il y a un traître et ce traître je l’ai fait arrêter (je ne cite pas ici, j’explique…)… Mercier ne dit pas autre chose.
Comme Pierre Gervais me pose plus bas cette question (je reformule pour une meilleure compréhension) : Pourquoi cela le 17 novembre quand il deviendra clair le 28 dans l’article du Figaro ? », je vais lui répondre maintenant. En quelques jours les choses avaient changé. La Libre Parole l’attaquait malgré son ralliement (voir notre Histoire) et le 22 lui avait même fait comprendre que « quels qu’aient été ses torts, il s’honorera en les confessant ; tandis qu’en continuant à se taire, il augmente ses responsabilités ». Mercier était acculé et devait parler. Il parla. Il savait ce faisant ce qui se passerait et que, selon nous, il avait voulu éviter le 17. De nombreux journaux s’offusquèrent alors et condamnèrent de telles paroles comme le firent quelques députés. Ainsi le socialiste Viviani déclara : « Il n’a pas le droit de faire connaître son avis aux juges qui composeront le conseil de guerre ». Quand au président du Conseil, il convoqua Mercier qui nia avoir dit ce que le journaliste rapportait…
Posez-vous donc une question Pierre Gervais. Vous savez comme moi que Mercier, et ce dès le début, n’aura de cesse de mentir. Pourquoi pour cet article se serait-il mis, pour la première et sans doute la seule fois, à dire la vérité ? Et élargissant la question posons-nous en une autre : la méthode, qui nous intéresse et nous oppose tous les deux, joue ici. Quelle doit être notre attitude face à un texte ? Tous les textes ont-ils la même valeur ? Que vaut une interview ? Que valent les paroles dites à un journaliste ? Et en allant plus loin que peut nous certifier qu’elles furent bien dites ? Quel rôle joue le journaliste, vecteur de l’information ? Les rapports Guénée, nous nous accorderons sur ce point, sont faux. Nous ne les discutons pas. Et pourquoi l’interview devrait-elle, elle, prise au pied de la lettre ? Vous qualifiiez, autrefois, contre l’avis de tous ceux qui ont travaillé sur l’Affaire, le commentaire Du Paty de faux. Pourquoi aurait-il moins de valeur qu’une interview à un journaliste ? Et d’ailleurs Mercier, nous venons de le rappeler, nia avoir tenu les paroles que Charles Leser lui attribuait dans son article du Figaro. Disait-il la vérité quand il parlait au journaliste ou quand il affirmait à son ministre n’avoir pas parlé ? Alors… Et il demeure une certitude, indiscutable celle-là. Mercier affirme sa « certitude » que Dreyfus était l’officier qui avait « communiqué à une puissance étrangère des renseignements obtenus en raison de ses fonctions à l’état-major de l’armée » tout en refusant de déclarer textuellement Dreyfus coupable. Ne pouvez-vous admettre ce que je propose ? Qu’il ne dise rien de ferme relativement à l’issue du procès parce qu’il ne le pouvait pas, parce qu’il n’en avait pas le droit, mais qu’il dise sans détour sa certitude que celui qui avait « communiqué à une puissance étrangère des renseignements obtenus en raison de ses fonctions à l’état-major de l’armée » était Dreyfus.
Paragraphe 6. Mes erreurs. Avant de répondre une remarque. J’avais parlé du paragraphe au passé pour expliquer que Mercier ne parlait pas dans cette interview de ses sentiments du 17 novembre mais de ceux du mois précédent. A cela Pierre Gervais ne répond pas mais reconnaît implicitement ce que je voulais lui faire comprendre. Voilà déjà quelque chose de gagné.
C’est vrai. J’ai répondu vite et je me suis trompé dans les dates. Mais ça ne change rien. L’enquête préalable est bien celle de Du Paty, entre le 15 octobre et l’indiscrétion des derniers jours du mois. Mercier livre donc ce qu’il voulait qu’on considérât comme ses sentiments de ce moment (« il était peut-être innocent ») et pas ceux du 17 novembre. Qu’il s’agisse du 1er octobre, du 15 ou du 29, il est toujours question de passé. Et là encore nous revenons à ce que nous avons dit précédemment. Mercier prend ici des précautions, montre bonne figure et tout en disant cela parle de sa « certitude ».
Voilà quoi qu’il en soit un exemple de la raison pour laquelle j’avais mis brutalement fin à ma discussion de 2008 avec Pierre Gervais. Pour ne pas avoir à discuter la question (passé/présent), il vient me chicaner sur une bricolette qui n’a rien avoir avec le sujet et brouille le débat.
La question du « silence », abordée à la suite est intéressante. Ce n’est pas parce qu’il doutait que Mercier n’avait rien révélé de l’affaire et qu’il fut obligé de le faire quand l’indiscrétion fut commise. C’est parce qu’il avait bien compris que sa précipitation à arrêter Dreyfus était catastrophique et qu’il ne pouvait pas revenir en arrière qu’il se taisait. Et c’est parce qu’il y eut une indiscrétion qu’il fut obligé de parler… la fameuse impasse dont je parlais et que Pierre Gervais signale comme n’ayant aucun rapport avec ce que dit le texte. Mais je n’ai pas dit que le texte disait cela. Il s’agissait d’une parenthèse, une explication…
Paragraphe 7. Déformation 1. Pierre Gervais me reproche de déformer le texte de l’interview. Mercier n’a pas prononcé le mot de « culpabilité », de « traître ». C’est vrai. Ce qu’a dit Mercier « mot pour mot », continue Pierre Gervais, c’est « dès que j’ai eu la certitude que l’officier qui avait communiqué à une puissance étrangère des renseignements dont il avait pris connaissance en raison des ses fonctions à l’état-major de l’armée était Dreyfus, je l’ai fait arrêter ». Je veux bien mais à moins d’être d’une indécrottable stupidité, je continue à croire que la phrase dit précisément l’un et l’autre. Que signifie « l’officier qui avait communiqué à une puissance étrangère des renseignements dont il avait pris connaissance en raison des ses fonctions à l’état-major de l’armée » sinon « traître » ? Un officier qui profite de sa présence dans les bureaux les mieux gardés et les plus secrets de la défense nationale pour livrer à une puissance étrangère les documents qu’ils conservent n’est-il pas ce que le langage commun appelle un traître ? Dire au sujet d’untel qu’on a la certitude qu’il est ce traître n’est-ce pas affirmer sa culpabilité ? J’avoue que je comprends mal. Les choses ne sont pas uniquement parce que le mot est prononcé. Une image, une comparaison, une métaphore, une périphrase ont aussi quelque valeur… Est-ce donc là ce que je veux y voir ou ce que dit le texte. Bien sûr les mots ne sont pas prononcés mais l’idée est la même et ce qu’elle sous-tend est tout aussi grave.
Maintenant j’ai du mal à suivre Pierre Gervais quand, pour pousser son raisonnement, il me rétorque que la formule de Mercier ne dit rien d’une question de trahison ou d’espionnage, d’imprudence ou de bavardage ? Quoi ? Mercier pouvait-il penser que Dreyfus aurait été l’officier qui aurait livré des documents et qu’il l’aurait fait par imprudence ? Pire qu’il aurait livré ces documents par bavardage ? Je ne dois pas comprendre…
Paragraphe 8. Déformation 2. Pierre Gervais me reproche d’avoir écrit « copié », « livré » quand Mercier n’a dit que : « A PU copier, livré ». C’est vrai encore. Mais encore une fois cela ne change rien et nous noyons là un nouveau poisson. Je reprends la phrase : « Mais je ne sais rien sur le nombre et la nature des pièces qu’il a pu copier et livrer, en dehors de celles que nous avons saisies. » Si le « pu » caractérise l’hypothétique inconnu, l’affirmation qui suit indique sans le moindre doute que les pièces saisies sur lesquelles de ce fait le doute n’est pas possible furent elles livrées ou copiées. Je ne sais pas quelle est la nature de ce qu’il a pu faire sur ce que je ne connais pas mais je le sais pour ce que je connais. Moralité Mercier nous dit bien que Dreyfus a copié et livré des pièces. Et pas livré ou copié… livré ET copié… Et quand il parlait de pièces saisies il faisait bien sûr ici référence aux notes communiquées à une puissance étrangère par Dreyfus, ainsi qu’il l’avait dit précédemment et dont nous avons longuement parlé dans les paragraphes précédents.
Paragraphe 9. Déformation 3. Pierre Gervais, qui aime les mots et continue son système, me reproche cette fois d’avoir dit « preuves » quand Mercier ne parle que de « pièces ». Je veux bien mais que sont des pièces saisies qui prouvent l’entente d’un officier avec une puissance étrangère sinon une preuve de trahison ? Elles n’indiquent pas bien sûr quel est le nom du coupable mais indiscutablement la matérialité de la trahison. Mais bon ma phrase pouvait laisser penser que je parlais de preuves de culpabilité. Je corrigerai donc. Il ne dit pas avoir de preuves, juste une certitude, de ces certitudes dont on fait des intimes convictions…
Paragraphe 10. Pas d’argument ici mais une petite phrase qui appelle un commentaire. Je ne souhaite pas que le lecteur « adopte » un quelconque point de vue qui par hasard serait le mien. Je me borne à faire de l’histoire…
Le Paragraphe 11 ayant déjà fait l’objet d’une réponse passons aux paragraphes 12 à 17. Le Figaro. Pierre Gervais me reproche de ne pas en parler. C’est fait depuis. Mais pourquoi en aurais-je parlé puisque notre sujet portait sur l’interview du Journal. Toutefois je ne peux laisser passer l’invitation sans y répondre. Pierre Gervais en cite l’extrait le plus intéressant que je livre à sa méditation. Mercier y dit, selon Leser qui rapporte une conversation récente, que la « culpabilité de [Dreyfus] est absolument certaine » mais surtout qu’il l’avait fait arrêter dès que lui avaient été soumis les rapports accablants », sous-entendu rapports qui indiquaient sa culpabilité. Je ne reviendrai pas sur les raisons de ce ton tout à coup très affirmatif. J’ai déjà longuement parlé de la question. En revanche je signalerai une petite chose intéressante. Si Mercier avait fait arrêter Dreyfus le 15 octobre après avoir reçu des rapports accablants, sous-entendu qui indiquaient sa culpabilité (sinon que signifie « accablants » ?), c’est donc bien que sa certitude de la culpabilité était antérieure à l’enquête préalable, celle de Du Paty. Mercier contredit donc ici ce que Pierre Gervais voit dans l’interview du 17 quand il nous dit y lire que le ministre « précise bien que Dreyfus “était peut-être innocent” au moment où il avait ordonné l’arrestation ». Alors Mercier ment ici ou mentait le 17 ? Car il ne peut dire un jour qu’il n’était pas sûr en arrêtant le capitaine et soutenir 11 jours plus tard qu’il l’avait arrêter sur la foi de pièces accablantes ? Passons sur le fait que nous avons là la parfaite illustration de ce que peuvent valoir les interviews de Mercier et que nous, historiens, devons peut-être faire preuve d’esprit critique en ne prenant pas pour argent comptant la moindre ligne parce qu’elle est écrite. Et ayant lu cela, ne peut-on soutenir que Mercier en effet ne varie en rien d’un article à l’autre, à cette seule différence près qu’il dit la seconde fois ce qu’il n’ose ou ne peut dire la première. Parce que finalement quelle différence y a-t-il entre « J’ai soumis à M. le président du Conseil et à mes collègues […] les rapports accablants qui m’avaient été communiqués, et, sans aucun retard, l’arrestation du capitaine Dreyfus a été ordonnée » et « dès que j’ai eu la certitude que [l’] officier [“qui avait communiqué à une puissance étrangère des renseignements dont il avait pris connaissance en raison de ses fonctions à l’état-major de l’armée”] était le capitaine Dreyfus, j’ai donné l’ordre de l’arrêter » ? Aucune. Et là peut-être peut-on comprendre que les phrases prudentes à la suite sont bien, comme nous le disons et répétons, la juste prudence d’un homme que sa fonction empêche d’aller plus loin…
Paragraphe 17. Conclusion. Nous le passons le temps de nous intéresser au paragraphe suivant, le 18 et dernier. Vais-je soutenir que les interviews des 17 et 28 novembre ont le même contenu ? Le même sens ? Que les formules sont les mêmes ? Qu’il n’y a pas de changements notables de ton ? Mais Pierre Gervais je ne fais que dire que les formules en sont différentes, que le ton n’est pas le même. Je ne fais que soutenir que Mercier a dit clairement le 28 que ce qu’il n’avait fait que dire sans le dire le 17. Parce que je pense en effet que ces deux articles ont le même sens et ont, finalement, le même contenu. Le parallèle avec Le Figaro me semble en être une bonne illustration. Mercier y affirme la culpabilité du traître, la première fois sans oser encore aller jusqu’au bout de l’expression de ce qu’est sa pensée et la seconde, pour répondre aux injonctions de La Libre Parole, comme nous l’avons dit précédemment, franchement, clairement, absolument.
Je reviens donc au paragraphe 18. Je passerai sur la première partie que je ne comprends pas. Puisque nous sommes partis pour discuter quelques temps, pourriez-vous m’expliquer le sens de ces phrases : « Les accusations portées par Philippe Oriol sur son blog au départ étaient infondées ; il n’en parle plus si ce n’est pour admettre une « maladresse ». Je ne vois pas de quoi vous parlez. J’ai reconnu en effet une maladresse d’expression dans mon livre en ne marquant pas assez les différences qui pouvaient exister entre les articles du Matin et du Journal. Mais pas dans le blog. Je ne sais de quoi vous parlez. A propos de cette maladresse, d’ailleurs, il faut dire que j’étais un peu « contenu » chez Stock. 400 pages et pas une de plus. Je suis plus libre aux Belles Lettres et ayez confiance, puisque je reprends le premier volume pour y ajouter quelques passionnants inédits (entre autres les notes de Dreyfus à destination de son avocat à l’occasion du procès de 1894), je pourrai parler de tout ce à quoi j’ai du renoncer pour tenir le format. Les précisions que vous attendez y seront.
Mais ce paragraphe vaut surtout pour sa seconde partie. Je ne peux guère y répondre puisque Pierre Gervais y exprime son sentiment sur sa lassitude devant mon refus obstiné d’être convaincu par ses arguments. Je ne demande qu’à l’être mais il en faudra pour cela d’autres que ceux de son ouvrage ou ceux qu’il développe ici. Cela dit je peux toutefois y apporter un petit commentaire qui sera ma conclusion de ce soir. Je ne dis pas, Pierre Gervais, que vous n’avez pas les titres pour pratiquer la méthode. Vous les avez sans doute plus que moi, simple docteur qui n’a jamais voulu passer l’agrégation, et à vrai dire ces questions de légitimité académique n’ont aucun sens pour moi. Vous pouvez venir discuter sur des points de détail – une date mal calculée (un mois et demi pour un mois), un mot donné comme explication et pris pour citation, etc. – cela ne changera rien. Expliquez-moi plutôt pourquoi au lieu de réagir sur une ligne de mon article (l’interview du Journal), vous ne répondez jamais sur aucun des autres points tellement plus importants ? Pourquoi encore vous n’avez pas répondu aux autres articles qui se trouvent tous sur le même blog et que vous avez lus. Expliquez-moi plutôt, puisque nous parlons là de méthode, pourquoi, après avoir argué de faux sans le moindre argument valable l’essentiel commentaire de Du Paty qui contredit votre thèse des petits numéros rouges, dans votre article de la RHMC, vous n’en parlez plus du tout dans votre livre ? Expliquez-moi plutôt pourquoi vous n’évoquez jamais cette phrase de Du Paty devant la Cour de cassation que votre lecture de la sténographie a dû vous faire rencontrer, cette phrase par laquelle il affirme qu’il n’avait jamais vu aucun numéro sur les pièces du dossier à l’époque du procès Dreyfus « parce que ce numérotage est postérieur au moment du procès de 1894 » ? Du Paty l’a dite, pourtant, cette phrase, et sous serment devant les magistrats de la Cour de cassation, pas à l’occasion d’une conversation avec un journaliste. Répondez donc à ces simples questions, je vous prie, et « bronchez » si vous le désirez. Mais ne noyez pas les poissons les uns après les autres. C’est cela qui est lassant et qui me fera m’obstiner, avec beaucoup d’autres moins opiniâtres que moi (et qui se nomment pour citer les plus fameux Bredin, Thomas, Duclert, Drouin, Joly), à dire que vos travaux ne sont pas convaincants.
Pierre Stutin :
Juste un point que l’on n’a pas abordé jusqu’ici et qui a contribué fortement à différencier dans notre esprit les interviews du 17 novembre et 28 novembre : c’est l’absence quasi totale de réaction à la première interview de Mercier. (Journaux consultés : Le Constitutionnel, La Croix, L’Echo de Paris, Le Figaro, Le Gaulois, L’Intransigeant, La Justice, La Libre Parole, Le Matin, Le Petit Parisien, Le Petit Journal, Le Siècle, Le Temps,L’Univers).
La seule petite réaction dans la presse vient de la Libre Parole qui y exprime son exaspération devant les hésitations du ministre !
Pour les autres journaux commence une période de silence sur l’affaire Dreyfus, faute d’informations. L’interview de Mercier est à peine citée.
Ce qui contraste très fortement avec les très nombreuses et violentes réactions consécutives à l’interview du général Mercier dix jours plus tard. Elle provoqua un véritable tollé avec de nombreux articles exaspérés, des interventions politiques multiples, et donna même lieu à un démenti officiel.
Si comme Philippe Oriol l’affirme, il n’existe pas de différence au fond entre les deux interviews, comment expliquer cette différence d’attitude à la fois de la presse, et du monde politique ?
Comment Philippe Oriol concilie-t-il son affirmation d’une identité de sens entre les deux interviews et cette différence dans les réactions, l’indifférence dans la première et la violence dans la deuxième ?
Vraiment, les contemporains de l’affaire n’auraient pas saisi le véritable sens de la première déclaration de Mercier ? Ou bien a-t-elle, plus vraisemblablement, été interprétée comme une déclaration évasive et embarrassée, ce qu’elle est bien à notre avis.
Il nous apparaît donc évident que le ministre a évolué entre ces deux dates, ce qui constitue un indice, soit de l’apparition du dossier secret entre le 17 et le 28 novembre, soit de la décision ferme et définitive de Mercier d’utiliser celui-ci pendant le procès à venir, soit les deux bien sûr.
Cela nous a éloigné du point initial de ce débat, qui était si on s’en souvient, un reproche assez mineur concernant une note de bas de page dans notre livre, dans laquelle nous mentionnions le fait que l’interview du 17 novembre n’avait pas été relatée de la même manière dans le quotidien Le Journal et dans Le Matin, contrairement à ce que laissait entendre Philippe Oriol dans son propre ouvrage.
Ce qu’il paraît avoir admis en définitive.
PS
Philippe Oriol :
En me connectant, je vois que Pierre Stutin me répond aussi. J’y répondrai plus tard. Dans l’attente la suite promise….
Chose promise, chose due. J’avais remis à plus tard une petite partie, je vais donc m’en occuper maintenant. Pierre Gervais me reproche en effet dans le paragraphe 3 de ne pas parler de l’article du Matin. Allons-y ! comme disait l’autre.
L’article du Matin est en effet « légèrement différent » de celui du Journal. Très légèrement différent pour être exact. Voici pourquoi je les avais groupés dans mon livre et, pour gagner de la place, considéré un peu rapidement comme étant pour ainsi dire le même. On verra plus loin pourquoi je n’avais pas toutefois tort. Le raccourci en était un et cela est fâcheux. Mais bon. Mettons en regard les paragraphes les uns après les autres :
Le Journal :
« Des incidents sur lesquels je n’ai pas à m’expliquer ; sur lesquels, du reste, vous ne me questionnez pas, ont mis entre mes mains des notes qui émanaient d’un officier qui prouvaient qu’il avait communiqué à une puissance étrangère des renseignements dont il avait pris connaissance en raison de ses fonctions à l’état-major de l’armée. [j’avais dans mon précédent post, écrit une fois « obtenus » en place de « avait pris connaissance » ; comme on risque de me le reprocher, je prends mes précautions].
« Dès que j’ai eu la certitude que cet officier était le capitaine Dreyfus, j’ai donné l’ordre de l’arrêter. »
Le Matin :
« Des notes que j’ai eues en ma possession m’ont révélé qu’un officier des bureaux de l’état-major avait communiqué à une puissance étrangère des documents dont il avait eu connaissance en vertu de ses fonctions.
« Je l’ai fait immédiatement arrêter ».
Le Journal :
Il était de mon devoir de m’assurer de lui, d’abord pour l’empêcher de faire de nouvelles communications, ensuite pour établir sa culpabilité et rechercher si d’autres actes de même nature ne pouvaient lui être imputés, car nous étions en droit de supposer, ou du moins de craindre, que celui dont nous étions saisi ne fût pas le seul ».
Le Matin :
Mon devoir n’était-il pas de le garder sous la main, tant pour éviter toute révélation ultérieure que pour procéder à une enquête rendue nécessaire par ses dénégations ».
Le Journal :
J’avais prescrit de conduire l’enquête préalable dans le plus grand mystère, tant pour ne pas déshonorer un officier qui était peut-être innocent, que pour découvrir ses complices, s’il était coupable ».
Le Matin :
Cette incarcération provisoire et cette enquête préliminaire ont été tenues rigoureusement secrètes et nul n’en a eu le soupçon pendant deux semaines. Mon devoir n’était-il pas aussi de ne pas déshonorer un officier en l’accusant publiquement d’un crime dont il affirmait être innocent ? »
Et le reste à l’avenant.
On ne discutera pas je pense l’identité. Mais pourquoi ces variantes de formulation ? On sait comment se passaient les interviews d’un personnage important comme pouvait l’être un ministre. Il recevait plusieurs journalistes qui chacun à sa manière rapportait les propos qu’il avait pris en note et qu’il reconstruisait pour ses lecteurs. D’où les nombreux démentis dus à des journalistes qui se laissaient porter par leur enthousiasme et prêtaient à l’interviewé les propos qu’ils auraient aimé entendre sortir de sa bouche. Parfois même, quand l’interview était exclusive, le journaliste qui l’avait obtenue la plaçait dans plusieurs journaux en l’écrivant différemment par respect pour ses différents employeurs. On ne sait dans quel cas nous sommes ici (le second semble plus probable) mais il est clair que ce ne peut être qu’un des deux. Et cette remarque pourra peut-être permettre à Pierre Gervais de comprendre qu’on ne peut prendre ces textes au mot près et que la plume du journaliste et tout autant sinon plus en jeu ici que la parole de l’interviewé.
Cela dit la version du Matin vient encore nous apporter quelques renseignements passionnants. Certes on nous rapporte que Mercier aurait dit (car c’est ainsi qu’il faut présenter une interview) qu’il ne voulait pas déshonorer un innocent, qu’il fallait compléter l’enquête, mais il redit bien ici aussi sa « certitude » et vient même y ajouter. En effet, un peu plus loin, à propos du silence qu’il se doit de garder, il affirme :
« sur la nature des documents communiqués par le capitaine Dreyfus à une puissance étrangère, vous comprendrez que je garde le plus complet silence ». Y a-t-il un doute ici ? « les documents communiqués par le capitaine Dreyfus » est bien affirmatif. S’il avait douté n’aurait-il pas plutôt écrit : « les documents qu’aurait communiqués le capitaine Dreyfus » ?
Il poursuit : « Cet officier en était-il à son coup d’essai ». N’est-ce pas affirmatif ? S’il avait douté n’aurait-il pas plutôt écrit : « Si cet officier est bien le traître, en était-il à son coup d’essai » ?
Et encore à la suite : « Avait-il déjà livré d’autres pièces ? » N’est-ce pas affirmatif ? S’il avait douté n’aurait-il pas plutôt écrit : « Si cet officier est bien le traître, avait-il déjà livré d’autres pièces » ?
Et quand il ajoute encore : « C’est à l’instruction de faire le jour ». Parle-t-il d’établir sa culpabilité ? Aucunement. Il illustre ses phrases précédentes. C’est à l’instruction de déterminer s’il en était à son coup d’essai, s’il avait livré d’autres pièces.
Voilà qui confirme non seulement la quasi-identité entre les deux textes mais qu’une nouvelle fois si Mercier y reste prudent quant à l’issue du procès, il n’hésite pas, et plus encore que dans l’article du Journal à dire sa « certitude ».
Philippe Oriol :
Répondons à Pierre Stutin. Pierre Gervais va croire que je lui en veux personnellement et cette pensée me contrarie. Je l’assure que je n’ai rien contre lui et ce d’autant plus que je ne le connais pas. Mais je dois avouer que je préfère les réponses de Pierre Stutin qui replacent le sujet, lui redonnent ses justes proportions et qui surtout développent des arguments qui n’éludent pas les questions en s’attardant sur des points de détail sans rapport avec ce qui nous intéress.
Je lui réponds donc. Il est vrai que les articles du 17 sont passés absolument inaperçus et que celui du 28, je le rappelais dans un précédent post, a provoqué un véritable tollé. Et je comprends que ce silence pose question. Mais peut-on pour autant en déduire que cette absence de réaction soit signe qu’il n’y avait pas matière à ce qu’elles furent ?
Je concilie donc mon affirmation d’une identité (et qu’on lise bien mon post : dans le fond, pas dans la forme ; et telle sera l’objet de ma rectification dans la réédition de mon livre) entre le sens des interviews du 17 avec celle du 28 et les différences de réactions par la prudence, comme je ne le cesse de le répéter, qui contraignait encore le ministre le 17 et qui ne le préoccupait plus le 28.
Le 17, il affirmait sa certitude mais voulait se montrer bon républicain et bon ministre, en refusant de se prononcer sur l’issue du procès à venir. C’est précisément ce que je dis p. 118 de mon livre : « Si, dans cette même interview, il refusait de répondre à la question de savoir si la preuve de la culpabilité était faite, au motif qu’alors “nous sortirions du secret de l’instruction et je dois être le premier à le respecter”, il affirmait parallèlement, contre toute justice, sa “certitude” de la culpabilité du capitaine Dreyfus. À la suite, il se donnait le beau rôle, précisant que s’il avait gardé le secret jusqu’à la question posée par La Libre Parole qui avait tout révélé, c’était pour “ne pas déshonorer un officier qui était peut-être innocent” ». Tel est ce que je crois et que m’indiquent les textes. Car enfin, comment soutenir par les textes mêmes que Mercier n’y affirme pas implicitement la culpabilité tout en refusant de le dire textuellement ?
Si l’analyse interne ne laisse à mon avis pas place à la discussion, qu’en est-il de l’analyse externe ? Poser cette question revient à se demander si Mercier pouvait croire à la mi-novembre à l’innocence de Dreyfus ou tout au moins à ne pas être encore tout à fait fixé relativement à sa culpabilité. Pour cela je me contenterai de donner quelques faits qui indiquent bien que Mercier, et ce dès le début, était tout à fait convaincu.
Prenons quelques faits dans l’ordre.
Pourquoi, après la conférence ministérielle du 11 octobre, quand son collègue Hanotaux lui déclara avec fermeté que s’il n’avait « pas d’autres preuves que cette lettre-missive et une ressemblance d’écriture, [il s’]oppos[erait] à toute poursuite judiciaire et même à toute enquête », Mercier décida de passer outre et de n’en pas tenir compte si ce n’était que parce qu’il croyait – réellement ou par intérêt personnel – à cette culpabilité ? La phrase qu’il rétorqua à Hanotaux n’est-elle pas la preuve de cette certitude : « […] je ne veux pas qu’on m’accuse d’avoir pactisé avec la trahison!…. » (voir mon Histoire, p. 25-26) ?
Pourquoi, s’il ne croyait pas à cette culpabilité jusqu’au 17 novembre, avait-il écrit, puis finalement biffé, sur les « recommandations spéciales » qu’il avait transmises à Forzinetti la veille de l’arrestation de Dreyfus, le 14 octobre, qu’il faudrait observer « la discrétion la plus absolue » sur l’affaire « jusqu’à mardi soir 16 octobre inclus » si ce n’était parce qu’il était sûr, la veille de l’arrestation que le traître passerait aux aveux à l’occasion de la dictée (voir mon Histoire, p. 69) ?
Pourquoi, s’il doutait de cette culpabilité, Mercier demanda-t-il à Du Paty, le 30, de dire à Dreyfus qu’il était « prêt à [le] recevoir s[’il] voul[ait] entrer dans la voie des aveux » (voir mon Histoire, p. 72) ?
Ces faits ne sont-ils pas plus probants que cette histoire d’interview dont nous savons devoir nous méfier du fait de sa nature même ?
Maintenant, pour éviter quelques développements à suivre, il est clair que quand je parle ici de certitude en la culpabilité, je veux dire que Mercier sut très vite, s’il put douter quelques jours, que Dreyfus était innocent mais qu’il s’obstina à proclamer une culpabilité qui lui était nécessaire pour ne pas perdre la face et servir ses ambitions personnelles… On ne sait jamais…
Pierre Gervais :
Rebonsoir à tous,
Une remarque préliminaire: nous ne sommes pas en train de nous demander si Mercier croyait à l’innocence de Dreyfus. Nous sommes en train d’essayer de déterminer quelle position Mercier présente au public dans les articles du 17 novembre. Il ne s’agit pas de ce que Mercier pense, mais de « la position du Ministre » (notre point de départ), de ce qu’il dit, affirme, publiquement, ce qui n’est pas du tout pareil. Je pensais que cela allait sans dire, mais certaines formules employées par Philippe Oriol m’inquiètent à cet égard, donc je répète notre formulation initiale (cf. haut de cette page), qui était la suivante et à laquelle je le prie de bien vouloir s’en tenir, c’est notre position et il n’y en a pas d’autre:
Le 17 novembre, Mercier « affirme sa certitude que Dreyfus est à l’origine d’une fuite, implique qu’il est coupable d’espionnage, mais refuse fermement d’employer le terme, et au contraire précise dans les phrases suivantes que la culpabilité n’était pas établie ». AFFIRME. Pas pense.
Que Mercier croie à la culpabilité de Dreyfus n’est pas la question, et ne l’a jamais été à ma connaissance: la question est de savoir quelle est la position de Mercier telle qu’il la présente aux lecteurs de la presse quotidienne. Et non, ce qu’il présente n’est nullement une affirmation nette de la culpabilité de Dreyfus, quoi qu’en dise Philippe Oriol. Notre métier est fait de précision et de prudence, que je m’étonne de voir réduire à du pinaillage.
Commençons par l’article du Matin, où non, le reste n’est pas « à l’avenant » non plus. Voici ce qui me paraît l’essentiel de ce reste:
« Toutes ces difficultés se compliquent encore par les dénégations persistantes de l’officier, qui maintient son innocence. Aussi a-t-on dû faire procéder à des expertises, et il n’y a pas eu moins de cinq experts en écritures consultés sur les notes que le capitaine Dreyfus affirme n’avoir pas rédigées.
Dans ces conditions, je ne serais pas surpris que l’instruction judiciaire durât encore une huitaine de jours.
En attendant des conclusions qui, d’ailleurs, n’apparaîtront guère que sous forme d’une ordonnance de non-lieu ou d’un ordre de mise en jugement, l’opinion publique ne saura rien que par les hypothèses des journaux. »
Et il ajoute plus loin, après un paragraphe en incise, « c’est à l’instruction judiciaire qu’incombe le soin d’établir la vérité » (et non « de faire le jour »; j’insiste pour cette précision dans les termes, de même que j’insiste sur les précisions de date. Je ne considère ni l’une, ni les autres comme des bricoles, mais comme le cœur de notre métier, je le répète).
Dreyfus nie; il dit n’avoir pas rédigé les notes qui lui sont attribuées; des expertises sont en cours QUI PEUVENT CONDUIRE A UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU. […] L’INSTRUCTION DECIDERA.
Voilà, c’est dit. Et dit fort explicitement, beaucoup plus encore que dans l’article du Journal, qui contient déjà pourtant la même idée implicitement. Les deux articles vont dans le même sens, mais celui du Matin dit explicitement que Dreyfus peut être innocent. Non pas qu’il l’est; non pas que le Ministre croit qu’il l’est (ce serait un comble…); mais qu’il peut l’être. La fin de l’article précise que même SI il est coupable, il n’a communiqué que des documents d’ordre secondaire. Mais la grosse différence réside dans la référence explicite à un non-lieu, chiffon rouge évidemment pour la Libre Parole, comme le rappelle Pierre Stutin.
Notre formulation, que je rappelle pour éviter tout glissement de sujet:
(Mercier « affirme sa certitude que Dreyfus est à l’origine d’une fuite, implique qu’il est coupable d’espionnage, mais refuse fermement d’employer le terme, et au contraire précise dans les phrases suivantes que la culpabilité n’était pas établie »)
décrit très exactement ce que Mercier dit le 17 novembre. Elle ne convient absolument pas à ce que Mercier dit le 28 novembre.
Nous ne discutons pas de la conviction intime de Mercier. Nous ne connaissons pas cette dernière à ce stade de l’Affaire. Il croyait certainement Dreyfus coupable à la mi-octobre, puisqu’il a ordonné son arrestation; le fait permet de prouver l’état d’esprit du Ministre, qui est confirmé effectivement par d’autres éléments. La demande à Du Paty est moins probante, puisqu’elle fait part d’une espérance et non d’une certitude, et qu’elle est rapportée uniquement par des témoins suspects, et non par des témoins fiables comme Hanoteaux ou Forzinetti (j’ai déjà dit plusieurs fois que je ne suis pas d’accord avec cette façon de mettre sur le même plan le témoignage des uns et des autres: Hanoteaux est fiable en première analyse, Du Paty ne l’est absolument pas!). Mais rien de tout cela ne nous dit ce que Mercier pense le 17 novembre (faut-il rappeler que la Dépêche Panizzardi est passée par là), ce qui prouve une fois de plus qu’il convient de faire très attention aux dates. Je pense pour ma part qu’il continue à penser Dreyfus coupable, du fait du ton général de ses communications et de ses actions ultérieures, mais je ne suis pas dans sa tête, et nous n’avons que des présomptions, pas des preuves.
Car les deux articles ne disent pas ce que Mercier pense, ou croit, au fond de lui-même: ils donnent une narration publique de la position du Ministre le 17 novembre, ce n’est pas du tout pareil.
Voici ce que Mercier dit le 17 novembre. Je ne sais pas ce qu’il croit, mais je sais que c’est ce que le lecteur de la presse va lire, parce que c’est ce que je lis (je rappelle entre crochets quelles lectures me semblent possibles, ou au contraire abusives au sens où elles vont au-delà de ce que le texte dit ou même implique)
1) lorsque Mercier arrête Dreyfus, il a, lui Mercier, la certitude que celui-ci a communiqué des informations à une(des?) puissance(s?) étrangère(s?)
[la trahison n’est pas établie, il n’y a pas de preuves de culpabilités. Les documents communiqués étaient sans importance, c’est dit dans le texte. Nous ne savons rien des circonstances de cette communication, et du degré auquel elle incrimine Dreyfus, ni du degré auquel elle a été faite volontairement — je me hâte d’ajouter DANS LE TEXTE, avant d’être traité d’imbécile. NOUS savons que Mercier et ses hommes étaient persuadés que Dreyfus avait trahi. Le lecteur NE LE SAIT PAS: c’est la première communication officielle détaillée du Ministère sur Dreyfus. Nous ne sommes pas en droit, nous historiens, d’utiliser nos connaissances a posteriori pour évaluer la réception d’un texte chez des lecteurs qui ne disposaient pas de cette connaissance. Nous devons nous remettre dans la position du lecteur DE L’EPOQUE pour évaluer l’impact de ce texte. Cela fait partie intégrante de ce que l’on appelle habituellement une analyse interne; c’est la position que je prends, et que Philippe Oriol me dit ne pas comprendre — et je ne comprends pas qu’il ne la comprenne pas. Je sais, moi, que Mercier ne pense pas que Dreyfus a agi par imprudence, mais le lecteur ne le sait pas.
Et surtout Mercier sait que le lecteur ne le sait pas: il s’adresse à un auditoire dont on peut déterminer certaines caractéristiques, et s’il ne proclame pas que Dreyfus est coupable de haute trahison alors que cet auditoire n’en est pas sûr (c’est même le motif de l’entretien!), c’est qu’il a ses raisons, que nous devons déterminer en essayant de recapturer la structure interne du texte et les directions dans lesquels il incite le lecteur DE L’EPOQUE à aller.
Et c’est pour la même raison de respect du sens apparent du texte, de souci de méthode visant à éviter toute surinterprétation, qu’il nous est également totalement interdit d’insérer des mots dans un texte où ils ne se trouvent pas et d’où leur absence est significative, ou d’imposer un « vrai » sens à un texte si celui-ci ne le justifie pas. Or aucune des formulations plus fortes que Philippe Oriol propose n’est utilisée par Mercier, et rien dans le reste du texte, l’ensemble des deux textes à vrai dire, ne les autorise, au contraire comme on va le voir]
2) cette certitude de Mercier provient de notes qu’il a eues en main
[Là je crois que tout le monde est d’accord. Enfin j’espère.]
3) ces notes n’étaient pas des preuves, et la culpabilité de Dreyfus n’était pas établie à la date de son arrestation
[comme précédemment, non seulement Mercier se garde de parler de preuve, mais il implique à plusieurs reprises et de plusieurs façons que la trahison n’est pas établie au moment de l’arrestation. Il est donc exclu de faire de ces notes des preuves, c’est même contraire à la lettre de certains passages du texte sur la culpabilité à établir, ou les expertises nécessaires. Et ce que nous en savons par ailleurs entre d’autant moins en ligne de compte qu’effectivement, ce n’était pas des preuves]
3) ces notes sont de la main de Dreyfus
[c’est la seule formulation motivant l’accusation contre Dreyfus. Mercier dit dans les deux articles que des données ont été communiquées, et qu’il sait que Dreyfus est l’auteur de ces fuites parce qu’un élément intermédiaire est de son écriture. Si nous en restions là, Philippe Oriol aurait raison — mais au passage, la formulation serait étrangement indirecte : pourquoi ne pas dire que Dreyfus a communiqué des notes à l’étranger? Elle est d’ailleurs peu claire du point de vue du lecteur, qui ne connaît évidemment pas la « voie ordinaire »: si des pièces ont été saisies, comment ont-elles pu être livrées par Dreyfus? Des notes prouvaient des communications mais notes et communications ne faisaient-elles qu’un? Je pense que l’interprétation la plus probable pour un lecteur non averti est qu’une note de la main de Dreyfus faisait référence à des notes copiées et livrées par Dreyfus — ce qui, au passage, est une description assez exacte de la situation. Mais la formulation est peu directe, une fois encore]
4) Dreyfus nie avoir rédigé ces notes
5) une enquête est en cours, qui aurait dû rester secrète
[Ce sont les deux éléments clés, ceux qui ont disparu le 28. MERCIER NE DIT A AUCUN MOMENT QUE L’ENQUETE A CONCLU A LA CULPABILITE DE DREYFUS; IL DIT TOUT LE CONTRAIRE!!!! L’article présente donc en tout et pour tout la certitude initiale du Ministre et la protestation d’innocence de Dreyfus, et l’alternative n’est PAS tranchée dans le texte, tout au contraire. Et il est parfaitement inutile d’ironiser sur l’évidence de ce que Mercier pense, ou la supériorité de la position du Ministre; le fait que Mercier pense que Dreyfus est coupable et que c’est lui qui a raison — encore heureux, étant donné qu’il maintient Dreyfus en prison — n’est pas l’axe principal du texte, qui s’articule au contraire autour de la nécessité d’une enquête, et interdit donc de penser cette certitude du Ministre comme concluante. C’est ainsi, et il nous faut en tenir compte dans l’analyse.].
6) l’enquête aurait dû rester secrète d’abord pour des raisons de contre-espionnage, complices éventuels, autres actes délictueux peut-être commis par Dreyfus
[Là encore, pas de problème entre nous je suppose]
7) l’enquête aurait dû rester secrète ensuite pour protéger l’honneur d’un officier peut-être innocent
[C’EST LOGIQUE DU FAIT DE CE QUI PRECEDE. Ca ne l’est pas si l’on suppose que Mercier déclare Dreyfus coupable, et il faut alors supposer aussi que Mercier dit ici quelque chose que non seulement il ne pense pas, mais surtout dont il espère que son lecteur ne tiendra pas compte! Rien ne force à faire cette supposition si l’on se contente de suivre le sens du texte et si l’on accepte que Mercier dit ce qu’il dit. En revanche, rien n’autorise à créer une explication ad hoc de cette nécessité du secret, sans aucune base dans le texte lui-même, et uniquement au nom de ce que Mercier doit penser par ailleurs. Je ne suis pas devin, j’ai un texte sous les yeux, j’essaie d’en saisir la cohérence, et me refuse à lui ajouter des éléments qui ne s’y trouvent pas, encore une fois pour me mettre dans la position du récepteur, autant que possible, et essayer de reconstruire celle du locuteur, autant que possible. L’enquête devait rester secrète, DANS LE TEXTE, pour les deux raisons que je viens d’exposer, et non parce que le général Mercier se trouvait dans une impasse politique qui n’est absolument pas évoquée ici, et pour cause.]
8 ) l’enquête est focalisée sur des expertises d’écritures qui sont en cours
[Confirmation sans équivoque, indiscutable, que la question n’est ni tranchée, ni prouvée. Autrement ces expertises ne se justifieraient pas, et la question serait réglée. La référence à des expertises en cours confirme qu’elle ne l’est pas, y compris le 17 novembre. Au passage, là encore le texte du Matin est beaucoup plus net que celui du Journal; mais les deux entretiens impliquent la même chose à cet égard]
9) le résultat de cette enquête n’est pas encore connu
[Mercier le dit et le répète; nous sommes toujours dans le même axe d’argumentation. L’une des indications qui permettent de penser que nous sommes parvenus à saisir la cohérence d’un texte, c’est justement lorsque tous les éléments du texte trouvent leur place dans la lecture, sans avoir besoin de supposer que cette cohérence n’existe pas ou qu’un élément y échappe pour une raison X ou Y extérieure au texte]
10) ce résultat de l’enquête ne sera connu que lorsque Dreyfus sera innocenté ou traduit en conseil de guerre
[Conclusion logique avec ce qui précède, non avec une affirmation de culpabilité. Et totalement différente de celle que l’on peut tirer de l’article du 28 novembre]
La conclusion de tout ceci est que, de manière remarquable, aucune de ces déclarations n’est mensongère dans son principe. Mercier croyait évidemment Dreyfus coupable quand il l’a fait arrêter; il le croyait sur la base d’une ressemblance d’écritures dans une note indiquant une livraison de documents à une puissance étrangère; mais Dreyfus nie; l’affaire doit être tranchée par expertise. Il ne s’agit pas de la vérité toute entière, elle est arrangée ici et là (plusieurs pièces au lieu d’une note, par exemple; saisie de pièces au lieu d’une liste de pièces; etc.), et Mercier a plutôt tendance à affirmer lorsqu’il accuse Dreyfus, et à mettre des conditionnels lorsqu’il évoque une possible innocence, directement ou indirectement (c’est l’un des éléments qui me conduit à penser qu’il continue à croire Dreyfus coupable — mais ce n’et évidemment pas probant à soi seul). Mais de toute manière les deux options, culpabilité ou innocence, sont clairement, nettement envisagées.
Je suis le premier à penser que Mercier ment tout le temps au cours de l’Affaire. mais ce n’est pas une raison pour changer ce qu’il dit quand ce qu’il dit correspond à ce que nous savons par ailleurs. Ce qu’il dit le 17 novembre correspond, quasiment point par point, à l’état réel de l’enquête tel que nous pouvons le reconstruire à partir de témoignages postérieurs plus fiables. C’est bizarre, mais c’est ainsi.
Passons au 28 novembre. l’exégèse sera rapide!
1) des rapports accablants contre Dreyfus m’ont été communiqués
2) il a été immédiatement arrêté
3) ce qu’il a fait ne concerne pas les Italiens
4) sa culpabilité est absolument certaine
5) il a eu des complices civils
Il n’y a aucun besoin de commentaires. La culpabilité est prouvée, le crime important (puisque le rapport est « accablant », il ne peut s’agir d’une imprudence). Rien n’est implicite, il n’y a aucun raisonnement à tenir, tout est très clair, et en particulier que Mercier ment comme un arracheur de dents. Ouf, nous voilà revenus (ou arrivés?) dans le monde normal. de l’Affaire Dreyfus. Mais cela ne fait bien sûr que renforcer le contraste avec l’entretien de la semaine précédence, dont l’analyse interne prouve de manière concluante que son fond est très différent. Ou alors, comme Philippe Oriol en évoque brièvement la possibilité, Charles Leser ment et Mercier n’a rien dit de tel le 28. Ce serait une interprétation nouvelle, à laquelle je ne crois guère pour toute une série de raisons. Nous en discuterons s’il le souhaite.
D’où l’on conclut que Mercier, qui disait plus ou moins la vérité le 17 novembre, ou du moins s’en tenait à des quarts de mensonges, ment sans complexes le 28, et, oui, se contredit (ce n’est pas la dernière fois, d’ailleurs). Et si, il peut « dire un jour qu’il n’était pas sûr en arrêtant le capitaine et soutenir 11 jours plus tard qu’il l’avait arrêter sur la foi de pièces accablantes », pour citer Philippe Oriol. C’est même exactement ce qu’il fait…
Pourquoi? Nous n’en savons rien. Philippe Oriol invoque la campagne de la Libre Parole. Mais celle-ci est nettement moins intense du 19 au 26 qu’à n’importe quel autre moment depuis début novembre, et surtout le journal de Drumont est très isolé; nous avons dépouillé Le Constitutionnel, L’Echo de Paris, Le Figaro, Le Gaulois, L’Intransigeant, Le Matin, et Le Siècle, et dans tous ces journaux la semaine du 19 au 26 le nombre d’articles sur Dreyfus varie de 0 à 2, et encore presque toujours des entrefilets. Même la Libre Parole, également dépouillée, ne consacre aucune place à l’affaire le 21 et le 25, et moins de 50 lignes tous les autres jours de cette semaine sauf deux, c’est une première pour cet organe (je n’ose employer le mot de journal) depuis le 1er novembre. L’hypothèse avancée par Philippe Oriol ne correspond donc pas au rythme réel de la campagne contre Dreyfus dans les journaux, ce qui rend difficile de comprendre pourquoi Mercier, insensible ou tout au moins résistant à cette campagne encore intense le 17, ne l’est plus alors qu’elle s’est considérablement ralentie le 28.
Je sors ici de la discussion initiale, et qu’il soit bien entendu qu’il ne s’agit que d’hypothèse: nous avons évoqué la possibilité que le dossier secret (à notre sens) ait été utilisé entre le 17 et le 28 pour convaincre Mercier. C’est possible, mais rien ne le prouve non plus.
Pour conclure sur la discussion d’origine: nous pouvons avoir des évaluations différentes du degré auquel Mercier affirme la culpabilité de Dreyfus le 17 novembre, ou de l’importance des différences entre les deux entretiens publiés le même jour. Mais il est impossible de nier que l’attitude de Mercier est très différente dans les deux entretiens du 17 de ce qu’elle est le 28, et que cette évolution mérite examen. Philippe Oriol admet « que les formules en sont différentes, que le ton n’est pas le même »; mais il faut aller plus loin, le fond a significativement changé — même s’il n’a évidemment jamais été question de voir Mercier proclamer l’innocence de Dreyfus.
Je crois avoir épuisé le sujet. Quelques réponses à deux questions spécifiques.
La première est un peu embarrassante: j’essaie en général de ne pas être trop méchant, et je n’allais pas rappeler à Philippe Oriol ce qu’il écrivait dans son blog, et qui a motivé notre premier billet. Il insiste, je serai donc précis mais bref: il nous accusait, en termes fort vifs (le lien est dans notre premier billet) d’avoir dit que le mot « certitude » ne se trouvait pas dans l’article du Journal, et d’avoir de surcroît confondu le Journal et le Matin, tout cela preuve pour lui que nous ne savions pas lire (sic). Il s’agissait d’une erreur de lecture de sa part: c’est lui qui nous avait mal lus. Je constate que ces accusations ont disparu des réponses qu’il a fournies, qui, sans être toujours très polies, redeviennent plus proche du ton normal qui sied à un échange entre chercheurs spécialistes (et au passage je tiens à préciser que dans ce cadre les CV des uns et des autres ne m’intéressent pas).
Deuxième demande, le commentaire de Du Paty. Il apparaît ici et là dans notre livre, pp. 158, 171, 198, 201, 202, surtout 207, et 211 enfin. Il a également été discuté dans notre article d’origine. La demande de Philippe Oriol m’étonne un peu car je croyais le sujet clos, mais soit, je vais ouvrir un sujet là-dessus. Il peut cependant déjà noter que
a) dans sa matérialité, le commentaire fourni par Du Paty en 1904 est, de manière démontrable absolument et sans contestation possible, pour une fois, un faux produit après 1896;
b) dans son contenu, le commentaire ajoute exactement zéro information à ce que Picquart avait rendu public en 1898 et 1899, si ce n’est une tentative de faux témoignage qui permet justement d’identifier le faux matériel.
Voilà, je laisse Pierre Stutin répondre sur la différence de réactions, mais je dois signaler que sur ce point je n’ai pas compris du tout la réponse de Philippe Oriol, qui me semble tautologique; la question est bien de savoir pourquoi Mercier est prudent le 17 et ne l’est plus le 28?
Pierre Gervais
Philippe Oriol :
Encore une fois…
Comme nous avons glissé et que nous tenons maintenant une discussion qui n’a plus rien à voir avec ce qui nous préoccupe (mon dernier post en est une belle illustration, je ne le nierai pas), je vais donc revenir à la source avant de faire deux ou trois remarques.
Cette discussion est née d’une remarque que je faisais dans mon compte rendu du livre de nos auteurs, remarque tout autant introductive qu’accessoire, et qui n’avait que pour but d’illustrer une manière de faire l’histoire que je trouve curieuse. L’essentiel n’était pas là, il était à la suite, et c’est sur ce point à vrai dire tout à fait dérisoire que l’attention a été portée. Peu importe puisqu’il semble maintenant que nous soyons en chemin pour aborder l’essentiel.
Que disais-je donc. Je m’étonnais (ou un peu plus que ça) de la note suivante :
Philippe Oriol (L’histoire de l’affaire Dreyfus, vol. 1 : L’affaire du capitaine Dreyfus 1894-1897, Stock, 2008, p. 94) affirme que Mercier fait part de sa « certitude » de la culpabilité de Dreyfus dans une autre version de ce même entretien, accordé au Journal. Ni le mot « certitude », ni une quelconque paraphrase de ce terme n’apparaissent cependant dans l’article du Matin, ou dans la version quasi identique (à une phrase près) publiée le lendemain par L’Intransigeant.
Je remarquais juste la curieuse logique du propos. Je parlais du Journal et la note me reproche que le mot que je citais ne se trouve pas dans Le Matin. Peut-être avais-je été maladroit dans ma formulation en parlant d’une « interview qu’il donnera au Journal et au Matin » sans expliquer qu’il s’agissait d’une même interview retranscrite différemment par les deux journaux. Sans doute aurais-je dû le faire… mais il n’en demeure pas moins que je citais le seul texte du Journal comme en témoigne la note infrapaginale qui ne mentionne que lui. Et les auteurs m’avaient bien compris puisqu’ils parlent d’une « autre version de ce même entretien » (pas une reprise, une autre version). Je trouvais donc – et continue à trouver – curieux de me reprocher de ne pas trouver dans Le Matin un mot que je dis se trouver et qui se trouve en effet dans Le Journal. C’est tout… Et c’était à vrai dire, au regard du reste, bien peu de choses… Mais cela dit, quand je lis cela, je ne peut que m’exaspérer et me poser des questions sur la manière de procéder et le sens réel de cette note.
Enfin je n’ai jamais dit que les deux textes, Journal/Matin et Figaro n’étaient pas les mêmes. Je dis que Mercier y proclame deux fois et dans chacun sa « certitude », la première fois entre les lignes et prudemment et la seconde clairement et fermement. Pourquoi dis-je cela ? Tout d’abord parce que les textes me l’indiquent. Laissons Le Figaro de côté puisque nous sommes d’accord. Mais en ce qui concerne les deux autres, je ne peux pas admettre, et ce parce que le texte le dit et juste parce que le texte le dit, que Mercier n’y fait pas comprendre pas qu’il croit Dreyfus coupable. Certes il ne le dit pas textuellement, certes il dit même qu’il ne peut prévoir ce que sera le résultat de l’instruction et que le procès, s’il procès il y a, aboutira dans un sens ou dans l’autre. C’est ce que je soutiens depuis le début et dans mon livre même (voir l’extrait cité dans un précédent post). Mais ce que je dis c’est que quand il affirme qu’il a fait arrêter l’officier qui « avait communiqué à une puissance étrangère des renseignements dont il avait pris connaissance en raison de ses fonctions à l’état-major de l’armée », donc un traître, il fait comprendre dans le même mouvement sa croyance en la culpabilité. Ce que je dis c’est que s’il a la prudence de dire que s’il l’a fait arrêter c’était « pour établir sa culpabilité », il ne laisse planer aucun doute sur sa certitude quand il ajoute, dans le même mouvement, d’une manière péremptoire, qu’il voulait aussi et ainsi « l’empêcher de faire de nouvelles communications,[…] et rechercher si d’autres actes de même nature ne pouvaient lui être imputés, car nous étions en droit de supposer, ou du moins de craindre, que celui dont nous étions saisi ne fût pas le seul ». L’absence ici de conditionnel ne l’indique-t-il pas ? S’il dit qu’il voulait « l’empêcher de faire de nouvelles communication », c’est donc qu’il estimait qu’il en avait fait auparavant. S’il dit qu’il était possible que « celui dont nous étions saisi ne fût pas le seul », c’est qu’il estimait que Dreyfus était celui qui avait fait des communications ». C’est tout encore…
Et ce que je dis sur cette base, qui ne repose que sur la lecture du texte, c’est que tout en jouant ce jeu, de manière insidieuse, Mercier a encore la prudence de ne pas outrepasser ses droits et refuse de se prononcer sur l’issue du procès à venir. Justement parce qu’il doit montrer qu’il n’en sait rien (alors qu’il sait qu’il aura sa condamnation puisque la décision de commettre une illégalité au procès est déjà arrêtée) et que son statut de ministre ne peut lui permettre de ne pas respecter le droit. D’où ses sorties sur le possible innocent qu’il ne faut pas déshonorer, les expertises demandées (et pas une : cinq !), etc. C’est vrai que cela ne fut pas relevé – et que j’aurais pu en parler – mais cela ne peut suffire pour annuler les phrases et leur sens.
Cette prudence initiale, je l’explique par le fait que Mercier était en péril et qu’on lui reprochait soit de ne rien faire, soit de s’être emballé, soit encore de protéger son coupable. Parlant ainsi, il restait dans son rôle tout en montrant qu’il était actif et quel était le fond de sa pensée relativement à celui que la presse avait déjà condamné avant tout procès. C’est bien sûr une interprétation mais qui me semble coïncider avec les textes. Il contentait par la même L’Intransigeant et La Libre Parole dont l’influence était grande (voir comment Saussier refusera plus tard le ministère de la Guerre à cause de la seule peur des attaques du journal de Dumont) et avec lesquels il semble (comme je l’explique dans mon livre en reprenant l’interprétation d’Eric Cahm) qu’il avait trouvé un arrangement quelques jours avant les fameuses interviews pour faire cesser leurs injurieuses attaques. On ne sait ce que furent ces arrangements, s’ils furent, mais ils purent être du même ordre et nature que celui passé avec Judet, que je raconte aussi sur la base de ses souvenirs, quand Mercier vint personnellement au début de l’affaire le convaincre de la culpabilité du traître. Mais cela ne pouvait suffire et les deux journaux voulaient plus. Telle est l’hypothèse que je soutiens dans mon livre. C’est pour cela, proposé-je encore, que comprenant qu’il ne pourrait s’en sortir sans le soutien des deux feuilles, qui s’exaspéraient d’autant plus qu’elles trouvaient l’instruction bien longue, Mercier décida de franchir le pas et de montrer à tous quel homme il était et que si étaient en jeu les intérêts supérieurs de la France (la condamnation d’un traître), le droit devait plier. Et c’est ainsi qu’il se confia à Charles Leser. Ce fut une bourde qui exaspéra les ambassades, ses collègues, une partie de la presse même acharnée mais lui permit de rallier définitivement Drumont et Rochefort, de reporter la responsabilité des lenteurs sur Saussier et de poser le terrible « Mercier ou Dreyfus » qui confortait son image de sauveur de la patrie.
Voilà ce que j’ai dit. Cela et rien d’autre…
Pour finir. Je note que Pierre Gervais répond à deux de mes questions et je veux bien commencer à discuter maintenant du « faux Du Paty ». En passant, je dois noter que sa réponse à ma question sur la mise à l’écart du commentaire Du Paty ne peut satisfaire qui que ce soit qui l’a lu. Le commentaire est bien évoqué aux pages 158, 171, etc. de son livre, je ne dis pas le contraire. Mais ma question était autre. Pourquoi n’est-il présenté que par incidente ou pour dire autre chose, pourquoi n’est-il pas dit quel témoignage il peut constituer pour connaître ce que contenait le dossier secret ? C’est pour cela que je m’agace souvent. Je réponds à tout. Je n’élude jamais et reconnais si je me trompe ou si je me suis mal exprimé. Pierre Gervais ici fait semblant de me répondre mais détourne en fait la question. Je ne lui dis pas qu’il n’a pas parlé du commentaire, je lui demande pourquoi il n’en parle pas pour ce qu’il est : un document qui ne peut être écarté, puisqu’il en est le descriptif, quand on cherche à savoir ce que contenait le dossier secret en 1894. Et en dehors du passage Valcarlos et uniquement pour illustrer celui de Picquart, rien n’est dit de ce qu’il contient et qu’en effet les lettres « érotiques » n’y figurent pas.
Maintenant Pierre Gervais a oublié une de mes questions, la plus importante. Je me permettrai donc de la lui reposer. Expliquez-moi pourquoi vous n’évoquez jamais cette phrase de Du Paty devant la Cour de cassation que votre lecture de la sténographie a dû vous faire rencontrer, cette phrase par laquelle il affirme qu’il n’avait jamais vu aucun numéro sur les pièces du dossier à l’époque du procès Dreyfus « parce que ce numérotage est postérieur au moment du procès de 1894 » ? Du Paty l’a dite, pourtant, cette phrase, et sous serment devant les magistrats de la Cour de cassation, pas à l’occasion d’une conversation avec un journaliste.
Pierre Gervais :
D’abord, à nouveau un glissement:
« certes il dit même qu’il ne peut prévoir ce que sera le résultat de l’instruction et que le procès, s’il procès il y a, aboutira dans un sens ou dans l’autre. »
« Mercier[ …] refuse de se prononcer sur l’issue du procès à venir. Justement parce qu’il doit montrer qu’il n’en sait rien (alors qu’il sait qu’il aura sa condamnation puisque la décision de commettre une illégalité au procès est déjà arrêtée) »
Non. Mercier ne parle absolument pas de procès, mais parle de l’issue de l’INSTRUCTION. Il y a plus qu’une nuance: il envisage un non-lieu SANS mise en jugement. Il n’est pas question de procès, jamais, nulle part. Il est question de l’instruction, qui est sous son autorité. Il ne se retranche pas derrière un jury. Invoquer le procès est une invention pure et simple. je suis désolé de devenir insistant, mais il est impossible de discuter si à chaque fois des éléments imaginaires sont introduits dans la discussion. Donc j’insiste: il n’y a pas de référence au procès. L’instruction est en cours, elle aboutira à un non-lieu ou à une mise en jugement.
Ensuite, à nouveau des amplifications injustifiées. Non, « donc un traître » n’est pas acceptable. « Supposer » et « craindre » sont des verbes qui jouent la même fonction qu’un conditionnel, et une phrase qui les contient ne peut être totalement affirmative. Et plus loin, « il est possible » n’est pas « il est certain ».
Enfin, une série d’affirmations dont je ne comprends pas la source:
– d’où sort cette certitude que la décision de commettre une illégalité au procès est déjà arrêtée le 17 novembre? J’aimerais bien voir la source! Ce serait certainement intéressant pour nous: nous avons passé au peigne fin les données sur les mois d’octobre à décembre 1894, et n’avons rien vu de tel. La constitution du dossier secret n’est jamais datée précisément, pas plus par Cordier que par d’autres.
– Si je comprends bien, les expertises, ou la déclaration sur la possible innocence, n’ont aucune importance parce que d’autres éléments disent le contraire. Pourquoi cette hiérarchisation? Rien ne la justifie.
– Mercier contente l’Intransigeant et la Libre Parole dans son entretien du 17 novembre? D’une part, je pense que Rochefort et Drumont doivent rougir de plaisir rétrospectivement en se voyant attribuer pareille influence dans ce qui est tout de même une République, d’autre part je ne comprends pas bien, si l’accord est signé le 17, ce qui amène Mercier à donner l’entretien du 28. Les deux journaux en voulaient plus? Pourquoi, s’il y avait accord (et préalable, en plus!)? Et où sont les sources pour tout ceci?
Bref. Pour nous, Mercier affirme sa croyance A LUI dans la culpabilité de Dreyfus le 17 novembre, mais introduit des réserves si importantes dans sa déclaration qu’elles la qualifient: Philippe Oriol nie qu’il y ait une différence entre la façon dont cette affirmation est présentée le 17 novembre et celle dont elle l’est le 28 novembre, et estime qu’il y a affirmation le 17 que Dreyfus est coupable, sans ambiguïté. C’est après tout son droit. Passons à autre chose….
Sur le témoignage de Du Paty sur la numérotation, une question qui devient importante semble-t-il (je ne me souviens pas de l’avoir rencontrée au départ sur le blog de Philippe Oriol): Du Paty sait que les pièces du dossier secret n’ont pas été numérotées, et le jure. C’est ennuyeux, parce que Du Paty ne sait pas par ailleurs quelles sont les pièces glissées dans le dossier secret distribué aux juges, ne les a pas vues, ne les a plus vues plus précisément après avoir donné son commentaire, et ne peux jurer de rien sur le contenu final du dossier — et le jure également. Il n’était PAS partie prenante de la version finale du commentaire et du dossier, il le répète sur tous les tons à chacun de ses témoignages, et donc peut difficilement savoir si elles étaient numérotées ou non, et quand. Outre le fait qu’il se parjure allègrement dans les différentes enquêtes, je ne pensais pas que ses déclarations, explicitement contradictoires, seraient prises au sérieux par quiconque, mais je me trompais. Bon, je vais ouvrir un autre sujet sur le forum quand j’aurais le temps — mais là, honnêtement, il n’y a pas urgence; décortiquer les déclarations de Du Paty, c’est une activité de week-end!
Enfin, un postscriptum sur cette histoire de note: notre note ne « reproche » rien du tout. Elle constatait, et c’est un fait, que le mot certitude apparaît dans le Journal, pas dans le Matin, donc qu’à nos yeux il y avait deux versions de l’entretien. Il ne s’agissait donc nullement d’une erreur de lecture de notre part, ni même d’un reproche (au départ du moins). Et encore maintenant je ne comprends pas bien ce qu’il y a de curieux dans notre logique, ni en quoi notre manière de procéder est exaspérante; un élément nouveau nous est apparu, nous le signalons, et signalons qu’il semble être nouveau par rapport à ce que disent les chercheurs qui nous ont précédés. C’est l’usage, du moins dans les champs d’étude que je fréquente — et c’est la première fois que je me trouve confronté à une réaction de ce genre. D’habitude, on dit: ah oui, merci, je n’avais pas vu, c’est intéressant.
Pour le commentaire. J’ai préparé un texte dont on me dit qu’il est trop long pour ce forum, et que je vais publier sur le blog en plusieurs parties. Par pitié, Philippe Oriol, lisez jusqu’au bout avant de vous lancer dans de nouveaux développements — je vous préviens, il y aura au moins trois chapitres. Je vous révèle la fin tout de suite: le commentaire Du Paty n’est pas un témoignage, c’est un faux. Ca n’est pas bien grave en plus pour votre thèse (absence de pièces érotiques), qui est beaucoup plus facilement soutenue à partir des déclarations de Picquart, dont le « commentaire » de Du Paty n’est au mieux qu’un décalque. Ce sont ces déclarations, et elles seules, qui constituent un descriptif du Dossier secret en 1896 — et pas en 1894, car pour 1894 nous n’en savons rien, cf. notre livre. Pas de pièces érotiques donc pour Picquart, vous devriez vous en tenir là. Mais enfin moi, ce que j’en dis…
Pierre Gervais
Philippe Oriol :
C’est vrai, j’ai glissé. Mercier ne parle pas de procès. J’extrapolais pour aller dans votre sens et je n’aurais pas dû. Je me fouetterai donc de ne pas retourner systématiquement à la source dans cette discussion qui n’est pas un ouvrage et qui est hébergée sur un forum. Et je surveillerai mes mots puisque je crée moi-même, en répondant trop vite, l’occasion de vous permettre de détourner l’attention. Et puisque le fond du propos est de discuter le sérieux de mon travail, je renverrai à mes ouvrages qui témoignent je crois du respect que l’ai pour notre chère méthode.
Dans le même ordre. Les éléments imaginaires que j’introduis. Là je commence à perdre patience. Nous sommes dans le plus pur grotesque. Vous rigolez, je suppose ? Vous dites : « « Supposer » et « craindre » sont des verbes qui jouent la même fonction qu’un conditionnel, et une phrase qui les contient ne peut être totalement affirmative ». Sur quoi portent « supposer » et « craindre » ? Je vous mets la phrase sous les yeux et je vous prie de vous concentrer. « Il était de mon devoir de […] rechercher si d’autres actes de même nature ne pouvaient lui être imputés, car nous étions en droit de supposer, ou du moins de craindre, que celui dont nous étions saisis ne fût pas le seul. » « Supposer » et « craindre » portent sur le second segment : la possibilité que Dreyfus eut des complices. Pas sur le premier. Et quand quelqu’un dit « Il était de mon devoir de […] rechercher si d’autres actes de même nature ne pouvaient lui être imputés », il affirme qu’un acte au moins lui est imputé. D’autres actes de même nature que quoi ? De la nature de celui qui lui a valu d’être arrêté et donc qu’il a commis. Et si cet acte est d’avoir livré des documents à l’étranger c’est donc qu’il est un traître. Mieux encore, et restez concentré, quand Mercier dit (selon l’interviewer) la phrase suivante : « Il était de mon devoir de m’assurer de lui, d’abord pour l’empêcher de faire de nouvelles communications », ne dit-il pas textuellement que Dreyfus a fait des communications puisqu’il craint qu’il n’en fît de nouvelles ? « L’empêcher de faire de nouvelles communications »… NOUVELLES… c’est donc qu’il en a déjà faites (des communications). Et si ces communications sont des notes (ou je ne sais quoi) livrées à une puissance étrangère, et des notes qui concernent la défense nationale, comment se nomme celui qui les a livrées ? Dans la langue que je pratique : un espion et, s’il n’est pas un agent double, un traître. C’est fabuleux, ça quand même… Et quand il dit qu’il « eu la certitude que cet officier était le capitaine Dreyfus » (l’officier qui a livré etc.) que dit-il sinon qu’il le considère comme coupable ? MERCIER NE DIT DONC PAS AUTRE CHOSE QUE JE LE CROIS COUPABLE MAIS JE NE PEUX EN DIRE PLUS ET JE N’EN DIRAI PAS PLUS PARCE QUE JE NE VEUX PAS INTERFERER DANS UNE QUESTION DE JUSTICE QUI N’EST PAS DE MON RESSORT. Et c’est ce paradoxe qui m’intéresse. C’est TEXTUELLEMENT ce que je dis dans mon livre : « Face à tous les mensonges colportés par la presse, Mercier, ainsi que nous le disions dans le premier chapitre, plutôt que de se taire ou de trouver d’impossibles arrangements, aurait dû démentir et garantir le droit en préservant les intérêts de l’accusé, présumé innocent jusqu’à preuve du contraire. Il ne le fit pas et aura l’audace de dire, dans une interview qu’il donnera au Journal et au Matin du 17 novembre, qu’il ne pouvait « empêcher les journaux de relater ce qu’ils croient être la vérité », que « tous les jours » il lui faudrait démentir et qu’il n’en voyait pas l’utilité dans la mesure où les commentaires étaient si « invraisemblables que leur inexactitude apparaît d’elle-même ». Voilà qui était pratique. Mais il ne se contenta pas de cette échappatoire. Si, dans cette même interview, il refusait de répondre à la question de savoir si la preuve de la culpabilité était faite, au motif qu’alors « nous sortirions du secret de l’instruction et je dois être le premier à le respecter », il affirmait parallèlement, contre toute justice, sa « certitude » de la culpabilité du capitaine Dreyfus. À la suite, il se donnait le beau rôle, précisant que s’il avait gardé le secret jusqu’à la question posée par La Libre Parole qui avait tout révélé, c’était pour « ne pas déshonorer un officier qui était peut-être innocent ».
Je veux bien que vous soyez historien et non littéraire Pierre Gervais, mais franchement, là… Et je comprends du coup la question du reproche… qui n’en est pas un… et qui est à l’origine de tout. Je donne une citation, je mets en note sa source (Le Journal) et vous me reprochez de ne pas la trouver dans Le Matin. Et il n’y a pas de problème pour vous. Et vous vous étonnez que je trouve ça « curieux » (parce que je suis poli). Je comprends bien votre logique et les lecteurs que ce forum aura peut-être un jour aussi. Il a dit que l’interview avait été publiée dans Le Journal et dans Le Matin et donc si elle n’est pas dans Le Matin alors qu’il ne cite que le Journal c’est qu’il y a erreur. Il cite Le Journal mais je n’irai pas voir puisqu’elle n’est pas dans Le Matin (ou variante que je ne peux imaginer : je sais qu’elle est dans Le Journal et je ne le dirai pas). Je trouve ce procédé « curieux ». Et je vous aurais répondu : « ah oui, merci, je n’avais pas vu, c’est intéressant » si vous aviez fait votre note comme on pouvait l’attendre en disant que je m’étais trompé en laissant penser par ma formulation que les deux interviews étaient les mêmes et que j’aurais dû écrire qu’elles disaient la même chose mais de deux manières différentes. C’est ce que j’aurais fait… ou pas non seulement parce la chose est dérisoire mais surtout parce que j’aurais compris le propos en constatant que le seul Journal était donné en note et pas Le Matin.
Le reste en quelques mots.
Cette certitude que la décision de commettre une illégalité au procès est déjà arrêtée le 17 novembre « sort » non pas du chapeau auquel vous semblez penser mais des témoignages qui corroborent que la décision de constituer le dossier secret a été prise antérieurement au 17. Un dossier secret est secret. Il ne sera donc pas montré qu’à ceux qui peuvent le voir et qui pourront en avoir besoin. Peut-être à l’instructeur qui sera désigné (s’il la décision de constituer le dossier est antérieure au 3 novembre) ou a été désigné (si elle est postérieure), et puisqu’il y aura procès (comme il devait y avoir instruction) – parce que Mercier a, je le crois, besoin de son procès -, aux juges du procès à venir.
Expertises et déclarations d’innocence, ensuite. Elles ont certes de l’importance mais à mon sens ne sont présente dans cette interview que parce que Mercier ne peut faire autrement qu’en parler. Elles ne sont à mon sens qu’une réponse à la tactique Demange qui en parlait à tous et en tout premier lieu à son ami Cassagnac qui le 15 en avait fait le centre de son leader.
L’influence de Rochefort et Demange encore. Eh oui elle était grande. Petits tirages certes mais feuilles à la grande influence. Ce n’est pas uniquement parce que Dreyfus était juif qu’on s’adressa à La Libre Parole pour tout révéler, c’est aussi, et entre autres, dans ses colonnes que fut publié le « dixi », c’est chez Rochefort que vint Pauffin, etc. Par hasard ??? Et je rappelle à nouveau l’épisode de Saussier possible ministre… J’en ai parlé, je ne recommence pas (voir les souvenirs de Louis Le Gall).
Du Paty et les numéros. Oui il n’a pas vu l’état dernier du dossier. Mais il ne dit pas qu’il n’a pas vu les numéros, il dit une phrase qui laisse entendre que ce n’était pas encore dans les usages. Mais sans doute ment-il…
Et sinon pas d’inquiétude. Je vous lis jusqu’au bout… même si je n’ai pas de thèse qui est un peu celle de tout le monde…