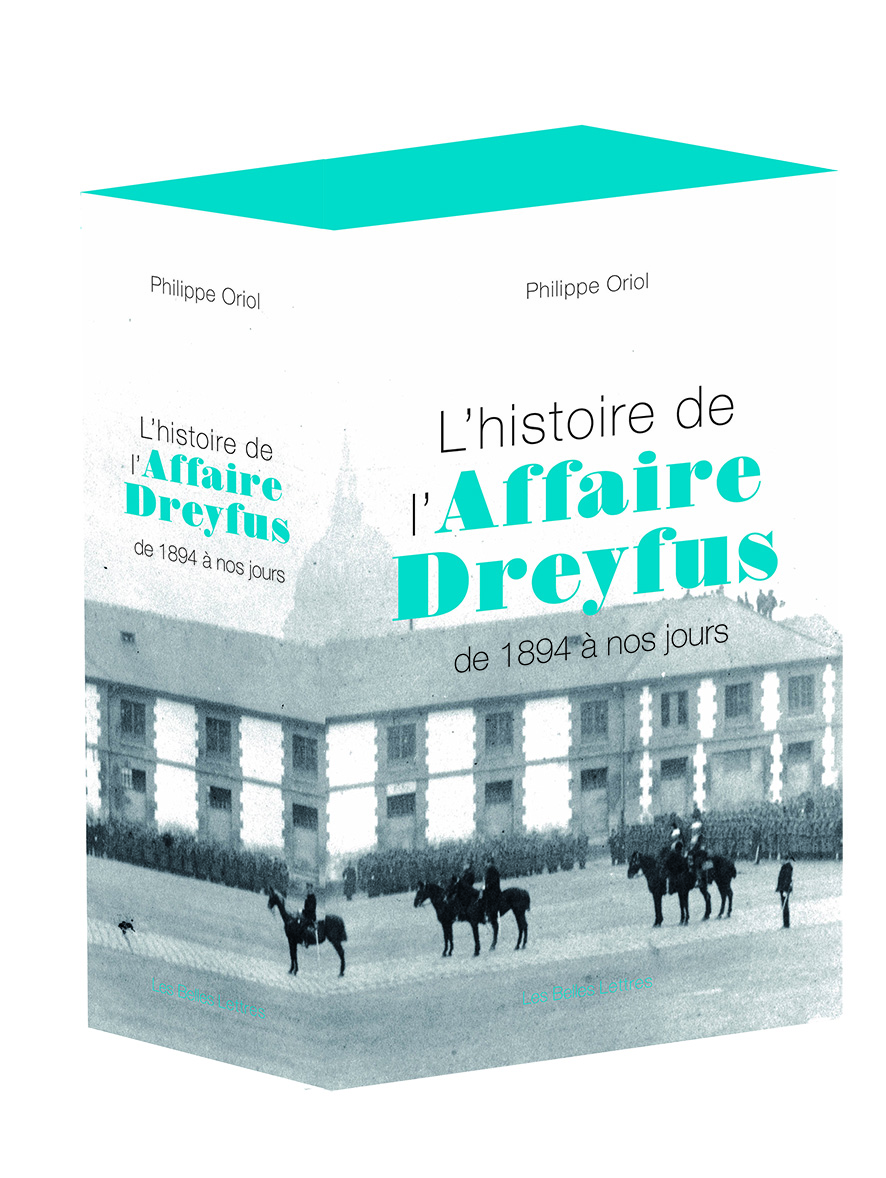En librairie depuis un mois, L’Histoire de l’Affaire Dreyfus de 1894 à nos jours (les Belles Lettres) par Philippe Oriol.
Archives de catégorie : Actualités
L’affaire Dreyfus au Mexique
Une thèse consultable en ligne sur l’affaire Dreyfus au Mexique : La recepción del caso Dreyfus en la prensa del porfiriato y en la comunidad judía de México (1894-1906) par Andrés Orgaz Martinez. On clique ici.
Jean-Jacques Tur, L’affaire Zola-Dreyfus. Le Vortex et la Trombe
Une intéressante conférence de Vincent Duclert
Une conférence du Vincent Duclert inspecteur de l’éducation nationale devant le public de l’APHG. A voir ici.
L’Affaire dans quelques récents numéros de revues universitaires III
Nouvelles glanes du semestre :
Le Monde rend hommage à « Michel Drouin (1934-2014), historien de l’affaire Dreyfus »
Par Philippe-Jean Catinchi. Publié sur lemonde.fr le 25 novembre 2014 :
Bertrand Joly, Histoire politique de l’affaire Dreyfus
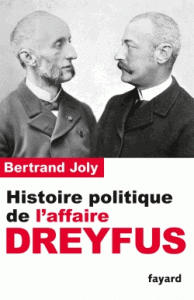 Bertrand Joly, Histoire politique de l’affaire Dreyfus, Paris, Fayard, 2014, 784 p. 32 €
Bertrand Joly, Histoire politique de l’affaire Dreyfus, Paris, Fayard, 2014, 784 p. 32 €
Ce livre est considérable. Agréable à lire, fondé sur une érudition impeccable, libre et distancié, drôle souvent, il est et demeurera longtemps un des trois ou quatre livres importants écrits sur l’Affaire. Le parti pris de Bertrand Joly est en soi original : appréhender non l’Affaire de « l’intérieur » mais de « l’extérieur », non par « le bas » mais par « le haut » ; non du côté de la famille Dreyfus ou de l’État-major mais du côté du gouvernement et de la représentation nationale, non du côté des journalistes et des publicistes mais de celui de la presse, non du côté des individualités mais de celui des groupes ou des institutions auxquelles ils appartenaient. L’affaire Dreyfus, l’affaire Esterhazy, l’affaire Zola, l’affaire Picquart, l’affaire Du Paty de Clam, « l’affaire de Dreyfus » sont à peine évoquées ici, autrement que parce qu’elles permettent de comprendre l’enchaînement des événements – constituant pour ainsi dire, dans cette perspective « retournée », le contexte –, et s’effacent pour laisser la place à l’Affaire, l’affaire politique, dont sont retracées, sur la base d’un travail archivistique étourdissant, les péripéties et fixés les causes, les enjeux et les conséquences en une analyse minutieuse et fine. En décalant ainsi le point de vue, le livre de Bertrand Joly nous offre à lire véritablement une autre histoire, qui est aussi celle des débuts de la Troisième République, une histoire de ses structures, des courants, des groupes et des hommes qui en étaient les acteurs et dont l’auteur suit pas à pas les positions, les hésitations, les évolutions. Mais avant tout, ce grand livre donne un tout autre éclairage à la célèbre Affaire qui remet en question tant d’évidences qui ne le furent en fait jamais et dont l’acceptation, l’exposition et la répétition ont faussé la perception de l’événement. Bertrand Joly nous extirpe de cette vision imposée d’un combat du bien et du mal, de la grande cause morale qui déchira la France pour nous montrer, en ramenant l’Affaire dans ses causes à ses justes proportions, ce qu’elle fut vraiment :
Michel Drouin nous a quittés
 Notre ami Michel Drouin nous a quittés cette nuit après un long et admirable combat contre la maladie. Attaché de recherches au CNRS (Institut des textes et manuscrits modernes, équipe Zola), Michel était historien de la littérature et le grand spécialiste d’André Suarès. Historien de formation, il travaillait depuis de longues années sur l’affaire Dreyfus et a laissé deux ouvrages importants : L’Affaire Dreyfus de A à Z (Flammarion 1994, réédition augmentée en 2006) et Zola au Panthéon. La Quatrième affaire Dreyfus (Perrin, 2008). Depuis 2001, Michel avait entrepris, chez Mémoire du Livre, la réédition des textes sur l’Affaire de Clemenceau, auquel il consacrait maintenant l’essentiel de ses pensées : L’Iniquité (2001), Vers la réparation (2003), Contre la Justice (2007) et Des juges (2009). Michel était aussi secrétaire de la SIHAD depuis sa fondation en 1995.
Notre ami Michel Drouin nous a quittés cette nuit après un long et admirable combat contre la maladie. Attaché de recherches au CNRS (Institut des textes et manuscrits modernes, équipe Zola), Michel était historien de la littérature et le grand spécialiste d’André Suarès. Historien de formation, il travaillait depuis de longues années sur l’affaire Dreyfus et a laissé deux ouvrages importants : L’Affaire Dreyfus de A à Z (Flammarion 1994, réédition augmentée en 2006) et Zola au Panthéon. La Quatrième affaire Dreyfus (Perrin, 2008). Depuis 2001, Michel avait entrepris, chez Mémoire du Livre, la réédition des textes sur l’Affaire de Clemenceau, auquel il consacrait maintenant l’essentiel de ses pensées : L’Iniquité (2001), Vers la réparation (2003), Contre la Justice (2007) et Des juges (2009). Michel était aussi secrétaire de la SIHAD depuis sa fondation en 1995.
Il était un grand ami et nous perdons à la SIHAD le plus jeune et le plus enthousiaste d’entre nous. Parfait honnête homme, fin connaisseur de l’Affaire, il laisse inachevé un important projet sur lequel il travaillait depuis de très nombreuses années : une édition des « papiers » de l’île du Diable, cahiers des gardiens de Dreyfus et correspondances de toute la chaîne hiérarchique chargée de garder ce formidable prisonnier. Un projet que j’essaierai de mener à bien sur la base du travail déjà réalisé par Michel.
Philippe Oriol, L’Histoire de l’affaire Dreyfus de 1894 à nos jours
26 Comment parler de ce monument de 1500 pages que Philippe Oriol vient de nous livrer ? Fruit de multiples années de travail, il propose un récit inégalé de l’Affaire reposant sur l’exploitation de l’ensemble des archives disponibles et sur un patient dépouillement de la presse nationale comme de la presse provinciale. Il m’est impossible d’en rendre compte dans le détail. Je me contenterai de souligner son ampleur pour inviter les lecteurs des Cahiers naturalistes à faire entrer dans leur bibliothèque cette somme dreyfusarde appelée à remplacer, comme outil de travail et de recherches, la grande Histoire de l’affaire Dreyfus, en sept volumes, publiée par Joseph Reinach entre 1901 et 1911. Si Reinach s’arrêtait à la révision de 1906, Philippe Oriol, en revanche, va bien plus loin, jusqu’à « nos jours », comme l’annonce la couverture du volume. Dépassant la frontière de 1906, il traite de la « quatrième affaire Dreyfus », celle de 1908 (l’affaire Grégori, liée à la panthéonisation de Zola), et, après avoir parcouru l’entre-deux-guerres, il s’avance jusque dans l’époque contemporaine, en analysant les années que nous venons de vivre, marquées par les commémorations successives de 1994 (le centenaire de la condamnation d’Alfred Dreyfus), de 1998 (le centenaire de « J’accuse »), de 2006 (le centenaire de la réhabilitation de Dreyfus) et de 2008 (le centenaire de la panthéonisation). En terminant, dans une dernière partie qui étudie la « postérité de l’Affaire », il recense les différentes adaptations littéraires, romanesques ou théâtrales (en fournissant notamment une liste de romans antidreyfusards peu connus). Puis il reprend méthodiquement toute l’historiographie de l’Affaire en dénonçant les thèses illusoires avancées par les chercheurs d’épaves de « l’histoire canon », habiles en hypothèses farfelues lorsqu’ils imaginent une réécriture de l’Affaire fondée sur la sauvegarde, par les services du contre-espionnage, des secrets du canon de 75. De telle sorte qu’il ne se contente pas de nous livrer une histoire de l’affaire Dreyfus, mais il médite sur la place que nous occupons dans la mémoire dreyfusarde, invitant même son lecteur (dans l’une des notes de sa conclusion, n.74, p. 1136) à poursuivre la réflexion sur son blog de la SIHAD.
Comment parler de ce monument de 1500 pages que Philippe Oriol vient de nous livrer ? Fruit de multiples années de travail, il propose un récit inégalé de l’Affaire reposant sur l’exploitation de l’ensemble des archives disponibles et sur un patient dépouillement de la presse nationale comme de la presse provinciale. Il m’est impossible d’en rendre compte dans le détail. Je me contenterai de souligner son ampleur pour inviter les lecteurs des Cahiers naturalistes à faire entrer dans leur bibliothèque cette somme dreyfusarde appelée à remplacer, comme outil de travail et de recherches, la grande Histoire de l’affaire Dreyfus, en sept volumes, publiée par Joseph Reinach entre 1901 et 1911. Si Reinach s’arrêtait à la révision de 1906, Philippe Oriol, en revanche, va bien plus loin, jusqu’à « nos jours », comme l’annonce la couverture du volume. Dépassant la frontière de 1906, il traite de la « quatrième affaire Dreyfus », celle de 1908 (l’affaire Grégori, liée à la panthéonisation de Zola), et, après avoir parcouru l’entre-deux-guerres, il s’avance jusque dans l’époque contemporaine, en analysant les années que nous venons de vivre, marquées par les commémorations successives de 1994 (le centenaire de la condamnation d’Alfred Dreyfus), de 1998 (le centenaire de « J’accuse »), de 2006 (le centenaire de la réhabilitation de Dreyfus) et de 2008 (le centenaire de la panthéonisation). En terminant, dans une dernière partie qui étudie la « postérité de l’Affaire », il recense les différentes adaptations littéraires, romanesques ou théâtrales (en fournissant notamment une liste de romans antidreyfusards peu connus). Puis il reprend méthodiquement toute l’historiographie de l’Affaire en dénonçant les thèses illusoires avancées par les chercheurs d’épaves de « l’histoire canon », habiles en hypothèses farfelues lorsqu’ils imaginent une réécriture de l’Affaire fondée sur la sauvegarde, par les services du contre-espionnage, des secrets du canon de 75. De telle sorte qu’il ne se contente pas de nous livrer une histoire de l’affaire Dreyfus, mais il médite sur la place que nous occupons dans la mémoire dreyfusarde, invitant même son lecteur (dans l’une des notes de sa conclusion, n.74, p. 1136) à poursuivre la réflexion sur son blog de la SIHAD.
Autour de la sortie de L’Histoire de l’affaire Dreyfus de Philippe Oriol. Une rencontre à la Médiathèque baron Edmond de Rothschild de l’Alliance israélite universelle
Infos à la suite :