On nous les avait demandés. Voici donc. On clique : ici.
On nous les avait demandés. Voici donc. On clique : ici.
Aux origines de le police scientifique. Alphonse Bertillon, précurseur de la science du crime
Dreyfus et Bernard Lazare nouveaux produits du marketing antisémite
Dreyfus et Bernard Lazare nouveaux produits du marketing antisémite (suite)
Serge Doessant, Le Général André. De l’affaire Dreyfus à l’affaire des fiches
Une thèse sur les transpositions romanesques de l’affaire Dreyfus
Vincent Duclert, L’Affaire Dreyfus. Quand la justice éclaire la République
Dreyfus et la question homophobe I. A propos de l’article de la RHMC
Dreyfus et la question homophobe II. A propos de l’article de L’Histoire.
Dreyfus et la question homophobe III. Dreyfus, le dossier secret et la question homosexuelle… suite
Dreyfus et la question homophobe IV. A propos du livre : Le Dossier secret de l’affaire Dreyfus.
Dreyfus et la question homophobe VII. Le commentaire Du Paty. Discussion avec Pierre Gervais
Avec gentillesse et élégance, Pierre Gervais vient de me faire parvenir le livre, écrit en collaboration avec Pauline Peretz et Pierre Stutin, que j’annonçais dans le premier post sur le sujet : Le Dossier secret de l’affaire Dreyfus, publié chez Alma éditeur. Dans sa dédicace, dont je le remercie, il « espèr[e] que ce travail [me] plaira plus que le précédent ! ». Je crains d’être décevant mais je dois dire que cet opus n’est pas plus convaincant que les deux articles précédemment publiés.  Si la lecture en est agréable, si la documentation, quoi que partielle – partiale ? ; nous en reparlerons –, est sûre et la connaissance du sujet indiscutable dans ses plus grandes lignes – on verra, comme on a pu déjà le voir (cf. par exemple ce qui concerne l’argument tiré de Cuignet dans notre premier article), qu’il n’en est pas de même des détails qui font la complexité de l’Affaire et, seuls, en permettent une juste compréhension –, si la première partie, mise en place (jusqu’à la page 116) sur la Section de statistique et les attachés militaires et leur monde est tout à fait remarquable de précision et de justesse, si la courte synthèse sur la « dépêche Panizzardi » (p. 144-153) l’est tout autant, la thèse qui en est le centre et l’argumentation qui la fonde n’emportent toujours pas la conviction du lecteur connaissant bien le sujet et cela pour une unique question de méthode. Et ce d’autant plus qu’elle est hautement revendiquée et tout à fait abusivement présentée comme étant ici mise en pratique pour la première fois. Il est pour le moins hardi de soutenir que « l’étude de l’affaire Dreyfus […] a jusqu’à présent eu tendance à privilégier la narration » (p. 13). Que sont, entre autres, les travaux de Maurice Baumont, de Marcel Thomas, de Vincent Duclert, les miens aussi ? Mais il ne suffit pas de parler de retour aux sources, de leur approche critique… il faut en effet le faire et le faire jusqu’au bout. Il faut aussi prendre ces sources pour qu’elles sont, pour ce qu’elles disent et non pour ce qu’on veut y voir. Et la moindre des choses pour qui reproche aux autres de ne pas travailler sérieusement est de ne pas tomber grossièrement dans les travers dénoncés. Un exemple personnel et pour cela secondaire mais tout à fait significatif. Page 315, en note 6, les auteurs me donnent la leçon en précisant que :
Si la lecture en est agréable, si la documentation, quoi que partielle – partiale ? ; nous en reparlerons –, est sûre et la connaissance du sujet indiscutable dans ses plus grandes lignes – on verra, comme on a pu déjà le voir (cf. par exemple ce qui concerne l’argument tiré de Cuignet dans notre premier article), qu’il n’en est pas de même des détails qui font la complexité de l’Affaire et, seuls, en permettent une juste compréhension –, si la première partie, mise en place (jusqu’à la page 116) sur la Section de statistique et les attachés militaires et leur monde est tout à fait remarquable de précision et de justesse, si la courte synthèse sur la « dépêche Panizzardi » (p. 144-153) l’est tout autant, la thèse qui en est le centre et l’argumentation qui la fonde n’emportent toujours pas la conviction du lecteur connaissant bien le sujet et cela pour une unique question de méthode. Et ce d’autant plus qu’elle est hautement revendiquée et tout à fait abusivement présentée comme étant ici mise en pratique pour la première fois. Il est pour le moins hardi de soutenir que « l’étude de l’affaire Dreyfus […] a jusqu’à présent eu tendance à privilégier la narration » (p. 13). Que sont, entre autres, les travaux de Maurice Baumont, de Marcel Thomas, de Vincent Duclert, les miens aussi ? Mais il ne suffit pas de parler de retour aux sources, de leur approche critique… il faut en effet le faire et le faire jusqu’au bout. Il faut aussi prendre ces sources pour qu’elles sont, pour ce qu’elles disent et non pour ce qu’on veut y voir. Et la moindre des choses pour qui reproche aux autres de ne pas travailler sérieusement est de ne pas tomber grossièrement dans les travers dénoncés. Un exemple personnel et pour cela secondaire mais tout à fait significatif. Page 315, en note 6, les auteurs me donnent la leçon en précisant que :
Philippe Oriol (L’histoire de l’affaire Dreyfus, vol. 1 : L’affaire du capitaine Dreyfus 1894-1897, Stock, 2008, p. 94) affirme que Mercier fait part de sa « certitude » de la culpabilité de Dreyfus dans une autre version de ce même entretien, accordé au Journal. Ni le mot « certitude », ni une quelconque paraphrase de ce terme n’apparaissent cependant dans l’article du Matin, ou dans la version quasi identique (à une phrase près) publiée le lendemain par L’Intransigeant.
Savons-nous lire ? J’ai parlé, p. 118 et non p. 94 (ce qui déjà est inquiétant), d’un article du Journal et les auteurs me reprochent que ce que j’en cite ne se trouve pas dans un autre article publié dans un autre journal (Le Matin) !!!! J’avoue ne pas comprendre. Et cela est dommage car si nos auteurs avaient pris la peine, comme le ferait tout historien sérieux, d’aller voir la collection du Journal (BNF micr d 205) et d’y lire l’article dont je parle signé H. Bathélemy et titré : « Le crime de trahison. Chez le ministre de la guerre », ils auraient pu y trouver l’expression de cette certitude (« […] je ne sais rien sur la nature et le nombre des pièces qu’il [Dreyfus] a pu copier et livrer, en dehors de celles que nous avons saisies ») et le mot lui-même :
Des incidents, sur lesquels je n’ai pas à m’expliquer ; sur lesquels, du reste, vous ne me questionnez pas, ont mis entre mes mains des notes qui émanaient d’un officier et qui prouvaient qu’il avait communiqué à une puissance étrangère des renseignements dont il avait pris connaissance en raison de ses fonctions à l’état-major de l’armée.
Dès que j’ai eu la certitude que cet officier était le capitaine Dreyfus, j’ai donné l’ordre de l’arrêter.
Voilà pour le moins de drôles de manière de faire et qui nous interrogent sur la valeur totale d’un travail qui parle de méthode et l’ignore absolument.
Mais cette question de méthode se révèle surtout dans la nécessité des auteurs pour servir leur thèse de forcer le sens des sources qu’ils utilisent. Ainsi, p. 186-187, citent-ils un rapport de Gonse de 1897 :
On voudra peut-être rejeter l’authenticité des documents (correspondance de P…. avec S….) dont il vient d’être question ? Ce serait vraiment bien difficile, attendu que le nombre des documents similaires, obtenus de la même façon, que nous possédons est tellement important et leur nature est si variée que le doute est impossible. Il en existe même qui ont une allure tellement intime et les personnes qu’ils concernaient ont un intérêt tellement évident à leur conserver leur caractère secret, que le seul fait de leur remise au Service prouve surabondamment leur authenticité, et par conséquent celle de tous les documents provenant de la même source parmi lesquels figurent ceux cité dans la présente note.
Quelle interprétation nos auteurs font-ils de ce texte ? Comment répondent-ils à cette question importante qui donne la clé de toute leur « démonstration » ?
Pourquoi Gonse insista-t-il à ce point sur l’« allure tellement intime » d’une partie de la correspondance ? Les conjurés mirent en avant une raison fort peu convaincante : la fonction d’authentification que pouvaient avoir les pièces à connotation sexuelle à l’égard du dossier principal. Cette authentification n’était pourtant nullement nécessaire : le ministère de la Guerre disposait d’une abondante correspondance officielle entre les attachés, dénuée de toute allusion sexuelle, qui aurait tout aussi bien pu contribuer à remplir cette fonction. Or les lettre échangées entre Schwartzkoppen et de Weede ne révèlent rien d’autre que la relation d’adultère qui les unissait. Leur présence prouve donc que les militaires eurent la volonté d’accentuer la dimension sexuelle du dossier.
Voilà qui force pour le moins et le texte et les faits. Que dit Gonse dans l’extrait précédemment cité ? Qu’on ne pouvait mettre en doute l’authenticité du faux Henry (« correspondance de P…. avec S…. ») – ce qui soit dit en passant était déjà un aveu et indiquait bien la part qu’il put y prendre. Pourquoi, selon lui, ce doute n’était-il pas possible ? Parce que les pièces étaient si nombreuses et de nature si variée, révélant même un tel degré d’intimité, qu’il n’aurait pas été possible des les fabriquer. Qui aurait pu écrire de tels propos, qui aurait pu entrer dans de tels secrets, sinon l’attaché militaire lui-même ? Si le dossier venait se grossir de ces pièces intimes ce n’était pas pour en « accentuer la dimension sexuelle » mais indiquer, grâce aux lettres qui en témoignaient, l’authenticité du « faux Henry », pièce trop parfaite pour ne pas faire naître le doute. Que nos auteurs fassent dire à un texte autre chose que ce qu’il dit est un problème. Mais qu’ils en tirent, sans le moindre argument, des conclusions pour expliquer leur thèse sur le cas particulier du dossier de 1894, en est un autre et un autre bien plus grave. Que leur permet, sur la base du témoignage de Gonse, d’écrire que « Mercier et ses successeurs justifièrent l’utilisation des “pièces de comparaison”, expression qui désignait les documents à contenu intime, par la nécessité d’authentifier les autres pièces » (p. 250) ? Nous avons le texte mal lu de Gonse mais rien sur Mercier qui permette une telle affirmation… Et pour cause puisqu’ainsi que le prouve indiscutablement le passage cité de Gonse c’est dans la perspective de l’authentification du « faux Henry » – donc à partir de 1897, quand fut relancée l’Affaire et mise en avant une pièce qui devenait tout à coup bien encombrante – que les « conjurés » eurent recours aux pièces à caractère intime.
Et le mieux – car il y a toujours mieux – est que nos auteurs font de cet extrait cité la justification de l’apport au « dossier de “26 lettres et cartes comprenant la correspondance de Panizz. avec les attachés militaires allemands”, datées de 1890 à 1896, et “45 lettres et cartes de M(me) de W… à Schw…” » (p. 186). Ces deux citations, qui semblent présentées comme émanant d’un même document, sont en fait l’assemblage de deux pièces distinctes : l’extrait de Gonse est d’un rapport du 29 octobre 1897 ; le passage juste cité d’un autre du mois suivant, du 29 novembre. Et encore une fois, Gonse (pour Boisdeffre qui signait) évoquait ces lettres qu’il transmettait pour la première fois dans l’unique but d’authentiquer le « faux Henry ». Il le faisait ici non pas pour dire la culpabilité de Dreyfus mais en principal argument pour faire comprendre à son ministre qu’il ne fallait pas accéder à la demande de Panizzardi d’être relevé de l’immunité diplomatique et ainsi à être admis à témoigner en justice. Panizzardi, auteur de la lettre dans laquelle était mentionné en toutes lettres le nom de Dreyfus (le « faux Henry »), expliquait Gonse, était non seulement « partie trop intéressée dans la question pour que son témoignage puisse être recevable » mais surtout obligerait l’état-major, pour le contrer, à brûler une pièce importante dont la production pourrait un jour devenir nécessaire « soit qu’un ancien ministre soit mis en cause, soit qu’on tente la révision du procès […] » (AN BB19 108). N’est-il pas étonnant de voir comment cette note essentielle, qui prouve la participation de Boisdeffre à une collusion qui avait bien pour but d’empêcher la révision et la mise en jugement de Mercier (l’ancien ministre), peut être réduite, sur une lecture forcée et une présentation tronquée et inexacte, à la secondaire question de la « correspondance intime »…
Une vraie déception, donc, devant des manières de faire pour le moins douteuses mais aussi par le fait qu’arrivé au terme de cet ouvrage on demeure sur sa fin. Quel dommage que ne soient pas tenues les promesses du titre. Nous pouvions espérer trouver dans cette étude une véritable histoire du dossier secret, de sa constitution en 1894 à son dernier inventaire fin 1898 mais il n’en est rien. Rien sur ses différents états (que nous listions dans notre premier post sur le sujet) dont nous avions espéré, puisqu’il n’en existe plus aucune trace, retrouver ici une description précise. Il est question de l’hypothétique premier (celui de 1894), un peu des deux derniers, mais rien n’est dit des cinq états intermédiaires qui ne sont pas même évoqués (pourquoi ?) et qui auraient permis de comprendre comment procédèrent les hommes de la Section de statistique et de l’état-major pour consolider une bien fragile accusation. Les auteurs semblent certes le faire, quand il parlent de dossier « complété »(p. 186) pour introduire les lettres « intimes » mais, comme nous l’avons vu, parlent en fait de tout autre chose : de notes ponctuelles dans lesquelles l’inventaire de pièces n’avaient que pour but d’illustrer le propos du moment…
Et nos auteurs peuvent se réclamer, en une partie pour le moins embrouillée, des médiévistes et de leur travail sur les variantes des manuscrits, ils ne nous prouvent rien. Dans mes précédents posts, comme dans les deux réponses faite à L’Histoire par Vincent Duclert et par moi-même, il était reproché aux trois auteurs de considérer un peu légèrement le brouillon du commentaire de Du Paty en arguant sans le moindre argument de faux un document qui contredit leur thèse. Ils ont, dans leur opus, réglé définitivement le problème en se contentant de l’évoquer sans dire ce qu’il contient, sans dire qu’il décrit précisément le contenu du dossier de 1894 et que bien sûr il ne fait pas la moindre allusion aux pièces « homosexuelles ». Il est pratique de laisser de côté une pièce quand elle dessert ce qu’on veut démontrer… L’histoire ne peut se faire en suivant de tels procédés… Et pourquoi, encore, oublier ce propos de Du Paty qui règle une fois pour toute la question de la numérotation à l’encre rouge ? Du Paty n’avait jamais vu à l’époque du procès Dreyfus « aucun numéro sur les pièces », ainsi qu’il le dira en 1904, « parce que ce numérotage est postérieur au moment du procès de 1894 » (Déposition Du Paty à l’occasion de la seconde révision dans La Révision du Procès de Rennes. Enquête de la Chambre criminelle de la Cour de cassation (5 mars 1904-19 novembre 1904), Paris, Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen, 1908, t. I, p. 239).
Nous voulons croire que nos trois auteurs sont de bonne foi et, sans apporter de réponse faute d’une réelle et complète connaissance d’un sujet complexe, posent une question qui mérite peut-être de l’être. Mais ils ne peuvent nous convaincre en procédant de cette manière, en trouvant dans les textes ce que les auteurs ne disent pas et qu’ils veulent y voir, en écartant systématiquement tout ce qui contredit leur thèse et en faisant comme si ces documents problématiques à leur point de vue n’avaient jamais existé, en changeant de point de vue à chaque nouvelle version de leur travail et en se contentant, faute de l’appliquer, de parler de méthode. Si la question mérite donc d’être posée, il faudra encore attendre un peu pour en avoir la réponse… Dans cette attente nous nous contenterons, pour décrire le dossier de 1894, de continuer à donner crédit au seul document contemporain, document qui en fait la description et en faisait partie, et qu’on ne peut, pour les raisons que nous avons données dans notre précédent post arguer sérieusement de faux : le commentaire de Du Paty qui mérite d’être donné ici intégralement. Et quant aux évolutions du dossier à travers le temps, nous nous contenterons encore de nous reporter au peu que put en dire Targe en 1904 et regretter que ces inventaires d’octobre 1897, janvier, mars et les deux d’avril 1898 aient disparu des archives.
Source : La Révision du procès de Rennes (15 juin 1906- 12 juillet 1906). Réquisitoire écrit de M. le procureur général Baudouin, Paris, Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen, 1907, p. 79 et La Révision du Procès de Rennes. Enquête de la chambre criminelle de la Cour de cassation (5 mars 1904-19 novembre 1904), op. cit., t. I, p. 374-375.
NB. Cette version a été revue et augmentée le 2 octobre 2012 à 16h30….
Nous ouvrons une discussion sur la question, bientôt tout aussi lassante que celle du canon de 75, à l’occasion de la prochaine actualité que constitue la publication, annoncée pour octobre, d’un nouvel article sur le dossier secret et la question homosexuelle, dans L’Histoire, de Pierre Gervais, Pauline Peretz et Pierre Stutin (qui remplace Romain Huret) et celle d’un prochain ouvrage des mêmes intitulé : Le Dossier secret de l’affaire Dreyfus (voir à ce sujet notre précédent post : « Dreyfus et la question homosexuelle« ).
Nous commenterons ces deux nouveautés à leur parution. Mais pour préparer la discussion, ouvrons un post sur le premier article, celui publiée en 2008 dans la Revue d’Histoire Moderne & Contemporaine (55-1, janvier-mars 2008) sous le titre : « Une relecture du “dossier secret” : homosexualité et antisémitisme dans l’affaire Dreyfus (téléchargeable ici : Cairn).
Nous donnerons ici deux textes. Celui de Marcel Thomas, tout d’abord, écrit dès 2008 pour une publication qui ne put se faire et qui prendra place, comme le suivant, dans le Cahier de la SIHAD à paraitre. A la suite, nous donnerons un complément par l’auteur de ces lignes et qui proposera une discussion sur les arguments présentés par notre trio.
Po

À propos d’Une relecture du « Dossier secret »…
Découverte ou mirage ?
Plus d’un siècle après le dernier épisode judiciaire de l’affaire Dreyfus, ni en France, ni à l’étranger, on n’a fini d’« en parler ». Nombre de chercheurs et d’historiens, professionnels ou amateurs, restent à juste titre persuadés qu’il subsiste à propos de ce drame national et de son contexte, des études sociopolitiques à entreprendre, des motivations individuelles ou collectives à analyser et quelques zones à scruter où toute l’ombre n’est pas encore dissipée en dépit des efforts déployés depuis plus d’un siècle pour faire enfin sortir du puits une vérité trop longtemps dissimulée.
Il s’en faut notamment de beaucoup que nous connaissions dans tous leurs détails les activités – et les machinations – des services tant français qu’étrangers dont chacun, à la Belle Époque comme aujourd’hui, avait mission de voler les secrets des autres et de protéger les siens. De tout temps, dans tous les pays du monde, la manipulation, l’intoxication, la corruption, le vol, le chantage, le faux, ont constitué entre leurs mains ces armes dont l’intérêt national justifie l’usage, mais exige le mystère.
Certes chacun sait aujourd’hui, et cela depuis longtemps, que « l’Affaire » est née d’un banal épisode de la guerre secrète qui opposait à la fin du XIXe siècle la « Section de Statistique » en France et le « Nachrichtenbüro » de l’autre côté du Rhin et que la monstrueuse erreur judiciaire qui enverrait au bagne un officier innocent naîtrait de la communication illégale à ses juges d’un « dossier secret », composé, sur ordre supérieur, de pièces fournies par notre service d’espionnage. Personne n’ignore non plus que c’est à ce même service qu’allait parvenir plus tard (dans des conditions d’ailleurs encore incomplètement éclaircies) le document révélant le nom du vrai coupable et que ce serait son nouveau chef qui, le premier, acquerrait, pièces en main, la conviction de l’innocence de Dreyfus, tandis qu’à son insu l’un de ses subordonnés, pour empêcher la vérité de voir le jour, trufferait de plusieurs faux un dossier nourri de documents recueillis par l’un de nos agents dans les locaux de l’ambassade d’Allemagne.
On ignore en revanche à peu près tout ce qui concerne les activités des agents à notre solde qui livraient aux attachés militaires allemands de « vrais-faux » documents officiels, fabriqués dans les bureaux de l’État-Major français dont l’existence a été reconnue par le Gal. Mercier à Rennes et par le Cdt. Targe au cours de la deuxième révision1.
C’est assez dire que pour connaître et surtout pour comprendre dans tous ses détails le fonctionnement des rouages occultes qui, de 1894 à 1899, provoquèrent d’abord la condamnation puis à long terme la réhabilitation du capitaine Dreyfus, les archives de notre « Section de Statistique », rapprochées de celles du « Nachrichtenbüro » auraient constitué une source documentaire d’une valeur considérable.
Du côté allemand, ces archives (en supposant qu’elles aient été conservées jusqu’en 1940) ont probablement disparu à la fin de la Seconde Guerre mondiale dans les décombres du IIIe Reich. Du côté français, il semble bien, hélas, que celles de la défunte « Section de Statistique » aient été détruites par ordre supérieur lorsque notre service de renseignements fut réorganisé après 1906 et qu’il n’en subsiste plus que le vénéneux « petit dossier » constitué en 1894 pour obtenir la condamnation du Capitaine Dreyfus, noyau initial de celui que vint grossir par la suite tout ce qui dans le « produit » recueilli à l’ambassade d’Allemagne pouvait contribuer à empêcher par tous les moyens la révision du procès.
Ce deuxième « dossier secret » incluant le premier fut intégralement communiqué aux magistrats de la Cour de Cassation au cours des deux révisions, mais il resta longtemps inaccessible aux chercheurs. Le bruit, heureusement infondé, de sa disparition en 1940 dans l’incendie d’un camion militaire se répandit même durant quelque temps. Enfin « retrouvé » à Vincennes, vers 1950 dans le dépôt de nos archives militaires, sa consultation vient d’être fort à propos facilitée par le catalogue d’une exemplaire précision qu’en ont dressé les archivistes du Service historique des Armées de terre (S.H.A.T.).
C’est à lui qu’après l’avoir soumis à un minutieux examen MM. Pierre Gervais, Romain Huret et Mme Pauline Peretz ont consacré en 2008 dans la Revue d’Histoire Moderne et Contemporaine 2 un important article dont les conclusions très neuves sont clairement résumées dans le compte-rendu suivant publié en français et en anglais à la fin du même numéro :
« Une relecture du “dossier secret” : homosexualité et antisémitisme dans l’affaire Dreyfus ».
L’affaire Dreyfus est en partie née de l’utilisation en 1894 d’un dossier secret communiqué de manière illégale au jury qui fit condamner le capitaine. Certaines des pièces de ce dossier dont le contenu exact n’est pas encore précisément connu aujourd’hui, étaient tirées d’une correspondance homosexuelle entre deux attachés militaires étrangers à Paris, l’Allemand Maximilien Von Schwartzkoppen et l’Italien Alessandro Panizzardi. L’article démontre que la dimension homosexuelle de ces pièces a été délibérément mise en valeur dans le dossier de 1894, dont une nouvelle reconstitution est proposée. Il fait l’hypothèse que cette dimension a incité les officiers membres du jury à condamner Dreyfus malgré le fait que ce dernier n’était nullement homosexuel, parce qu’homophobie et antisémitisme étaient souvent reliés dans le contexte politico-culturel de l’époque. L’article conclut en analysant les raisons pour lesquelles cet aspect de l’Affaire a été négligé jusqu’à présent.
Dès le début de leur article les auteurs, on le voit, précisent sans ambiguïté que ce n’est pas sur la découverte de documents jusque-là inconnus qu’ils entendent fonder leurs conclusions, mais seulement sur la composition du dossier illégalement communiqué en 1894 aux juges militaires de Dreyfus. En affirmant qu’il comprenait quelques pièces « de dimension homosexuelle » toutes depuis longtemps connues mais dont personne n’avait jusqu’à présent décelé la présence dans le «petit dossier » de 94, ils entendent démontrer qu’en les y faisant inclure Mercier et ses subordonnés comptaient exacerber l’homophobie latente prêtée aux membres du Conseil de Guerre et rendre ainsi quasi certaine une condamnation jugée indispensable.
Comme je viens de le dire les pièces du dossier en question ont ultérieurement fait partie du grand « dossier secret » réuni par Henry qui, pour empêcher la révision, y inséra aussi ses propres faux lorsqu’il il eût remplacé à la tête de son service Picquart disgracié en 1896. Échantillons d’une « correspondance à caractère homosexuel’ échangées entre les attachés militaires allemand et italien », elles provenaient, comme le “bordereau” attribué à Dreyfus, de la corbeille à papiers de l’attaché allemand où les recueillait chaque jour Mme Bastian, une femme de ménage à notre solde, discrètement appelée « la voie ordinaire ».
C’est donc à la vérification scrupuleuse de leur hypothèse de base selon laquelle le caractère homosexuel des pièces en question aurait joué un rôle important, voire majeur, dans la première condamnation de Dreyfus, que se sont consacrés les auteurs de cette « relecture » d’un dossier depuis longtemps connu. Certes le nombre impressionnant de références et de citations qu’ils ont rassemblées prouve avec quelle minutieuse attention ils ont examiné à la loupe chaque document faisant partie du dossier et longuement pesé chaque témoignage contemporain relatif à son contenu et à son usage. L’on n’en est pas moins forcé de constater qu’une large part de leurs conclusions repose essentiellement sur quelques postulats présentés comme des faits acquis, alors que leur démonstration reste souvent à faire.
Nous sommes en effet invités à admettre d’entrée de jeu que la révélation de l’homosexualité non de Dreyfus, certes, mais des attachés militaires au profit desquels il était censé trahir, devait ou pouvait amener les juges du Conseil de Guerre à accepter plus facilement la culpabilité de l’accusé. En leur faisant communiquer des documents prouvant les rapports de celui-ci avec deux « sodomites » étrangers, le général Mercier aurait misé à la fois sur un antisémitisme et une homophobie largement répandus à l’époque dans la société française et en particulier dans l’armée. Prédestiné à la trahison par son appartenance à la race déicide, mis en mauvaise posture par les « démonstrations » alambiquées de Bertillon relatives à un prétendu maquillage de sa propre écriture, Dreyfus ne fournissait-il pas une preuve supplémentaire de son ignominie en s’étant acoquiné avec des pervers sexuels qui d’ailleurs le méprisaient au point de parler de lui entre eux comme de « cette canaille de D… » ?
En l’absence de tout écrit ou tout témoignage contemporain susceptible de l’étayer, on est en droit d’estimer pour le moins téméraire cette reconstitution des pensées secrètes du général Mercier et des considérations machiavéliques lui ayant inspiré les ingrédients de sa trop fameuse « forfaiture ». Certes ses auteurs s’appuient sur une importante documentation faisant état d’une forte poussée (parallèle à celle de l’antisémitisme) des préjugés homophobes dans la France de la Belle Époque, mais est ce là un argument suffisant, même si l’on admet volontiers que la croyance patriotique qui faisait alors de l’homosexualité « le vice allemand » par excellence ait pu se trouver renforcée après la défaite subie par la France en 1870 ?
Ce n’est pas ici le lieu de discuter cette question certes intéressante, mais à propos de laquelle nous n’avons aucune compétence. Tout au plus, souhaiterions nous rappeler que dans le dossier secret de 1894 – tel du moins que nous pensions le connaître après l’examen qu’en avait fait la Cour de Cassation au cours des deux révisions – ne figuraient en tout et pour tout que deux spécimens (relativement anodins) de la « correspondance à caractère homosexuel » des attachés militaires. C’est d’ailleurs ce qu’affirmèrent aussi tous les témoins qui, à un titre ou à un autre, eurent connaissance de ce dossier et même participèrent à sa composition.
Le premier de ces deux document « révélateurs » est le fameux billet dit « Canaille de D… » adressé par Schwartzkoppen à Panizzardi3. Il avait été choisi par le colonel Sandherr, qui dirigeait alors la « Section de Statistique » parce que l’initiale « D » pouvait, pensait-il, désigner Dreyfus. L’évidente absurdité que représentait l’attribution à un officier aussi fortuné de la livraison de plans tarifés à raison de quelques francs l’unité n’avait arrêté personne.
Le second est la lettre dite « des appels » ou « lettre Davignon »4 relative aux rapports professionnels que Schwartzkoppen et Panizzardi entretenaient en tout bien tout honneur avec le colonel Davignon, alors chargé à l’État-Major des relations avec les attachés militaires étrangers.
Certes ces deux documents contenaient, l’un comme l’autre, des indices probants de l’homosexualité de leurs auteurs. Il aurait même fallu être bien naïf pour ne pas lever les sourcils en constatant que les deux amis avaient coutume de féminiser leurs signatures, Maximilien et Alessandro devenant ainsi « Maximilienne » et « Alexandrine », et de s’appeler affectueusement « Mon cher Bourreur » ou « Mon bon petit chien » en se recommandant à l’occasion de « ne bourrer pas trop ! ».
La « voie ordinaire » avait déjà fourni à des dates diverses un nombre assez important de pièces de même style, voire plus significatives encore, mais qui, pensons-nous, faisaient sourire leurs lecteurs appartenant à la Section de Statistique plus qu’elles ne les révoltaient. L’on a donc quelque peine à admettre qu’à elles seules les signatures de ces deux billets aient pu faire sur les juges militaires plus d’impression que leur contenu de nature strictement professionnelle, et surtout que la malencontreuse initiale « D » d’apparence si accusatrice. On est même en droit de douter que ces officiers momentanément changés en juges, mais ayant longtemps servi dans des corps de troupe aient été assez naïfs pour que leur indignation de voir un capitaine juif soupçonné de trahir sa patrie au bénéfice de sujets de la Triplice ait pu se trouver renforcée par la découverte chez ces officiers étrangers de telles tendances. Ils ne pouvaient ignorer qu’en France aussi elles étaient partagées par certains de leurs camarades sans que leur démission eût été exigée pour autant, ou qu’on les eût mît en quarantaine dans leurs garnisons.
N’oublions pas à ce propos que le Lt. colonel Georges Picquart avait pu à la fois se faire attribuer le surnom de « Georgette » (si du moins l’on en croit un ragot de Gonse aussi malveillant que mal fondé) et néanmoins faire à l’État-Major une carrière exceptionnellement brillante jusqu’au jour où ses efforts pour démontrer l’innocence de Dreyfus lui vaudraient de la part de ses chefs non seulement la disgrâce, mais les pires persécutions.
Il n’est donc pas interdit de supposer qu’ayant pris conscience de la relative faiblesse de tels arguments, leurs auteurs se trouvèrent logiquement amenés à présenter comme une quasi-certitude que le « dossier secret » ayant constitué en 94 la « forfaiture » de Mercier avait en réalité été tout autrement composé que ne l’avaient cru les juges de la deuxième révision lorsqu’il avait pu alors être impartialement reconstitué.
À l’appui de ce que Le Monde allait présenter en 2008 comme un véritable « scoop », ils établirent donc une nouvelle liste des pièces qu’ils estimaient avoir été communiqués aux juges de 94.
Dans cette liste ils firent figurer plusieurs billets sélectionnés par eux parmi les multiples pièces du même genre contenues dans l’épais dossier rassemblé à partir de la fin de 1897 par Gonse et Henry5 pour en faire un arsenal d’arguments antirévisionnistes.
Si ingénieuse que paraisse cette reconstitution, on n’en est pas moins en droit de s’étonner qu’aucun des témoins qui furent invités, au cours des deux révisions, à décrire le contenu du « petit dossier » qu’ils avaient, à un titre ou à un autre, eu entre les mains, soit en 1894, soit entre 1896 et 1897 n’ait gardé le moindre souvenir de pièces à ce point significatives. Par ailleurs comme tous les témoignages contemporains attestent que le « petit dossier » ne contenait qu’un très petit nombre de pièces, le fait d’affirmer un siècle plus tard qu’il en contenait d’un caractère homosexuel plus accentué encore que « Canaille de D… » et « la lettre Davignon » les obligeait logiquement à éliminer au moins la seconde des deux pour éviter un « trop-plein » dans le dossier reconstitué, même s’il fallait pour cela récuser les témoignages, sur ce point concordants de Picquart, Mercier, et Du Paty6.
Cette élimination ne nous paraît pas fondée sur des arguments irréfutables, mais c’est là un détail relativement peu important que nous nous abstiendrons pour l’instant de discuter. Il nous semble en revanche impossible d’accepter sans une argumentation approfondie que soit présenté comme un faux tardivement fabriqué par son auteur et par suite aussitôt écarté un autre document d’une importance capitale quant à la composition du « dossier secret » de 94.
Il s’agit là, nos lecteurs l’auront déjà compris, du « commentaire » rédigé conjointement en 1894 par du Paty et Sandherr sur l’ordre de Mercier, avant la réunion du Conseil de Guerre.
Ce document assez fumeux connu sous le nom de « commentaire Du Paty » s’efforçait de relier les unes aux autres les pièces du premier dossier secret en expliquant tant bien que mal qu’elles constituaient autant de démonstrations de la trahison de Dreyfus. Conscient du danger que représentait pour lui cette preuve indiscutable de son « crime d’État », Mercier, avant de quitter le ministère de la Guerre en 1895, se le fit remettre par Sandherr sous les yeux duquel il le détruisit lui-même. De surcroît, il lui donna l’ordre de faire disparaitre la matérialité du « petit dossier » en réintégrant à la place qu’elle occupait auparavant dans les archives du service chacune des pièces qui l’avaient momentanément constitué.
Fut-ce un tardif remords, ou la crainte d’avoir peut-être à rendre des comptes à un successeur de Mercier, qui poussa Sandherr à transgresser sur ces deux points les ordres de son ministre ? On ne le saura jamais. Toujours est-il que les pièces mises en 94 sous les yeux des membres du Conseil de Guerre restèrent groupées dans le « petit dossier » que Picquart se fit apporter par Gribelin en 96. Il y trouva joint un exemplaire du « commentaire » rédigé deux ans plus tôt par Sandherr et par Du Paty qui avaient travaillé de concert à cette clé de voute du dossier.
Ce document était potentiellement si dangereux pour Mercier, que lorsqu’il en apprit la survie en 97, après la disgrâce de Picquart, il obtint de Boisdeffre, toujours chef d’État-major, qu’on le lui restituât, sous le fallacieux prétexte qu’il l’avait fait préparer « à son usage personnel ». Gonse lui apporta la pièce à domicile et Mercier la jeta au feu en sa présence7.
Hélas ! Pareille à la tache de sang sur la main de Lady Macbeth, cette trace de son crime allait une fois encore réapparaître lors de la révision du procès de Rennes. Pour sa propre défense et pour minimiser son rôle en 94 dans l’affaire du « dossier secret », Du Paty s’était trouvé contraint de remettre en 1904 aux juges de la Cour de Cassation un brouillon de son commentaire qu’il avait depuis longtemps placé en lieu sûr à l’étranger. Il n’accepta d’ailleurs de s’en dessaisir qu’après avoir obtenu de Mercier un feu vert qui ne pouvait décemment plus lui être refusé. Picquart, et Mercier lui-même, déclarèrent alors tous deux sans hésiter que ce premier état du commentaire était dans le fond et, à quelques détails de rédaction près dans la forme, identique à la pièce jointe au « petit dossier » de 94.
Une telle unanimité entre un Du Paty qui en 94 avait écrit de sa main le « commentaire », un Picquart qui en avait retrouvé un double en 96, et un Mercier qui, après l’avoir commandé et approuvé, avait par deux fois tenté de faire à jamais disparaître cette preuve de sa « forfaiture », constitue à l’évidence la meilleure des garanties de véracité de témoignages pour une fois concordants émanant d’adversaires depuis longtemps déclarés ! À notre connaissance personne jusqu’à présent ne les avait jamais mis en doute sur ce point.
Il serait par ailleurs contraire à la plus élémentaire logique d’admettre que Du Paty qui n’avait aucun intérêt personnel à couvrir Mercier, ni d’ailleurs aucune intention de le faire, ait pu décider, des années après la première condamnation de Dreyfus, de fabriquer une nouvelle version de son commentaire, d’y analyser des pièces qui n’ auraient pas été incluses dans le dossier secret de 94, et de passer sous silence plusieurs autres pièces (y compris une lettre « intime » n’ayant aucun rapport avec les actes reprochés à Dreyfus)8 dont la présence y est aujourd’hui affirmée, pour la première fois depuis un siècle. On doit donc s’étonner qu’un postulat en appelant un autre, il nous soit affirmé, sans la moindre citation ou discussion de son contenu, que le « Commentaire Du Paty » tel qu’il fut enfin versé non sans peine en 1904 aux débats de la Cour de Cassation était « un faux », au seul prétexte qu’il faisait référence aux « faux rapports Guénée » lesquels sont du même coup présentés (à notre avis contre toute vraisemblance) comme forgés en 1897-18989.
Cette manière trop hâtive d’écarter une pièce aussi importante que le « Commentaire » rend d’autant moins crédible la reconstitution arbitraire du dossier de 1894 sur laquelle les auteurs de l’article ont bâti tout l’édifice de leurs hypothèses.
Pour en revenir une fois encore à l’homophobie et à son rôle dans « l’Affaire», ces deux thèmes essentiels de la « relecture » qui nous est proposée, il n’est pas inutile de rappeler qu’au cours de « l’Affaire » le général Gonse, sous chef d’État-Major général envisagea bel et bien d’utiliser comme moyen de chantage la révélation de certains détails relatifs à la vie intime tant de Picquart que de Schwartzkoppen. En ce qui concernait Picquart, on se contenta « d’agir sur le mari » de sa maîtresse – vilenie dont le seul résultat fut de provoquer un divorce. Quant aux attachés militaires ce ne fut pas de la fameuse « correspondance à caractère homosexuel » que Gonse pensa un moment se servir pour imposer en cas de besoin silence à Schwartzkoppen, mais d’une série de lettres intimes émanant d’une maitresse de l’attaché allemand à qui elles avaient été, on ne sait trop comment, volées10. Elles attestaient chez son discret amant une propension manifeste à ce que Roger Peyrefitte appelait volontiers « le bimétallisme ». Le fait que le général Gonse ait un instant songé (à la grande indignation de Du Paty) à les utiliser pour manipuler Schwartzkoppen semble bien démontrer le peu d’importance accordée par l’État-Major à l’autre facette de ses mœurs intimes.
Que reste-t-il donc, en fin de compte de cette ingénieuse construction, fondée sur une série d’hypothèses certes aussi neuves qu’intéressantes, mais dont aucune ne saurait résister à une confrontation sérieuse avec un ensemble de faits aujourd’hui bien établis et de témoignages devenus indiscutables ? Peu de choses, hélas, et l’on doit d’autant plus regretter que tant d’efforts et de recherches aient été consacrés à cette « relecture » d’un dossier déjà connu dans tous ses détails depuis un bon siècle, alors qu’il reste encore quelques petits mystères à percer dans les épisodes de « guerre secrète » d’où est née l’Affaire.
Pour mettre un point final à cette trop longue discussion (contrairement à ce que laisseraient croire quelques propos diffusés par la voie d’internet elle ne doit rien à une inconsciente homophobie !) nous pardonnera-t-on d’évoquer sans méchanceté à propos d’une thèse plus ingénieuse que crédible, les célèbres bâtons flottants dont parlait La Fontaine et de répéter après lui : “De loin c’est quelque chose, et de près ce n’est rien…” ?
1. – Cf. Rennes, I, 75 et suiv. Mercier. II eme Rev. I, 459-60, Targe.
2. – Pierre Gervais, Romain Huret, Pauline Peretz, Une relecture du “dossier secret” : homosexualité et antisémitisme dans l’Affaire Dreyfus, ds. Revue d’histoire moderne et contemporaine, t.55-1 (2008), p.125- 160.
3. – Si connue que soit cette pièce, peut-être n’est-il pas inutile de la reproduire une fois de plus ici : « Je regrette bien de ne pas vous avoir vu avant mon départ. Du reste, je serais [sic] de retour dans 8 jours. Ci-joint 12 plans directeurs de Nice que ce canaille de D… m’a donné [sic] pour vous. Je lui ai dit que vous n’avez [sic]pas l’intention de reprendre les relations. Il prétend qu’il y a eu un malentendu et qu’il ferait tout son possible pour vous satisfaire. Il dit qu’il s’était entêté et que vous ne lui en voulez [sic] pas. Je lui ai dit qu’il était fou et que je ne croyais pas que vous voudriez [sic] reprendre les relations. Faites ce que vous voulez [sic]. Au revoir, je suis très pressé. ALEXANDRINE. Ne bourrez [sic] pas trop ! ».
Cette funeste pièce porte le numéro 25 dans le récent inventaire du “dossier secret” dressé par le S.H.A.T.Le Cdt. Cordier, adjoint en 1894 du Lt. Col. Sandherr, affirma au cours du procès de Rennes avoir déclaré à son chef à propos de la pièce « Canaille de D… », tandis qu’ils préparaient ensenble le “petit dossier” : « Tout cela n’a pas l’air de signifier grand-chose, mais enfin il y a une initiale, on peut l’envoyer. Et pour moi c’était à l’instruction que cela devait être porté ». (Rennes, II, 513).
4. – N° 40 de l’inventaire du S.H.A.T.
5. – C’est ce dossier dont, en mai 1898, au cours d’une période de réserve le substitut Wattinne, gendre du Gal. Billot alors ministre de la Guerre dressa l’inventaire en l’accompagnant d’un rapport établi avec le Gal. Gonse et daté du 1er juin. Le 15 août de la même année, le capitaine Cuignet, attaché au cabinet de Godefroy Cavaignac qui avait remplacé Billot à la tête du Ministère de la Guerre y découvrit le célèbre document où Dreyfus était nommé en toutes lettres maladroitement fabriqué fin octobre 1896 par le Cdt. Henry pour discréditer les efforts de Picquart qui tentait alors de persuader ses chefs de l’erreur commise en 1894.
6. – On voudra bien me pardonner de ne pas reproduire ici les nombreuses références relatives à la composition du premier “dossier secret”.0n les trouvera soit dans l’article de la R.H.M.C., soit dans le répertoire toujours tendancieux, mais bibliographiquement toujours utile de H. Dutrait-Crozon, Précis de l’Affaire Dreyfus… Paris, Nouvelle Librairie nationale, 1909.
7. – Cette destruction qui constituait moralement une nouvelle “forfaiture” fut reconnue par Mercier lui-même au cours de la première révision par la Cour de Cassation, dans une lettre transmise le 26 avril 1899 au Premier Président Mazeau. Gonse confirma le 30 le récit de Mercier, en précisant avoir agi en la circonstance sur l’ordre formel de Boisdeffre.
8. – Cf. R.H.M.C., Op.cit, pp.134-135.
9. – Les auteurs de l’article cité plus haut (n.1) considèrent comme certainement “fausses” et reconstituées après le verdict de 94 les précisions sur le contenu du dossier secret de 94 contenues dans le “brouillon du ‘commentaire Du Paty’ produit tardivement en 1904 par son coauteur. Une telle accusation, qui fait de Du Paty (sans lui prêter le moindre mobile !) un faussaire plus habile qu’Henry est fondé sur la référence aux rapports de ‘l’agent Guénée’ contenu dans le document. Le truquage des originaux de ces rapports de police rassemblés avant le procès Dreyfus est indiscutable. En revanche il nous parait impossible d’accepter l’affirmation selon laquelle cette falsification aurait eu lieu bien après le procès. cf., R.H.M.C., Op.cit., p.130, et ibid.. n.23..Pour éviter une digression, inutile ici, à propos du policier Guénée et de ses divers rapports, vrais ou truqués, on voudra bien nous pardonner de renvoyer le lecteur à ce que nous en avons dit pour la première fois en 1961.Cf. L’Affaire sans Dreyfus (Paris, Fayard, 1961), p.164 et suiv.
10. – Il s’agit de Mme. De Weede, épouse d’un conseiller à l’ambassade des Pays-Bas à Paris. Il est difficile de croire qu’un paquet d’une bonne vingtaine de ses lettres ne laissant aucun doute sur la nature de ses relations avec Schwartzkoppen ait été apporté à la Section de Statistique par ‘la voie ordinaire’ ce qui impliquerait que leur destinataire les aient jetées intactes dans sa corbeille à papiers. À la suite d’une rupture non démontrée ? Ce serait aussi à prouver. Elles furent à notre avis plus probablement volées au domicile de son amant. Quoi qu’il en soit, il semble certain que leur utilisation par notre service aurait été aussi odieuse certes, mais probablement plus efficace comme moyen de chantage sur leur destinataire que la révélation par des échos de presse de son homosexualité. Même plus discret le scandale mondain et les complications, voire le duel qu’aurait pu provoquer une fois rendue publique la liaison de deux personnalités du monde diplomatique appartenant aux ambassades parisiennes de deux nations différentes aurait certainement attiré plus d’ennuis à Schwartzkoppen que son appartenance à une certaine ‘camarilla’ proche de Guillaume II, encore très puissante alors.
Marcel Thomas
Le dossier secret de 1894.
question de méthode
Nous voulons bien discuter sur tout et mieux encore être convaincus par tout. Mais pour cela il ne suffit pas de parler de retour aux sources premières, d’archives et de méthode. Il faut le faire et il faut le montrer. Or, qu’avons-nous là ? Une série de postulats qui sont autant de certitudes… « […] il est certain qu’une partie des pièces d’origine étaient tirées d’une correspondance homosexuelle etc. » (p. 125-126 de l’article de la RHMC). Et qui ne suit pas cette piste, ainsi balisée d’affirmations péremptoires, se trompe : « L’antisémitisme reste au cœur de l’Affaire : Dreyfus a bien été attaqué et condamné comme juif. Mais, sans prendre en compte l’homophobie, soulignée d’abord puis occultée, il est impossible de saisir le mécanisme conduisant de l’interception de la correspondance entre les deux attachés militaires à la condamnation du capitaine, sauf à supposer que les responsables du contre-espionnage comme leurs supérieurs manquèrent délibérément à tous leurs devoirs. » (p. 147)
Soit. Mais sur quoi est fondée cette « hypothèse » (p. 126) « certain[e] » (p. 124) ? Avant de la prouver, nos auteurs réfutent ce qui aujourd’hui est admis comme une certitude et qui contredit leur thèse, à savoir que le dossier était composé de quatre ou cinq pièces. Cela nous le savons grâce à Picquart, dont nos auteurs citent les paroles suivantes :
Ce dossier tel qu’il avait été enfermé dans l’armoire d’Henry fin décembre 1894, et tel que je l’ai reçu de Gribelin [l’archiviste de la Section de statistiques] fin août 1896, était divisé en deux parties. La première qui fut communiquée aux juges en chambre du conseil se composait de quatre pièces accompagnées d’un commentaire explicatif rédigé, à ce que m’a assuré le colonel Sandherr, par Du Paty de Clam. [La deuxième partie] était de peu de valeur. Elle comprenait 7 ou 8 pièces en tout, quelques photographies de la pièce « ce canaille de D. », quelques pièces sans importance se rattachant plus ou moins à celles de la première partie. (p. 127)
Que dit cette citation – qui ne se trouve pas à la place indiquée en note (« Débats, 1899, p. 40-41) mais est extraite de la deuxième lettre de Picquart à Sarrien du 14 septembre 1898 et se trouve citée p. 110 dans le précédent volume de débats (La Révision du procès Dreyfus à la Cour de cassation. Compte rendu sténographique « in extenso ». (27, 28, 29 octobre 1898), Paris, P.-V. Stock, 1898) ? Elle dit que le dossier secret, tel que Picquart l’avait vu près de deux ans plus tard, comprenait deux parties. Que la première, celle de 4 pièces, fut communiquée aux juges et que la seconde, composée de 7 ou 8 pièces, comprenait quelques photographies de « Ce canaille de D » et quelques pièces « sans importance ». Elle est donc utile à la thèse du dossier d’une dizaine de pièces, thèse de nos auteurs, mais pose le problème qui est de considérer que la seule première partie fut communiquée. Picquart le « suppose », nous disent-ils (p. 129). Non, Picquart ne le suppose pas, il l’affirme ! Si nous nous reportons en effet à ses autres déclarations, nous apprenons bien plus de choses sur la question de la communication en chambre du Conseil. Entendu par la Cour de cassation, deux mois après cette lettre, Picquart reviendra sur cette seconde partie et déclarera nettement que les pièces la composant « ne formaient que le rebut du dossier et n’avaient pas été communiquées aux juges » (La Révision du procès Dreyfus. Enquête de la Cour de cassation, Paris, Stock, 1899, t. I : Instruction de la chambre criminelle, p. 139). De même si nous lisons la lettre de Picquart à Sarrien du 6 septembre (et non du 4, comme le disent nos auteurs : p. 127), peut-être en « réfection » et « pas consultable » (p. 127, note 9) au moment de la rédaction de l’article mais alors consultable en ligne sur l’excellent site des AN (http://www.dreyfus.culture.fr/fr/mediatheque/zoom.php?id=283&langue=0&page=1&txt=6+septembre ; reproduite à la fin de l’article), nous y pouvons lire :
La portion du dossier secret non communiquée aux juges comprenait 7 ou 8 pièces ; les unes étaient des photographies de la lettre : « ce canaille de D… » les autres des document sans importance.
Un témoignage « capital », reconnaissent nos auteurs, mais « insuffisant pour reconstituer le dossier de 1894 » (p. 128). Nous comprenons bien qu’il s’offre l’avantage de « grossir » le dossier, il pose l’épineux problème de cette affirmation de la non-communication des pièces de « rebut » que par le choix de leur citation et par l’oubli des autres nos auteurs affirment tout de go qu’il permet de « réinsérer dans la discussion les “pièces de rebut” » (p. 130). Il ne réinsère pas. Il en parle pour les exclure. Mais ce témoignage pose un autre problème : celui d’y affirmer comme une certitude la présence de la lettre « Davignon ». Or le statut de cette lettre est pour nos auteurs « douteux » (p. 128). La lettre elle-même est « douteuse » (p. 134). Pourquoi ? Parce que toute la démonstration repose sur la présence de petits numéros à l’encre rouge sur les pièces en question et que la pièce « Davignon » en est vierge. Pourquoi est-elle donc douteuse ? A cela deux ordres d’arguments ou plus exactement deux témoignages. Le premier est dû à Targe qui affirma que « cette lettre n’était pas mentionnée dans un premier rapport sur le dossier secret, à l’automne 1897 » (p. 128). La chose est exacte mais n’explique rien. Rien ne nous dit que ce document d’octobre 1897 avait pour ambition l’exhaustivité et son titre nous indiquerait bien au contraire que ce qui semble poser problème pourrait en fait bien être une réponse qui serait aussi la confirmation des déclarations de Picquart. En effet, ce « Bordereau des pièces secrètes établissant la culpabilité de Dreyfus en dehors de la procédure suivie devant le premier Conseil de Guerre du Gouvernement militaire de Paris » écartait toutes les pièces de 1894. Il n’était peut-être certes pas malin de reconnaître ainsi l’existence du dossier secret, puisque la lettre « Davignon » ne fit jamais partie de la procédure mais ce document à usage interne n’avait pas pour vocation d’être livré à la publicité et ne le sera en effet pas avant que Targe, en 1904, le découvrît (La Révision du Procès de Rennes. Enquête de la chambre criminelle de la Cour de cassation (5 mars 1904-19 novembre 1904), 3 vol., Paris, Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen, 1908, t. I. p. 79). Mais il y a sans doute une tout autre raison à cette absence. Depuis quelques temps, depuis octobre 1897 que Gonse et Henry avaient entrepris de tirer, de classer et d’enrichir le dossier secret, les hommes de la Section de statistique étaient plutôt enclins à laisser de côté une lettre dont l’interprétation avait été pour le moins forcée en 1894. Pour comprendre, rappelons-en le texte :
Mon cher Bourreur,
Je vous envoie ce que vous savez. Dès que vous êtes parti j’ai étudié la question des appels et j’ai vu que certaines questions de domicile etc. sont toutes subordonnées à celle principale dont voilà la direction.
Pour un appel partiel, [c’est-à]-dire limité seulement [dans quel]ques régions, les manifestes [sont-ils] publiés seulement dans les régions intéressées ou dans tout l’état ?
J’ai écrit encore au colonel Davignon et c’est pour ce que je vous prie. Si vous avez occasion [de v]ous occuper de cette [que]stion avec votre ami de le faire particulièrement en façon que Davignon ne vient [sic] pas à le savoir. Du reste il répondrai [sic] pas, car il faut jamais faire savoir qu’un attaché s’occupe de l’autre.
Adieu, mon bon petit chien [illisible]
En 1894, la lecture suivante en avait été faite : l’« ami » était bien sûr Dreyfus qui devait agir à l’insu de Davignon auprès duquel il travaillait… Cette lecture était d’une rare stupidité et ne pourrait souffrir la discussion. Peut-on sérieusement imaginer Panizzardi conseiller à Schwartzkoppen que si son « ami » – son espion – venait à se renseigner sur la question de l’appel des réservistes, il devait le faire sans que son supérieur le sût ? Était-il nécessaire de recommander à un attaché militaire la discrétion dans une affaire d’espionnage ? Une telle interprétation était tout à fait impossible, risible même, et on peut se demander comment on put faire de Dreyfus un « ami » quand il était dans la première pièce du dossier secret un « canaille » et dans la deuxième, datant de la même époque, le sujet des « doutes » de Schwartzkoppen. Pourtant, malgré sa langue improbable, cette troisième pièce était d’une absolue clarté et n’avait en soi rien de compromettant, raison pour laquelle elle avait été classée simplement à son arrivée. Panizzardi entretenait des relations avec le lieutenant-colonel Davignon, second du général Le Loup de Sancy au 2e bureau de l’État-major. Il faisait juste savoir à Schwartzkoppen que s’il était amené à discuter de la question de l’appel des réservistes avec son propre contact à l’état-major, son « ami » depuis 1880, il ne devait pas oublier de le faire en particulier (« particulièrement »), loin de la présence de Davignon. Devant son second, Sancy ne répondrait de toute façon pas et il ne fallait pas faire savoir à Davignon que sur une question pour laquelle il était en relation avec Panizzardi, Schwartzkoppen l’était avec de Sancy : « il faut jamais faire savoir qu’un attaché s’occupe de l’autre »… Relativement à la prise de conscience de la faiblesse de cette pièce, que nous évoquions, nous en avons une trace dans un rapport postérieur de quelques mois – 26 mai 1898 – dans lequel Gribelin semblait revenu à la raison :
La pièce portant le n° 40 (lettre de Panizzardi à Schwartzkoppen) fait allusion à des renseignements que Panizzardi aurait demandés directement au lieutenant-colonel Davignon, sous-chef du 2e Bureau de l’État-major de l’Armée, alors de Schwartzkoppen serait disposé à demander ces mêmes renseignements à la même source, par un autre intermédiaire.
Dans une pensée de méfiance, Panizzardi recommande à Schwartzkoppen de ne plus s’occuper de cette affaire, afin que le lieutenant-colonel Davignon ne sache pas que les attachés militaires, italien et allemand, travaillent ensemble les mêmes questions. (« Dossier secret Dreyfus », AN BB19 118 et MAHJ, 97.17.61.1. Il en existe aussi une copie dans les papiers Esterhazy conservées à la BNF (n.a.fr. 16464).)
Le second argument de nos auteurs ne tient pas plus. S’en remettant à Cuignet, ils expliquent que c’est lui, ainsi qu’il l’avait affirmé dans une note du 10 septembre 1898, qui « l’avait […] introduite dans le dossier à l’été 1898 » (p. 128). Nous avons là un parfait exemple de toute la limite des « traces d’archives » mises en avant par les auteurs. Il n’est pas possible de considérer un texte en lui-même sans lui redonner sa place dans le contexte dans lequel il s’inscrit. Cuignet mentait ici et la présence sur la pièce de la mention de l’inventaire Gonse/Wattinne (N°53), de quelques mois précédant celui de Cuignet, aurait dû les en alerter. Cuignet mentait donc et le faisait pour une bonne raison. Jusqu’à la révélation du « faux Henry », Picquart, docile, s’était toujours tu relativement au dossier secret. Dans sa lettre évoquée à Sarrien, lettre du 6 septembre 1898, il en avait pour la première fois parlé et en avait même, comme on peut le voir dans la reproduction donnée à la fin de l’article, précisé qu’il contenait 4 pièces. Il n’avait pas donné plus de précision mais il n’était pas douteux que Sarrien voudrait en savoir plus. Et de cela il ne pouvait être question. A la fin du conseil des ministres du 6 septembre, Sarrien avait transmit à Zurlinden la lettre qu’il venait de recevoir de Picquart (lettre de Zurlinden à Sarrien du 7 septembre 1898, AN BB19 106). Dès le lendemain, Zurlinden avait pu envoyer ses impressions à son collègue, expliquant que si Picquart disait la vérité relativement « au rôle qu’il s’attribu[ait] » dans l’affaire – à savoir l’avoir suivie dès le début –, il ne fallait pas tenir compte de ce qu’il avait dit des aveux que de nombreuses pièces « réduis[ai]ent à néant » (lettre de Zurlinden à Sarrien du 7 septembre 1898, AN BB19 105 et 106). Il ne parlait que des aveux et se gardait bien de toute allusion au dossier secret dont la révélation, au moment d’une révision de plus en plus certaine, serait une véritable catastrophe. Pour parer le coup, Cuignet, le 10, avait transmis à son ministre la note qu’évoquent en preuve nos auteurs, note qui expliquait « Comment sont nés les premiers soupçons de la culpabilité de Dreyfus ». Habilement, Cuignet y affirmait que la « lettre Davignon » n’avait pas été « retenue comme une charge contre Dreyfus, lors du procès de 1894 », avait été « complètement perdue de vue par la suite » et que c’est lui qui avait mis en lumière « son importance et sa gravité » (Cuignet, « Comment son nés les premiers soupçons de la culpabilité de Dreyfus », note du 10 septembre 1898, pièce 42 du dossier secret, publié dans « Dossier secret Dreyfus », AN BB19 118 et MAHJ, 97.17.61.1). Voilà qui permettrait de disqualifier le bavard si Sarrien répondait à sa demande. Il serait un menteur, celui qui donnerait comme faisant partie du dossier une pièce qui avait été négligée en 1894 et oubliée dans quelque dossier… Et s’il mentait, n’était-ce pas parce que ce fameux dossier secret n’avait jamais existé que dans l’imagination des dreyfusards… et de leur instrument Picquart ? Voici l’histoire d’une preuve qui n’en est pas une et nous pouvons regretter que nos auteurs, qui renvoient en note à la déposition de Cuignet de 1904, n’aient pas retenu que Cuignet y reconnait finalement qu’affirmer que la pièce « Davignon » n’avait pas été présentée en 1894 était « parfaitement » « inexact » (La Révision du Procès de Rennes. Enquête de la chambre criminelle de la Cour de cassation (5 mars 1904-19 novembre 1904), op. cit., t. II. p. 487).
Autre disqualification, celle du commentaire de Du Paty, attesté par Picquart, et dont la version que nous connaissons, exhumée en 1904 à l’occasion de la seconde révision, est qualifiée par nos auteurs de « faux ». (p. 130) Il est vrai que ce brouillon d’un document détruit précise le contenu du dossier secret et, en tous points concordant avec les souvenirs de Picquart, contredit donc la thèse de nos auteurs. Nous voulons bien admettre que ce document soit un faux mais les preuves manquent cruellement pour étayer pareille affirmation. Tout, au contraire, prouve qu’il était bien sinon identique tout au moins très proche du document qui accompagnait le dossier secret en 1894. Pendant longtemps, il n’avait pas été possible de parler, pire même de rendre public, un commentaire qui prouvait l’existence d’une illégalité que tous niaient farouchement. Dans ses souvenirs, en grande partie inédits, Du Paty racontera qu’au moment du procès Zola il s’était ouvert à Gonse de doutes de plus en plus forts, enjoignant son supérieur à faire la révision, « vous savez en révélant quoi ». Gonse lui aurait répondu, offusqué, qu’il ne comprenait pas que « pareille idée ait pu venir à un gentilhomme » : « Le général Mercier seul peut vous délier de votre serment… », aurait-il ajouté (Marcel Thomas, L’Affaire sans Dreyfus, Paris, Fayard, 1961, p. 183). En 1899, appelé à déposer devant la Cour de cassation, Du Paty avait à nouveau demandé à Mercier de le libérer. Dans le brouillon – inédit – de sa déposition, il écrira ainsi : « j’ai demandé par écrit au ministre de la Guerre en fonctions en 1894 de me délier de ma parole, il n’a pas cru devoir le faire, je me tais. / J’attends, car un officier ne peut pas violer l’engagement l’honneur qu’il a pris. » (Du Paty, « Projet de déposition devant les Chambre réunies », BNF n.a.fr., inventaire en cours). De même, lors de la seconde révision, par « devoir vis-à-vis du général Mercier » et pour ne pas lui « manquer », Du Paty renoncera à montrer certaines pièces qu’il avait conservées. Et encore, en avril 1899, en réponse aux attaques du général Roget qui tentait de lui faire endosser la responsabilité de tout, Du Paty avait à nouveau écrit à Mercier pour qu’il l’autorisât à produire sa défense et pour cela, soit « de me délier de ma parole en me permettant de produire les preuves, soit tout simplement de m’adresser quelques lignes pour me dire “qu’il est à votre connaissance que j’ai obéi à des considérations d’ordre supérieur, patriotique et impersonnel, ignorées de mes accusateurs”, rien de plus » (La Révision du Procès de Rennes. Enquête de la chambre criminelle de la Cour de cassation (5 mars 1904-19 novembre 1904), op. cit., t. I, p. 260. Voir aussi les pages 240-241 et 244). Mercier refusera encore et ce ne sera qu’après Rennes, il où ne put que reconnaître la matérialité de l’illégalité à laquelle il avait présidée, qu’il acceptera enfin. A l’occasion de la seconde révision, après avoir été pressé par des magistrats qui surent lui faire comprendre qu’il ne pouvait soustraire une pièce de la procédure à leur connaissance, Du Paty retournera voir Mercier, le 24 mars 1904, et, rentré chez lui, nota dans son Journal inédit : « Il ne voit pas d’inconvénient à ce que je donne le commentaire. Il s’exclame : “Pourquoi n’a-t-on pas exécuté mes ordres, Picquart n’aurait pas vu le commentaire !” ». Une phrase lourde de sens qui nous indique bien l’importance du commentaire et la concordance du brouillon de 1904 avec l’original. Pourquoi sans cela Mercier aurait-il authentiqué ce « faux » ? Pour protéger la correspondance « amoureuse » des attachés militaires ? Mais elle était révélée par « Ce canaille de D » et par la lettre « Davignon »… pourquoi dans ce cas ne pas les avoir sorties aussi… Et s’il s’agissait en effet d’un faux, quelle drôle d’idée assurément de s’arranger pour le faire coller avec les témoignages connus de Picquart. Quel intérêt Mercier et son complice Du Paty auraient-il eu à donner raison à leur accusateur. Non, comme le dit Marcel Thomas dans l’article qui précède : « Une telle unanimité entre un Du Paty qui en 94 avait écrit de sa main le « commentaire », un Picquart qui en avait retrouvé un double en 96, et un Mercier qui, après l’avoir commandé et approuvé, avait par deux fois tenté de faire à jamais disparaître cette preuve de sa « forfaiture », constitue à l’évidence la meilleure des garanties de véracité de témoignages pour une fois concordants émanant d’adversaires depuis longtemps déclarés ! »
Mais cela dit, si cette argumentation ne tient guère, demeure la question de cette numérotation à l’encre rouge, centre de la thèse de nos auteurs. La lettre « Davignon » n’en fait donc pas partie, le n°1 manque, ainsi que les n° 7 et 8 pour lesquels nous est proposée une explication pour le moins conditionnelle : les n° 7 et 8 seraient devenus après un reclassement les 3bis et 3ter, ce dernier corrigeant un « 8 » que l’image reproduite ci-dessous rend pour le moins hypothétique.
 Il est indiscutable que cette numérotation indique un ensemble. Mais que prouve qu’il s’agisse de celui de 1894 ? Les « traces d’archives » évoquées par nos auteurs n’emportent guère plus l’adhésion que les précédentes. Cuignet, qui n’avait pas vu le dossier avant 1898, expliqua qu’il « y avait des numéros bis, ter » et Cordier, qui y travailla à la constitution, que « les correspondances sortant du service [étai]nt numérotées lorsqu’elle [étaie]nt livrées à d’autres service ». Et nos auteurs de rappeler, suivant lé témoignage du même Cordier, « que Sandherr avait “refait trois ou quatre fois le paquet” » du dossier secret en 1894 (p. 134). Soit. Mais que cela prouve-t-il ? En quoi, sans forcer le sens des mots, pouvons-nous en déduire que les documents de 1894 portaient des « bis » et des « ter » puisque Sandherr avait refait le paquet et que la numérotation fut faite parce que les documents sortaient de la Section de statistique ? C’est un drôle d’exercice que celui qui consiste à superposer des bouts de citations et de leur faire dire ce que l’on veut prouver. Cuignet ne parle que du dossier qu’il a eu entre les mains (mentant au passage quand il dit ne pas avoir vu le rapport Wattinne) à partir de mai 1898… En aucun cas son information ne sous-entend un « de tous temps ». En revanche, Du Paty affirmera à l’occasion de la seconde révision qu’il n’avait jamais vu « aucun numéro sur les pièces, parce que ce numérotage est postérieur au moment du procès de 1894 » (Déposition Du Paty à l’occasion de la seconde révision dans La Révision du Procès de Rennes. Enquête de la Chambre criminelle de la Cour de cassation (5 mars 1904-19 novembre 1904), op. cit., t. I, p. 239). L’affaire est entendue et on regrettera que nos auteurs n’aient pas cru bon retenir cette déclaration claire, nette et précise.
Il est indiscutable que cette numérotation indique un ensemble. Mais que prouve qu’il s’agisse de celui de 1894 ? Les « traces d’archives » évoquées par nos auteurs n’emportent guère plus l’adhésion que les précédentes. Cuignet, qui n’avait pas vu le dossier avant 1898, expliqua qu’il « y avait des numéros bis, ter » et Cordier, qui y travailla à la constitution, que « les correspondances sortant du service [étai]nt numérotées lorsqu’elle [étaie]nt livrées à d’autres service ». Et nos auteurs de rappeler, suivant lé témoignage du même Cordier, « que Sandherr avait “refait trois ou quatre fois le paquet” » du dossier secret en 1894 (p. 134). Soit. Mais que cela prouve-t-il ? En quoi, sans forcer le sens des mots, pouvons-nous en déduire que les documents de 1894 portaient des « bis » et des « ter » puisque Sandherr avait refait le paquet et que la numérotation fut faite parce que les documents sortaient de la Section de statistique ? C’est un drôle d’exercice que celui qui consiste à superposer des bouts de citations et de leur faire dire ce que l’on veut prouver. Cuignet ne parle que du dossier qu’il a eu entre les mains (mentant au passage quand il dit ne pas avoir vu le rapport Wattinne) à partir de mai 1898… En aucun cas son information ne sous-entend un « de tous temps ». En revanche, Du Paty affirmera à l’occasion de la seconde révision qu’il n’avait jamais vu « aucun numéro sur les pièces, parce que ce numérotage est postérieur au moment du procès de 1894 » (Déposition Du Paty à l’occasion de la seconde révision dans La Révision du Procès de Rennes. Enquête de la Chambre criminelle de la Cour de cassation (5 mars 1904-19 novembre 1904), op. cit., t. I, p. 239). L’affaire est entendue et on regrettera que nos auteurs n’aient pas cru bon retenir cette déclaration claire, nette et précise.
Passons. Que prouve donc, disions-nous, que cette numérotation soit celle 1894, si toutefois il y en eut une ? Ne pourrait-elle être celle d’octobre 1897 – qui nous l’avons vu ignorait la lettre « Davignon » ? Celle de janvier 1898 ? Celle de mars ? Ou des deux d’avril ?… autant de rapports que retrouva Targe et qui ont aujourd’hui disparu (La Révision du Procès de Rennes. Enquête de la Chambre criminelle de la Cour de cassation (5 mars 1904-19 novembre 1904), op. cit., t. I, p. 79-80) ? Mais en fait la question doit se poser autrement. Combien y eut-il de classements (sélection et/ou ordonnancement) du dossier ? 1° le premier, celui de 1894 qui fut transmis aux juges ; 2° celui d’octobre 1897 ; 3° celui de janvier 1898 ; 4° celui de mars de la même année ; 5° le premier d’avril ; 6° le second d’avril ; 7° le rapport Gonse/Wattinne de mai ; 8° celui de l’été 1898 constitué par Cuignet ; 9° celui de l’automne 1898 constitué à la demande de Freycinet par le même Cuignet dans l’optique d’une prochaine présentation devant la Cour de cassation. Combien y eut-il de numérotations ? 6 au total mais qui ne se retrouvent pas sur chacune des pièces (en prenant en considération les dates). Chaque pièce porte donc entre 1 et 4 numérotations dont deux seulement nous sont connues : celle en rouge paraphée par Gonse et qui correspond au 7e classement et celle au crayon bleu du classement Cuignet, le 8e. Que sont les 4 autres : celle, sur quelques rares pièces donc, dont nos auteurs font l’axe de leur thèse ; celle, plus fréquente, d’une autre encre, sous la même forme (n° X) et souvent biffée et corrigée ; celle, fréquente aussi, simple numéro souligné d’un trait ou d’un arc de cercle ; et la dernière, rarissime, numéros entre parenthèses. Voilà qui nous indique que chaque inventaire ne fut pas numéroté. Pourquoi donc celui de 1894 l’aurait été ? Et puis que nous indique que ces numérotations, hormis les deux identifiées, soient en rapport avec l’affaire Dreyfus quand nous savons que ce n’est qu’à partir de mai 1898 (à l’occasion du rapport Wattinne) qu’il fut décidé de rassembler les pièces éparses, classées ailleurs en divers dossiers et pouvant de près ou de loin s’y rapporter. Que nous indique encore que la présence ou non du « n° », que l’utilisation d’une même encre soient le signe d’une appartenance à un ensemble ? Et si la numérotation à l’encre rouge était bien par hasard celle de 1894, pourquoi les accusateurs de Dreyfus auraient-ils laissé de côté d’autres pièces plus claires encore sur la question homosexuelle comme celle, pour ne citer qu’un exemple, datée de 1893 (n°51 de l’inventaire Gonse/Wattinne, n° 287 du dernier classement Cuignet) et qu’évoquent nos auteurs, lettre dans laquelle Maximilienne, avec un sens consommé de la métaphore, informait son « grand chat » que « son petit frère n’a cessé de pleurer » et qu’il fallait qu’il « le soign[ât] ».
Concluons. Nous ne voyons pas quel est ce « chaînon manquant dans les récits de l’Affaire » qu’évoquent les auteurs de l’article (p. 144). Mais s’il existe, il nous en faudra plus, et de plus précis, pour nous convaincre que la correspondance « amoureuse » des deux attachés permette de le « reconstituer ». Et si l’homophobie fut – et demeure – une réalité, nous ne parvenons pas à voir en quoi c’est le « lien entre judaïsme et homosexualité qui permet le mieux d’expliquer pourquoi le Conseil de guerre se vit confier, de manière illégale, un dossier vide, sur la base duquel Dreyfus fut jugé coupable ». S’il y eut un dossier secret ce n’est que parce que le dossier judiciaire était vide. Et peu importait ce qu’il pouvait alors contenir. Il ne valait que parce qu’il existait et qu’il était transmis par le ministre. En 1896, quand l’ami de Demange, Salles, rencontra chez des amis communs un des juges de 1894 qui lui parla de l’illégalité, du dossier secret et de sa transmission, l’avocat s’offusqua de qu’il considérait comme un « crime de lèse-justice ». Le juge lui répondit : « Comment un crime de lèse-justice ? C’est le ministre de la Guerre lui-même qui nous a apporté ce document. » (« Me Demange [interview] », Le Matin, 7 février 1898) Voilà ce que fut ce dossier. Un ordre de condamner et pas autre chose…
Philippe Oriol
La lettre du 6 septembre 1898 de Picquart à Sarrien :
2
La SIHAD s’est donnée, à sa création en 1995, une mission de vigilance à l’égard de la vérité historique. Elle la remplit donc en répondant point par point à la dernière tentative antidreyfusarde très récemment publiée.
On trouvera à la suite (en complément à la critique du livre : ici), les commentaires – globalement débarrassés des trop nombreuses coquilles et fautes – laissés sur YouTube à cette vidéo. Chacun donne le moment précis où commence à être développé le propos qui se devait d’être rectifié.
4’ 06 : Adrien Abauzit n’a pas tout lu contrairement à ce qu’il affirme avec une fierté un peu puérile : l’affaire Dreyfus ce n’est pas 7 000 pages de débats judiciaires et 9 ou 10 volumes comme on le voit mais 20 volumes et près de 14 000 pages… À cela il faudrait ajouter les procédures non publiées et conservées dans divers centres d’archives qu’Adrien Abauzit n’a pas plus lues : instruction Pellieux, instruction Ravary, les deux instructions Tavernier, l’instruction contre de Pellieux ; et encore les procès connexes qu’il n’a toujours pas lus ; le procès Henry-Reinach, le procès Rochefort Valcarlos, le procès des ligues, le procès en Haute-Cour, le procès Grégori.
4’40 et 5’04. S’appuyer « sur tout ce qui est disponible » et « assimiler les pièces du dossier intégralement, les pour et les contre », comme l’affirme Adrien Abauzit, c’est, en librairie et en bibliothèques, près de deux mille ouvrages, autant d’articles, et des centaines de milliers de pages inédites conservées dans les centres d’archives. A en lire ses notes en bas de page, si Adrien Abauzit a lu 10 livres, c’est le bout du monde…
14’54. « un frère de Dreyfus va choisir l’Allemagne. Donc la famille Dreyfus est une famille franco-allemande ». Les choses ne sont pas aussi simples que cela… Ayant des intérêts en Alsace, la famille avait décidé qu’un de ses membres, pour ne pas perdre les dits-intérêts, demeurerait en Alsace. Et Jacques fut choisi parce qu’ayant déjà servi dans l’armée française, il était le seul qui ne pourrait pas, ainsi que l’avait concédé Bismarck, porter l’uniforme allemand. Les Dreyfus firent ici un choix douloureux qui fut fait dans de nombreuses familles, juives comme chrétiennes qui ne pouvaient se résoudre à tout perdre.
15’28. « C’est un officier qui a eu des bonnes notes, donc il n’a pas été brimé, soit dit en passant »… À l’École de guerre, parmi les notes, une « cote d’amour », note subjective d’appréciation d’aptitude au service d’état-major, était donnée. Dreyfus, qui avait brillamment réussi ses examens, s’était vu attribuer un 5 par le général Bonnefond. Un des condisciples de Dreyfus, le lieutenant Picard, juif aussi, avait eu droit à la même note. Deux notes injustifiées qui leur faisaient perdre des places, fermèrent la porte de l’Etat-major à Picard (pouvaient y entrer les 10 premiers) mais pas à Dreyfus qui, mauvais calcul, passait de la 5e à la 9e place.
20’18. Si la relation de Dreyfus avec Bodson est avérée, il ne fut jamais prouvé qu’elle ait été une espionne. Interviewée pour Le Journal du 6 novembre 1894, elle raconta qu’elle, qui recevait beaucoup de militaires, considérait le capitaine comme « le plus patriote », « le plus chauvin » d’entre tous et qu’ils s’étaient brouillés quand Dreyfus avait appris qu’elle fréquentait un officier allemand qu’il refusait de risquer d’être amené à le croiser un jour. Affirmer qu’elle poussa Dreyfus « à se livrer à ce qu’on appelle de l’amorçage » est une affirmation sans preuve et que rien ne peut établir. Il faudrait déjà pouvoir établir qu’elle fût une espionne ce que même Dutrait-Crozon ou l’acte d’accusation de 1894 contre Dreyfus n’osent faire…
23’41. Le télégramme allemand disant qu’il n’a « aucun signe [de l’]État-major » nous dit donc que le traître n’y est pas… et donc comment le faire coller à Dreyfus qui y était ? Quant à la réponse, elle ne dit aucunement que Schwartzkoppen est en négociations avec un officier de l’État-major : « Bureau des renseignements – Aucune relation… Corps de troupe – Importance seulement… Sortant du Ministère… »… autrement dit : je n’ai aucune relation avec le bureau des renseignements et seuls importent les documents sortant du ministère… Quant à la mention « corps de troupe », veut-elle dire que si l’attaché militaire n’a aucune relation avec le bureau des renseignements, il en a avec un officier de corps de troupe ? On peut le comprendre mais rien n’est sûr. Quoi qu’il en soit, il n’est aucunement dit ici que Schwartzkoppen est en négociations avec un officier du ministère. Où si on l’y voie, c’est qu’on force violemment le texte…
24’12. La lettre Davignon qui dit que Schwartzkoppen a un « ami » au 2e bureau de l’État-major où est Dreyfus à ce moment (« J’ai écrit encore au colonel Davignon et c’est pour ce que je vous prie. Si vous avez occasion [de v]ous occuper de cette [que]stion avec votre ami de le faire particulièrement en façon que Davignon ne vient [sic] pas à le savoir. Du reste il répondrai [sic] pas, car il faut jamais [sic] faire savoir qu’un attaché s’occupe de l’autre ». C’est entendu mais l’ami n’est pas Dreyfus mais Davignon. C’est ce que dira d’ailleurs dans un rapport un homme de la Section de statistique, Gribelin : La pièce portant le n° 40 (lettre de Panizzardi à Schwartzkoppen) fait allusion à des renseignements que Panizzardi aurait demandés directement au lieutenant-colonel Davignon, sous-chef du 2e Bureau de l’État-major de l’armée, alors que Schwartzkoppen serait disposé à demander ces mêmes renseignements à la même source, par un autre intermédiaire. Dans une pensée de méfiance, Panizzardi recommande à Schwartzkoppen de ne plus s’occuper de cette affaire, afin que le lieutenant-colonel Davignon ne sache pas que les attachés militaires, italien et allemand, travaillent ensemble les mêmes questions. Un fait se dégage de cette lettre : Panizzardi tient à ce que tout le monde ignore, au ministère de la Guerre français, que les attachés militaires italien et allemand s’unissent dans leurs travaux. (références dans l’article dont un précédent post donne le lien). Il est intéressant de constater qu’Adrien Abauzit qui a « tout lu » ne cite pas l’extrait donné de Gribelin…
25’. « Ce canaille de D. ». « D » comme Dreyfus. Il est clair que les espions avaient des noms de code et que jamais l’attaché militaire n’aurait employé l’initiale du vrai nom de son espion. Le commandant Cuignet, un des principaux accusateurs de Dreyfus, l’expliquera : « Il est plus vraisemblable que l’individu dont il est question dans la lettre de B…, tout en étant un agent d’espionnage, n’est pas désigné sous son véritable nom ; conformément à l’usage constant de B…, usage dont nous avons plusieurs preuves ». Ce qui au final lui fera dire : « Quant à la pièce “ce canaille de D…” (n° 25), rien ne prouve qu’elle désigne Dreyfus, et je serais plutôt de l’avis de M. Picquart, qui estime qu’elle ne peut s’appliquer à lui, étant donné le sans-gêne avec lequel l’auteur de la lettre traite ce D… » Il est intéressant de constater qu’Adrien Abauzit qui a « tout lu » ne cite pas ces deux extraits qui se trouvent dans un des livres posés devant lui.
25’36. Valcarlos informateur. Le rapport qui en parle est un faux fait bien après la condamnation de Dreyfus… Impossible d’en parler ici : la démonstration tient en 5 pages. On la trouve dans L’Histoire de l’affaire Dreyfus de 1894 à nos jours.
26’29. « Le fameux bor-de-reau ». Adrien Abauzit truque encore et toujours. Le bordereau n’est pas l’énumération de 5 notes comme le soutient Adrien Abauzit : mais de 4 notes et d’un document : le manuel d’artillerie : « Sans nouvelles m’indiquant que vous désirez me voir, je vous adresse cependant, Monsieur, quelques renseignements intéressants / 1° une note… 2° une note… 3° une note… 4° une note… 5° Le projet de manuel de tir de l’artillerie de campagne (14 mars 1894). » La chose est essentielle parce qu’elle prouve que si Dreyfus était le traître, il avait le manuel au moment de la rédaction du bordereau, ce que contredisent les quelques témoignages des collègues de Dreyfus qui disent qu’il le lui avait demandé le mois suivant (et donc qu’il ne l’avait pas au moment de la rédaction du bordereau). C’est sur cette question qu’Adrien Abauzit développe ses « preuves » dans son livre qui ne tiennent qu’à condition de faire ce petit tour de passe-passe… mais sans doute faudra-t-il y revenir…
27’51. « Des secrets qui ne sont pas minces ». Du premier, le frein hydraulique du 120, canon et frein anciens adoptés depuis plusieurs années, l’Allemagne savait tout depuis 1889 grâce aux aimables Boutonnet et Greiner. Ce canon avait même été présenté aux attachés militaires étrangers en 1891, présentation dont avait rendu compte la presse allemande, et fait l’objet de nombreuses publications dont une description complète qui était à la disposition de tous depuis le 7 avril 1894. Les deuxième et quatrième documents, relatifs aux troupes de couverture et à Madagascar, étaient si peu secrets que plusieurs journaux en avaient largement parlé : le Journal des sciences militaires avait consacré en mai 1894 un article au premier sujet et le Mémorial de l’artillerie de la marine, La France militaire et Le Yacht quelques séries au second, en juin, août et septembre 1894. Le troisième document était lui aussi peu secret, qui avait fait l’objet d’articles dans La France militaire et, mieux même, d’une publication annuelle émanant du ministère de la Guerre. Sujet d’actualité, il avait été aussi au centre de nombreux débats à la Chambre, débats publiés au Journal officiel. Quant au cinquième document, le manuel de tir, si « difficile à se procurer » selon l’auteur du bordereau, il était à la disposition des officiers dans tous les régiments et avait fait l’objet d’une édition autographiée par une société d’officiers de réserve, la Société de tir au canon. À Rennes, le sous-lieutenant Bruyerre racontera même se l’être procuré contre vingt centimes à la presse régimentaire.
28’55. « Il fallait être passé par tous les bureaux ». Non ! puisqu’il s’agit de notes, c’est-à-dire de mémos, qu’il était possible de faire sur la base des articles évoqués dans le post précédent.
29’35. Le canon de 120, sujet très technique dont seul aurait pu parler un artilleur. Non et pour les mêmes raisons que vus dans les post précédents. De plus le vocabulaire employé dans le bordereau n’est pas celui d’un artilleur. Un artilleur, en effet, n’aurait jamais parlé de « corps » mais de « régiment », du « 120 » mais du « 120 court de campagne », de « conduite » de la pièce mais de « comportement », de « frein hydraulique » mais de « frein hydropneumatique », de « manuel de tir de l’artillerie de campagne » mais de « manuel de tir d’artillerie de campagne ».
29’35. Dreyfus était « le seul à être passé à l’école de Pyrotechnie au moment où était fabriqué le canon de 120 ». Dreyfus fut certes à l’école de Pyrotechnie de Bourges de septembre 1889 à avril 1890 mais tout cela est sans intérêt. Le bordereau n’a jamais parlé du canon de 120 court en soi mais du « frein hydraulique du 120 et [de] la manière dont s’est conduite cette pièce ». Et à vrai dire, non pas du frein hydraulique qui n’était pas le sujet mais du frein hydropneumatique (confusion qu’un artilleur ne pouvait faire ; voir post précédent). Un frein qui n’a été fabriqué que bien plus tard et dont, dira le commandant Baquet, « les premiers dessins exacts et complets […] ne sont sortis de la fonderie que le 29 mai 1894, où ils ont été envoyé au Ministère pour l’établissement des tables de construction du canon court. » Quant à la première décision de faire des essais – la seule qui compte pour dire comment s’était comporté le frein –, elle datait du 13 février 1894, avait été confirmée le 16 mai 1894, et les essais prescrits avaient eu lieu pendant les écoles à feu. Des écoles à feu (5 au 9 août) auxquelles n’assista pas Dreyfus mais auxquelles assista Esterhazy… tiens donc… Il faudrait donc éviter de dire n’importe quoi…
30’31. « Le 11 octobre, un conseil restreint des ministres, décide donc de l’arrestation de Dreyfus ». Non. La décision fut du seul Mercier et pas celle du gouvernement. Mercier avait promis à ce conseil de ne pas donner suite si d’autres preuves n’étaient pas trouvées. « [J]’obtins de lui, racontera Hanotaux, l’engagement que s’il ne trouvait pas d’autres preuves contre l’officier dont il s’agissait et dont nous ignorions le nom, la poursuite n’aurait pas lieu. » Mais Mercier avait pris sa décision. « […] je ne veux pas qu’on m’accuse d’avoir pactisé avec la trahison !… », déclara-t-il, « inébranlable », à Hanotaux, « préoccupé », qui était passé le voir dans la soirée pour une nouvelle fois lui demander de « renoncer à une procédure qui pouvait [les] entraîner vers les plus graves difficultés internationales ».
30’41. La preuve de la culpabilité pendant la dictée et le changement de disposition des mots quand Dreyfus reconnaît qu’il s’agit du bordereau. J’invite à aller voir sur le lien donné sur le premier post la reproduction de la dictée (ici)… On n’y verra aucunement le changement affirmé qui n’est qu’un pur fantasme. C’est drôle comme on peut voir ce qu’on veut voir… Quant à Dreyfus qui aurait reconnu avoir modifié son écriture sous prétexte qu’il avait froid aux doigts, là encore Adrien Abauzit se livre à son bricolage habituel. Voici ce que dit Dreyfus : « Quand le commandant du Paty de Clam m’a fait la dictée, au bout d’un certain nombre de mots, il m’a demandé : “Qu’avez-vous ? Vous tremblez ?” Je ne tremblais pas du tout. L’interpellation m’a paru tout à fait insolite. Faites une interpellation pareille à quelqu’un qui est en train d’écrire, et vous verrez. L’interpellation m’a donc paru insolite. J’ai cherché dans mon esprit pourquoi cette interpellation. Je me suis dit “Il est probable que c’est parce que j’écris lentement, et en effet, j’avais les doigts raidis. Il faisait froid dehors ; c’était le 15 octobre, et il faisait si froid qu’il y avait, il faut bien vous le rappeler, un très grand feu allumé dans le cabinet du chef d’État-major. Je pensais que l’interpellation provenait de ce que j’avais écrit lentement, et c’est précisément parce que j’avais les doigts raidis. C’est pour cela que j’ai répondu “J’ai froid aux doigts”, mais l’interpellation me paraissait tout à fait insolite. » Dreyfus ne reconnaît aucunement avoir changé son écriture. Enfin, relativement à la température, il faisait ce matin-là 9° ce qui est froid surtout dans les grands appartements de la rue Saint-Dominique et qui justifiait justement le grand feu dont parle Dreyfus et que personne ne contredira.
34’54. « Dreyfus avait attiré l’attention de nombre de ses camarades »… curiosité, etc. Que valent des témoignages de subordonnés recueillis par des supérieurs au sujet d’un homme présenté comme un traître ? Après la réhabilitation, un de ces « camarades » écrira à Dreyfus pour expliquer son attitude de 1894 : « Quand, en 1894, le sous-chef d’état-major nous réunit pour nous dire que tu étais coupable et qu’on en avait les preuves certaines, nous en acceptâmes la certitude sans discussion puisqu’elle nous était donnée par un chef. Dès lors nous oubliâmes toutes tes qualités, les relations d’amitié que nous avions eues avec toi pour ne plus rechercher dans nos souvenirs que ce qui pouvait corroborer la certitude qu’on venait de nous inculquer. Tout y fut matière. »
35’31. Les espionnes. Nous avons déjà parlé de madame Bodson qui jamais ne fut espionne contrairement à ce que dit Adrien Abauzit. Notons d’ailleurs qu’il la fréquentait en 1886 ou 1887 à l’époque où il était lieutenant au 31e d’artillerie et ne risquait pas là d’avoir accès à grand-chose. Quant à ce que dira Dreyfus à Rennes à ce sujet, ce n’est pas encore ce que nous dit Adrien Abauzit : « Mon colonel, vous comprenez bien par quel sentiment de discrétion je ne parlerai ici ni de M. ni de Mme Bodson ; je n’ai pas à parler des relations anciennes que j’ai eues avec une personne et vous comprendrez très facilement toute ma discrétion à cet égard. Les relations que j’ai eues avec Mme Bodson ont cessé vers 1886 ou 1887 ; à partir de cette époque, je n’ai revu ni M. ni Mme Bodson. »
36’18. « L’estocade fatale » : le manuel de tir et les témoignages de Jeannel, Brault et Sibille. Si Jeannel avait prêté à Dreyfus le manuel en juillet, comme il le dira dans ses dépositions et qu’e Dreyfus le lui avait « rendu 48 heures peut-être ou trois jours après », comme l’ajoutait Jeannel, pourquoi se renseigner auprès d’autres le mois suivant ? Pour savoir si le manuel était à jour, comme le dit Adrien Abauzit (38’30) ? Si Dreyfus avait eu le manuel entre les mains et même s’il n’avait jamais su avant qu’il en existait un, il avait dû comprendre, au millésime présent sur la couverture (voir photo reproduite dans le compte rendu correspondant au lien donné dans le premier post ; ici), que le manuel sortait tous les ans. Le prochain, édition de 1895, sortirait donc en toute probabilité l’été suivant. De plus, si Dreyfus est le traître, et s’il a envoyé à Schwartzkoppen non une note sur le manuel mais le manuel lui-même comme nous l’avons expliqué précédemment (le bordereau liste : 1° une note… 2° une note… 3° une note… 4° une note… 5° Le projet de manuel de tir de l’artillerie de campagne ; ce qui écroule donc la « démonstration » d’Adrien Abauzit), il l’a donc fait en juillet comme le dit Jeannel. Il n’a donc aucune raison de se renseigner auprès de Sibille et de Brault… L’accusation comprit d’ailleurs tellement bien la faiblesse du témoignage de Jeannel et son incompatibilité avec ceux de Brault et de Sibille, que Jeannel ne sera pas cité à comparaître en 1894 et ce malgré les demandes réitérées de Dreyfus lui-même. Jeannel, à Rennes, racontera que d’Ormescheville lui avait dit : « Nous avons d’autres preuves de culpabilité suffisantes pour obtenir la condamnation, nous ne retiendrons pas la question du manuel de tir. » Surprenant pour une « estocade fatale ». Dommage qu’Adrien Abauzit, ici comme dans son livre, passe ce fait passionnant et si significatif sous silence. Quant à Dreyfus, il affirmera en effet avoir tout ignoré du manuel de tir français mais avoir demandé à Jeannel pour un travail qu’il avait à faire celui de l’artillerie allemande…
Mais le plus beau n’est pas là. À son habitude, Adrien Abauzit a lu de travers. Les témoignages de Jeannel et de Brault et Sibille ne sont pas liés : Jeannel parlait du manuel d’artillerie ; Brault et Sibille de celui de l’infanterie !!!
42’57. Le dossier secret et la manière dont les dreyfusards en furent au courant. L’affaire de la voyante Léonie est vraie ou tout au moins il est vrai que Mathieu consulta une voyante… Le fait indique bien le désespoir du frère. Mais dire que c’est ainsi que Mathieu Dreyfus fut au courant de la violation du droit commis au procès de 1894 est une farce absolue qui est une nouvelle indication des méthodes abauzitiennes… Mathieu fit en effet ces expériences au cours desquelles Léonie lui parla des pièces secrètes soumises aux juges et, dans ses mémoires, explique qu’il « n’insist[a] pas » (p. 51), n’ayant sans doute pas compris… Ce sont les témoignages de Gibert, Develle, Reitlinger, Salles, etc. qui lui apprirent l’illégalité. Dans le bricolage narratif qu’il livre ici, Adrien Abauzit passe bien sûr cette réalité sous silence ; une réalité présente dans les mémoires de Mathieu (p. 68-69 de l’édition de 1978) qu’il a consultées et qu’il oublie consciencieusement pour ne conserver que cette histoire de voyante en faisant dire à Mathieu des choses qu’il n’a jamais dites ou qui, sorties de leur contexte et de la chronologie, lui permettent de nous faire cette petite blague qui le réjouit tant… Et le pire, c’est que la malhonnêteté éclate plus fracassante encore quand on voit la page en effet consultable sur Gallica où juste après la citation donnée (p. 51), Mathieu raconte la visite que lui avait faite Gibert après avoir reçu les confidences du président de la République et la révélation de l’illégalité. C’est ainsi que Mathieu comprit, ainsi qu’il le raconte, les paroles de Léonie. Jamais, dans ses mémoires, il ne dit autre chose et certainement pas ce qu’Adrien Abauzit nous rapporte…
47’. La dégradation. Adrien Abauzit nous dit que Dreyfus a déclaré : « c’est vrai que j’ai livré des documents mais je l’ai fait pour en obtenir d’autres ». Adrien Abauzit demeure dans son registre en bricolant les citations. La phrase exacte rapportée par Lebrun Renaud est : « Le ministre sait que je suis innocent, il me l’a fait dire par le Comdt du Paty de Clam, dans ma prison, il y a quelques jours, et il sait que si j’ai livré des documents, ce sont des documents sans importance et que c’était pour en obtenir de plus sérieux des allemands. » Pas de « c’est vrai », et une proclamation d’innocence en parallèle qui est pour le moins curieuse pour quelqu’un qui ferait des aveux… De plus, d’Attel n’a pas entendu ces mêmes propos, comme le soutient encore Adrien Abauzit mais : « « Pour ce que j’ai livré, cela n’en valait pas la peine. Si on m’avait laissé faire, j’aurais eu davantage en échange ». Comment deux témoins ont-ils pu, au même moment, entendre des propos si différents ? Que nous dit donc qu’ils aient bien entendu ? Que nous dit que Dreyfus ait dit « sait » et non « pense » ou « croit » ou « dit »… ce qui changerait de tout au tout le sens de la phrase ? Pour un avocat, Adrien Abauzit à une curieuse conception de la preuve…
49’22. Reinach. Il est, nous dit Adrien Abauzit, « le fils d’un banquier israélite allemand ». C’est faux ! Hermann-Joseph Reinach, né en 1814 à Francfort n’est pas allemand mais d’origine allemande. Il fut naturalisé en 1838 et donc était français depuis 18 ans à la naissance de Joseph.
53’10. « Esterhazy était au final un sale type ». Première vérité en presqu’une heure. J’avais raison de ne pas désespérer.
53’26. Picquart. Ma joie fut de courte durée… Quelques secondes… Adrien Abauzit nous dit que Picquart va succéder à Sandherr, à la Section de statistique, grâce aux réseaux gambettistes et grâce à Galliffet. Eh bien non ! Il va lui succéder grâce au général Millet et surtout grâce au général de Boisdeffre…
54’03. Picquart découvre Esterhazy. Passons sur la date fausse (février pour mars) et l’avancement anticipé de Lauth (capitaine qui ne sera commandant qu’en septembre 1897)… C’est dans l’ordre des choses quand on ne connaît pas son dossier… Donc le petit bleu est un faux parce qu’il n’est pas de l’écriture de Schwartzkoppen, qu’il n’est pas signé et qu’il n’est pas timbré. L’écriture : il arrive que parfois des hommes tels que des attachés militaires utilisent les service d’un secrétaire qu’ils paient pour cela… Signature : il ne me semble pas extraordinaire qu’un employeur écrive à son espion… pas extraordinaire à une seule condition qui est de ne pas signer… Pas timbré : comment le petit bleu aurait-il pu l’être s’il a été trouvé par la Bastian dans la corbeille à papier ? S’il l’avait été, la chose aurait paru curieuse… Donc : Schwartzkoppen n’aurait-il pu faire écrire son secrétaire à son espion puis se raviser et jeter la lettre à laquelle il avait renoncé à la poubelle ?
58’40. Picquart a introduit le petit bleu dans le paquet apporté par la voie ordinaire. Admettons cela. Mais si cela était, il faut convenir que Picquart était un âne. N’eût-il pas été plus simple, dès le départ, si le grand complot avait existé, de faire un document intact, sans déchirure, de profiter de l’occasion pour faire imiter l’écriture de Schwartzkoppen, de le signer de son nom, de ne pas oublier l’oblitération, de ne surtout pas le mettre dans les cornets de la Bastian et de faire croire qu’il avait été saisi à la poste ou mieux même, puisqu’Esterhazy était complice, de le lui envoyer ? Et puisqu’il s’agissait de sauver Dreyfus, n’aurait-il pas été aisé et surtout judicieux de ne pas oublier d’y mettre une phrase d’une grande clarté sur son innocence ?
59’19. Les truquages de Picquart. Impossible de montrer ici les erreurs et les errances d’Adrien Abauzit. Ce serait trop long. Je renvoie une nouvelle fois à L’Histoire de l’affaire Dreyfus de 1894 à nos jours. Mais toutefois, une remarque… Si Picquart a demandé à Gribelin de faire timbrer le petit bleu, ce ne pouvait être sur les photos demandées à Lauth mais inévitablement sur l’original. Un timbre sur une photo aurait été pour le moins surprenant… Du coup pourquoi avoir fait faire des photos pour faire disparaître les déchirures ? Simplement parce que Picquart ne voulait pas, quand il montrerait les photos, qu’on sache la provenance du petit bleu et certes pas pour faire croire ce qui n’était pas. Et s’il avait demandé de faire timbrer l’original pour faire croire ce qui n’était pas, il est vraiment un âne… On ne pouvait faire timbrer que le document reconstitué : donc les timbre aurait été sur les bandes de reconstitution !!!! Allons allons Adrien, il faut réfléchir… Pourquoi le timbre alors ? Toujours pour qu’on ne sache la provenance du petit bleu. Mais pourquoi cela ? Parce que l’arrivée du bordereau avait été si mal gérée en 1894 que Picquart voulait éviter la même catastrophe. Il arrive, Adrien Abauzit, que les choses soient simples…
1’00’31. Les témoins Iunck et Valdant. Que ces deux-là témoignent avec Lauth contre Picquart qui était devenu l’ennemi aurait tendance à relativiser leur témoignage… ni parents, ni alliés…..
1’02’27. Cuers et la « collusion germano-dreyfusarde ». Trop long toujours pour réduire à néant autant d’arguments qui n’en sont toujours pas et ne sont que des affirmations que ne soutient pas la moindre preuve. Toutefois… si Cuers était la preuve de cette « collusion germano-dreyfusarde », pourquoi donner une description du traître qui pouvait concerner une cinquantaine de personne et ne pas simplement dire que le traître était Esterhazy ? De même, Cuers, à Bâle, vit Henry et Lauth. Pourquoi si tout était prévu, Picquart, qui était le chef, ne fut-il pas du voyage ? Car en effet, ces deux-là avaient intérêt à empêcher Cuers de parler et en tout cas, comme ils le feront dans leur rapport, de ne rien dire au sujet de la question de l’innocence de Dreyfus à laquelle, au passage, Picquart ne porta pas la moindre attention. Mais pourquoi Henry et Lauth avaient-ils intérêt à empêcher Cuers de parler ? Parce que revenir sur le procès Dreyfus était ouvrir le procès de l’État-major et de la Section de statistique : Henry avait fait un faux témoignage au procès de 1894, le dit-procès était illégal et tous le savaient et il fallait protéger Mercier, initiateur de cette illégalité, qui au début de 1895 avait fait promettre à tous le silence. Pour le détail de ces faits, voir une nouvelle fois L’Histoire de l’affaire Dreyfus de 1894 à nos jours qui ne se contente pas d’affirmer…
1’07’26. « Mathieu Dreyfus va payer extrêmement cher un journaliste anglais pour qu’il publie dans son journal la rumeur selon laquelle Dreyfus se serait évadé ». D’où sort cette information que Mathieu a « payé extrêmement cher » ? Mathieu dans ses mémoires (qu’Adrien Abauzit a lus) n’a jamais parlé de cela et personne d’autre que lui n’aurait pu le dire preuves en main… Mathieu ne parle que de l’offre de concours que Clifford Millage, convaincu de l’innocence de son frère, lui avait faite…
1’07’57. L’article de L’Éclair. Le premier article ne demandait pas quelles étaient les preuves sur lesquelles Dreyfus avait été condamné comme l’avance avec assurance Adrien Abauzit mais promettait au contraire de les donner si la campagne qui commençait ne s’arrêtait pas (articles qui parlaient de doute et avaient paru dans Le Jour nationaliste et dans L’Autorité bonapartiste et antisémite qu’on ne peut pas soupçonner de faire partie du syndicat). La promesse fut tenue puisqu’en effet quelques jours plus tard était publié l’information de l’illégalité de 1894 qui bien évidemment n’était pas donnée comme telle. Adrien Abauzit se garde bien de le dire, bien qu’il ait dû le lire puisque l’information est dans un des volumes qui est devant lui. On sut plus tard qu’avant d’être retouché par l’antidreyfusard Georges Montorgueil l’article avait été porté à L’Éclair par Lissajoux, journaliste au Petit Journal, et tout autant antidreyfusard que le précédent, à partir des informations, affirmait-il assurément pour protéger sa source, obtenues par plusieurs personnes ». Pourquoi Adrien Abauzit ne dit-il pas cela qu’il a du lire ? Du coup, qui est donc la source ? Il est probable que ce fût bien un homme du ministère. Le premier article de L’Éclair ne dissimulait d’ailleurs pas sa source qui en avait promis un second, de l’avis « du monde militaire », si devait s’accentuer la campagne visant à insinuer le doute. Un homme du ministère, si ce n’était l’ancien ministre de la Guerre, Mercier, lui-même, qui, plus que quiconque, avait tout intérêt à mettre fin aux rumeurs en parant par avance la possible découverte de l’illégalité. Mercier n’avait d’ailleurs pas hésité, aux premiers jours de l’affaire, à aller voir Judet, directeur du Petit Journal, pour l’inviter à « soutenir » son action… Ce n’est qu’une hypothèse dont la démonstration, trop longue à reproduire ici peut se lire dans L’Affaire Dreyfus de 1894 à nos jours déjà citée.
1’09’40. La mission de Picquart en Tunisie. Là nous frisons la blague… Adrien Abauzit nous dit que ses amis ne savent pas qu’il est parti parce que sa mission est top secrète et que donc qu’ils continuent à lui écrire au ministère. Et en décembre, nous dit Adrien Abauzit un peu plus d’une minute plus tard (1’11’09), il aurait reçu cette lettre qui lui disait : « votre malheureux départ à tout dérangé ». Mais puisqu’ils l’ignoraient ? Vraiment… On imagine donc que le sachant parti, les complices de Picquart ne lui auraient pas écrit où il était ? Et admettons qu’ils n’aient pas son adresse tunisienne, lui auraient écrit une lettre qui prouvait sa culpabilité non chez lui mais au ministère ? Enfin… ce n’est pas sérieux… Picquart n’a sans doute pas tort d’arguer de faux une telle missive… Et comment Adrien Abauzit peut-il se contredire ainsi et aussi souvent ?
1’11’55. Scheurer-Kestner. Adrien Abauzit nous dit que SK avait demandé à Billot de rouvrir le dossier Dreyfus dès « le printemps 1896 ». Billot, en effet, dira à Rennes que « M. Scheurer-Kestner, vice-président de la Haute Assemblée, est venu à mon banc me demander confidentiellement si je ne voudrais pas m’occuper de l’affaire Dreyfus. » Scheurer-Kestner, dans ses mémoires qu’Adrien Abauzit aurait dû lire, à une tout autre version, ne donne pas cette date et en donne deux autres. SK explique tout d’abord, qu’après avoir reçu en février 1895 la visite de Mathieu qui lui demandait son aide, il refusa mais avait été troublé. Il s’était donc adressé à Billot pour en savoir plus et Billot l’avait dissuadé de s’intéresser à cette affaire. Ensuite, SK explique qu’en juillet 1897 (mais la date semble plutôt fin 1896), il avait demandé à Billot de lui « donner quelques preuves inédites, c’est-à-dire convaincantes, de la culpabilité de Dreyfus ». C’est tout.
Parole contre parole… Il est dommage qu’Adrien Abauzit, avocat, refuse systématiquement de connaître, et d’évoquer quand il la connaît, la parole de la défense et n’écoute que celle de l’accusation.
1’12’44’. Faux Henry. Adrien Abauzit affirme que les antidreyfusards ne firent qu’un faux quand les dreyfusards en firent « des légions » [sic] dont le plus frappant est le petit bleu. Non. Les antidreyfusards ou plus exactement la Section de statistique en firent de nombreux. Nous en avons ainsi retrouvé un nouveau, récemment, indiscutable, preuves à l’appui : une lettre de Gonse à Boisdeffre au sujet des aveux qu’il serait trop long d’expliquer ici mais dont on pourra retrouver l’explication dans L’Affaire Dreyfus de 1894 à nos jours déjà citée. À cela on pourrait ajouter la pièce des chemins de fer dont Adrien Abauzit parle longuement dans son livre et n’évoque pas ici (le faux y consiste en un changement de date), les rapports Guénée et quelques autres. Quant aux faux « dreyfusards », encore faudrait-il les prouver avec d’autres arguments que ceux avancés pour le petit bleu dont on a vu la faiblesse. Pour qu’un chose soit, il ne suffit pas de dire qu’elle est, il faut le prouver. Et le prouver avec de vrais arguments, non des déductions qui reposent sur de simples affirmations ou des « développements » qui font le tri dans les faits. Quant à la « blague Macron », elle ne démontre pas grand-chose si ce n’est qu’Adrien Abauzit a un sens de l’humour assez pauvre.
1’16’02. Picquart n’a pas fait venir à la Section de statistique Leblois en septembre-octobre 1896 pour lui communiquer des dossiers secrets. Il a été prouvé qu’à ces dates Leblois n’était pas à Paris et en dehors des témoignages non concordants et évolutifs d’Henry et de Gribelin, rien ne put jamais prouver qu’il lui avait communiqué le dossier secret. Si Adrien Abauzit avait réalisé un réel travail d’historien, il aurait pris les différents témoignages des deux sur cette question et aurait pu observer de quelle manière ils furent préparés et évoluèrent au gré des besoins. Peut-être aurait-il pu ainsi comprendre que dans une affaire judiciaire, les témoignages d’une même partie doivent être évalués et qu’ils peuvent parfois n’être pas la vérité, rien que la vérité et toute la vérité.
1’16’38. La « jonction » Leblois-SK. Adrien Abauzit nous la dit « complètement bidon » et qu’elle devait être bien antérieure à ce que les deux intéressés en dire. « Devait » ? Il faudrait quelques preuves qu’Adrien Abauzit ne donnera jamais. Si elle ne repose que sur le témoignage Billot vu précédemment, ce ne peut suffire. Parole contre parole. Nous avons aujourd’hui tous les originaux de la correspondance Leblois-SK qui indique bien ce que fut leur relation. Pourquoi Adrien Abauzit n’est-il pas allé la voir ?
1’17’07. Les événements d’octobre-novembre 1897. Dommage qu’Adrien Abauzit n’ait pas préparé son dossier. Il aurait pu découvrir les souvenirs de Du Paty de Clam et un certain nombre de documents dont les autres lettres d’Esterhazy à Billot, lettres dont il ignore tout, et qui détruisent sa narration. Pour le détail réel de ces événements, nous renvoyons encore à L’Affaire Dreyfus de 1894 à nos jours.
1’24’47. LE MEILLEUR. On a là un parfait échantillon de la méthode abauzitienne, pour ainsi dire une synecdoque. « Sans [s]e vanter », Adrien Abauzit nous révèle un scoop extraordinaire, « une analyse et une conclusion nouvelles » qui prouve tout. Souffrain, agent du Comité de défense contre l’antisémitisme, est l’auteur des faux télégrammes adressés à Picquart. Pour commencer la chose n’est pas nouvelle, ni comme exposition, ni comme analyse, ni comme conclusion, et se trouve tout entière en mieux écrite dans le Dutrait-Crozon, bible antidreyfusarde publiée en 1924, p. 98. Adrien Abauzit ou l’art de faire du vieux avec du vieux. Adrien Abauzit découvre donc du connu et emprunte à ses aînés sans le dire ce qui leur appartient et auquel ils attachaient d’ailleurs si peu d’importance qu’ils ne l’exploitèrent pas. Mais peu importe. Ce qui compte ici, comme toujours avec Adrien Abauzit, c’est ce qu’il ne dit pas. Pourquoi, puisque la chose se trouve dans un des volumes présents devant lui, n’explique-t-il pas comment il est possible que si Esterhazy est un agent du syndicat, c’est lui, qui dès l’instruction de Pellieux, le 24 novembre 1897, parle à l’enquêteur du rôle de Souffrain et de ses liens avec le « Syndicat » ? Voici ce qu’il dit, évoquant la fameuse et fantasmatique dame voilée qui l’aurait renseignée : « Au cours d’une de ses conversations, elle est entrée dans de très grands détails sur l’organisation de ce qu’elle appelait « la bande », et elle m’a dit notamment qu’un M. Isaïe Levaillant avec l’ancien agent Souffrain s’occupaient très activement de l’affaire ; et que, notamment, M. Isaïe Levaillant avait eu pouvoir du colonel Picquart de se faire remettre sa correspondance au domicile qu’il avait conservé à Paris ». Quel intérêt pour le syndicat de jouer cette partition ? Mais il y a encore mieux… Pourquoi le 19 novembre, donc quelques jours plus tôt, le même Esterhazy avait lui-même publiquement accusé Souffrain et Levaillant en déclarant à Charles Roger de l’Intransigeant qui s’était empressé de l’imprimer que : « L’affaire est machinée de toutes pièces par trois [sic] personnes : M. Isaïe Levaillant, ancien haut fonctionnaire de la police ; l’ex-agent Souffrain, qui a échangé récemment des télégrammes avec ce dernier ; l’avocat L…, et le colonel Picquart » ? Pourquoi encore le 17 novembre, Esterhazy avait-il, sous son pseudonyme de « Dixi », rendu la chose pour la première fois publique en publiant dans La Libre Parole : « À Monsieur Scheurer-Kestner. M. Scheurer-Kestner n’a pas répondu à nos questions concernant la parenté entre : 1° Le juriste M. L. qui a fouillé dans les dossiers du service des informations du ministère de la guerre et son juriste conseil. 2° Le capitaine Lebrun-Renault, qui a reçu les aveux de Dreyfus. 3° L’ex-agent Souffrain qui, avec Isaïe Levaillant, mène la campagne policière pour Dreyfus. Si M. Scheurer-Kestner veut des renseignements complémentaires, nous lui dirons ceci : Dès que Souffrain sut qu’il s’était montré comme un novice en apprenant qu’on faisait une petite enquête sur des télégrammes imprudents et affolés, il a essayé de se rattraper en prévenant son compère et ami par l’intermédiaire d’un Juif de Tunis. Le compère va protester qu’il n’a jamais connu Souffrain. Nous chargeons Mlle S… de le démentir. » Quel intérêt pour le complice Esterhazy d’impliquer ainsi SK, Leblois, Picquart, de révéler les télégrammes et l’identité de Souffrain et de Levaillant avec lesquels il est censé travailler, et, dans le dernier, de parler des aveux…. Adrien Abauzit, il faut nous expliquer, sans vous vanter, quelle est cette stratégie….
1’31’22. Esterhazy auteur des télégrammes. Adrien Abauzit réfléchit pour une fois à l’endroit mais le problème c’est qu’il en arrive tout de même à une conclusion qui n’est pas la bonne. Une conclusion qui n’est pas la bonne et en induit une autre qui est la nôtre, à nous « historiens de la vulgate ». Comment Esterhazy a-t-il pu, martèle-t-il, parler des télégrammes envoyés à Picquart, s’il ne les a pas écrits ? Il joue donc la partition du « Syndicat ». C’est vrai qu’Esterhazy en parle et que s’il peut en parler, c’est qu’il les a écrits ou tout au moins qu’il en connaît l’existence. Mais ne pouvait-il justement le savoir parce que, protégé par l’État-major, comme le dit plus tôt Adrien Abauzit, les gens de l’État-major lui en avaient parlé et que s’ils lui en avaient parlé, c’est parce qu’ils en étaient à l’origine ? Ils lui en avaient parlé ou les lui avait fait écrire ? C’est ce que dira d’ailleurs Esterhazy dans ses mémoires inédites qu’une nouvelle fois Adrien Abauzit s’est bien gardé d’aller voir. Parce que si Esterhazy est complice de Picquart, il faut vraiment, comme nous le disions dans le dernier post, qu’Adrien Abauzit nous explique pourquoi Esterhazy pouvait dans les articles de La Libre Parole y dénoncer ses complices : Picquart, Leblois, Souffrain, Levaillant et même rappeler à tous ceux qui n’y pensaient plus que Dreyfus avait fait des aveux. Et puisque nous en sommes à demander des explications, il faudrait aussi qu’Adrien Abauzit explique pourquoi il évoque ces articles sans jamais dire qu’Esterhazy y livre au public le nom de ses complices… Et c’est d’autant plus amusant qu’à la suite, Adrien Abauzit vient attaquer Marcel Thomas qui fut un grand historien et lui reprochant de passer des faits sous silence. La poutre dans l’œil d’Adrien Abauzit et si épaisse et si bien enfoncée qu’ainsi doivent s’expliquer ses constantes erreurs de lectures…
1’32’03. Les contradictions de Marcel Thomas. Oui, Marcel Thomas s’est contredit d’un livre à l’autre sur un point de détail qui n’intéresse personne et surtout pas la justice de l’époque qui fut saisie et n’inquiéta jamais Souffrain. Cela prouve juste que Marcel Thomas travaillait et qu’il était un vrai historien, c’est-à-dire quelqu’un qui qui sait que l’histoire est une matière vivante et que toute hypothèse, toute thèse peut-être à tout moment remise en question par la découverte d’une nouvelle source… et même quand cette thèse est celle qu’on a soi même défendue. Ce qui est d’ailleurs amusant, c’est que Souffrain fut découvert avant l’instruction Ravary (contre Esterhazy) et que le commandant Ravary refusa de l’entendre… Celui qui déposa plainte le 4 janvier 1899 contre Souffrain était… Picquart… et qu’il n’y fut pas donné suite… Pourquoi Picquart déposa-t-il plainte contre celui censé être son complice… Cela fait partie du grrrrrand complot ? Mais dans ce cas pourquoi un homme de l’État-major refusa-t-il d’entendre dans le cadre d’une procédure judiciaire un suspect qui était présenté comme la cheville ouvrière du Syndicat ?
1’34’43. Esterhazy n’était pas en mesure de livrer les documents énumérés au bordereau. Carvallo l’a dit à Rennes, à partir du 7 avril 1894, les officiers d’artillerie avaient eu à leur déposition « une description complète du frein hydropneumatique ». S’étant rendu à Châlons, comme nous le savons, il n’aurait pas été d’une extrême difficulté à Esterhazy de se la procurer. De même de la question des troupes de couverture dans laquelle le 6e corps d’armée jouait un rôle essentiel, 6e corps d’armée basé à Châlons… et si Esterhazy n’avait pu là obtenir les renseignements dont il avait besoin il lui aurait suffi de lire et de résumer le Journal des sciences militaires qui s’était intéressé à la question dans son numéro de mai 1894. Relativement aux modifications apportées aux formations de l’artillerie, nous savons qu’elles avaient été mises en application, toujours à Châlons, et au moment même où Esterhazy s’y trouvait. Concernant Madagascar, on pourrait rappeler les différentes publications qui livrèrent sur le sujet des informations ou, rappeler que le colonel de Torcy, chargé de préparer l’expédition, était alors affecté à Châlons où Esterhazy aurait très bien pu recueillir quelques informations. Le manuel de tir était, nous en avons parlé dans un précédent post, à la disposition de tous et avait même fait l’objet d’une édition autographiée. Il n’était donc pas difficile de se le procurer, contrairement à ce qu’en dit Esterhazy dans le bordereau pour lui donner de la valeur. Et faut-il rappeler que la phrase du bordereau : « le ministère de la Guerre […] a envoyé un nombre fixe dans les corps et ces corps en sont responsables. Chaque officier détenteur doit remettre le sien après les manœuvres » ne peut indiquer qu’une chose : que son auteur ne pouvait être qu’un officier d’un corps, comme l’était Esterhazy et non un officier d’État-major qui n’avait aucune raison de parler de ce qui se passait dans les corps. Demeurent les manœuvres. Marcel Thomas, lui-même… Adrien Abauzit, a prouvé qu’Esterhazy avait assisté « à des manœuvres de garnison » à la fin d’août 1894. Cela pourrait suffire dans le cas où nous ne voudrions pas considérer, ce qui nous semble pourtant probable, qu’il ne s’agissait là encore que d’un mensonge visant à rendre intéressante sa « collaboration ». Même écriture, même papier, possibilité de fournir les documents, relation établie avec Schwartzkoppen… il n’en faut souvent pas autant pour convaincre le plus retors des policiers…
1’35’14. Zola « couillon », Jaurès « raclure », soit. Mais ce n’est pas le général de Boisdeffre qui parle au procès Zola de la pièce qu’on découvrira être un faux mais le général de Pellieux…
1’39’14. La saisie de la commission de révision. Elle vota contre dit Adrien Abauzit. C’est faux. Elle n’a pas pu se départager, à 3 voix contre 3, égalité qui laissait donc la question ouverte… La source vient de Dardenne qui raconte, comme souvent, n’importe quoi. Il faut aller voir les sources primaires, Adrien Abauzit, et ne pas se contenter des livres des autres même (surtout ?) quand ce sont des amis politiques…
1’41’10. Les « experts en graphologie [sic] ». La graphologie n’étant pas une science et graphologue n’étant pas un métier, mieux vaut avoir en face de soi des chartistes et des philologues pour analyser une écriture et tenter de proposer une attribution… Qu’il y eut donc un seul graphologue parmi les experts dreyfusards est rassurant. Adrien Abauzit devrait comprendre la différence entre un graphologue et un expert en écritures. Quant à se gausser du fait qu’un d’eux pût être dentiste… on voit bien des avocats spécialistes du droit du travail se lancer dans l’histoire…
1’44’00. Le vote de la commission de révision (bis). Comme, nous dit Adrien Abauzit, la commission de révision s’étant opposé à la révision, il fallut trouver une solution, une solution que donna Esterhazy. Avant d’en parler, une petite parenthèse. Pour ne pas être désobligeant, je n’avais pas jusqu’à présent relevé les approximations de vocabulaire fréquentes d’Adrien Abauzit. Je ne peux pas laisser passer celle-ci dans la mesure où elle est presque un lapsus : voulant parler d’enchaînement, de succession, peut-être d’imbrication, sûrement de synchronisation, Adrien Abauzit, pour « faire bien », mais toujours « sans se vanter », parle de la synchronicité des événements. Synchronicité : Apparition simultanée d’événements qui semblent être étroitement liés mais qui n’ont aucun lien de causalité visible »… Aïe ! Revenons à Esterhazy. La révision aurait été possible uniquement parce que juste après la décision de la commission de révision, Esterhazy aurait dans la presse avoué avoir écrit le bordereau, influant ainsi sur le gouvernement pour démentir juste après quand aucun retour en arrière n’était possible, la révision ayant été décidé. « On se fout de nous ! », s’exclame Adrien Abauzit. C’est Adrien Abauzit qui se fout de nous. Cette « démonstration », en partie empruntée d’ailleurs à Dutrait-Crozon, repose, nous l’avons dit dans un post précédent, sur une énième erreur qui écroule encore une fois le fragile édifice : la commission de révision n’a pas voté contre mais n’a pas pu se départager, à 3 voix contre 3, laissant la question ouverte… Mais cela dit, Esterhazy avouera bien avoir écrit le bordereau sur ordre de Sandherr et démentira en effet. Mais il ne démentira pas avoir écrit le bordereau dont il rééditera à plusieurs reprises l’aveu. Le 26, le jour même où la nouvelle des déclarations d’Esterhazy était publiée par la presse française, le conseil des ministres, tôt le matin, décidait la révision. Tout cela est vrai. Mais que permet de dire que les aveux d’Esterhazy jouèrent dans la décision ? Rien… Adrien Abauzit se perd encore en ces affirmations péremptoires qu’il est si prompt à reprocher aux historiens qu’il tient à qualifier de « dreyfusards ». En fait, et c’est une évidence, la révision était dans les tuyaux depuis la mort d’Henry et c’est pour ne pas la voter que Cavaignac, Zurlinden puis Tillaye avaient démissionné. Il avait été question d’enfin en finir, après tant d’atermoiements, dès le conseil du samedi 24 septembre mais la discussion avait dû être repoussée au 26 du fait de l’absence de deux ministres. Le Journal des Débats notait ainsi dans son édition du 24 : « On s’attendait à apprendre d’un moment à l’autre que le Conseil des ministres avait autorisé M. Sarrien à saisir la Cour de cassation de la révision du procès Dreyfus (et à un moment, donc, où l’information des aveux d’Henry n’avaient pas passé le Channel). Et si le 26, elle fut donc votée, ce ne fut pas sans difficulté. Un Sarrien, par exemple, ministre de la Justice, qui jusqu’à présent s’était plutôt déclaré pour, avait résisté longtemps avant d’être convaincu par les arguments de Bourgeois. L’idée du gouvernement n’était donc pas ici d’obéir au fantasmatique syndicat – et à quel titre ? – mais de « faire rentrer l’affaire dans le domaine judiciaire », autrement dit d’en finir, ce qui peut expliquer qu’un Chanoine, ministre de la Guerre, bien qu’antidreyfusard, s’abstint. Les aveux d’Esterhazy n’ont rien à y voir et il est significatif qu’aucun antidreyfusard de l’époque n’en fît d’ailleurs un argument.
1’46’23. La cassation du procès de 1894. « Absolument scandaleux » nous dit Adrien Abauzit parce que l’arrêt repose essentiellement sur les trois « experts bidons » du procès Zola. « Bidons », Meyer, Giry et Molinier ? Soit. Encore une fois Adrien Abauzit ne dit qu’une partie des faits et ne conserve ce qui l’arrange. Il faut donc donner le texte :
La Cour,
Ouï M. le président Ballot-Beaupré dans son rapport, M. le procureur général Manau dans ses réquisitions, et Me Mornard, avocat de la dame Dreyfus, ès qualités, intervenante, en ses conclusions,
[…] Sur le moyen TIRÉ de ce que la PIÈCE SECRÈTE, « CE CANAILLE DE D… », AURAIT ÉTÉ COMMUNIQUÉE AU CONSEIL DE GUERRE :
Attendu que cette communication est prouvée, à la fois, par la déposition du président Casimir-Perier et par celles des généraux Mercier et de Boisdeffre eux-mêmes ;
Que, d’une part, le président Casimir-Perier a déclaré tenir du général Mercier que l’on avait mis sous les yeux du conseil de guerre la pièce contenant les mots : « Ce canaille de D… », regardée alors comme désignant Dreyfus ;
Que, d’autre part, les généraux Mercier et de Boisdeffre, invités à dire s’ils savaient que la communication avait eu lieu, ont refusé de répondre, et qu’ils l’ont ainsi reconnu implicitement ;
Attendu que la révélation, postérieure au jugement, de la communication aux juges d’un document qui a pu produire sur leur esprit une impression décisive et qui est aujourd’hui considéré comme inapplicable au condamné, constitue un fait nouveau de nature à établir l’innocence de celui-ci ;
Sur le moyen concernant le bordereau :
Attendu que le crime reproché à Dreyfus consistait dans le fait d’avoir livré à une puissance étrangère ou à ses agents des documents intéressant la défense nationale, confidentiels ou secrets, dont l’envoi avait été accompagné d’une lettre missive ou bordereau, non datée, non signée, et écrite sur un papier pelure « filigrané au canevas après fabrication de rayures au quadrillage de quatre millimètres en chaque sens » ;
Attendu que cette lettre, base de l’accusation dirigée contre lui, avait été successivement soumise à cinq experts chargés d’en comparer l’écriture avec la sienne, et que trois d’entre eux, Charavay, Teyssonnières et Bertillon la lui avaient attribuée ;
Que l’on n’avait, d’ailleurs, ni découvert en sa possession, ni prouvé qu’il eût employé aucun papier de cette espèce et que les recherches faites pour en trouver du pareil chez un certain nombre de marchands au détail avaient été infructueuses ; que, cependant un échantillon semblable, quoique de format différent, avait été fourni par la maison Marion, marchand en gros, cité Bergère, où l’on avait déclaré que « le modèle n’était plus courant dans le commerce » ;
Attendu qu’en novembre 1898 l’enquête a révélé l’existence et amené la saisie de deux lettres sur papier pelure quadrillé, dont l’authenticité n’est pas douteuse, datées l’une du 17 avril 1892, l’autre du 17 août 1894, celle-ci contemporaine de l’envoi du bordereau, toutes deux émanées d’un autre officier qui, en décembre 1897, avait expressément nié s’être jamais servi de papier calque ;
Attendu, d’une part, que trois experts commis par la Chambre criminelle, les professeurs de l’École des chartes, Meyer, Giry et Molinier, ont été d’accord pour affirmer que le bordereau était écrit de la même main que les deux lettres susvisées, et qu’à leurs conclusions Charavay s’est associé, après examen de cette écriture qu’en 1894 il ne connaissait pas ;
Attendu, d’autre part, que trois experts également commis : Putois, Choquet, président honoraire de la Chambre syndicale du papier et des industries qui le transforment, et Marion, marchand en gros, ont constaté que, comme mesures extérieures et mesures de quadrillage, comme nuance, épaisseur, transparence, poids et collage, comme matières premières employées à la fabrication, « le papier du bordereau présentait les caractères de la plus grande similitude » avec celui de la lettre du 17 août 1894 ;
Attendu que ces faits, inconnus du Conseil de guerre qui a prononcé la condamnation, tendent à démontrer que le bordereau n’aurait pas été écrit par Dreyfus ;
Qu’ils sont, par suite, de nature, aussi, à établir l’innocence du condamné ;
Qu’ils rentrent, dès lors, dans le cas prévu dans le paragraphe 4 de l’article 443 ;
Et qu’on ne peut les écarter en invoquant des faits également postérieurs au jugement, comme les propos tenus le 5 janvier, par Dreyfus, devant le capitaine Lebrun-Renaud [sic] ;
Qu’on ne saurait, en effet, voir dans ces propos un aveu de culpabilité, puisque non seulement ils débutent par une protestation d’innocence, mais qu’il n’est pas possible d’en fixer le texte exact et complet par suite des différences existant entre les déclarations successives du capitaine Lebrun-Renaud [sic] et celles des autres témoins ;
Et qu’il n’y a pas lieu de s’arrêter davantage à la déposition de Depert, contredite par celle du directeur du Dépôt qui, le 5 janvier 1895, était près de lui ;
Et attendu que, par application de l’article 445, il doit être procédé à de nouveaux débats oraux ;
Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, etc.
J’ai fini. Qu’est-ce qu’Adrien Abauzit ? Quelqu’un qui a une thèse à défendre, qui a lu juste une toute partie du dossier et encore pas complètement. Sur cette base, et tout en mettant en avant un travail présenté comme titanesque censé faire taire ses contradicteurs, il va à la pêche dans le dossier – quand il y va et ne se contente pas de simplement, ce qu’il fait le plus souvent, reprendre les arguments de ses prédécesseurs –, sélectionne les éléments qui soutiennent sa thèse et passe sous silence les autres… « Quand un élément du dossier est trop gênant, autant faire comme s’il n’existait pas, puisqu’aucun trouble-fête, a priori, ne viendra le relever », écrit-il à propos de Bredin (p. 229-230 de son livre)… et dans ces éléments sélectionnés, il lit vite ou lit de travers et comprend ce qu’il veut y voir. Ce qui est étonnant avec les modernes antidreyfusards, c’est qu’ils se détruisent eux-mêmes… Mais comme aujourd’hui personne n’est au courant, il faut apporter un peu d’aide. C’est ce que j’ai fait aujourd’hui et je prie le lecteur de m’excuser d’avoir occupé tant d’espace sur cette chaîne. Mais j’y reviendrai… au prochain livre d’Adrien Abauzit. Maintenant, amis patriotes, ne croyez-vous pas qu’il serait temps de vous trouver urgemment un autre champion ?
Georges Sorel, dans La Révolution dreyfusienne, écrit que « l’affaire Dreyfus ne mérite vraiment d’être racontée en détail que dans la forme du roman-feuilleton[1] ». Elle s’y prête assurément en ce qu’elle en contient tous les ingrédients : des personnages fortement typés, des héros et des traîtres, des morts énigmatiques, de constants rebondissements, des secrets et des révélations qui ne pouvaient qu’exciter les imaginations. Exciter l’imagination, sans doute, mais aussi le goût de la réclame de quelques-uns qui se fixèrent la mission de nous dire ce que nous ne savons pas et qui à vrai dire ne nous intéresse que rarement. Aux « mystères » qui existent, et qui sont assurément à relativiser, il fallait donc en ajouter d’autres pour découvrir quelques vérités cachées et dire le fin mot de l’histoire. Reprenons donc la lecture de ces trop nombreux ouvrages « du doute et du soupçon », comme le dit très justement Vincent Duclert, « élucubrations les plus futiles proférées du haut de l’érudition la plus revendiquée et la moins solide sur les “mystères cachés” de l’Affaire et de Dreyfus »[2].

 Dans ce qui deviendra une course effrénée à la révélation, celui qui ouvrit la voie fut, dans les années 30, Henri Mazel, poète symboliste, chantre de l’Idéalisme, partisan d’un arisme pré-fasciste et directeur de la revue L’Ermitage au début des années 1890. En 1934, il publia une Histoire et psychologie de l’affaire Dreyfus qui, tout en reprenant à l’antienne un certain nombre de refrains antidreyfusards[3] pour en arriver à dire qu’il n’y avait « rien eu de monstrueux dans l’erreur judiciaire dont le malheureux capitaine a été victime » (p. 205), avait pour but de permettre d’« obtenir définitivement [la] réconciliation » (p. 199 et 207). Sans poser la moindre hypothèse – ce qui est une constante du genre –, il révélait qu’il n’y avait pas eu trahison mais « une très subtile mystification machinée par M. de Schwartzkoppen ». Pourquoi ? Simplement pour « jouer un tour » – et quel tour ! – à Sandherr et à Esterhazy, agent de la Section de statistique, qui avaient tenté à ses dépens une intox… Voilà, c’est tout. Quelles preuves venaient étayer une telle thèse ? Aucune à vrai dire, si ce n’est que pour Mazel, et il en faisait une démonstration peu concluante, il était évident que le bordereau ne pouvait ni émaner d’un espion ni d’un officier français. Une intox, donc, qui pouvait expliquer l’usage du papier pelure, la thèse de la forgerie avancée par la plupart des experts, etc. Rien de plus.
Dans ce qui deviendra une course effrénée à la révélation, celui qui ouvrit la voie fut, dans les années 30, Henri Mazel, poète symboliste, chantre de l’Idéalisme, partisan d’un arisme pré-fasciste et directeur de la revue L’Ermitage au début des années 1890. En 1934, il publia une Histoire et psychologie de l’affaire Dreyfus qui, tout en reprenant à l’antienne un certain nombre de refrains antidreyfusards[3] pour en arriver à dire qu’il n’y avait « rien eu de monstrueux dans l’erreur judiciaire dont le malheureux capitaine a été victime » (p. 205), avait pour but de permettre d’« obtenir définitivement [la] réconciliation » (p. 199 et 207). Sans poser la moindre hypothèse – ce qui est une constante du genre –, il révélait qu’il n’y avait pas eu trahison mais « une très subtile mystification machinée par M. de Schwartzkoppen ». Pourquoi ? Simplement pour « jouer un tour » – et quel tour ! – à Sandherr et à Esterhazy, agent de la Section de statistique, qui avaient tenté à ses dépens une intox… Voilà, c’est tout. Quelles preuves venaient étayer une telle thèse ? Aucune à vrai dire, si ce n’est que pour Mazel, et il en faisait une démonstration peu concluante, il était évident que le bordereau ne pouvait ni émaner d’un espion ni d’un officier français. Une intox, donc, qui pouvait expliquer l’usage du papier pelure, la thèse de la forgerie avancée par la plupart des experts, etc. Rien de plus.
 Le deuxième ouvrage de cette série, Les Côtés mystérieux de l’affaire Dreyfus, parut trois ans plus tard. L’auteur, Armand Charpentier, dreyfusard émérite, y présentait une thèse – qui rencontrera un certain succès – qui devait permettre d’expliquer les fameuses zones d’ombres, à son point de vue nombreuses, de l’Affaire. Comment expliquer que coïncident si parfaitement la date (juillet 1894) à laquelle, selon les dires d’Esterhazy, Sandherr lui avait demandé d’entrer en relation avec les allemands[4] et celle donnée par Schwartzkoppen dans ses Carnets[5] ? Comment expliquer que Schwartzkoppen ait pu soutenir, toujours dans ses Carnets, n’avoir jamais reçu le bordereau ? Pourquoi, après avoir encouragé Picquart, quand il découvrit Esterhazy, à continuer son enquête, Gonse et Boisdeffre lui demandèrent-ils, tout à coup, fin août 1896, de l’abandonner ? Pourquoi les hommes de l’État-major décidèrent-ils, l’année suivante, de venir en aide à Esterhazy et de le protéger ? Pourquoi Boisdeffre avait-il parlé à Judet de la « valeur » des « service rendus » par Esterhazy et lui avait avoué ne pas connaître « le premier mot de l’Affaire » ? Qu’étaient ces preuves inconnues dont avait parlé le même Boisdeffre à Du Paty ? Et qu’étaient ces documents que Sandherr gardait « par devers [lui] » dont Henry avait parlé au procès Zola ? Étaient-ils les mêmes que ceux de ce dossier dont Sandherr avait dit à Du Paty, sans vouloir le lui montrer, qu’il « ne verra[it] jamais le jour[6] » ? Et ne pouvait-on croire Esterhazy qui, les dernières années, avait affirmé à tous et sans se lasser jamais qu’il avait écrit le bordereau sur les ordres et sous la dictée de Sandherr ? Pourquoi, encore, la veuve Henry avait-elle dit à Charpentier qu’elle jugeait « impossible que l’on puisse pour l’Histoire, faire un récit exact [de l’Affaire] avec des éléments trop pauvres et trop insuffisamment exacts[7] » ? Pour Charpentier, la réponse à toutes ces questions se trouvait dans la déposition de Wattinne faite à l’occasion de la seconde révision. Le gendre de Billot avait en effet raconté qu’à la question qu’il avait posée à Henry visant à savoir ce que pouvait avoir Sandherr « contre Dreyfus », il avait reçu pour réponse qu’il existait « quelque chose de particulier qu’[il] n’[avait] jamais connu », « une lettre venant d’Alsace et touchant quelqu’un de sa famille [de la famille de Dreyfus] ou de ses relations »[8]. Pour Charpentier, puisqu’il y avait un dossier dont Sandherr avait parlé à Henry et à Du Paty, cette lettre, perdue ou en tout cas depuis introuvable, devait en faire partie. Mais comment l’avait-il obtenue ? Et de qui ? Pour Charpentier, le correspondant de Sandherr, l’auteur de la « lettre d’Alsace », ne pouvait être qu’un de ses parents. Pourquoi ? Parce qu’ainsi seulement pouvait s’expliquer le secret, « secret qu’il n’eût pas gardé si les documents accusateurs lui avaient été adressés directement par un agent de contre-espionnage dont il n’aurait pas eu à cacher le nom ». Au terme d’une longue enquête en Alsace, Charpentier avait pu découvrir la trace d’un certain René Kullmann qui avait rendu « d’immenses services au 2e Bureau, tant que [son parent] Sandherr en [avait été] le chef ». Le parent était trouvé mais quel rapport avec Dreyfus ? Écoutons Charpentier raconter son histoire. Un jour de 1894, « un quelconque Dreyfus », nom « très répandu en Alsace », « voyageant dans l’Est français », aurait « pris quelques photographies de nos fortifications, en y ajoutant de menues notes » et aurait transmis le tout « à la police de Strasbourg, afin de se concilier les faveurs des autorités allemandes ». « Par une filière difficile à préciser [sic], ces notes, sur lesquelles figure le nom du voyageur Dreyfus, vont entre les mains de René Kullmann qui les envoie au colonel Sandherr. » Sandherr, découvrant cela, aurait cherché son traître et, commettant une erreur, porté ses soupçons sur le pauvre Dreyfus.
Le deuxième ouvrage de cette série, Les Côtés mystérieux de l’affaire Dreyfus, parut trois ans plus tard. L’auteur, Armand Charpentier, dreyfusard émérite, y présentait une thèse – qui rencontrera un certain succès – qui devait permettre d’expliquer les fameuses zones d’ombres, à son point de vue nombreuses, de l’Affaire. Comment expliquer que coïncident si parfaitement la date (juillet 1894) à laquelle, selon les dires d’Esterhazy, Sandherr lui avait demandé d’entrer en relation avec les allemands[4] et celle donnée par Schwartzkoppen dans ses Carnets[5] ? Comment expliquer que Schwartzkoppen ait pu soutenir, toujours dans ses Carnets, n’avoir jamais reçu le bordereau ? Pourquoi, après avoir encouragé Picquart, quand il découvrit Esterhazy, à continuer son enquête, Gonse et Boisdeffre lui demandèrent-ils, tout à coup, fin août 1896, de l’abandonner ? Pourquoi les hommes de l’État-major décidèrent-ils, l’année suivante, de venir en aide à Esterhazy et de le protéger ? Pourquoi Boisdeffre avait-il parlé à Judet de la « valeur » des « service rendus » par Esterhazy et lui avait avoué ne pas connaître « le premier mot de l’Affaire » ? Qu’étaient ces preuves inconnues dont avait parlé le même Boisdeffre à Du Paty ? Et qu’étaient ces documents que Sandherr gardait « par devers [lui] » dont Henry avait parlé au procès Zola ? Étaient-ils les mêmes que ceux de ce dossier dont Sandherr avait dit à Du Paty, sans vouloir le lui montrer, qu’il « ne verra[it] jamais le jour[6] » ? Et ne pouvait-on croire Esterhazy qui, les dernières années, avait affirmé à tous et sans se lasser jamais qu’il avait écrit le bordereau sur les ordres et sous la dictée de Sandherr ? Pourquoi, encore, la veuve Henry avait-elle dit à Charpentier qu’elle jugeait « impossible que l’on puisse pour l’Histoire, faire un récit exact [de l’Affaire] avec des éléments trop pauvres et trop insuffisamment exacts[7] » ? Pour Charpentier, la réponse à toutes ces questions se trouvait dans la déposition de Wattinne faite à l’occasion de la seconde révision. Le gendre de Billot avait en effet raconté qu’à la question qu’il avait posée à Henry visant à savoir ce que pouvait avoir Sandherr « contre Dreyfus », il avait reçu pour réponse qu’il existait « quelque chose de particulier qu’[il] n’[avait] jamais connu », « une lettre venant d’Alsace et touchant quelqu’un de sa famille [de la famille de Dreyfus] ou de ses relations »[8]. Pour Charpentier, puisqu’il y avait un dossier dont Sandherr avait parlé à Henry et à Du Paty, cette lettre, perdue ou en tout cas depuis introuvable, devait en faire partie. Mais comment l’avait-il obtenue ? Et de qui ? Pour Charpentier, le correspondant de Sandherr, l’auteur de la « lettre d’Alsace », ne pouvait être qu’un de ses parents. Pourquoi ? Parce qu’ainsi seulement pouvait s’expliquer le secret, « secret qu’il n’eût pas gardé si les documents accusateurs lui avaient été adressés directement par un agent de contre-espionnage dont il n’aurait pas eu à cacher le nom ». Au terme d’une longue enquête en Alsace, Charpentier avait pu découvrir la trace d’un certain René Kullmann qui avait rendu « d’immenses services au 2e Bureau, tant que [son parent] Sandherr en [avait été] le chef ». Le parent était trouvé mais quel rapport avec Dreyfus ? Écoutons Charpentier raconter son histoire. Un jour de 1894, « un quelconque Dreyfus », nom « très répandu en Alsace », « voyageant dans l’Est français », aurait « pris quelques photographies de nos fortifications, en y ajoutant de menues notes » et aurait transmis le tout « à la police de Strasbourg, afin de se concilier les faveurs des autorités allemandes ». « Par une filière difficile à préciser [sic], ces notes, sur lesquelles figure le nom du voyageur Dreyfus, vont entre les mains de René Kullmann qui les envoie au colonel Sandherr. » Sandherr, découvrant cela, aurait cherché son traître et, commettant une erreur, porté ses soupçons sur le pauvre Dreyfus.
[…] comment le prendre ?… Dire que des documents avaient été volés à la police de Strasbourg ? C’était impossible. Il est bien certain qu’en acceptant les renseignements que celui-ci lui envoyait, Sandherr avait dû s’engager sur l’honneur, non seulement à ne jamais le nommer, mais, même, à ne jamais indiquer la source d’où provenaient les renseignements. […]
Il fallait donc créer une pièce qui, tout en permettant d’arrêter Dreyfus, pût être montrée à l’officier de police judiciaire, à l’officier rapporteur et aux membres du conseil de guerre. Cette pièce fut la lettre-missive ou bordereau.
Et sur la base d’une idée trouvée dans un roman publié en feuilleton par Le Petit Journal de janvier à juillet 1894 – Les Deux frères de Louis Létang[9] –, et dont l’histoire a de curieux points communs avec l’Affaire, Sandherr et son collaborateur Henry auraient bâti tout un scénario dont Esterhazy, qui offrait l’avantage d’avoir une écriture proche de celle de Dreyfus, permettrait la réalisation. Sur les indications de Sandherr, Esterhazy aurait donc écrit le bordereau qui, déposé à l’ambassade d’Allemagne pendant une absence de Schwartzkoppen, aurait été récupéré par la « voie ordinaire ». Voilà donc pourquoi Esterhazy « ne commit aucun acte de trahison » et que, Sandherr mort, Henry s’était retrouvé le seul « détenteur du terrible secret » pour la protection duquel il manœuvra contre Picquart et commit tous ses faux[10].
Quel roman… Pourtant Charpentier ne doute guère et va même un peu plus loin encore :
[…] Évidemment, la version du voyageur n’est qu’une hypothèse et d’autres hypothèses peuvent être formulées. Mais, quelles qu’elles soient, on peut considérer comme certain que, vers la fin du printemps de 1894, Sandherr reçut de René Kullmann des documents sur l’un desquels figurait, vraisemblablement, le nom d’un « Dreyfus ».
D’autre part, il est bien certain que René Kullmann ne signait pas de son nom la correspondance secrète qu’il échangeait avec son cousin. Il avait dû prendre un pseudonyme. Or, […] la grand-mère du colonel Sandherr était une demoiselle Wilhelm. Il ne serait pas impossible que René Kullmann eût adopté ce nom pour signer ses lettres.
S’il en fut ainsi, la légende du fameux bordereau annoté de l’empereur d’Allemagne trouverait une explication plausible.
[…] Sans doute, sur l’annotation divulguée par la presse, le nom de Guillaume était orthographié « Wilhem » au lieu de « Wilhelm ». Mais, comme personne ne vit jamais cette annotation, il est fort probable que le premier journaliste qui en donna le texte commit la faute d’orthographe – qui ne fut peut-être qu’une erreur typographique – laquelle fut naturellement répétée par tous les journaux, puisqu’aucun texte ne permettait une vérification.
Ne cédons pas à l’irionie – facile – et contentons-nous de poser un certain nombre de questions qui demeurent sans réponse et entament considérablement cet ingénieux montage. Que justifie la piste du parent de Sandherr ? Quelle était cette obligation de tenir son nom secret ? Certes, si Charpentier donne quelques exemples d’Alsaciens qui avaient connu quelques ennuis avec les autorités allemandes pour leur activité d’espionnage[11], n’était-il pas possible à Henry et Sandherr d’être discrets, de ne rien révéler et de faire croire qu’elle émanait d’un des divers espions qui émargeaient à la Section de statistique ? N’aurait-il pas même été possible, comme pour le bordereau, de rester flou sur sa provenance dans l’acte d’accusation ? Et puis, surtout, n’était-il pas curieux pour taire cette source de préférer celle de l’ambassade qui constituait pourtant un acte bien plus grave ? Et, puisqu’il est question de l’ambassade, pourquoi se compliquer la vie en l’y déposant pour le récupérer ensuite ? N’était-il pas possible, s’il fallait absolument donner cette provenance, de conserver la pièce et de se contenter d’affirmer qu’elle avait été saisie rue de Lille ? Et pourquoi encore ne pas la signer simplement du nom de Dreyfus pour éviter toute discussion ? De même, si ce fameux dossier des « documents Z » – selon le nom que donne Charpentier au dossier contenant la « lettre d’Alsace » – était si terrible, pourquoi ne pas l’avoir joint au dossier secret de 1894 ? Pourquoi ne pas avoir mis Picquart et Boisdeffre dans la confidence dès le début et avoir laissé le second demander au premier d’enrichir le dossier ? Pourquoi aux premiers soupçons de Picquart ne pas lui avoir dit ce dont il retournait ? Soit par Henry, quand il fut au courant de la découverte de son chef ou par Gonse ou Boisdeffre quand – pour suivre la thèse de Charpentier – ils furent mis au courant par Henry ? Cela aurait évité bien des ennuis et Picquart, comme il l’avait dit au procès Zola, aurait « rempli [s]on devoir d’officier[12] ». De même, comment comprendre cette lettre insupportable qu’avait envoyée Henry à Picquart quand il remplissait sa mission en Tunisie, bien loin et ne risquant plus de gêner ? Quelle drôle d’idée, si la thèse de Charpentier avait été une réalité, de provoquer ainsi le disgracié et de lui donner une bonne raison de faire éclater une affaire qui aurait pu, sans cela, ne jamais voir le jour. Que penser encore de la lettre « Espérance » (et non « Speranza » comme le dit Charpentier p. 163) qu’ils envoyèrent à Esterhazy pour le prévenir ? Une lettre qui le laissait seul face à ses problèmes en lui disant que « c’[était] à [lui] maintenant de défendre [son] nom et l’honneur de [ses] enfants » ? N’aurait-il pas été plus simple, s’il fallait sauver cet ami, d’aller le voir dans sa province, de le mettre au courant de ce qui se tramait et de l’inviter à disparaître au plus vite ? Et pourquoi ne pas avoir mis Du Paty, que sa fantaisie rendait difficilement contrôlable, dans la confidence ? Pourquoi avoir fait écrire Esterhazy à Boisdeffre la lettre « p. de C. » si, comme le dit Charpentier, le chef d’État-major avait été informé par Henry à la fin du mois d’août ? Pourquoi ne pas lui avoir dit que Boisdeffre était au courant du « secret », comme l’indique le fait qu’Esterhazy envoya au chef d’État-major la lettre anonyme du 24 octobre pour vérifier que la protection venait d’en haut ? Et pourquoi lui avoir fait aussi écrire à Félix Faure au risque de tout compromettre ? Pourquoi lui avoir encore fait écrire, le 7 novembre, cette lettre à Picquart qui ne pouvait qu’engager l’ancien chef de la Section de statistique à passer à l’offensive tout en lui apprenant que l’homme qu’il avait soupçonné était au courant de son enquête ? Pourquoi encore n’avoir pas mis Pellieux et Ravary, consciencieusement stylés, au courant du « secret » ?
Nous pourrions ainsi multiplier à l’infini ces questions qui montrent le peu de solidité de la thèse de Charpentier. Mais si elle ne tient guère, cette thèse, qu’en est-il alors de ces fameuses zones d’ombres à l’origine de cet incroyable montage ? Reprenons les principales questions posées par Charpentier et voyons combien elles peuvent trouver aisément leur réponse sans être obligé d’échafauder ce véritable roman. Si la question de la coïncidence des dates entre les dires d’Esterhazy et les souvenirs de Schwartzkoppen peut être vite écartée – c’est bien le 20 juillet qu’eut lieu une première rencontre à laquelle Sandherr ne devait rien –, celle de l’affirmation de Schwartzkoppen selon laquelle il n’avait jamais reçu le bordereau est plus intéressante et assez facile à résoudre. Que vaut le témoignage de Schwartzkoppen à ce sujet ? Ne peut-on penser qu’il le reçut bien mais ne pouvait l’avouer sans reconnaître avoir été bien léger, bien inconséquent en confiant à sa corbeille à papier une lettre d’une telle importance ? Concernant le changement d’attitude de Gonse et de Boisdeffre, la réponse est simple. Mais avant d’y répondre une petite précision s’impose. Charpentier se trompe – à moins qu’il ne force les événements pour coller à sa thèse – quand il écrit : « Certain, désormais, de l’importance de sa découverte, Picquart en parle à de Boisdeffre, puis à Gonse. Ceux-ci le félicitent de façon discrète dont il a conduit son enquête et l’invitent à la poursuivre. Puis, insensiblement, vers la fin d’août, leur attitude se modifie. Gonse recommande à Picquart de ne pas mêler l’Affaire Dreyfus à l’Affaire Esterhazy, alors que le bon sens commanderait au contraire de procéder à une comparaison immédiate des trois écritures en cause. » Et c’est à ce moment, selon lui, qu’Henry, inquiet, informa ses chefs du secret de Sandherr (p. 161-162). Cela expliquant ceci. Charpentier bouleverse ici les événements. Ce fut le 5 août que la première fois Picquart parla à Boisdeffre de sa découverte. Mais il s’était bien gardé, prudent, de parler de sa conviction qu’Esterhazy était le véritable auteur du bordereau. C’est à la fin d’août qu’il la lui révéla et c’est le 3 septembre que pour la première fois il en parla à Gonse qui ne le félicita aucunement mais lui demanda au contraire et dès les premiers mots de distinguer les deux affaires. Il n’y a aucun mystère ici. Gonse ne changea donc aucunement d’avis et s’il lui fit cette demande ce n’était que parce qu’il ne voulait pas d’une enquête qui eût pu amener à la révision du procès Dreyfus. De même, si Henry avait parlé à ce moment à Gonse et Boisdeffre du fameux secret, comme le soutien Charpentier, comment expliquer que pour tenter d’entrer au ministère, démarche qu’il entreprenait depuis avril précédent, Esterhazy se fût adressé à des députés et pas directement à Henry auquel il aurait pu faire valoir – ce qui était bien dans sa manière – de sérieux arguments pour qu’il intervînt et intervînt vite auprès de ses chefs ? Mais Picquart avait commencé son enquête, pourrait répondre Charpentier, et Henry ne devait pas se brûler. Sans doute mais alors Henry n’aurait-il pas eu tout à fait intérêt à prendre contact avec son « ami » et lui demander, au nom de leur cher secret, de s’abstenir d’une démarche pour le moins dangereuse ? Autre question. Pourquoi Henry, Gonse, etc. défendirent-ils Esterhazy et machinèrent-ils ces rendez-vous de roman-feuilleton pour le sauver ? Pourquoi, comme le demande Charpentier, n’ont-ils pas « laissé les événements se dérouler d’eux-mêmes et attendu en toute tranquillité de connaître les faits sur lesquels l’honorable vice-président du Sénat appuierait sa requête » ? Pourquoi une telle inquiétude ? (p. 162-163). Mais tout simplement parce qu’ils étaient compromis, parce qu’une illégalité avait été commise en 1894, parce qu’Henry avait fait un faux témoignage au procès, parce qu’ils avaient promis à Mercier de ne jamais rien dire de ce qui s’était passé… Et pourquoi croire que si Boisdeffre, à Du Paty, Henry, au procès Zola, avait parlé de documents plus importants que le bordereau, ce ne pouvait être que parce que ces documents existaient ? Ne pouvait-il s’agir que de nouveaux mensonges qui avaient tout simplement pour but de faire comprendre que, si le dossier connu n’était guère probant, il existait de vraies, de graves preuves, de trop graves preuves pour les livrer au public ?
Non la thèse de Charpentier est décidément bien fragile. Mais restons encore un peu avec lui. Car en effet il ne s’en tient pas là. Dans la seconde partie de son livre, il développe une autre théorie relative à la mort d’Henry en partant de la juste remarque qu’il « n’avait aucune raison pour se tuer ». Rejetant la thèse du suicide et celle de la mort maquillée et de la fuite d’Henry, dont la presse s’était faite l’écho en 1905[13], il proposait une autre explication : « Ou bien ce fut l’apoplexie foudroyante, ce qui n’est pas impossible. Ou bien, [un] visiteur inconnu [dont il avait découvert l’existence] lui tendit “la boulette” fatale, car il ne fallait pas songer au revolver dont la présence en ses mains n’aurait pu se justifier. » Charpentier « inclin[ait] pour la boulette » en raison du mot incohérent destiné par Henry à sa femme, mot qui avait été retrouvé sur sa table et dans lequel il disait être sur le point d’aller « [s]e baigner dans la Seine ». Le mystérieux visiteur, une fois le poison ingéré, lui aurait tranché la gorge pour faire croire au suicide. Voilà ce qui selon Charpentier pouvait expliquer le fait qu’Henry, droitier, ait été retrouvé le rasoir, et le rasoir fermé, dans la main gauche. Le fait est mystérieux, c’est indéniable. Mais cela dit, il est difficile de suivre Charpentier dans sa théorie du « visiteur » qui ne repose que sur une hypothèse formulée par Esterhazy[14] et dans la raison qu’il donne de ce qu’il faut bien considérer comme un assassinat, à savoir la nécessité de protéger le secret des fameux « documents Z » (p. 288-289). Nous ne savons bien sûr pas ce qui s’est réellement passé ce 31 août 1898 dans la cellule 13 du Mont-Valérien. Mais nous serions assez enclin à préférer une solution que ne propose pas Charpentier, et que nous avons évoquée précédemment, celle du « suicide par suggestion ». Ne peut-on penser en effet que ne pas enlever à Henry son rasoir était en tout comparable au pistolet laissé à disposition de Dreyfus le jour de la dictée ? Nous serions bien là dans les manières de l’État-major… Mais demeure ce mystère du rasoir fermé (ou « à demi fermé », comme le corrigera Walter en 1903[15]) et de sa présence dans la main gauche d’un droitier…
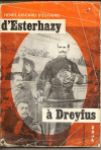 La curiosité suivante qui devait nous dire toute la vérité vit le jour en 1960. D’Esterhazy à Dreyfus,d’Henri Giscard d’Estaing, reprenait la thèse de Paléologue qui, dans son Journal de L’Affaire Dreyfus, avait, sans entrer dans les détails, proposé une « hypothèse constructive » qui expliquait selon lui toute l’affaire. Il n’y aurait pas eu un coupable mais trois : Esterhazy, son ami Weil et « un officier d’un très haut grade, qui, après avoir occupé pendant plusieurs années des fonctions importantes au ministère de la Guerre, exerce aujourd’hui un commandement de troupes » (p. 156). Paléologue, modeste, s’était contenté d’ouvrir la piste. Mais son éditeur, Plon, assurément pour en prolonger la vente – en « parfaire la thèse », comme le dit l’introduction du Giscard[16] –, éditera ce curieux D’Esterhazy à Dreyfus. Reposant sur une méconnaissance assez vertigineuse de l’Affaire, l’auteur expose, sans la moindre précaution, une thèse, exposition de « l’organisme » et non de « la tumeur », qui n’a pour but que de donner le nom que Paléologue avait gardé pour lui et qui permettrait d’établir « les vraies culpabilités de 1894[17] ». Esterhazy serait l’auteur du bordereau et le deuxième homme dont parle Paléologue, l’« officier d’un très haut grade », celui qui lui fournissait les documents et ne pouvait qu’appartenir à l’État-major, ne serait pas le général Rau, comme beaucoup le dirent[18] mais Mercier ! Et bien sûr tout cela n’aurait eu pour but que de protéger la fabrication du canon de 75, première occurrence de ce qui deviendra bientôt une véritable obsession. Critique avisé, Giscard corrigeait toutefois les erreurs du diplomate et entre autres celle de la complicité d’Henry dont Reinach – que Giscard s’obstine à nommer pour une raison que nous nous expliquons mal « Bernard Lazare » – avait fait l’axe de sa lecture de l’Affaire. La démonstration mérite d’être exposée[19]. Jusqu’au procès Zola, les défenseurs de Dreyfus avaient défendu une thèse simple : Dreyfus était innocent et Esterhazy coupable. Mais après la déposition de Pellieux – suffisante pour leur faire changer d’avis (!?) –, déposition qui établissait qu’Esterhazy n’avait pu être en mesure de livrer les documents énumérés au bordereau, ils avaient dû revoir leur copie. Bernard Reinach devait donc reprendre sa thèse et trouver un complice à Esterhazy, un complice qui devait bien sûr appartenir à l’État-major. Henry serait donc ce complice, thèse qui ne pourrait être contredite puisqu’Henry avait avoué son faux et s’était tué. Joseph Lazare en fera son « grand cheval de bataille », comme Zola d’ailleurs qui sur la base de « ce bagage sommaire […] enfla les effets oratoires de sa fameuse lettre “J’accuse” ». A-t-on compris ? En février 1898 (procès Zola), Zola et Reinach – que nous pouvons arrêter de nommer Lazare – portèrent toute la responsabilité sur Henry qui offrait l’avantage d’être mort depuis… sept mois plus tard… Et parce qu’en février 1898, ils avaient pris conscience de cela, Zola pourra en parler dans son « J’Accuse.. ! »… le mois précédent… Quant au petit bleu, il était l’œuvre des amis de Dreyfus… Comme l’écrit Giscard à propos de Charpentier : « Soyons magnanime et arrêtons-là un massacre trop facile…[20] »
La curiosité suivante qui devait nous dire toute la vérité vit le jour en 1960. D’Esterhazy à Dreyfus,d’Henri Giscard d’Estaing, reprenait la thèse de Paléologue qui, dans son Journal de L’Affaire Dreyfus, avait, sans entrer dans les détails, proposé une « hypothèse constructive » qui expliquait selon lui toute l’affaire. Il n’y aurait pas eu un coupable mais trois : Esterhazy, son ami Weil et « un officier d’un très haut grade, qui, après avoir occupé pendant plusieurs années des fonctions importantes au ministère de la Guerre, exerce aujourd’hui un commandement de troupes » (p. 156). Paléologue, modeste, s’était contenté d’ouvrir la piste. Mais son éditeur, Plon, assurément pour en prolonger la vente – en « parfaire la thèse », comme le dit l’introduction du Giscard[16] –, éditera ce curieux D’Esterhazy à Dreyfus. Reposant sur une méconnaissance assez vertigineuse de l’Affaire, l’auteur expose, sans la moindre précaution, une thèse, exposition de « l’organisme » et non de « la tumeur », qui n’a pour but que de donner le nom que Paléologue avait gardé pour lui et qui permettrait d’établir « les vraies culpabilités de 1894[17] ». Esterhazy serait l’auteur du bordereau et le deuxième homme dont parle Paléologue, l’« officier d’un très haut grade », celui qui lui fournissait les documents et ne pouvait qu’appartenir à l’État-major, ne serait pas le général Rau, comme beaucoup le dirent[18] mais Mercier ! Et bien sûr tout cela n’aurait eu pour but que de protéger la fabrication du canon de 75, première occurrence de ce qui deviendra bientôt une véritable obsession. Critique avisé, Giscard corrigeait toutefois les erreurs du diplomate et entre autres celle de la complicité d’Henry dont Reinach – que Giscard s’obstine à nommer pour une raison que nous nous expliquons mal « Bernard Lazare » – avait fait l’axe de sa lecture de l’Affaire. La démonstration mérite d’être exposée[19]. Jusqu’au procès Zola, les défenseurs de Dreyfus avaient défendu une thèse simple : Dreyfus était innocent et Esterhazy coupable. Mais après la déposition de Pellieux – suffisante pour leur faire changer d’avis (!?) –, déposition qui établissait qu’Esterhazy n’avait pu être en mesure de livrer les documents énumérés au bordereau, ils avaient dû revoir leur copie. Bernard Reinach devait donc reprendre sa thèse et trouver un complice à Esterhazy, un complice qui devait bien sûr appartenir à l’État-major. Henry serait donc ce complice, thèse qui ne pourrait être contredite puisqu’Henry avait avoué son faux et s’était tué. Joseph Lazare en fera son « grand cheval de bataille », comme Zola d’ailleurs qui sur la base de « ce bagage sommaire […] enfla les effets oratoires de sa fameuse lettre “J’accuse” ». A-t-on compris ? En février 1898 (procès Zola), Zola et Reinach – que nous pouvons arrêter de nommer Lazare – portèrent toute la responsabilité sur Henry qui offrait l’avantage d’être mort depuis… sept mois plus tard… Et parce qu’en février 1898, ils avaient pris conscience de cela, Zola pourra en parler dans son « J’Accuse.. ! »… le mois précédent… Quant au petit bleu, il était l’œuvre des amis de Dreyfus… Comme l’écrit Giscard à propos de Charpentier : « Soyons magnanime et arrêtons-là un massacre trop facile…[20] »
 En 1962, L’Enigme Esterhazy d’Henri Guillemin nous offrit une nouvelle thèse. Refusant celle de Marcel Thomas, « docilité […] au dogme posé par l’État-Major » (p. 259), il proposait l’hypothèse suivante : Sandherr aurait découvert que Saussier – l’« X » mystérieux de Paléologue, selon lui, – fournissait – sans doute au terme d’un chantage – les documents qu’Esterhazy livrait. Il aurait alors fait écrire à Esterhazy un bordereau reprenant des documents précédemment livrés dans le but que la photographie vînt sous les yeux de Saussier et qu’il comprît que tout étant découvert il lui faudrait à l’avenir « se montrer plus circonspect ». La seule chose qu’il n’avait pas prévue était que le zèle de d’Aboville découvrirait dans ce bordereau, ce faux document de trahison, la main d’un jeune stagiaire qui n’avait vraiment rien à y voir (p. 288-290). Cette hypothèse, cette « rêverie » comme la qualifie Guillemin lui-même (p. 290), reposait sur le fait que Saussier avait toujours été, en 1894, partisan de ne rien faire et qu’il n’avait pas jugé bon de faire arrêter Esterhazy en 1897. Le fait, exact, de 1894, ne prouve pas grand-chose : Hanotaux était du même avis et n’est pas complice pour cela. Mais ce n’est pas exactement de cette manière que le présente Guillemin : il parle, lui, d’une tentative « d’empêcher, en 1894, toute poursuite, toute enquête même, lorsque le bordereau a surgi » (p. 286). Si tel avait été le cas, pourquoi Saussier aurait-il signé l’ordre de mise en jugement ? Pourquoi avoir dit à Casimir-Perier, qui s’étonnait qu’il engageât les poursuites, que les conclusions du rapport ne lui « permettaient pas d’agir autrement » ? La décision lui incombait, à lui seul, et il était libre, s’il l’avait voulu, d’aller contre le rapporteur. La peur de la presse pouvait-elle suffire à expliquer une décision qui risquait de le perdre ? Et quel formidable sang-froid que celui d’un complice qui ajoutait : « d’ailleurs qu’importe ? Le conseil de guerre décidera »[21]. Il est vrai, toutefois, que Saussier ne fit rien en 1897 pour faire arrêter Esterhazy. Mais nous savons que s’il ne le fit pas c’est parce que Billot le refusait[22] ? Saussier avait-il vraiment beaucoup de chance ou Billot était-il aussi complice ?
En 1962, L’Enigme Esterhazy d’Henri Guillemin nous offrit une nouvelle thèse. Refusant celle de Marcel Thomas, « docilité […] au dogme posé par l’État-Major » (p. 259), il proposait l’hypothèse suivante : Sandherr aurait découvert que Saussier – l’« X » mystérieux de Paléologue, selon lui, – fournissait – sans doute au terme d’un chantage – les documents qu’Esterhazy livrait. Il aurait alors fait écrire à Esterhazy un bordereau reprenant des documents précédemment livrés dans le but que la photographie vînt sous les yeux de Saussier et qu’il comprît que tout étant découvert il lui faudrait à l’avenir « se montrer plus circonspect ». La seule chose qu’il n’avait pas prévue était que le zèle de d’Aboville découvrirait dans ce bordereau, ce faux document de trahison, la main d’un jeune stagiaire qui n’avait vraiment rien à y voir (p. 288-290). Cette hypothèse, cette « rêverie » comme la qualifie Guillemin lui-même (p. 290), reposait sur le fait que Saussier avait toujours été, en 1894, partisan de ne rien faire et qu’il n’avait pas jugé bon de faire arrêter Esterhazy en 1897. Le fait, exact, de 1894, ne prouve pas grand-chose : Hanotaux était du même avis et n’est pas complice pour cela. Mais ce n’est pas exactement de cette manière que le présente Guillemin : il parle, lui, d’une tentative « d’empêcher, en 1894, toute poursuite, toute enquête même, lorsque le bordereau a surgi » (p. 286). Si tel avait été le cas, pourquoi Saussier aurait-il signé l’ordre de mise en jugement ? Pourquoi avoir dit à Casimir-Perier, qui s’étonnait qu’il engageât les poursuites, que les conclusions du rapport ne lui « permettaient pas d’agir autrement » ? La décision lui incombait, à lui seul, et il était libre, s’il l’avait voulu, d’aller contre le rapporteur. La peur de la presse pouvait-elle suffire à expliquer une décision qui risquait de le perdre ? Et quel formidable sang-froid que celui d’un complice qui ajoutait : « d’ailleurs qu’importe ? Le conseil de guerre décidera »[21]. Il est vrai, toutefois, que Saussier ne fit rien en 1897 pour faire arrêter Esterhazy. Mais nous savons que s’il ne le fit pas c’est parce que Billot le refusait[22] ? Saussier avait-il vraiment beaucoup de chance ou Billot était-il aussi complice ?
 Il faudra attendre dix ans pour découvrir la nouvelle thèse et lire L’Affaire Dreyfus. La Clé du mystère de Michel de Lombarès[23]. Variation des précédents, il revenait sur la thèse du « troisième homme » qui pour lui, indiscutablement, ne pouvait être que Saussier. Aucune trahison ici, mais, à nouveau, une histoire de renseignements sur fond d’intox qui avait pour but de protéger l’inévitable canon de 75. Pour aider Saussier à en savoir plus sur les avancées de l’artillerie allemande qui développait de son côté un nouveau canon, son ami et ancien ordonnance Weil aurait eu l’idée de faire appel à Esterhazy et de lui faire proposer ses services à Schwartzkoppen. « […] on verrait bien, d’après les questions qui lui seraient posées, où en sont les études de canon à tir rapide en Allemagne. » Saussier n’aurait eu qu’à « donner son accord » et « fournir, de temps en temps, quelques documents, quelques renseignements, qui pourront être périmés ou faux, pourvu qu’ils soient vraisemblables ». Et ce faisant Saussier ne pourrait que « faire œuvre utile en fournissant de tels renseignements dans le cadre de la campagne d’intoxication que commence le directeur de l’Artillerie pour tromper le Grand État-Major allemand sur nos études de canons à long recul » (p. 36-37). A cette nouvelle thèse, Lombarès, sentant qu’il serait difficile d’y faire coïncider le bordereau, venait en ajouter une autre : le fameux document ne serait pas l’œuvre d’Esterhazy mais celui du S.R. allemand qui voulait ainsi vérifier une dénonciation récente au sujet de la manière dont le S.R. français obtenait ses informations et, donc, s’assurer que la corbeille à papiers de Schwartzkoppen n’en était pas la source. Si les renseignements obtenus étaient exacts, le bordereau, imitant l’écriture d’Esterhazy et parlant de documents récemment livrés, parviendrait, « par la voie dénoncée, au S.R. français. Ce service reprochera cette imprudente lettre à Esterhazy. Ce dernier niera en être l’auteur. On ne le croira pas. Au cas, bien improbable, où on le croirait, on comprendrait qu’il est “brûlé” et que, par un juste retour des choses, la corbeille à papiers de Schwartzkoppen est devenue une source d’intoxication. Dans tous les cas, Esterhazy sera tellement surpris qu’il réagira inévitablement, d’une manière ou d’une autre, auprès de Schwartzkoppen. Le contre-espionnage allemand aura ainsi, d’un même coup, vérifiés les renseignements de la [dénonciation] et démontré aux services de l’espionnage que leur prétendu traître n’est qu’un agent du S.R. français » (p. 239).
Il faudra attendre dix ans pour découvrir la nouvelle thèse et lire L’Affaire Dreyfus. La Clé du mystère de Michel de Lombarès[23]. Variation des précédents, il revenait sur la thèse du « troisième homme » qui pour lui, indiscutablement, ne pouvait être que Saussier. Aucune trahison ici, mais, à nouveau, une histoire de renseignements sur fond d’intox qui avait pour but de protéger l’inévitable canon de 75. Pour aider Saussier à en savoir plus sur les avancées de l’artillerie allemande qui développait de son côté un nouveau canon, son ami et ancien ordonnance Weil aurait eu l’idée de faire appel à Esterhazy et de lui faire proposer ses services à Schwartzkoppen. « […] on verrait bien, d’après les questions qui lui seraient posées, où en sont les études de canon à tir rapide en Allemagne. » Saussier n’aurait eu qu’à « donner son accord » et « fournir, de temps en temps, quelques documents, quelques renseignements, qui pourront être périmés ou faux, pourvu qu’ils soient vraisemblables ». Et ce faisant Saussier ne pourrait que « faire œuvre utile en fournissant de tels renseignements dans le cadre de la campagne d’intoxication que commence le directeur de l’Artillerie pour tromper le Grand État-Major allemand sur nos études de canons à long recul » (p. 36-37). A cette nouvelle thèse, Lombarès, sentant qu’il serait difficile d’y faire coïncider le bordereau, venait en ajouter une autre : le fameux document ne serait pas l’œuvre d’Esterhazy mais celui du S.R. allemand qui voulait ainsi vérifier une dénonciation récente au sujet de la manière dont le S.R. français obtenait ses informations et, donc, s’assurer que la corbeille à papiers de Schwartzkoppen n’en était pas la source. Si les renseignements obtenus étaient exacts, le bordereau, imitant l’écriture d’Esterhazy et parlant de documents récemment livrés, parviendrait, « par la voie dénoncée, au S.R. français. Ce service reprochera cette imprudente lettre à Esterhazy. Ce dernier niera en être l’auteur. On ne le croira pas. Au cas, bien improbable, où on le croirait, on comprendrait qu’il est “brûlé” et que, par un juste retour des choses, la corbeille à papiers de Schwartzkoppen est devenue une source d’intoxication. Dans tous les cas, Esterhazy sera tellement surpris qu’il réagira inévitablement, d’une manière ou d’une autre, auprès de Schwartzkoppen. Le contre-espionnage allemand aura ainsi, d’un même coup, vérifiés les renseignements de la [dénonciation] et démontré aux services de l’espionnage que leur prétendu traître n’est qu’un agent du S.R. français » (p. 239).
Le problème est que rien n’étaye une telle thèse. Rien ne dit que l’auteur de la dénonciation, la femme Millescamps, ait parlé du « ramassage de papiers dans la corbeille de l’attaché militaire », comme le soutient avec assurance Lombarès (p. 238). Dans un rapport à Münster de 1896, Schwartzkoppen, revenant sur l’affaire, avait expliqué que la Millescamps avait « racont[é] toutes sortes de choses, d’allure invraisemblable, sur la façon dont l’ambassade d’Allemagne et son personnel étaient observés par des agents secrets français ». Il avait dit cela mais n’en avait pas dit plus. Et toutes les recherches faites à la suite n’avaient rien donné[24]. Peut-être que Schwartzkoppen mentait ici, objecterait Lombarès, ne pouvant dire à Münster avec quelle facilité il était possible de se procurer des documents confidentiels à l’ambassade. Ou peut-être refusait-il d’entendre la vérité et disqualifiait-il (« une allure invraisemblable ») une telle dénonciation dont la réalité serait bien trop extraordinaire. Cela serait vraisemblable mais on comprend mal, dans ce cas, si la Millescamps avait en effet parlé de la corbeille, que l’attaché militaire ait pu continuer à la remplir si consciencieusement de documents qui continueront, bien après le bordereau, à venir garnir les dossiers de la Section de statistique… D’autre part, on comprend mal la « démonstration » de Lombarès. Si Esterhazy était en effet un agent du S.R. français, réagir, prendre contact avec Schwartzkoppen, était le plus sûr moyen d’avouer sa véritable appartenance. Il était clair que, puisque le postulat était que le bordereau mentionnait des pièces déjà livrées, il ne pouvait que s’agir d’une intox. Esterhazy et ses employeurs l’eussent assurément compris et la consigne n’eût pu être que de ne surtout pas se manifester. Et quel danger représentait pour les allemands une telle stratégie si la Millescamps avait menti ou si Esterhazy était un authentique traître et non un agent double. Le S.R. allemand aurait ainsi rendu un fier service à son homologue français en lui révélant un fait d’importance, à savoir qu’il existait un traître dans l’armée française.
Mais le problème ne se posa pas puisque, comme nous le dit Lombarès, la manœuvre échoua : « contrairement à tout ce que le S.R. de Berlin pouvait raisonnablement imaginer, si Esterhazy était bien un agent double, il n’était pas un agent du S.R. » (p. 239). Suivant cette méthode on peut avancer tout et n’importe quoi. Et sur quoi repose donc cette thèse ? Elle ne s’appuie – comme à chaque fois – sur aucun document et n’est qu’une explication censée répondre à une impossibilité : celle de la conception du bordereau par Esterhazy. Pour Lombarès, en effet, le bordereau ne peut en aucun cas être l’œuvre du « uhlan » et ce pour de multiples raisons : son inutilité, sa graphie, son style maladroit, l’état dans lequel il parvint à la Section de statistique, son papier, sa date et son texte (p. 224-232). Voyons cela. Inutile, le bordereau, ne faisant que récapituler des pièces qui y étaient jointes, l’était en effet mais le remarquer ne prouve pas grand-chose et le fait n’est peut-être finalement pas aussi curieux que Lombarès le pense. Il arrive souvent qu’on fasse parvenir à un correspondant un objet, un document quelconque, et que cet envoi soit accompagné d’un mot qui annonce ce que l’ouverture de l’enveloppe indiquerait d’elle-même. Cela s’appelle aussi de la politesse… Le second point – la graphie – est difficile à soutenir tant sont semblables les écritures d’Esterhazy et du bordereau. Et pour y parvenir, il faudrait que Lombarès ait d’autres arguments, moins naïfs dans tous les cas, que celui selon lequel « lorsque se posa la question d’Esterhazy, au procès de cet officier tous les experts consultés ont estimé que l’écriture du bordereau avait les caractères d’une imitation. Tous ! ». La question de la rédaction n’est pas plus convaincante. Esterhazy, cultivé, n’aurait pu commettre les impropriétés de langue, de mots et de tournures du bordereau. Certaines se retrouvent pourtant à l’identique dans sa correspondance. La question du papier est équivalente. Esterhazy possédait ce papier peu courant, comme le révéla l’enquête de la Cour de cassation et comme le sait aussi Lombarès. Alors ? « Un faussaire pouvait se procurer ce papier chez cet officier, ou chez son fournisseur »… Soit. Mais une nouvelle fois avec de tels arguments tout est possible. La date ? Comment, demande Lombarès, une lettre faite – si Esterhazy en était l’auteur – entre le 15 août et le 1er septembre, aurait-elle pu parvenir à la Section de statistique un mois plus tard ? Pourquoi l’agent aurait-il été « assez maladroit pour attendre grand mois avant de la faire parvenir » ? Cela serait douteux en effet. Mais pourquoi Schwartzkoppen, s’il a reçu le bordereau comme nous nous obstinons à le croire, aurait-il dû le jeter dès lecture ? N’aurait-il pu le garder, un jour, deux jours, quelques jours, une semaine, un mois même et le jeter plus tard ? Quant au texte, Lombarès voulait y voir un certain nombre de « véritables impossibilités dans l’hypothèse qui en fait l’œuvre du commandant Esterhazy ». Comment aurait-il pu écrire la première phrase (« Sans nouvelles m’indiquant… ») quand il allait et venait librement à l’ambassade ? Comment pouvait-il écrire « Je vous adresse », indiquant la livraison, et la livraison concomitante, alors que Schwartzkoppen a expliqué dans ses Carnets avoir reçu les documents en mains propres ? Pourquoi Esterhazy aurait-il donné entre parenthèse dans le bordereau la date du manuel de tir alors qu’elle figurait sur l’exemplaire qui lui transmettait ? Pourquoi, toujours à propos du manuel, avoir dire « je le prendrai », indiquant qu’il ne l’avait pas encore pris, alors qu’il le lui adressait ? Enfin, que signifiait la dernière phrase (« Je vais partir en manœuvres ») alors qu’il n’y se rendit pas à cette époque ? Autant d’impossibilités qui n’en sont pas. Aux manœuvres, il n’y alla pas fin août-début septembre 1894. Il n’y alla pas mais affirma à Schwartzkoppen y être allé quand, si on en croit les Carnets de l’attaché militaire, le 1er septembre, il lui avait dit revenir de celles de Sissonne dont il lui promettait la livraison des « observations qu’il y avait faites[25] ». Il n’y alla pas. Nous le savons, mais n’était-ce pas là un moyen, comme le dit Lombarès lui-même, d’« expliquer et valoriser » les observations en question ? N’est-ce pas aussi ainsi que peut s’expliquer la mention de la date du manuel dans le texte du bordereau ? Mais continuons. Comment expliquer la première phrase ? Sans doute qu’Esterhazy ne se gênait pas pour aller à l’ambassade. Mais ayant enfin obtenu l’accord de Schwartzkoppen, le 15 août, ne peut-on imaginer qu’il pouvait attendre que son nouvel employeur lui formulât quelque demande précise ? Comment put-il envoyer des documents avec le bordereau si Schwartzkoppen par ailleurs affirma les avoir reçu des mains d’Esterhazy lors d’une de ses visites ? Nous l’avons dit… et nous le répétons. Schwartzkoppen pouvait-il assumer aux yeux du monde, pour des mémoires qui feraient peut-être un jour l’objet d’une édition, de bien coupables négligences, négligences qui plus est, par la répétition, frôlaient la bêtise ?… Demeure la question du « je le prendrai ». En aucun cas, il ne signifie qu’Esterhazy ne l’avait pas encore, ce qui en effet serait curieux dans une lettre qui disait l’envoyer. Il suffit de lire le texte du bordereau pour comprendre que Lombarès à mal lu… ou a voulu lire ce qui pouvait servir son propos. Rappelons-nous le passage en question : « Ce dernier document est extrêmement difficile à se procurer et je ne puis l’avoir à ma disposition que peu de jours. Le ministère de la Guerre en a envoyé un nombre fixe dans les corps, et ces corps en sont responsables. Chaque officier détenteur doit remettre le sien après les manœuvres. Si donc vous voulez y prendre ce qui vous intéresse et le tenir à ma disposition après. Je le prendrai. A moins que vous ne vouliez que je le fasse copier in extenso et ne vous en adresse la copie. » « Je le prendrai » a ici le sens de « je le récupérerai », une fois, comme le dit la phrase précédente, que son correspondant en aura fini avec le document en question. Et ce dans le cas, Esterhazy devant le rendre le plus vite possible, n’en copier qu’une partie pourrait suffire à l’attaché militaire. Dans le cas où il souhaiterait l’avoir intégralement, Esterhazy lui proposait de le reprendre vite et de s’arranger pour le faire copier… Comment peut-on lire ici autre chose ? Parmi tous ces arguments qui n’en sont pas, le seul qui pourrait êtrelearguments qui n’portent jamais sur le fond et ne résistent pas longtemps à la critique recevable est celui des déchirures. Elles sont en effet curieuses et ne ressemblent que peu à celles des autres documents issus de la voie ordinaire. Mais si cela est, indubitablement, ce n’est guère suffisant pour en faire la preuve qui pourrait expliquer une autre origine au bordereau que la corbeille de l’attaché militaire.
 En 1985, Lombarès réédita son ouvrage sous le titre L’Affaire Dreyfus[26]. La suppression de la seconde partie du titre de la première édition (La Clé du mystère) pouvait laisser espérer plus de mesure comme, dans l’introduction, l’aveu d’erreurs commises (p. 11). Mais il ne fallait pas le lire trop vite. Ces erreurs n’étaient à son point de vue que « de détail » et à bien y réfléchir ce nouveau titre était pire encore qui présentait cette seconde édition comme une histoire ou un essai. En fait, à l’exception de menues corrections, cette édition n’était que la reprise de la précédente, augmentée de trois chapitres qui, affirmait l’auteur avec sérieux, venaient sur la base de publications récentes confirmer son hypothèse, « la seule en accord avec tout ce qu’on savait de cette histoire » (p. 215). Voyons rapidement ce qui pouvait justifier autant d’assurance. Dans ses souvenirs, Mathieu, on s’en souvient, raconte ses expériences avec la voyante Léonie[27]. Lors d’une des séances, elle fit une déclaration dans laquelle Lombarès trouve une confirmation de sa thèse : « Interrogée, poussée par nous, elle déclara que cette pièce [le bordereau] était une copie, un décalque fait à Metz, rapporté par Greber [un agent allemand], dans un but qu’elle ignorait, à l’ambassade allemande à Paris, où elle avait été volée par un agent français.[28] » Et Lombarès, après avoir cité – inexactement –, de commenter : « Cette fois c’était clair, du moins pour nous, car, on le voit, cette phrase écrite dès 1895, résumait parfaitement notre hypothèse. » (p. 197). La preuve est donc une vision de voyante ? Est-ce sérieux ? Et puis si on veut bien prendre le passage entier dont est extraite la citation on verra qu’en aucun cas, comme elle pourrait à elle seule le faire croire, elle ne vient conforter la thèse d’une intox du SR allemand. La citation ne dit pas qui est à l’origine du document et peut faire croire, prise seule, hors de son contexte, que copiée à Metz elle était l’œuvre des Allemands. Mais ce que disait Léonie était tout autre. Citons le passage qui introduit celui sélectionné par Lombarès : « Ainsi elle prétendait que le coupable était un officier du ministère de la Guerre dont elle ne trouvait pas le nom, en relations avec un agent allemand du nom de Greber. Celui-ci apportait à Metz les documents, livrés par cet officier, d’où ils étaient expédiés à Berlin. » Voilà qui ne résume rien et contredit tout… Lombarès ne pouvait trouver meilleure source et meilleure définition de sa manière de travailler. Ce n’est pas de l’histoire que font ces auteurs mais bien de la divination.
En 1985, Lombarès réédita son ouvrage sous le titre L’Affaire Dreyfus[26]. La suppression de la seconde partie du titre de la première édition (La Clé du mystère) pouvait laisser espérer plus de mesure comme, dans l’introduction, l’aveu d’erreurs commises (p. 11). Mais il ne fallait pas le lire trop vite. Ces erreurs n’étaient à son point de vue que « de détail » et à bien y réfléchir ce nouveau titre était pire encore qui présentait cette seconde édition comme une histoire ou un essai. En fait, à l’exception de menues corrections, cette édition n’était que la reprise de la précédente, augmentée de trois chapitres qui, affirmait l’auteur avec sérieux, venaient sur la base de publications récentes confirmer son hypothèse, « la seule en accord avec tout ce qu’on savait de cette histoire » (p. 215). Voyons rapidement ce qui pouvait justifier autant d’assurance. Dans ses souvenirs, Mathieu, on s’en souvient, raconte ses expériences avec la voyante Léonie[27]. Lors d’une des séances, elle fit une déclaration dans laquelle Lombarès trouve une confirmation de sa thèse : « Interrogée, poussée par nous, elle déclara que cette pièce [le bordereau] était une copie, un décalque fait à Metz, rapporté par Greber [un agent allemand], dans un but qu’elle ignorait, à l’ambassade allemande à Paris, où elle avait été volée par un agent français.[28] » Et Lombarès, après avoir cité – inexactement –, de commenter : « Cette fois c’était clair, du moins pour nous, car, on le voit, cette phrase écrite dès 1895, résumait parfaitement notre hypothèse. » (p. 197). La preuve est donc une vision de voyante ? Est-ce sérieux ? Et puis si on veut bien prendre le passage entier dont est extraite la citation on verra qu’en aucun cas, comme elle pourrait à elle seule le faire croire, elle ne vient conforter la thèse d’une intox du SR allemand. La citation ne dit pas qui est à l’origine du document et peut faire croire, prise seule, hors de son contexte, que copiée à Metz elle était l’œuvre des Allemands. Mais ce que disait Léonie était tout autre. Citons le passage qui introduit celui sélectionné par Lombarès : « Ainsi elle prétendait que le coupable était un officier du ministère de la Guerre dont elle ne trouvait pas le nom, en relations avec un agent allemand du nom de Greber. Celui-ci apportait à Metz les documents, livrés par cet officier, d’où ils étaient expédiés à Berlin. » Voilà qui ne résume rien et contredit tout… Lombarès ne pouvait trouver meilleure source et meilleure définition de sa manière de travailler. Ce n’est pas de l’histoire que font ces auteurs mais bien de la divination.
 Entre les deux éditions du Lombarès, parut en 1975 Dreyfus ou l’intolérable vérité de Jean Cherasse et Patrice Boussel[29], reprise et complément du « film-débat » sorti l’année précédente. Parallèlement aux commentaires et déclarations, extraites du documentaire, de François Mitterrand, Michel Debré, Alain Krivine, François Brigneau, Edgar Faure, Jean-Pierre Bloch, Daniel Mayer, Marcel Thomas et Henri Guillemin, Jean Chérasse, agrégé d’histoire, ancien élève de l’ENS, y proposait une « hypothèse originale » déjà présente dans son film. Selon lui, l’affaire Dreyfus était un « téléscopage » entre deux affaires : une affaire française et une affaire allemande. Du côté français, elle était une machination antisémite montée par le commandant Biot, journaliste de La Libre Parole et un des promoteurs de la campagne de 1892 contre la présence des juifs dans l’armée. Une machination qui avait pour but de « non seulement porter atteinte à la politique républicaine des Juifs, mais aussi et surtout discréditer le régime de la Troisième République avec un scandale touchant à la Défense nationale et à ce mythe de la “revanche” qui traumatisait littéralement les Français ». L’idée était « de trouver un officier juif alsacien […] et promis à un très bel avenir (c’est-à-dire un saint-cyrien ou un polytechnicien) ; d’observer attentivement son comportement s’il accédait à un des plus hauts niveaux du ministère de la Guerre (état-major de l’armée par exemple) : et de lui “coller une vilaine affaire d’espionnage sur le dos” ». C’est ainsi qu’aurait été choisi Dreyfus. Mais pour que son plan pût réussir, il fallait « disposer au ministère ou à l’état-major des “hautes oreilles favorables” sinon des complicités de premier ordre ». Mercier fut le premier conquis, contre la promesse du soutien de la presse de droite, puis Gonse, Henry, Lauth, Boisdeffre et « probablement bien d’autres ». Sur la base du roman de Louis Létang – encore une fois –, ils machinèrent donc l’affaire et il ne restait plus qu’à piéger la victime choisie, ce dont fut chargé d’Aboville, ami de Biot avec lequel « il allait souvent à la chasse ». Mais Esterhazy ? Et c’est là que commençait la seconde affaire, l’affaire « allemande ». Et Chérasse, pour l’expliquer, de reprendre la thèse de Lombarès (p. 193-200). Il n’est assurément pas nécessaire de commenter cette nouvelle variation de ce que Vincent Duclert appelle drôlement l’« histoire-canon[30] ». Juste deux remarques toutefois. Chérasse, pour expliquer l’affaire « française », affirme que « la “conquête” de Mercier » est un « fait historique ». Dommage que, suivant le procédé de tous ses prédécesseurs et suiveurs, il se contenta de cette simple affirmation. Il eût été intéressant de savoir à quoi il pouvait bien penser et sur quoi pouvait reposer une telle certitude… D’autre part, à propos du « télescopage », on ne peut s’empêcher de noter quelle fut la chance des bourreaux de Dreyfus. Si les allemands n’avaient pas eu la formidable idée d’intoxiquer le S.R. français, Biot et ses amis auraient sans doute pu attendre encore longtemps pour mettre leur plan à exécution…ry, Lauth, Boisdeffre et « e
Entre les deux éditions du Lombarès, parut en 1975 Dreyfus ou l’intolérable vérité de Jean Cherasse et Patrice Boussel[29], reprise et complément du « film-débat » sorti l’année précédente. Parallèlement aux commentaires et déclarations, extraites du documentaire, de François Mitterrand, Michel Debré, Alain Krivine, François Brigneau, Edgar Faure, Jean-Pierre Bloch, Daniel Mayer, Marcel Thomas et Henri Guillemin, Jean Chérasse, agrégé d’histoire, ancien élève de l’ENS, y proposait une « hypothèse originale » déjà présente dans son film. Selon lui, l’affaire Dreyfus était un « téléscopage » entre deux affaires : une affaire française et une affaire allemande. Du côté français, elle était une machination antisémite montée par le commandant Biot, journaliste de La Libre Parole et un des promoteurs de la campagne de 1892 contre la présence des juifs dans l’armée. Une machination qui avait pour but de « non seulement porter atteinte à la politique républicaine des Juifs, mais aussi et surtout discréditer le régime de la Troisième République avec un scandale touchant à la Défense nationale et à ce mythe de la “revanche” qui traumatisait littéralement les Français ». L’idée était « de trouver un officier juif alsacien […] et promis à un très bel avenir (c’est-à-dire un saint-cyrien ou un polytechnicien) ; d’observer attentivement son comportement s’il accédait à un des plus hauts niveaux du ministère de la Guerre (état-major de l’armée par exemple) : et de lui “coller une vilaine affaire d’espionnage sur le dos” ». C’est ainsi qu’aurait été choisi Dreyfus. Mais pour que son plan pût réussir, il fallait « disposer au ministère ou à l’état-major des “hautes oreilles favorables” sinon des complicités de premier ordre ». Mercier fut le premier conquis, contre la promesse du soutien de la presse de droite, puis Gonse, Henry, Lauth, Boisdeffre et « probablement bien d’autres ». Sur la base du roman de Louis Létang – encore une fois –, ils machinèrent donc l’affaire et il ne restait plus qu’à piéger la victime choisie, ce dont fut chargé d’Aboville, ami de Biot avec lequel « il allait souvent à la chasse ». Mais Esterhazy ? Et c’est là que commençait la seconde affaire, l’affaire « allemande ». Et Chérasse, pour l’expliquer, de reprendre la thèse de Lombarès (p. 193-200). Il n’est assurément pas nécessaire de commenter cette nouvelle variation de ce que Vincent Duclert appelle drôlement l’« histoire-canon[30] ». Juste deux remarques toutefois. Chérasse, pour expliquer l’affaire « française », affirme que « la “conquête” de Mercier » est un « fait historique ». Dommage que, suivant le procédé de tous ses prédécesseurs et suiveurs, il se contenta de cette simple affirmation. Il eût été intéressant de savoir à quoi il pouvait bien penser et sur quoi pouvait reposer une telle certitude… D’autre part, à propos du « télescopage », on ne peut s’empêcher de noter quelle fut la chance des bourreaux de Dreyfus. Si les allemands n’avaient pas eu la formidable idée d’intoxiquer le S.R. français, Biot et ses amis auraient sans doute pu attendre encore longtemps pour mettre leur plan à exécution…ry, Lauth, Boisdeffre et « e
 En 1988, parut, plus confidentielle, une nouvelle thèse due à Max Guermann, « La “terrible” verité », publiée dans Les Cahiers naturalistes[31]. L’auteur y développe la thèse d’un montage de la Section de statistique dans le but de se débarrasser de Schwartzkoppen et de l’officine d’espionnage qu’il avait fait de l’ambassade d’Allemagne. Dans cette nouvelle thèse, Dreyfus n’aurait été ainsi que la victime, finalement pratique, de la ressemblance de son écriture avec celle du bordereau, découverte qui contraria l’ingénieux montage. Admettons et pour l’admettre faisons confiance à Esterhazy sur les déclarations duquel repose l’essentiel de l’argumentation. Mais ce faisant regrettons que l’auteur ne nous dise rien de la manière dont la création et la révélation du bordereau eût pu permettre d’atteindre son but si en Dreyfus n’avait pas été reconnu dans le bordereau le scripteur qu’il n’était pas. Sa découverte « a bouleversé le scénario original ». Certes, mais quel était-il ce scénario ? Qu’aurait permis d’obtenir cette pièce qui, comme le dit l’auteur lui-même, « précarité d[e la] combinaison », était pour le moins « un document douteux, ni daté, ni signé, sans destinataire désigné » (p. 53) ? Rien ne nous en est dit. S’il s’agissait de se débarrasser de l’attaché militaire, n’était-il pas plus simple de sortir sa correspondance intime, celle avec Panizzardi, dont la Section de statistique avait quelques pièces pour le moins édifiantes plutôt que d’échafauder ce plan compliqué, incomplet et tellement risqué ?
En 1988, parut, plus confidentielle, une nouvelle thèse due à Max Guermann, « La “terrible” verité », publiée dans Les Cahiers naturalistes[31]. L’auteur y développe la thèse d’un montage de la Section de statistique dans le but de se débarrasser de Schwartzkoppen et de l’officine d’espionnage qu’il avait fait de l’ambassade d’Allemagne. Dans cette nouvelle thèse, Dreyfus n’aurait été ainsi que la victime, finalement pratique, de la ressemblance de son écriture avec celle du bordereau, découverte qui contraria l’ingénieux montage. Admettons et pour l’admettre faisons confiance à Esterhazy sur les déclarations duquel repose l’essentiel de l’argumentation. Mais ce faisant regrettons que l’auteur ne nous dise rien de la manière dont la création et la révélation du bordereau eût pu permettre d’atteindre son but si en Dreyfus n’avait pas été reconnu dans le bordereau le scripteur qu’il n’était pas. Sa découverte « a bouleversé le scénario original ». Certes, mais quel était-il ce scénario ? Qu’aurait permis d’obtenir cette pièce qui, comme le dit l’auteur lui-même, « précarité d[e la] combinaison », était pour le moins « un document douteux, ni daté, ni signé, sans destinataire désigné » (p. 53) ? Rien ne nous en est dit. S’il s’agissait de se débarrasser de l’attaché militaire, n’était-il pas plus simple de sortir sa correspondance intime, celle avec Panizzardi, dont la Section de statistique avait quelques pièces pour le moins édifiantes plutôt que d’échafauder ce plan compliqué, incomplet et tellement risqué ?
 Après quelques années d’accalmie, le virus reparut. Les commémorations à venir relancèrent une machine qu’on avait pu espérer avoir disparu. En 1993, Ida-Marie Frandon publia un curieux ouvrage qui offrait de faire le point sur la lassante question du canon de 75 : L’Affaire et le grand secret. Le Capitaine Dreyfus ou l’épopée du 75[32]. La thèse est connue : pour protéger le formidable canon Esterhazy aurait été envoyé par la Section de statistique à Schwartzkoppen pour lui donner de faux renseignements et l’engager sur la voie du canon de 120. Aucun argument n’étant avancé, il n’y guère plus à dire, à part toutefois une vraie nouveauté, pas plus soutenue, selon laquelle Dreyfus, « courageux, patriote, prisonnier d’apparences ambiguës », aurait accepté une « culpabilité temporaire » (p. 52-53). Cette dernière thèse, qui sera développée en 2000 par Jean-François Deniau, ne nécessite guère d’autre réponse que celle que nous avons donnée ailleurs[33] – et que nous reprendrons à la suite – et qui permet de comprendre la manière de procéder et l’ordre de preuves douteuses convoqué pour servir cette impossible thèse.
Après quelques années d’accalmie, le virus reparut. Les commémorations à venir relancèrent une machine qu’on avait pu espérer avoir disparu. En 1993, Ida-Marie Frandon publia un curieux ouvrage qui offrait de faire le point sur la lassante question du canon de 75 : L’Affaire et le grand secret. Le Capitaine Dreyfus ou l’épopée du 75[32]. La thèse est connue : pour protéger le formidable canon Esterhazy aurait été envoyé par la Section de statistique à Schwartzkoppen pour lui donner de faux renseignements et l’engager sur la voie du canon de 120. Aucun argument n’étant avancé, il n’y guère plus à dire, à part toutefois une vraie nouveauté, pas plus soutenue, selon laquelle Dreyfus, « courageux, patriote, prisonnier d’apparences ambiguës », aurait accepté une « culpabilité temporaire » (p. 52-53). Cette dernière thèse, qui sera développée en 2000 par Jean-François Deniau, ne nécessite guère d’autre réponse que celle que nous avons donnée ailleurs[33] – et que nous reprendrons à la suite – et qui permet de comprendre la manière de procéder et l’ordre de preuves douteuses convoqué pour servir cette impossible thèse.
 En 1994, en annonce au centenaire du début de l’affaire Dreyfus, parut Un secret bien gardé. Histoire militaire de l’affaire Dreyfus par Jean Doise[34], livre tout à fait impressionnant sur les questions relative à la chose militaire et dont on peut juste regretter que son auteur ait cru bon y mêler l’Affaire. Variation de la plupart des ouvrages que nous venons de voir et plus particulièrement du Charpentier, dont il reprend tous les arguments (p. 44-46), il repose sur le postulat de la lettre d’Alsace qu’il entremêle avec la question de l’intox montée pour protéger le 75. Sandherr ayant reçu des informations en provenance d’Alsace sur la trahison d’un nommé Dreyfus, aurait décidé de mettre hors d’état de nuire le stagiaire ainsi nommé et, confiant le travail à Henry, aurait fait fabriquer pour cela le bordereau pour lequel Esterhazy aurait prêté son écriture. Coup double, le bordereau permettait de se débarrasser du traître et de crédibiliser l’informateur Esterhazy. Coup double et même coup triple dans la mesure où la mention du 120 dans le bordereau devait permettre de concentrer l’attention des allemands sur le 120 qui y était mentionné (p. 46, 55-57). Pour Mercier, tout à ses préoccupations relatives au nouveau canon, peu importait finalement que Dreyfus ait trahi. S’il fallait, à tout prix, l’arrêter, le faire juger et condamner, c’était à ses yeux pour le mettre hors d’état de nuire et l’empêcher de parler un jour du 75. Ainsi s’explique pour Doise l’empressement et le peu de souci de la légalité qui furent ceux de Mercier dans le traitement de l’affaire naissante (p. 63-64 et 179). Le montage est ingénieux et à vrai dire plus convaincant et mieux fondé que les précédents. Seulement, il ne repose sur rien et Doise n’avance pas la moindre preuve qui permette de fonder une thèse qui n’est qu’une suite d’affirmations et se heurte à toutes les objections que nous avons déjà soulevées au sujet des ouvrages de ses prédécesseurs. Page 44, l’auteur regrette que la « lettre d’Alsace » ait été « niée ou négligée par la plupart des dreyfusologues », expliquant ainsi pourquoi « ils ont mal interprétés la suite ». Mais comment ne pas négliger – et ne pas nier – une lettre que rien n’atteste, que personne n’a vue, qui aurait disparu si tant est qu’elle ait existé et dont la seule mention un peu tangible est due à Charpentier dans un travail dont nous avons vu ce qu’on pouvait en attendre ? L’histoire ne peut se faire sur d’uniques hypothèses, des spéculations, sur l’absence d’archives et le parti pris de ne pas les consulter, sur une bibliographie étique et discutable et, plus largement, sur une vision tout autant myope qu’astigmate de l’événement qui ne pourrait être compris qu’à la lumière des questions militaires et plus particulièrement de celle liées à l’artillerie[35].
En 1994, en annonce au centenaire du début de l’affaire Dreyfus, parut Un secret bien gardé. Histoire militaire de l’affaire Dreyfus par Jean Doise[34], livre tout à fait impressionnant sur les questions relative à la chose militaire et dont on peut juste regretter que son auteur ait cru bon y mêler l’Affaire. Variation de la plupart des ouvrages que nous venons de voir et plus particulièrement du Charpentier, dont il reprend tous les arguments (p. 44-46), il repose sur le postulat de la lettre d’Alsace qu’il entremêle avec la question de l’intox montée pour protéger le 75. Sandherr ayant reçu des informations en provenance d’Alsace sur la trahison d’un nommé Dreyfus, aurait décidé de mettre hors d’état de nuire le stagiaire ainsi nommé et, confiant le travail à Henry, aurait fait fabriquer pour cela le bordereau pour lequel Esterhazy aurait prêté son écriture. Coup double, le bordereau permettait de se débarrasser du traître et de crédibiliser l’informateur Esterhazy. Coup double et même coup triple dans la mesure où la mention du 120 dans le bordereau devait permettre de concentrer l’attention des allemands sur le 120 qui y était mentionné (p. 46, 55-57). Pour Mercier, tout à ses préoccupations relatives au nouveau canon, peu importait finalement que Dreyfus ait trahi. S’il fallait, à tout prix, l’arrêter, le faire juger et condamner, c’était à ses yeux pour le mettre hors d’état de nuire et l’empêcher de parler un jour du 75. Ainsi s’explique pour Doise l’empressement et le peu de souci de la légalité qui furent ceux de Mercier dans le traitement de l’affaire naissante (p. 63-64 et 179). Le montage est ingénieux et à vrai dire plus convaincant et mieux fondé que les précédents. Seulement, il ne repose sur rien et Doise n’avance pas la moindre preuve qui permette de fonder une thèse qui n’est qu’une suite d’affirmations et se heurte à toutes les objections que nous avons déjà soulevées au sujet des ouvrages de ses prédécesseurs. Page 44, l’auteur regrette que la « lettre d’Alsace » ait été « niée ou négligée par la plupart des dreyfusologues », expliquant ainsi pourquoi « ils ont mal interprétés la suite ». Mais comment ne pas négliger – et ne pas nier – une lettre que rien n’atteste, que personne n’a vue, qui aurait disparu si tant est qu’elle ait existé et dont la seule mention un peu tangible est due à Charpentier dans un travail dont nous avons vu ce qu’on pouvait en attendre ? L’histoire ne peut se faire sur d’uniques hypothèses, des spéculations, sur l’absence d’archives et le parti pris de ne pas les consulter, sur une bibliographie étique et discutable et, plus largement, sur une vision tout autant myope qu’astigmate de l’événement qui ne pourrait être compris qu’à la lumière des questions militaires et plus particulièrement de celle liées à l’artillerie[35].
 L’année 2000 fut riche en suprises. Deux volumes parurent, celui d’Armand Israël, dont il sera question à la suite, et le chapitre de Jean-François Deniau dans Le Bureau des secrets perdus[36]. Dans ce livre, l’ancien ministre, académicien-rameur, développa une thèse selon laquelle toute l’Affaire s’expliquerait par la nécessité pour le SR français de « cacher aux Allemands que nous sommes peut-être en train de découvrir l’arme absolue en matière d’artillerie de campagne », à savoir le prodigieux 75 (p. 23). Mais ce que n’avaient pas prévus les responsables de l’intox – Mercier, Saussier, Deloye –, c’est qu’apparaîtrait un jour un bordereau – oeuvre du SR allemand (p. 52-53) – qui les obligerait à agir pour ne pas éveiller les soupçons des Allemands. Mais là où la thèse est originale – quoi qu’empruntée à Frandon –, c’est que selon notre auteur, Dreyfus aurait été mis dans la confidence et, patriote, aurait accepté de se sacrifier pour le pays (p. 42). « Il n’est pas seulement un innocent injustement condamné : c’est désormais un officier français en service commandé » (p. 43). Ainsi s’explique le « détachement » (!!!???) du capitaine (p. 43), sa certitude que l’Affaire serait réglée dans quelques années (p. 42). Mais l’ultime preuve, le « témoignage aussi poignant qu’irrécusable », est ce « pacte » dont le capitaine parla souvent et qui le liait à Casimir-Perier. Et de citer, en argument définitif à sa démonstration, un extrait d’une de ses lettres au président de la République, qui dit : « C’est pourquoi dans ma dernière lettre, je vous disais, Monsieur le Président, que pour moi, s’il fallait une victime innocente, sacrifiée sur l’autel de la patrie, oh ! que je le sois, que l’on fasse vite, mais que l’on sache pourquoi je succombe… » (p. 57). Qu’on remette cette citation dans son contexte pour voir qu’il s’agit de tout autre chose :
L’année 2000 fut riche en suprises. Deux volumes parurent, celui d’Armand Israël, dont il sera question à la suite, et le chapitre de Jean-François Deniau dans Le Bureau des secrets perdus[36]. Dans ce livre, l’ancien ministre, académicien-rameur, développa une thèse selon laquelle toute l’Affaire s’expliquerait par la nécessité pour le SR français de « cacher aux Allemands que nous sommes peut-être en train de découvrir l’arme absolue en matière d’artillerie de campagne », à savoir le prodigieux 75 (p. 23). Mais ce que n’avaient pas prévus les responsables de l’intox – Mercier, Saussier, Deloye –, c’est qu’apparaîtrait un jour un bordereau – oeuvre du SR allemand (p. 52-53) – qui les obligerait à agir pour ne pas éveiller les soupçons des Allemands. Mais là où la thèse est originale – quoi qu’empruntée à Frandon –, c’est que selon notre auteur, Dreyfus aurait été mis dans la confidence et, patriote, aurait accepté de se sacrifier pour le pays (p. 42). « Il n’est pas seulement un innocent injustement condamné : c’est désormais un officier français en service commandé » (p. 43). Ainsi s’explique le « détachement » (!!!???) du capitaine (p. 43), sa certitude que l’Affaire serait réglée dans quelques années (p. 42). Mais l’ultime preuve, le « témoignage aussi poignant qu’irrécusable », est ce « pacte » dont le capitaine parla souvent et qui le liait à Casimir-Perier. Et de citer, en argument définitif à sa démonstration, un extrait d’une de ses lettres au président de la République, qui dit : « C’est pourquoi dans ma dernière lettre, je vous disais, Monsieur le Président, que pour moi, s’il fallait une victime innocente, sacrifiée sur l’autel de la patrie, oh ! que je le sois, que l’on fasse vite, mais que l’on sache pourquoi je succombe… » (p. 57). Qu’on remette cette citation dans son contexte pour voir qu’il s’agit de tout autre chose :
Le martyre devient trop grand, Monsieur le Président, car non seulement je suis innocent de ce crime abominable, mais contre vents et marées, dans les pires supplices, je n’ai jamais oublié aucun de mes devoirs, devoirs si multiples, tant vis-à-vis de ma famille, que je devais soutenir de mon inébranlable volonté, que vis-a-vis de la patrie.
Oui, Monsieur le Président, j’ai voulu la lumière, je la veux, je veux la vérité de toutes les forces de mon âme, de toutes les forces d’un cœur horriblement mutilé et blessé, je la veux par tous les moyens, mais pour la patrie et par la patrie.
Et alors, Monsieur le Président, il vous est impossible de vous figurer l’horrible détresse de mon âme quand, avec la conscience sûre d’avoir toujours et partout rempli tous mes devoirs, et je défie qui que ce soit d’en apporter une preuve contraire, je vois chaque mois arriver de nouvelles mesures de sûreté, qui donnent lieu, je le vois, je le sens, étant donné la situation, aux hypothèses les plus atroces, les plus infamantes.
C’est pourquoi dans ma dernière lettre, je vous disais, Monsieur le Président, que pour moi, s’il fallait une victime innocente, sacrifiée sur l’autel de la patrie, oh ! que je le sois, que l’on fasse vite, mais que l’on sache pourquoi je succombe…
Si je suis encore debout, dans une situation aussi atroce, supportée depuis longtemps, sous un pareil climat, le cerveau halluciné, le cœur malade, c’est pour ma chère femme, c’est pour mes pauvres enfants, mes pauvres petits martyrs, qui grandissent déshonorés[37]…
Il n’est bien question ici que de la double promesse faite, en premier lieu, au président de taire l’origine du bordereau et, en second lieu, à sa famille de vivre jusqu’à la réhabilitation. Et pour comprendre le sens exact de la phrase qui ne peut en aucun cas permettre l’interprétation forcée qu’en fait Deniau, « s’il fallait une victime innocente, sacrifiée sur l’autel de la patrie, oh ! que je le sois, que l’on fasse vite, mais que l’on sache pourquoi je succombe… », rien n’était plus simple que de se référer à la lettre précédente, ainsi que le capitaine lui-même nous invite à le faire. Dans cette supplique du 8 juillet 1897, il écrivait :
Ma vie, Monsieur le Président, je n’en parlerai pas. Aujourd’hui comme hier, elle appartient à mon pays. Ce que je lui demande simplement comme une faveur suprême, c’est de la prendre vite, de ne pas me laisser succomber aussi lentement par une agonie atroce, sous tant de supplices infamants que je n’ai pas mérités, que je ne mérite pas.
Mais ce que je demande aussi à mon pays, c’est de faire faire la lumière pleine et entière sur cet horrible drame ; car mon honneur ne lui appartient pas, c’est le patrimoine de mes enfants, c’est le bien propre de deux familles[38].
 Mais le chef d’œuvre dans le domaine est assurément le second volume de cette année 2000, Les Vérités cachées de l’affaire Dreyfus, publié par Armand Israël[39]. En dehors de ce titre qui à lui seul est une promesse, le livre d’Armand Israël semble offrir toutes les garanties de la scientificité : un éditeur prestigieux, un préfacier directeur des Archives de la Préfecture de Police et une recherche menée, sous la direction de l’auteur, par « une équipe de chercheurs » et reposant sur « l’exploitation de fonds d’archives jusqu’alors inaccessibles » (quatrième de couverture). Pourtant, on est rapidement frappé par le nombre d’erreur de faits, de noms, de dates, de contradictions d’une page à l’autre qui en font une véritable moulinette de l’approximation. Sous la forme d’une histoire de l’événement, il aborde, pour les corriger, trois points essentiels : le bordereau, son origine et son histoire, la mort d’Henry dont il a en toute simplicité découvert l’identité de l’assassin et le pacte secret passé à l’époque du procès de Rennes entre la famille Dreyfus et le gouvernement. Commençons par le bordereau. Deloye, Boisdeffre et Gonse auraient mis au point un projet visant à protéger les secrets de conception du… nouveau 75. Pour ce faire, Gonse, aurait convoqué Sandherr qui, avec l’aide d’Henry et d’Esterhazy, auraient conçu un plan complexe dans le but d’intoxiquer les allemands. « La découverte d’une affaire d’espionnage d’une telle importance », auraient pensé Gonse et ses comparses, n’aurait pu que faire « du bruit et il suffira à l’État-major français de feindre une grande inquiétude pour que l’information présentée par le bordereau prenne une importance capitale aux yeux de l’Allemagne. Pendant que celle-ci se préoccupera du frein du 120, la France aura le champ libre pour fabriquer sa véritable arme secrète : le canon de 75 » (p. 80). Sandherr aurait donc envoyé Esterhazy chez Schwartzkoppen. Seulement, un problème de taille se serait rapidement posé. Comment en effet, nous explique l’auteur, un simple officier de troupes pouvait-il livrer des informations d’une telle importance (p. 83) ? Les attachés militaires, « au fil du temps » (un peu moins de deux mois !?), commençant à s’interroger, il devenait nécessaire, pour que l’intox se fît, de faire taire leurs soupçons. C’est pour cela que Gonse, Henry, Deloye, demandèrent à Esterhazy « d’écrire sous leur dictée une offre de renseignements (le bordereau) […], laissant entendre que ses informations proviennent de l’État-Major par l’intermédiaire d’un officier félon infiltré dans les lieux » (p. 83-84). Et qui mieux que Dreyfus, alsacien, artilleur, juif, pourra incarner ce fournisseur (p. 84) ? Esterhazy se plia donc à la demande de ses chefs mais « Henry a exigé qu’[il] en recopie une deuxième afin d’en conserver le double, “pour mémoire”. » Pour ce faire, « Esterhazy utilise une technique habituelle à l’époque : un papier calque, aussi appelé papier pelure. C’est en fait ce double qui servira à la machination, et c’est son original, conservé par Henry, que l’on tiendra pour le bordereau annoté (faussement annoté) par Guillaume II, encore désigné sous les termes de « document libérateur » ou « bordereau impérial ». « Esterhazy était si intimement convaincu de la protection inconditionnelle de ses chefs, explique l’auteur, qu’il n’a même pas cherché à dissimuler son écriture de ce deuxième bordereau. Il est cependant très probable qu’il a contrefait son écriture sur le premier bordereau, croyant que seul ce dernier document – non sa copie – serait utilisé, et dans le secret des chancelleries uniquement » (p. 85). La chose est pour le moins bien compliquée et pose une véritable question. Comment cela aurait-il pu être possible puisqu’à en croire l’auteur le bordereau ne serait jamais parvenu à Schwartzkoppen, comme l’indique l’absence d’enveloppe, le fait qu’il n’ait pas été froissé, les déchirures pour le moins curieuses et, surtout, le fait que l’attaché militaire ait dit dans ses souvenirs ne pas l’avoir reçu (p. 86-87) ? Si le bordereau ne lui est pas parvenu, comment Schwartzkoppen aurait-il pu être intoxiqué ? Ce ne put donc être que le 10 novembre 1896, quand Schwartzkoppen découvrit Le Matin et le fac-simile du bordereau, que commença l’intox ? Et de même comment aurait-il pu être rassuré sur la provenance des informations d’Esterhazy ? Pour que cela fût, Esterhazy se devait absolument d’en informer Schwartzkoppen. Il est clair que lui rendant visite le 3 novembre 1894, après la diffusion de la nouvelle de l’arrestation d’un traître à l’État-major, il n’aurait certainement pas laissé passer cette occasion de « faire taire les soupçons ». Pourquoi alors Schwartzkoppen n’en dit-il pas le moindre mot dans ses Carnets ? Pourquoi n’y évoque-t-il pas les soupçons que lui prête M. Israël ? Comment put-il se contenter de noter « qu’interrogé sur l’arrestation de Dreyfus [Esterhazy] n’a pu m’en donner aucune explication[40] ». Mais la principale objection n’est pas là. Comment peut-on imaginer que Sandherr et Henry aient pu imaginer un stratagème si compliqué qui ne pouvait que les desservir et réellement, cette fois, discréditer Esterhazy ? Certes, Esterhazy avait donc un informateur infiltré à l’État-Major… mais il ne l’avait plus… il avait été arrêté, incarcéré et attendait son jugement… A moins, bien sûr, que toute cette mise en scène bien compliquée n’ait eu pour but que de faire passer le seul bordereau. Mais, et nous en revenons au point de départ, encore eût-il fallu que ce fameux bordereau arrivât entre les mains de Schwartzkoppen. Et cela M. Israël le conteste. Passons au « bordereau annoté ». Le montage est ingénieux mais ne tient pas plus. Sans s’attarder sur le « document libérateur » qui ne fut jamais le « bordereau annoté », il est difficile de croire à la possibilité d’un tel stratagème. Quelle complication et quelle épaisse bêtise que celle d’hommes qui voulant perdre Dreyfus gardent le document à l’écriture contrefaite (qui doit sans doute imiter son écriture) et livrent celle qui est de l’écriture « naturelle » d’Esterhazy !!! Et quelle drôle d’idée que d’utiliser du papier pelure dans le but de « doubler le plus précisément possible ce document » pour finalement ne pas le faire…
Mais le chef d’œuvre dans le domaine est assurément le second volume de cette année 2000, Les Vérités cachées de l’affaire Dreyfus, publié par Armand Israël[39]. En dehors de ce titre qui à lui seul est une promesse, le livre d’Armand Israël semble offrir toutes les garanties de la scientificité : un éditeur prestigieux, un préfacier directeur des Archives de la Préfecture de Police et une recherche menée, sous la direction de l’auteur, par « une équipe de chercheurs » et reposant sur « l’exploitation de fonds d’archives jusqu’alors inaccessibles » (quatrième de couverture). Pourtant, on est rapidement frappé par le nombre d’erreur de faits, de noms, de dates, de contradictions d’une page à l’autre qui en font une véritable moulinette de l’approximation. Sous la forme d’une histoire de l’événement, il aborde, pour les corriger, trois points essentiels : le bordereau, son origine et son histoire, la mort d’Henry dont il a en toute simplicité découvert l’identité de l’assassin et le pacte secret passé à l’époque du procès de Rennes entre la famille Dreyfus et le gouvernement. Commençons par le bordereau. Deloye, Boisdeffre et Gonse auraient mis au point un projet visant à protéger les secrets de conception du… nouveau 75. Pour ce faire, Gonse, aurait convoqué Sandherr qui, avec l’aide d’Henry et d’Esterhazy, auraient conçu un plan complexe dans le but d’intoxiquer les allemands. « La découverte d’une affaire d’espionnage d’une telle importance », auraient pensé Gonse et ses comparses, n’aurait pu que faire « du bruit et il suffira à l’État-major français de feindre une grande inquiétude pour que l’information présentée par le bordereau prenne une importance capitale aux yeux de l’Allemagne. Pendant que celle-ci se préoccupera du frein du 120, la France aura le champ libre pour fabriquer sa véritable arme secrète : le canon de 75 » (p. 80). Sandherr aurait donc envoyé Esterhazy chez Schwartzkoppen. Seulement, un problème de taille se serait rapidement posé. Comment en effet, nous explique l’auteur, un simple officier de troupes pouvait-il livrer des informations d’une telle importance (p. 83) ? Les attachés militaires, « au fil du temps » (un peu moins de deux mois !?), commençant à s’interroger, il devenait nécessaire, pour que l’intox se fît, de faire taire leurs soupçons. C’est pour cela que Gonse, Henry, Deloye, demandèrent à Esterhazy « d’écrire sous leur dictée une offre de renseignements (le bordereau) […], laissant entendre que ses informations proviennent de l’État-Major par l’intermédiaire d’un officier félon infiltré dans les lieux » (p. 83-84). Et qui mieux que Dreyfus, alsacien, artilleur, juif, pourra incarner ce fournisseur (p. 84) ? Esterhazy se plia donc à la demande de ses chefs mais « Henry a exigé qu’[il] en recopie une deuxième afin d’en conserver le double, “pour mémoire”. » Pour ce faire, « Esterhazy utilise une technique habituelle à l’époque : un papier calque, aussi appelé papier pelure. C’est en fait ce double qui servira à la machination, et c’est son original, conservé par Henry, que l’on tiendra pour le bordereau annoté (faussement annoté) par Guillaume II, encore désigné sous les termes de « document libérateur » ou « bordereau impérial ». « Esterhazy était si intimement convaincu de la protection inconditionnelle de ses chefs, explique l’auteur, qu’il n’a même pas cherché à dissimuler son écriture de ce deuxième bordereau. Il est cependant très probable qu’il a contrefait son écriture sur le premier bordereau, croyant que seul ce dernier document – non sa copie – serait utilisé, et dans le secret des chancelleries uniquement » (p. 85). La chose est pour le moins bien compliquée et pose une véritable question. Comment cela aurait-il pu être possible puisqu’à en croire l’auteur le bordereau ne serait jamais parvenu à Schwartzkoppen, comme l’indique l’absence d’enveloppe, le fait qu’il n’ait pas été froissé, les déchirures pour le moins curieuses et, surtout, le fait que l’attaché militaire ait dit dans ses souvenirs ne pas l’avoir reçu (p. 86-87) ? Si le bordereau ne lui est pas parvenu, comment Schwartzkoppen aurait-il pu être intoxiqué ? Ce ne put donc être que le 10 novembre 1896, quand Schwartzkoppen découvrit Le Matin et le fac-simile du bordereau, que commença l’intox ? Et de même comment aurait-il pu être rassuré sur la provenance des informations d’Esterhazy ? Pour que cela fût, Esterhazy se devait absolument d’en informer Schwartzkoppen. Il est clair que lui rendant visite le 3 novembre 1894, après la diffusion de la nouvelle de l’arrestation d’un traître à l’État-major, il n’aurait certainement pas laissé passer cette occasion de « faire taire les soupçons ». Pourquoi alors Schwartzkoppen n’en dit-il pas le moindre mot dans ses Carnets ? Pourquoi n’y évoque-t-il pas les soupçons que lui prête M. Israël ? Comment put-il se contenter de noter « qu’interrogé sur l’arrestation de Dreyfus [Esterhazy] n’a pu m’en donner aucune explication[40] ». Mais la principale objection n’est pas là. Comment peut-on imaginer que Sandherr et Henry aient pu imaginer un stratagème si compliqué qui ne pouvait que les desservir et réellement, cette fois, discréditer Esterhazy ? Certes, Esterhazy avait donc un informateur infiltré à l’État-Major… mais il ne l’avait plus… il avait été arrêté, incarcéré et attendait son jugement… A moins, bien sûr, que toute cette mise en scène bien compliquée n’ait eu pour but que de faire passer le seul bordereau. Mais, et nous en revenons au point de départ, encore eût-il fallu que ce fameux bordereau arrivât entre les mains de Schwartzkoppen. Et cela M. Israël le conteste. Passons au « bordereau annoté ». Le montage est ingénieux mais ne tient pas plus. Sans s’attarder sur le « document libérateur » qui ne fut jamais le « bordereau annoté », il est difficile de croire à la possibilité d’un tel stratagème. Quelle complication et quelle épaisse bêtise que celle d’hommes qui voulant perdre Dreyfus gardent le document à l’écriture contrefaite (qui doit sans doute imiter son écriture) et livrent celle qui est de l’écriture « naturelle » d’Esterhazy !!! Et quelle drôle d’idée que d’utiliser du papier pelure dans le but de « doubler le plus précisément possible ce document » pour finalement ne pas le faire…
Tout cela est ridicule, certes. Mais voyons quand même les preuves avancées par l’auteur. La première tient au vocabulaire et n’a que pour but de prouver qu’Henry en est le scripteur. Lisons : « Seul un homme peu cultivé comme Henry a pu commettre ces incorrections. C’est notamment le signe que Sandherr, homme de lettres brillant [ce qui mériterait une explication], n’a pas participé à la rédaction même s’il l’a inspirée. Sans doute s’est-il contenté de préparer le texte dicté par Henry, sans en corriger le vocabulaire qui, pensait-il, ne choquerait pas de la part d’un Alsacien comme Dreyfus. » (p. 86-87) Nous touchons là au comique. Les Alsaciens, à l’époque comme aujourd’hui, parlent parfaitement français et cela surtout quand ils sont polytechniciens. Il est douteux, d’autre part, que Sandherr, lui-même Alsacien – et pourtant présenté comme un « homme de lettres brillant » –, ait pu se dire une chose pareille. Mais passons. La deuxième et la troisième preuves sont sérieuses, qualifiées d’« indiscutables » (p. 92). Henry ayant découvert le bordereau en premier et connaissant Esterhazy depuis vingt ans, il aurait pu, reconnaissant l’écriture de son ami, le détruire. Sans doute, mais à condition que les deux anciens collègues soient restés en relations après 1880, ce qui reste à prouver. L’autre preuve, tout aussi « indiscutable », est plus sérieuse et nous permet de comprendre la méthode. M. Israël cite un rapport de police signé de l’agent Flor qui précise que « Le seul traître de l’État-Major était Henry ayant pour agent Esterhazy et Lemercier-Picard, chargés des communications avec Schwartzkoppen. […] le bordereau fut écrit par Esterhazy agissant par intermédiaire […] sous ordre de Sandherr » (p. 92). Nous savons ce que valent les rapports de police et qu’il faut toujours les prendre avec précaution. Mais surtout, si on veut leur donner quelque crédit, encore faut-il les lire avec attention et les citer en en respectant le texte. En effet, quand on regarde l’original – reproduit en fac-similé ! –, on lit :
Observer assure seul traître état major fut Henry ayant pour agent Esterhazy et Lemercier-Picard chargés des communications avec Schwartzkoppen Bordereau accompagne pièces livrées par Esterhazy il fut écrit par Esterhazy, agissant par intermédiaire et trouvé chez Schwarzkoppen par un agent français qui le porta à commandant Cordier sous ordre de Sandherr. (p. 92)
Passons sur la mauvaise transcription pour nous intéresser aux coupures opérées dans le texte. Le premier mot, « Observer », manque. Il est le titre du périodique anglais. Voilà déjà qui écroule la preuve : le rapport révélateur n’est qu’une vulgaire note de lecture… De plus, la seconde coupe donne un tout autre sens au texte. Disparaît non seulement le fait qu’il fut « trouvé chez Schwartzkoppen », ce qui contredirait la thèse du bordereau jamais sorti de la Section de Statistique, mais encore la phrase relative à Cordier, qui, dans l’original indique juste que Cordier était sous les ordres directs de Sandherr (« qui le porta à commandant Cordier sous ordre de Sandherr »), devient ici la preuve de la participation de Sandherr au complot (« le bordereau fut écrit par Esterhazy agissant par intermédiaire […] sous ordre de Sandherr »).
Concernant le deuxième point, la mort d’Henry, l’auteur a trouvé son assassin : Cesti, que nous avons rencontré auparavant. L’auteur a retrouvé aux archives de la Préfecture de Police un rapport selon lequel un tout à fait obscur régisseur de théâtre affirmait « avoir les preuves que le lieutenant-colonel Henry a été assassiné par Lionel de Cesti » (p. 256 et 257). La preuve est maigre et nous savons, quitte à nous répéter, ce que vaut ce genre de document. Si on devait en croire les rapports de police, Dreyfus aurait été joueur, aurait collectionné les maîtresses, aurait fréquenté des officiers allemands en Belgique, le Syndicat dirigé d’Allemagne aurait existé et distribué des millions à poignées, les dreyfusards auraient été les salariés d’une cause à laquelle ils ne croyaient pas, ou, pour citer un rapport qui se trouve aux Archives nationales, Picquart descendrait « d’un juif du Palatinat nommé Spitzer (traduction : qui pique) », Bernard Lazare serait « un ancien rabbin de Koenigsberg », Zola descendrait « d’un juif dalmate, émigré à Venise »[41], etc. Que Cesti soit mentionné dans un rapport de police ne prouve donc pas grand-chose. Qu’il fut un escroc, qu’il eut des rapports avec Drumont, qu’il fut interrogé par Laurent-Atthalin et que son dossier à la Préfecture de Police soit curieusement vide entre 1898 et 1917 (p. 257-270) n’y ajoute rien. Pourtant il y avait bien une solution pour être définitivement fixé. L’auteur nous la révèle : « […] il nous manquait malgré tout un maillon pour reconstituer la chaîne de nos déductions : il fallait rechercher si une quelconque relation avait pu exister entre Cesti et les grands acteurs de l’Affaire […]. » Et il ajoute : « Cette démarche nous a semblé vouée à l’échec jusqu’à ce que nous découvrions un interrogatoire mené par le général de Pellieux, chargé de l’enquête sur Esterhazy, dans lequel Cesti raconte qu’il a tenté de piéger Mathieu Dreyfus sur ordre de la Section de Statistique » (p. 270). Cesti agent d’Henry… Et l’auteur souligne et donne en note une référence : « Cassation V. II, p. 101, interrogatoire du 25 novembre 1897 ». Et un peu plus loin : « […] Selon Esterhazy, c’est Henry lui-même qui a envoyé Cesti dans la famille Dreyfus » ; et en note une nouvelle référence : Reinach V. III, p. 103. » Et de conclure : « […] Cesti, homme de main de l’État-Major, de la Section de Statistique et de tous ceux qui le payaient, a, sur ordre, assassiné Henry et tenté de maquiller le crime en suicide. » (p. 270). Reconstituons la méthode. Si nous ouvrons le Reinach aux références données, nous pouvons lire que « […] c’était Henry qui avait envoyé cet aventurier [Cesti] aux Dreyfus ». En note, une référence : « Voir t. II, p. 183 ». Si on s’y reporte, on peut lire que « Mathieu avait supposé que Cesti lui était envoyé, par le bureau des Renseignements, pour lui tendre quelque piège ». Ici une nouvelle note qui dit que « Cesti raconta sa tentative à Henry, qui en informa Esterhazy ; celui-ci en parla à Pellieux ». (cass., II, 101, interrogatoire du 25 novembre 1897) ». L’auteur peut donc écrire avoir découvert « un interrogatoire mené par le général Pellieux, chargé de l’enquête sur Esterhazy, dans lequel Cesti raconte qu’il a tenté de piéger Mathieu Dreyfus sur ordre de la Section de Statistique » et, sans vérification, reproduire la note de Reinach. Et c’est là qu’apparaît le problème de méthode qui fait de ce livre, dont les bonnes intentions sont incontestables, un bien curieux travail. Si l’auteur était allé à la source qu’il indique, la source Pellieux, il aurait pu lire : « […] l’un des agents les plus actifs dans les bas-fonds du syndicat, est le nommé Cesti, compromis dans les affaires Lebaudy. […] Il a eu, il y a quelques temps, un dossier Dreyfus entre les mains, qu’il a fait copier, à la machine à écrire, par une dactylographe, dont je saurai bientôt le nom. Il a eu aussi, entre les mains, une série de lettres soi-disant à moi adressées par une espionne, de différents points de la frontière. » La déposition n’est donc pas de Cesti, mais d’Esterhazy et, surtout, Cesti y est présenté non comme un « agent de la Section de Statistique » mais comme un allié des Dreyfus. Et quant à l’instruction Pellieux, consultable aux Archives nationales, elle ne contient pas la moindre déposition de Cesti… et pour cause… La boucle que l’auteur annonçait « bouclée » se déboucle.
Quant au troisième point, le pacte entre le gouvernement et la famille Dreyfus, il est le suivant. Pour satisfaire l’armée et permettre à l’innocent de ne pas rester en prison, Waldeck-Rousseau va « convaincre Alfred Dreyfus de se reconnaître coupable en échange de sa grâce » (p. 318).
Alfred Dreyfus, d’abord réticent à cette idée, n’a accepté cette solution que pour sauver l’Armée. A ses yeux, l’honneur de l’Armée française compte plus que le sien.
Par dévouement à sa patrie, Alfred Dreyfus taira même toute sa vie l’existence de ce pacte, sans jamais répondre à ceux qui trouvaient inacceptable son silence. (p. 321).
Pour soutenir l’insoutenable, l’auteur se fonde sur les « archives de Maître Labori », intitulées en note : “Notes manuscrites” de Labori, recueillies par sa femme Marguerite » (p. 322) et données dans la section « Les archives » de la bibliographie (p. 489). On n’aura compris qu’il ne s’agit pas d’archives, ici, mais de l’ouvrage de Marguerite-Fernand Labori[42] qui, curieusement, manque dans la partie « Sources bibliographiques ». Ce sont sans doute là « les fonds d’archives jusqu’alors inaccessibles » annoncés par le quatrième de couverture[43]… Est-il nécessaire de préciser les problèmes que posent l’ouvrage de Marguerite-Fernand Labori[44] et donc sur la thèse qu’il défend et qui est reprise ici, en toute tranquillité, sans recul ni esprit critique ?
 En 2008, ce fut au tour de Franck Ferrand de nous donner son point de vue sur l’Affaire dans son Histoire interdite. Révélations sur l’histoire de France[45]. En 30 pages qui accumulent les approximations, les erreurs et les naïvetés (on notera le superbe : « cette pièce prendra le nom de faux Henry, ce qui nous en dit long, déjà, sur son authenticité…), il reprenait la thèse du troisième homme, occasion de fustiger la « vulgate » de « l’histoire officielle ». Passons.
En 2008, ce fut au tour de Franck Ferrand de nous donner son point de vue sur l’Affaire dans son Histoire interdite. Révélations sur l’histoire de France[45]. En 30 pages qui accumulent les approximations, les erreurs et les naïvetés (on notera le superbe : « cette pièce prendra le nom de faux Henry, ce qui nous en dit long, déjà, sur son authenticité…), il reprenait la thèse du troisième homme, occasion de fustiger la « vulgate » de « l’histoire officielle ». Passons.
Tous ces ouvrages, qui procèdent – nous voulons le croire – de louables intentions, posent toutefois de sérieux problèmes. Le premier, on l’a vu, est un problème de méthode. Le recours aux sources secondaires, voire aux sources de seconde main, ne peut permettre d’avoir une lecture claire, et surtout une lecture exacte, de l’Affaire et ouvre la porte à toutes les interprétations dont le principal défaut est de ne reposer sur rien d’autre que sur la capacité d’imagination de celui qui écrit. On ne peut travailler sur l’Affaire en faisant l’économie d’un sérieux travail archivistique et sans avoir au moins lu la totalité des procédures au cours desquelles les différents acteurs s’exprimèrent, se contredirent, se corrigèrent, etc. Le deuxième problème est un problème de parti pris qui dépasse très largement la question historienne stricto sensu. Le ton péremptoire qui caractérise tous ces travaux, la grille de lecture mise en place et dans laquelle tout doit entrer, quitte à en étirer ce qui est trop court, à en couper ce qui dépasse – une manière d’écrire l’histoire comme Procuste concevait l’hospitalité qu’il offrait à ceux qu’il rencontrait sur son chemin –, relève d’une simple question d’honnêteté intellectuelle. Enfin, le troisième problème, qui est plus sérieux celui-là, est que cette nécessité de trouver d’autres raisons que le simple engrenage fatal de l’erreur devenu crime pour ne pas se dédire, que cette manie de l’intox, du sacrifice volontaire, etc., constitue une manière de légitimation de la politique de l’État-major[46], pire même une proclamation d’innocence qui n’est jamais qu’une nouvelle forme, d’une manière douce et recevable dans le propos, de la défense antidreyfusarde de la raison d’État. On ne remet plus en question l’innocence de Dreyfus mais on continue d’excuser le crime dont il fut victime par des « raisons supérieures » face auxquelles les libertés individuelles ne pouvaient, ne peuvent et ne pourront jamais avoir de poids.
Philippe oriol
[1] Georges Sorel, La Révolution dreyfusienne, Paris, Librairie des sciences politiques et sociales Marcel Rivière, 1909, p. 9.
[2] Vincent Duclert, Alfred Dreyfus. L’honneur d’un patriote, Paris, Fayard, 2006, p. 999.
[3] A propos de l’arrêt de 1906 : « En fuyant les débats, Dreyfus semblait, une seconde fois, se reconnaître coupable ! » (p. 197).
[4] Lettre d’Esterhazy à Carrière du 6 août 1899 publiée dans La Révision du Procès de Rennes. Enquête de la Chambre criminelle de la Cour de cassation (5 mars 1904-19 novembre 1904), 3 vol., Paris, Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen, 1908, t. III, p. 681.
[5] Les Carnets de Schwartzkoppen (la vérité sur Dreyfus), Paris, Rieder, 1930, p. 5.
[6] Déposition Du Paty à l’occasion de la seconde révision dans La Révision du Procès de Rennes. Enquête de la Chambre criminelle de la Cour de cassation (5 mars 1904-19 novembre 1904), op. cit., t. II, p. 720-721.
[7] Lettre de Berthe Henry à Charpentier du 15 décembre 1935 citée dans Armand Charpentier, Les Côtés mystérieux de l’affaire Dreyfus, op. cit., p. 139. Voir aussi la lettre du 2 juin, p. 136.
[8] Déposition Wattinne dans La Révision du Procès de Rennes. Enquête de la Chambre criminelle de la Cour de cassation (5 mars 1904-19 novembre 1904), op. cit., t. II, p. 605-606.
[9] Publié l’année suivante chez Calmann-Lévy.
[10] Armand Charpentier, Les Côtés mystérieux de l’affaire Dreyfus, op. cit., p. 180-214.
[11] Ibid., p. 207, note 1.
[12] Déposition Picquart dans L’Affaire Dreyfus. Le Procès Zola devant la Cour d’Assises de la Seine et la Cour de Cassation (7 février-23 février – 31 mars-2 avril 1898. Compte rendu sténographique « in extenso », Paris, Stock, 1998, p. 346-347.
[13] Articles reproduits p. 267-271 du livre de Charpentier.
[14] « La Déposition d’Esterhazy devant le Consul général de France à Londres. Texte publié par “L’Indépendance belge” » dans Commandant Esterhazy. Dépositions et explications complètes, Bruxelles, G. Fischlin, 1901, p. 101.
[15] « Note » de Walter du 7 mai 1903, AN BB19 75.
[16] Il enseignant de voir sur les rabats de la jaquette un argus du livre de Paléologue…
[17] Maurice Paléologue, Journal de l’affaire Dreyfus,Paris, Plon, 1955, p. 271.
[18] Est-ce à lui que pensait Paléologue, comme nous l’indiquerait Legrand-Girarde (Un quart de siècle au service de la France, Paris, Presses Littéraires de France, 1954, p. 461) qui note en 1904 cette conviction des Affaire étrangères ? Une conviction qu’il qualifie de « haut délire, ou alors… » Ou pensait-il à Saussier, comme l’aurait confirmé son « hréritière » (Michel de Lombarès, L’Affaire Dreyfus. La Clé du mystère, Paris, Robert Laffont, Les ombres de l’histoire, 1972, p. 12-13).
[19] On la trouve aux pages 67-69.
[20] P. 113.
[21] Maurice Paléologue, Journal de l’Affaire Dreyfus, op. cit., p. 29.
[22] Sur ce fait, peu connu, voir notre Histoire de l’Affaire Dreyfus à paraître en 2013 aux Belles Lettres.
[23] Michel de Lombarès, L’Affaire Dreyfus. La Clé du mystère, Paris, Robert Laffont, Les ombres de l’histoire, 1972. La thèse exposée dans ce livre était la reprise très largement augmentée d’un article, « L’Affaire Dreyfus. Aperçu général. Aperçus nouveaux », publié dans la Revue de Défense nationale, juillet 1969, p. 1125-1143.
[24] Maurice Baumont, Aux sources de l’Affaire Dreyfus. L’Affaire Dreyfus d’après les archives diplomatiques, Paris, Les Productions de Paris, 1959, p. 22-23.
[25] Les Carnets de Schwartzkoppen (la vérité sur Dreyfus), op. cit., p. 19.
[26] Michel de Lombarès, L’Affaire Dreyfus, Paris/Limoges, Lavauzelle, 1985.
[27] Cf. supra, p. ???????????
[28] Mathieu Dreyfus, L’Affaire telle que je l’ai vécue, Paris, Grasset, 1978, p. 50.
[29] Jean Cherasse et Patrice Boussel, Dreyfus ou l’intolérable vérité, Paris, Pygmalion, 1975.
[30] Vincent Duclert, Dreyfus au Panthéon. Voyage au cœur de la République, op. cit., p. 275.
[31] Max Guermann, « La “terrible” vérité », Les Cahiers naturalistes, n° 62, 1988, p. 35-57.
[32] Ida-Marie Frandon, L’Affaire et le grand secret. Le Capitaine Dreyfus ou l’épopée du 75, Fontainebleau, L’Auteur, 1993.
[33] Dans notre Histoire de l’affaire Dreyfus, op. cit., p. 301-303.
[34] Jean Doise, Un secret bien gardé. Histoire militaire de l’affaire Dreyfus, Paris, Seuil, 1994.
[35] Voir à ce sujet l’excellent et salutaire article de Vincent Duclert, « L’Affaire Dreyfus et le tournant critique », Annales. Histoire, Sciences sociales, 50e année, n° 3, 1995, p. 563-578.
[36] Jean-François Deniau, Le Bureau des secrets perdus, Paris, Odile Jacob, 2000, p. 17-72.
[37] Lettre de Dreyfus au Président de la République du 5 octobre 1897 (lettre dont une copie figurait sous le numéro 106 dans le dossier secret : « Dossier secret Dreyfus », AN BB19 118 et MAHJ, 97.17.61.1. Il en existe aussi une copie dans les papiers Esterhazy conservées à la BNF, n.a.fr. 16464).
[38] Lettre de Dreyfus au Président de la République du 8 juillet 1897, dans Alfred Dreyfus, Cinq années de ma vie, op. cit., p. 228. Citée dans La Révision du procès Dreyfus. Débats de la Cour de cassation, op. cit., p. 324. Sur cette question du « pacte », voir notre Histoire de l’affaire Dreyfus, op. cit., p. 298-308.
[39] Armand Israël, Les Vérités cachées de l’affaire Dreyfus, Paris, Albin Michel, 2000.
[40] Les Carnets de Schwartzkoppen (la vérité sur Dreyfus), op. cit., p. 127.
[41] « Information du 20 février 1898 », AN BB19 114.
[42] Marguerite-Fernand Labori, Labori. Ses notes manuscrites. Sa vie, Paris/Neuchatel, Éditions Victor Attinger, 1947.
[43] Encore les « Archives juives » qui sont la revue du même nom publiée par Liana Lévi.
[44] Nous reviendrons longuement sur cette question dans notre Histoire à paraître.
[45] Franck Ferrand, L’Histoire interdite. Révélations sur l’histoire de France, Paris, Tallandier, 2008.
[46] Vincent Duclert, « L’Affaire Dreyfus et le tournant critique », Annales. Histoire, Sciences sociales, 50e année, n° 3, 1995, p. 563-578.