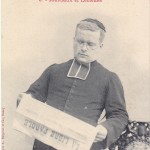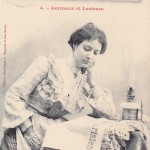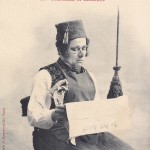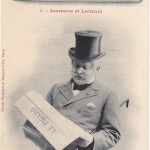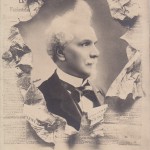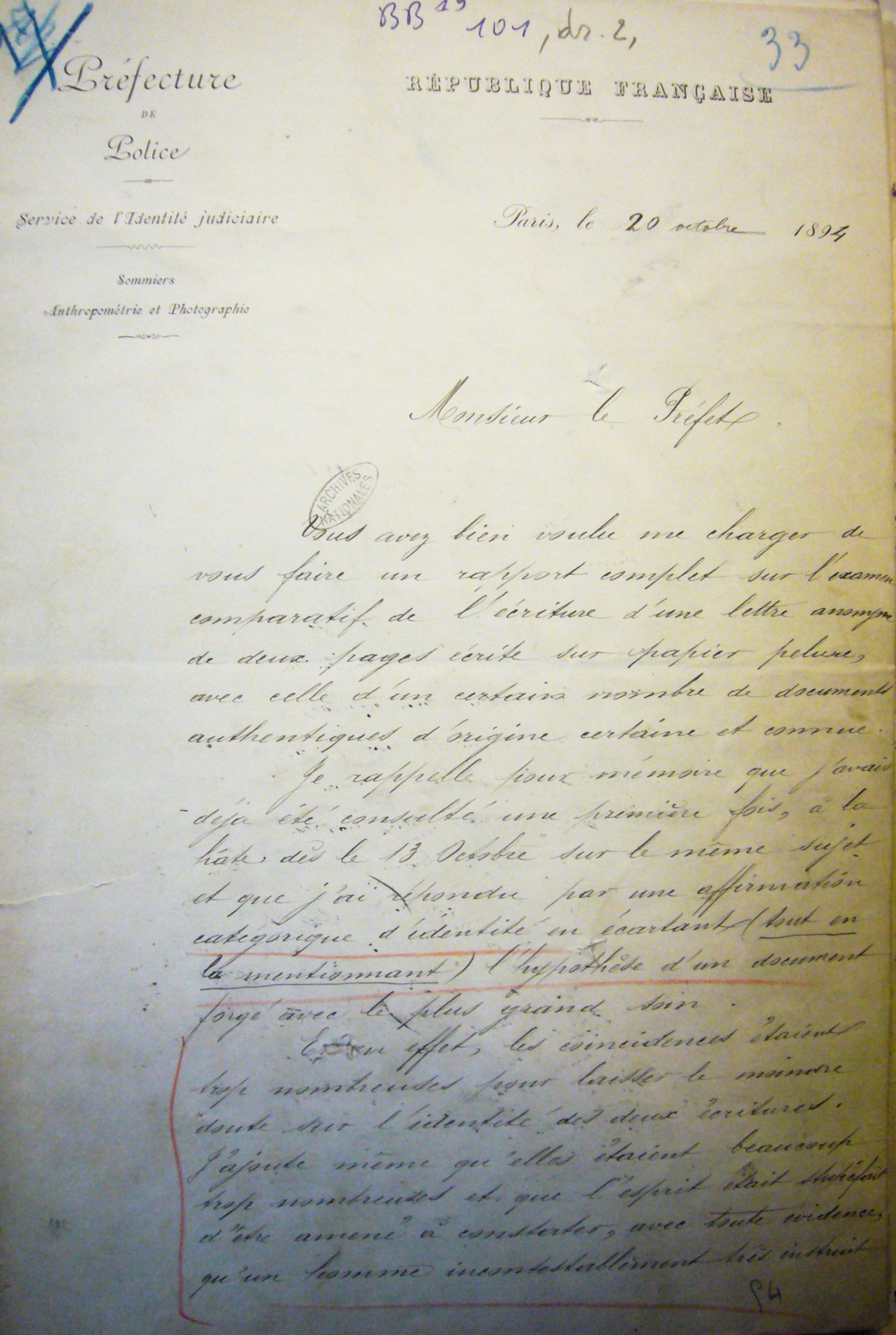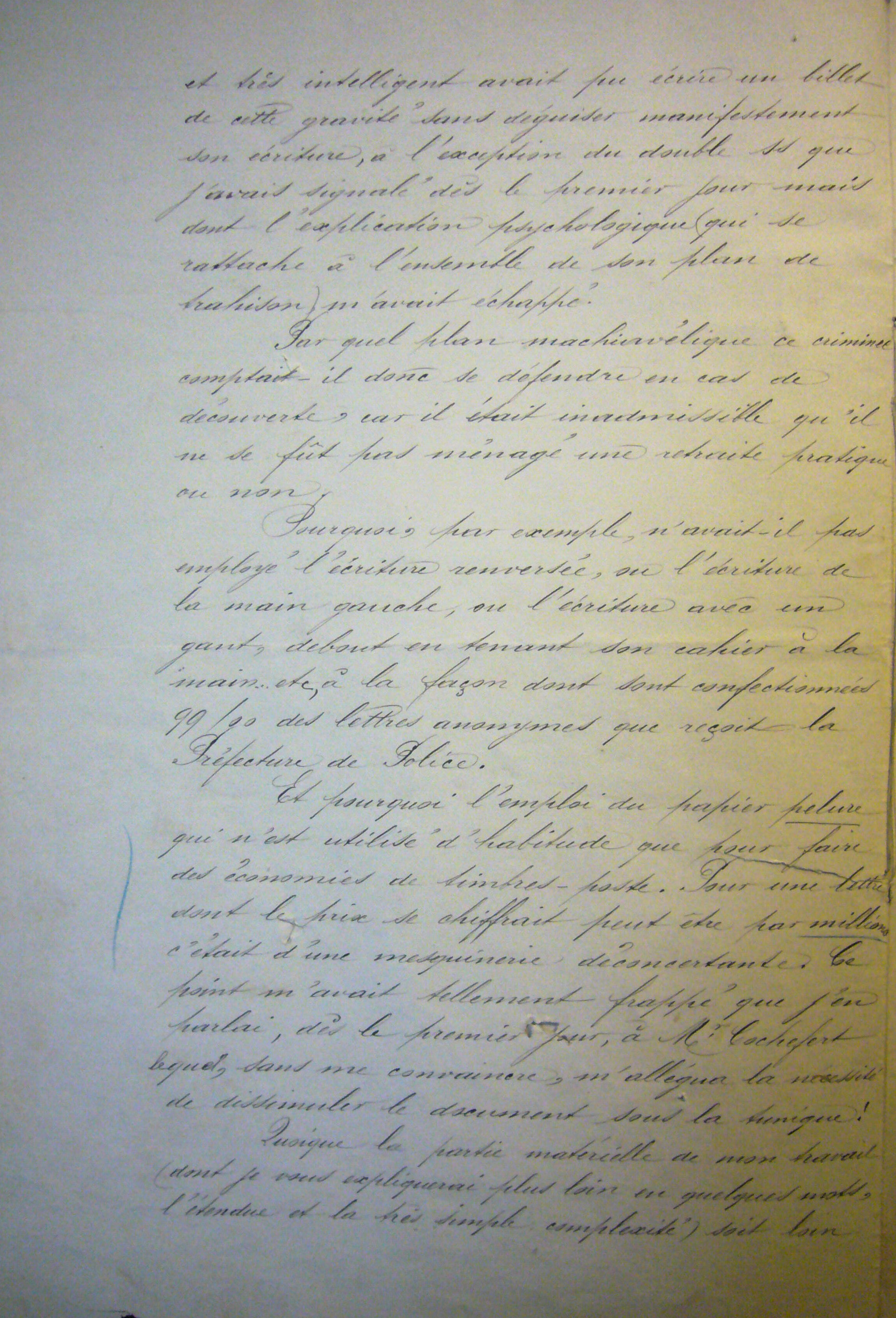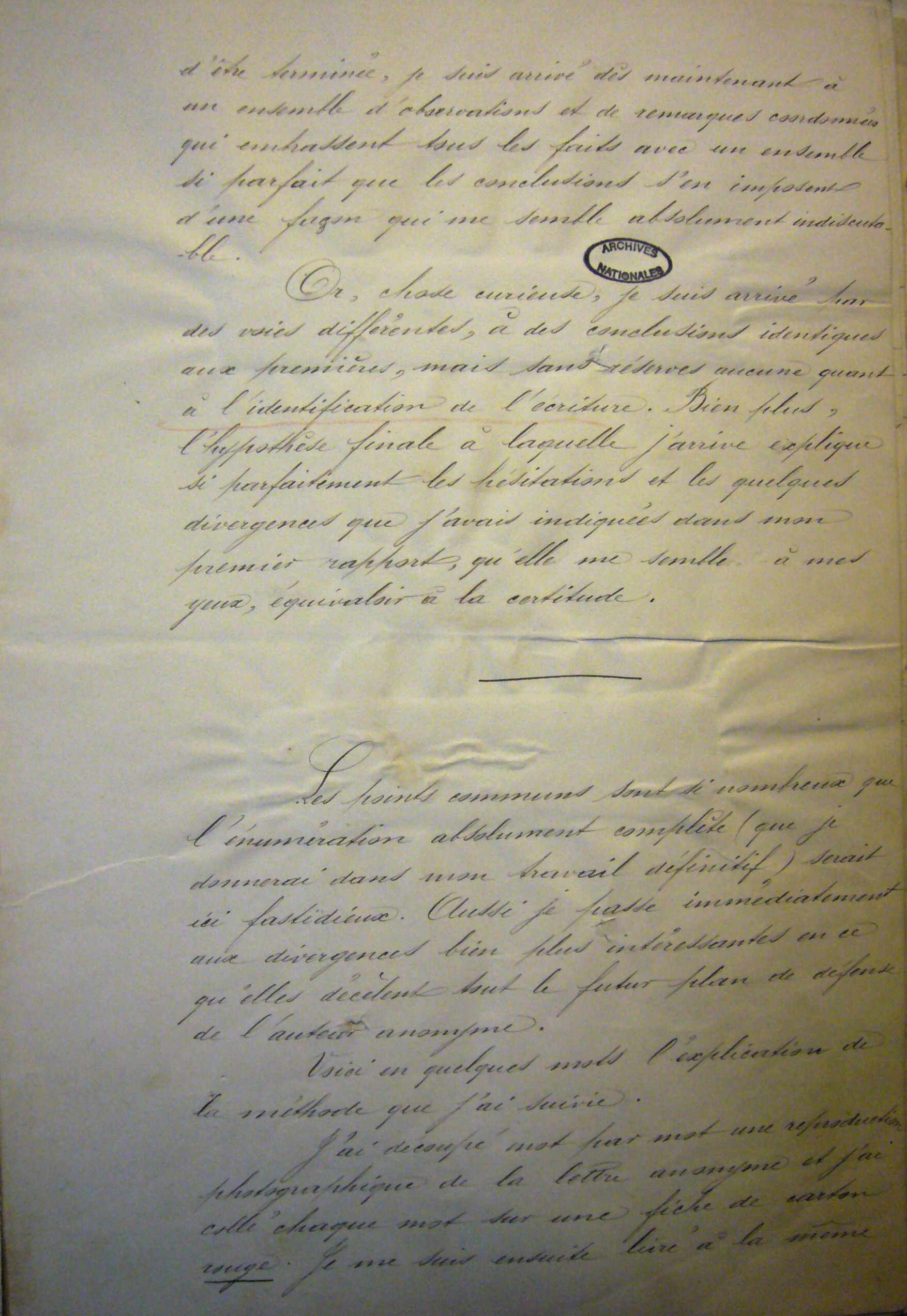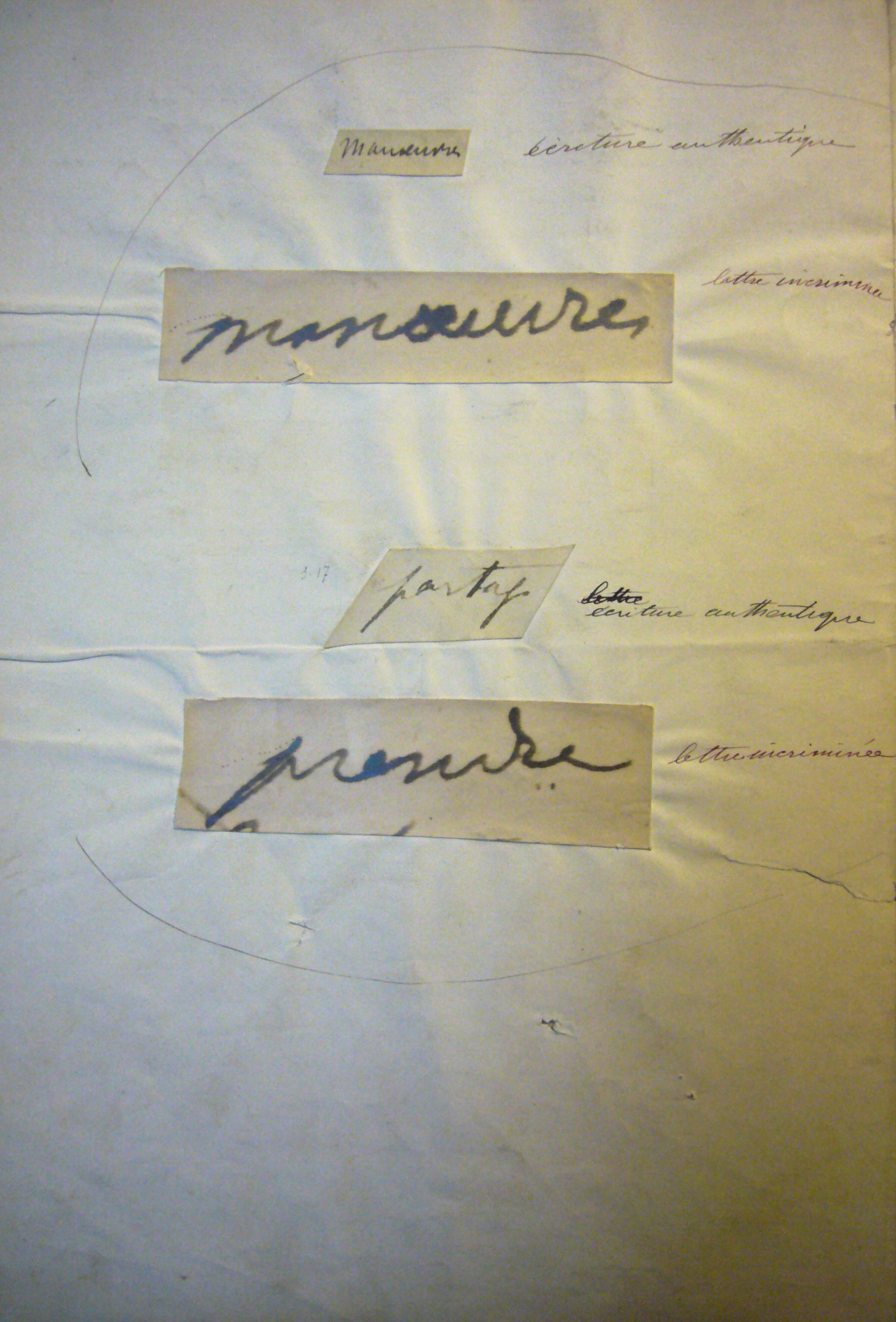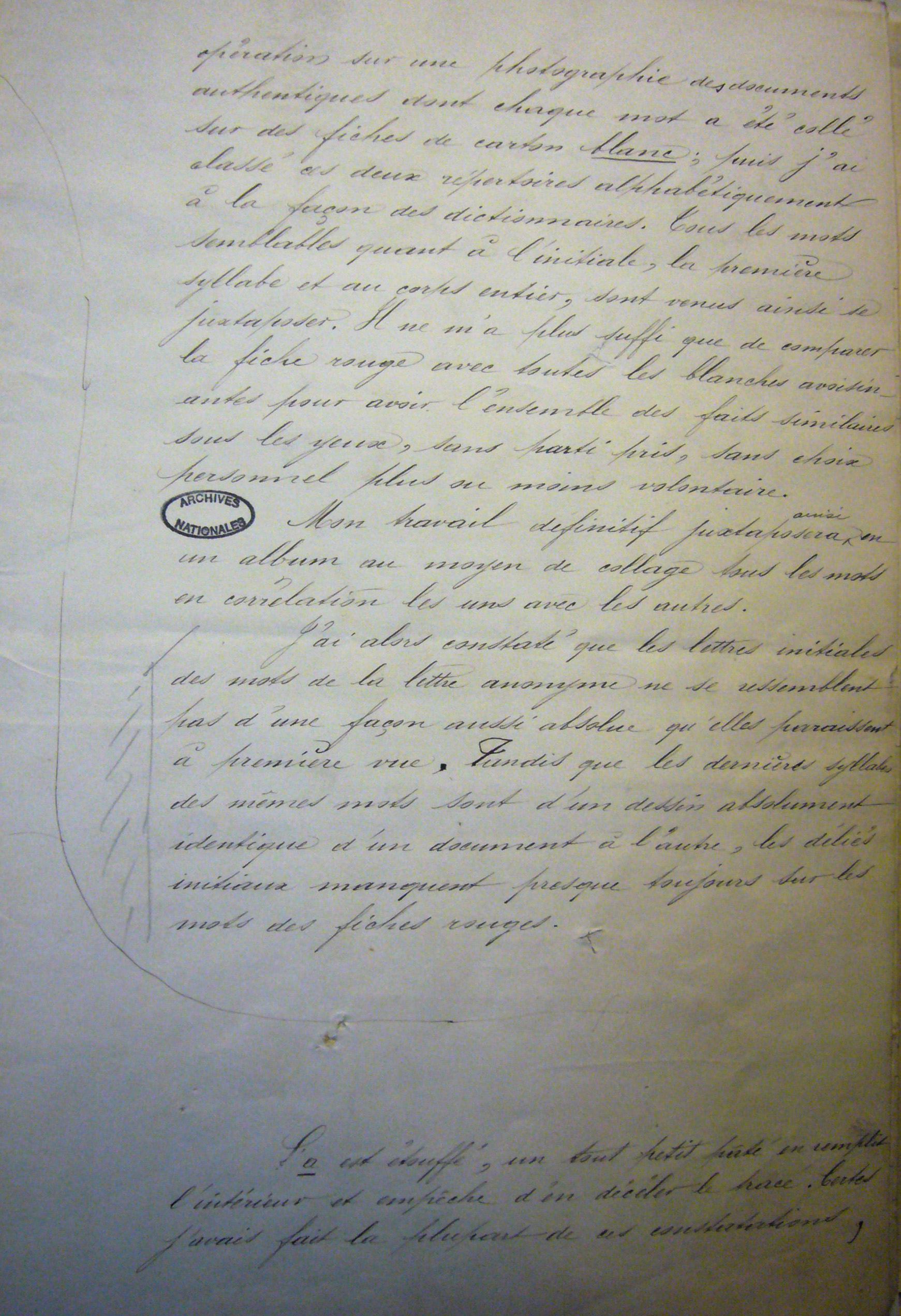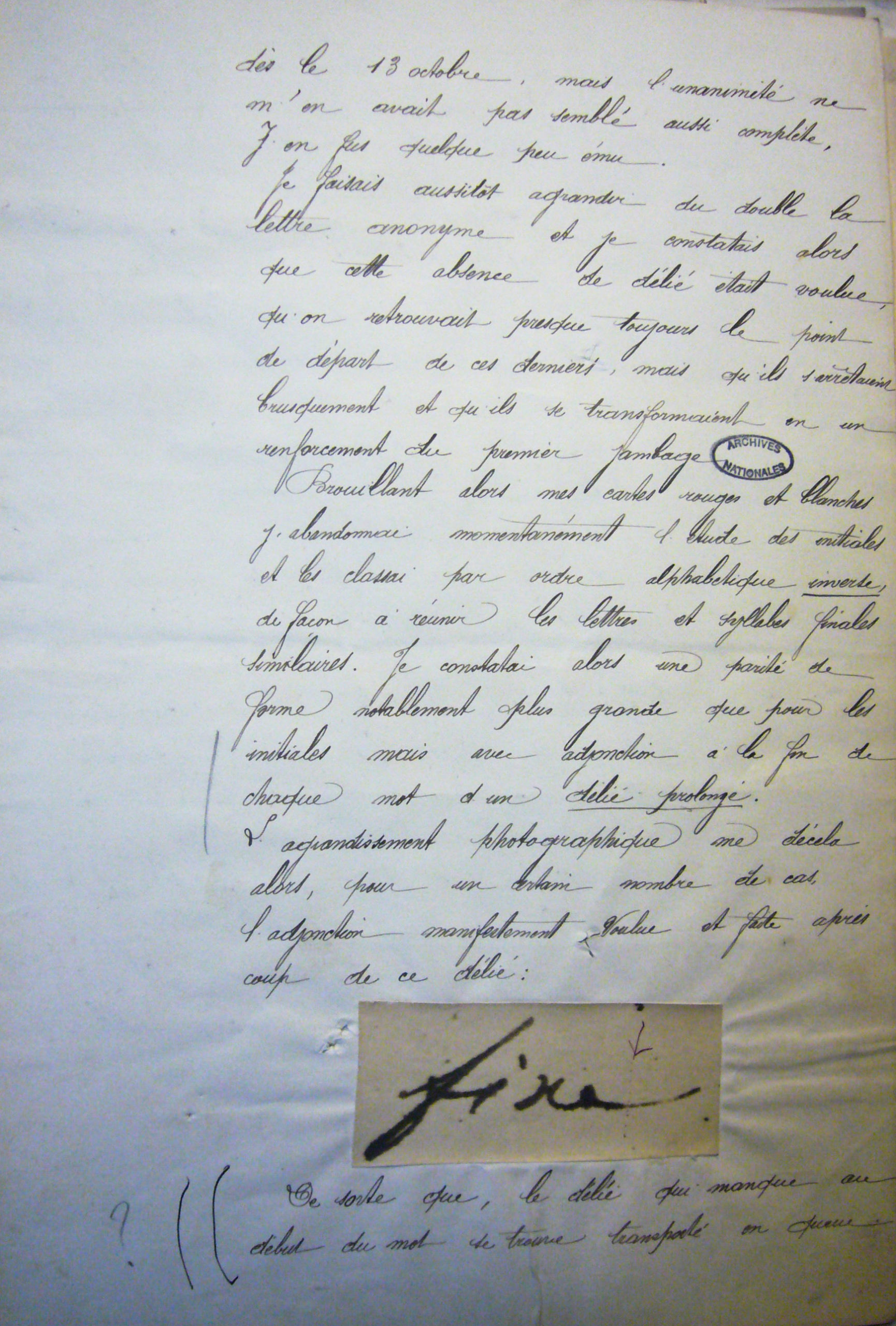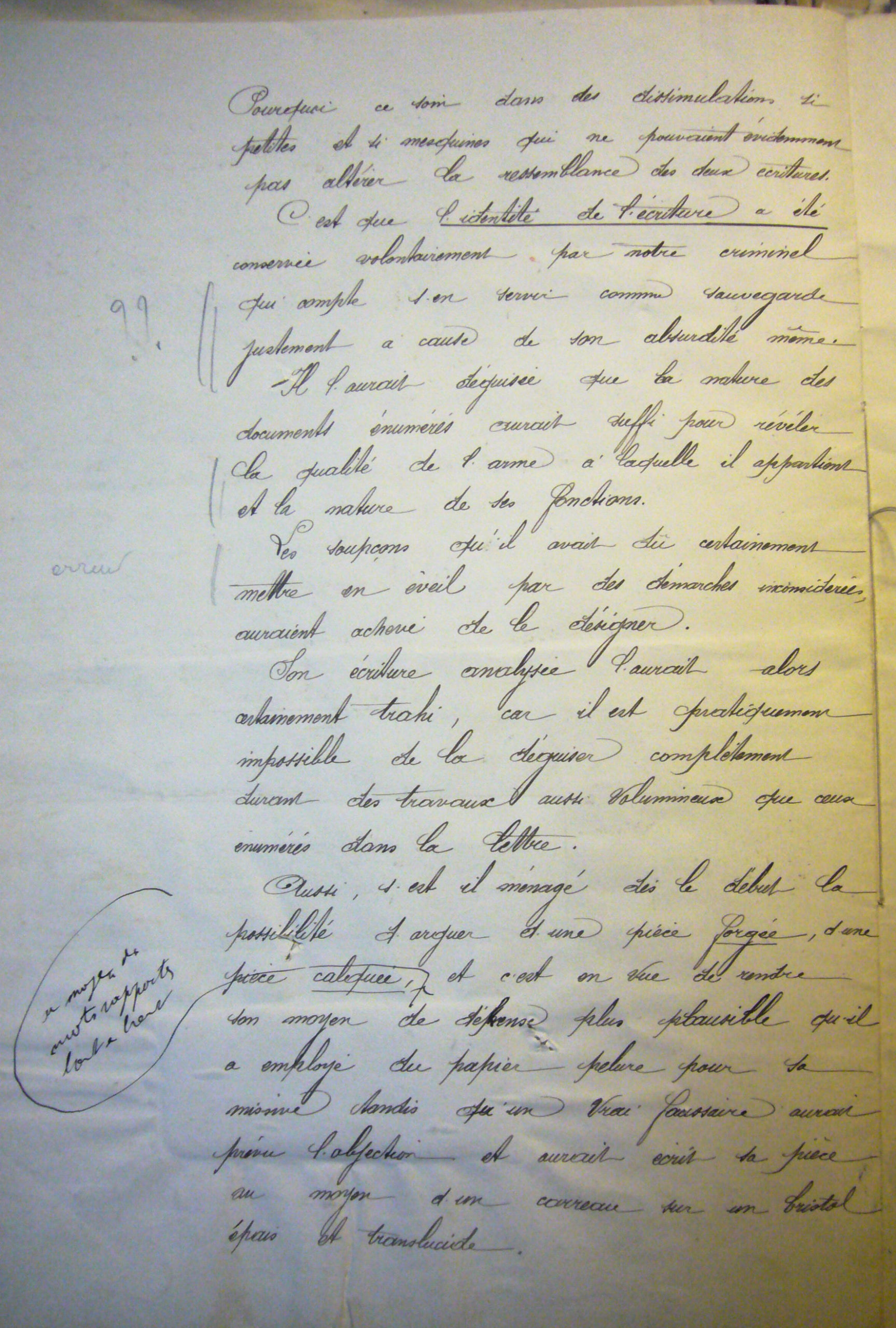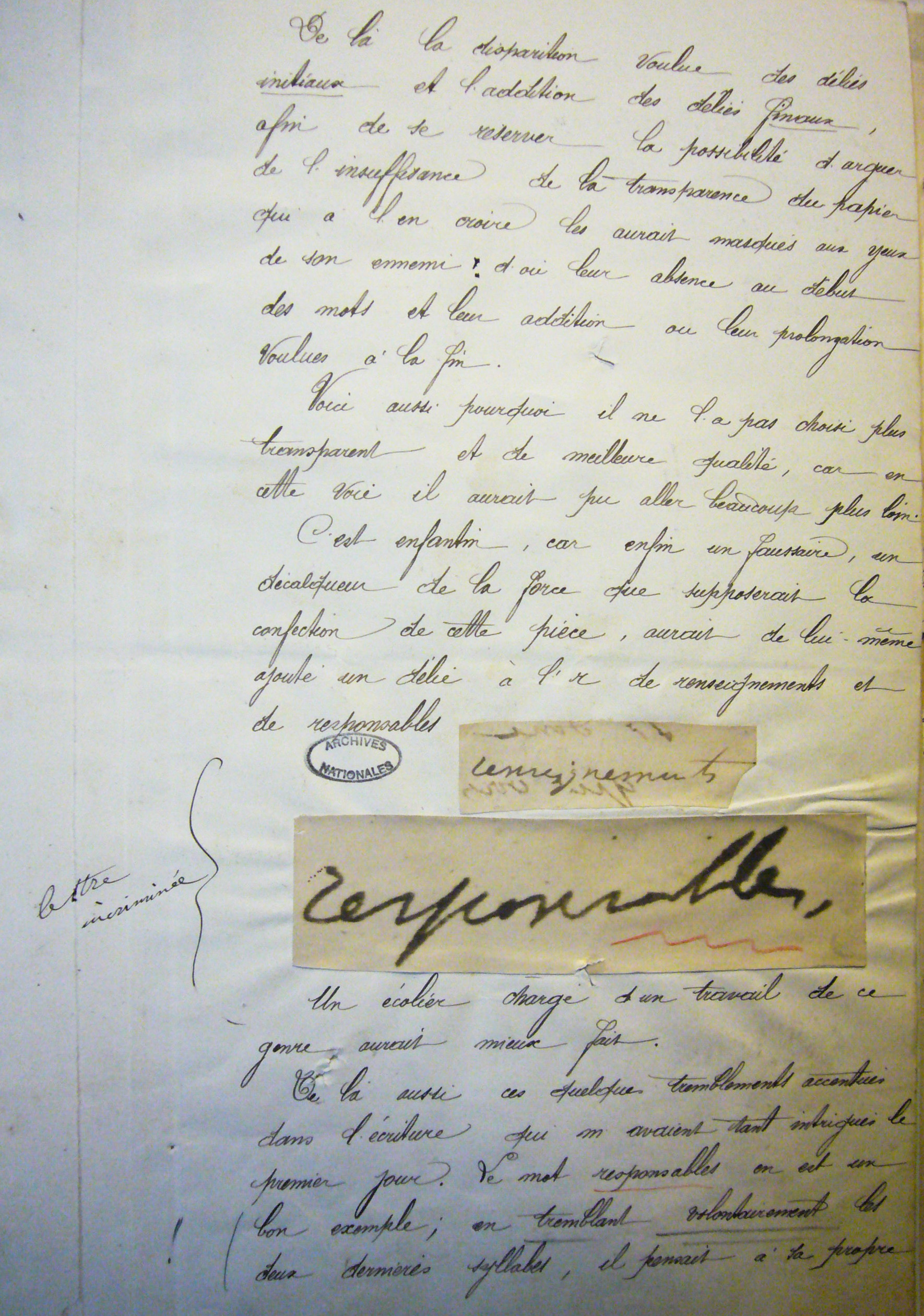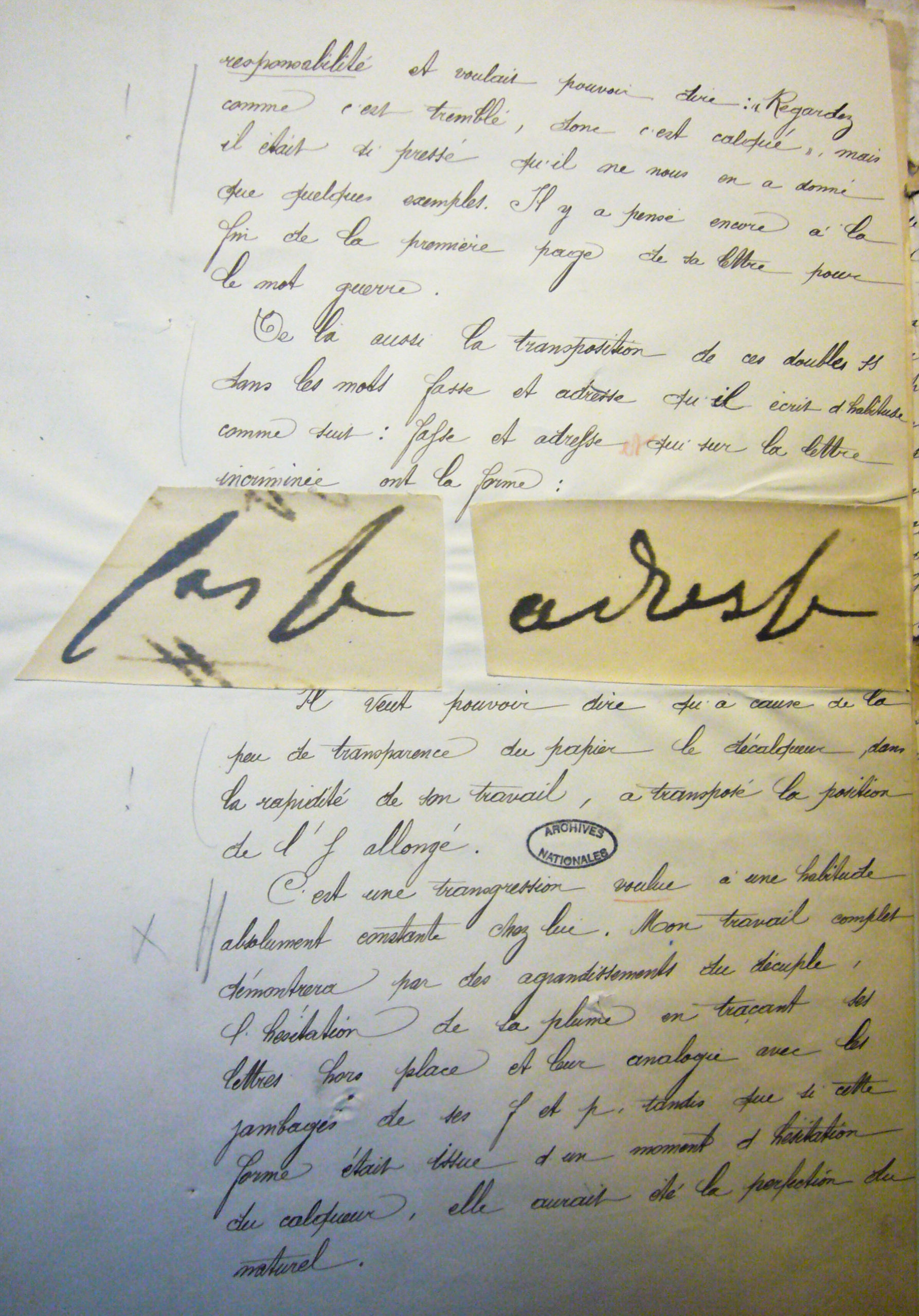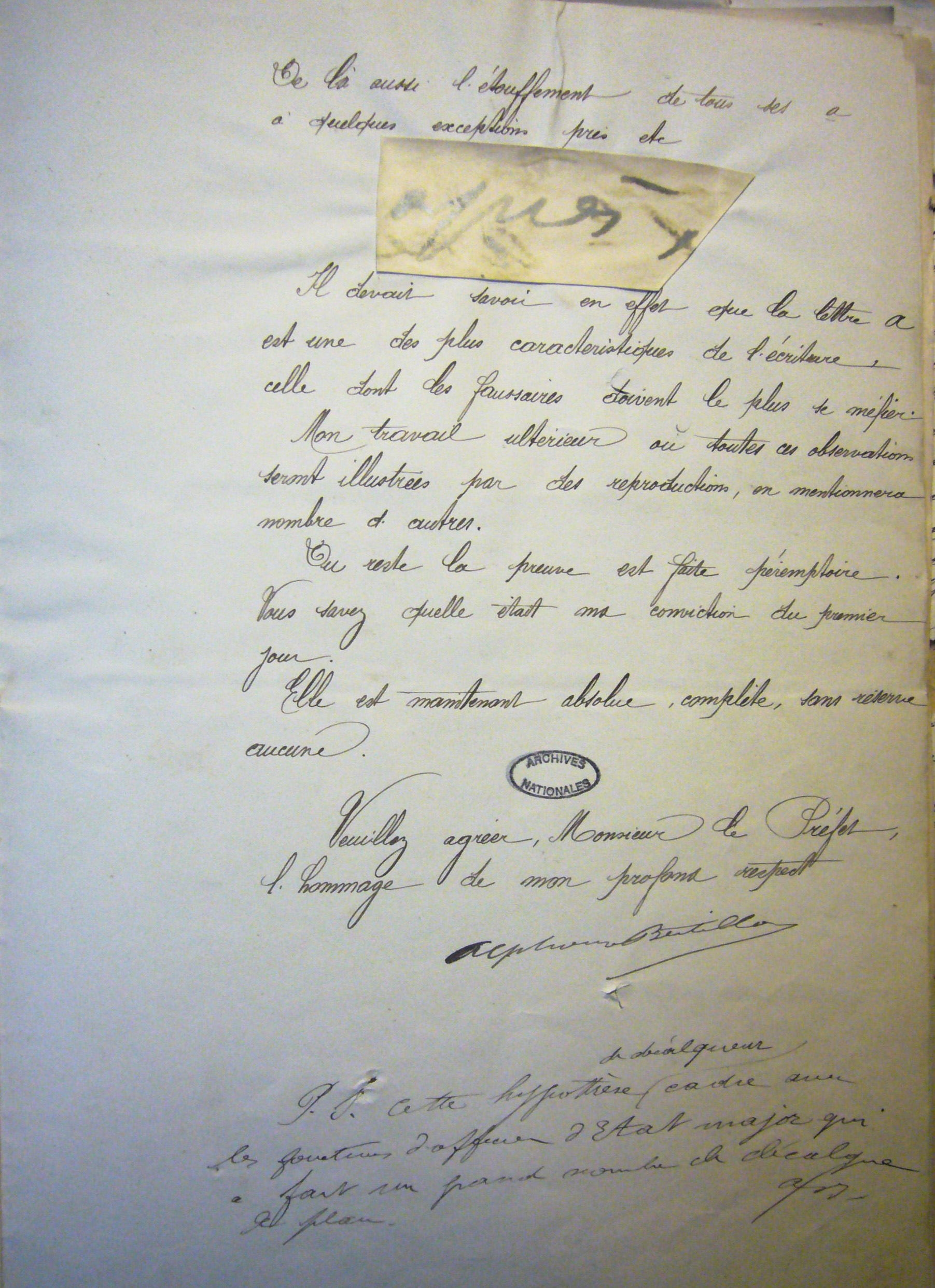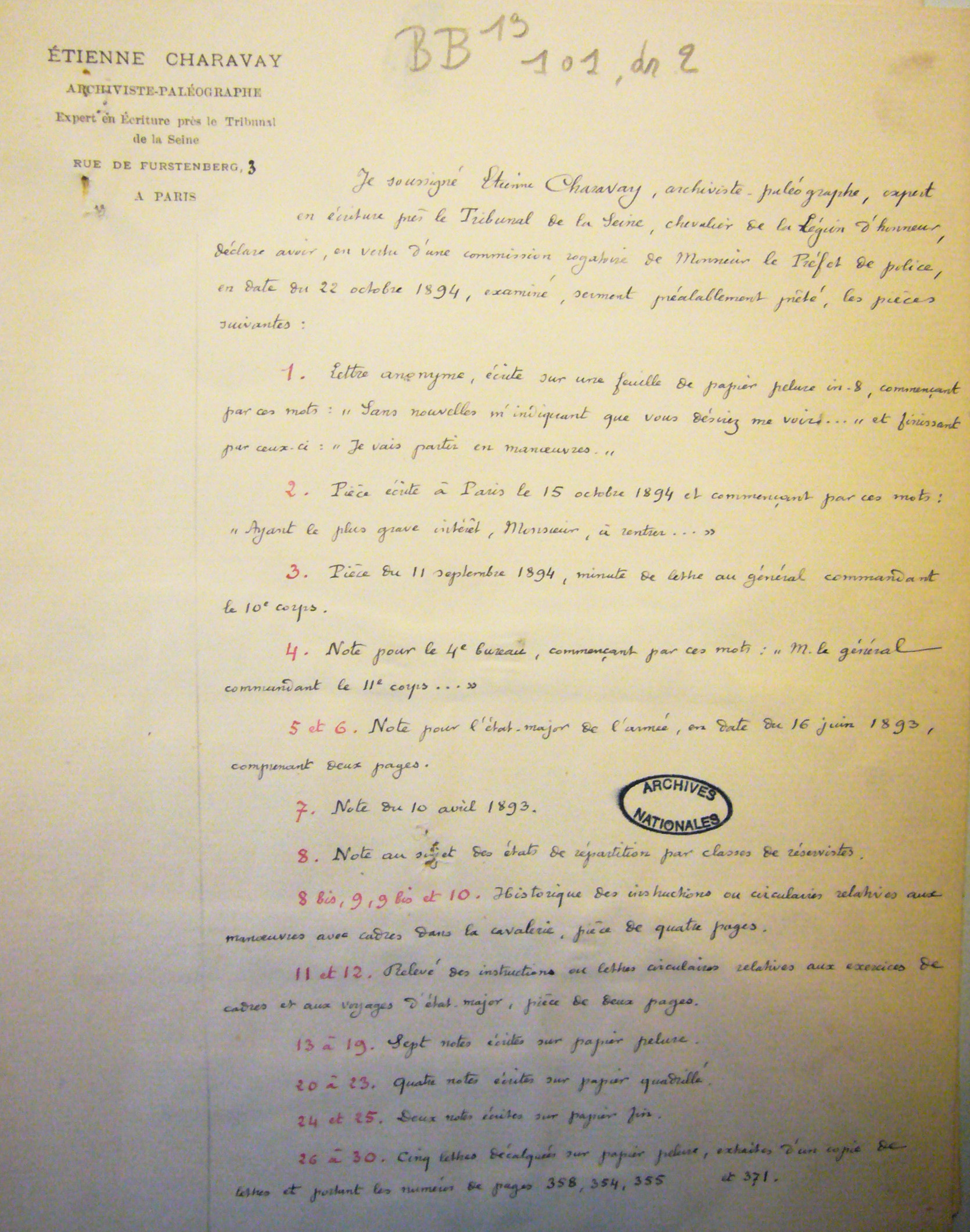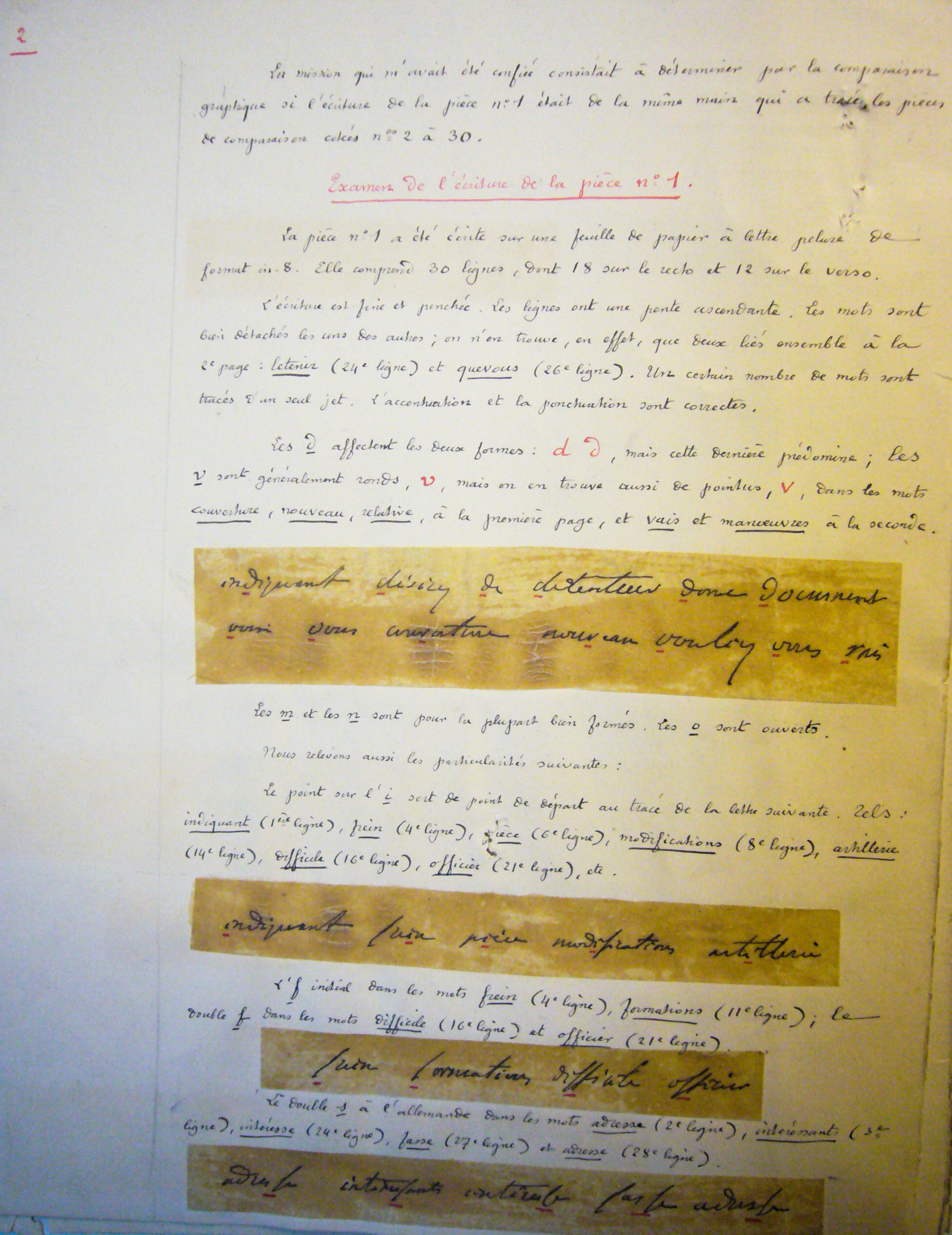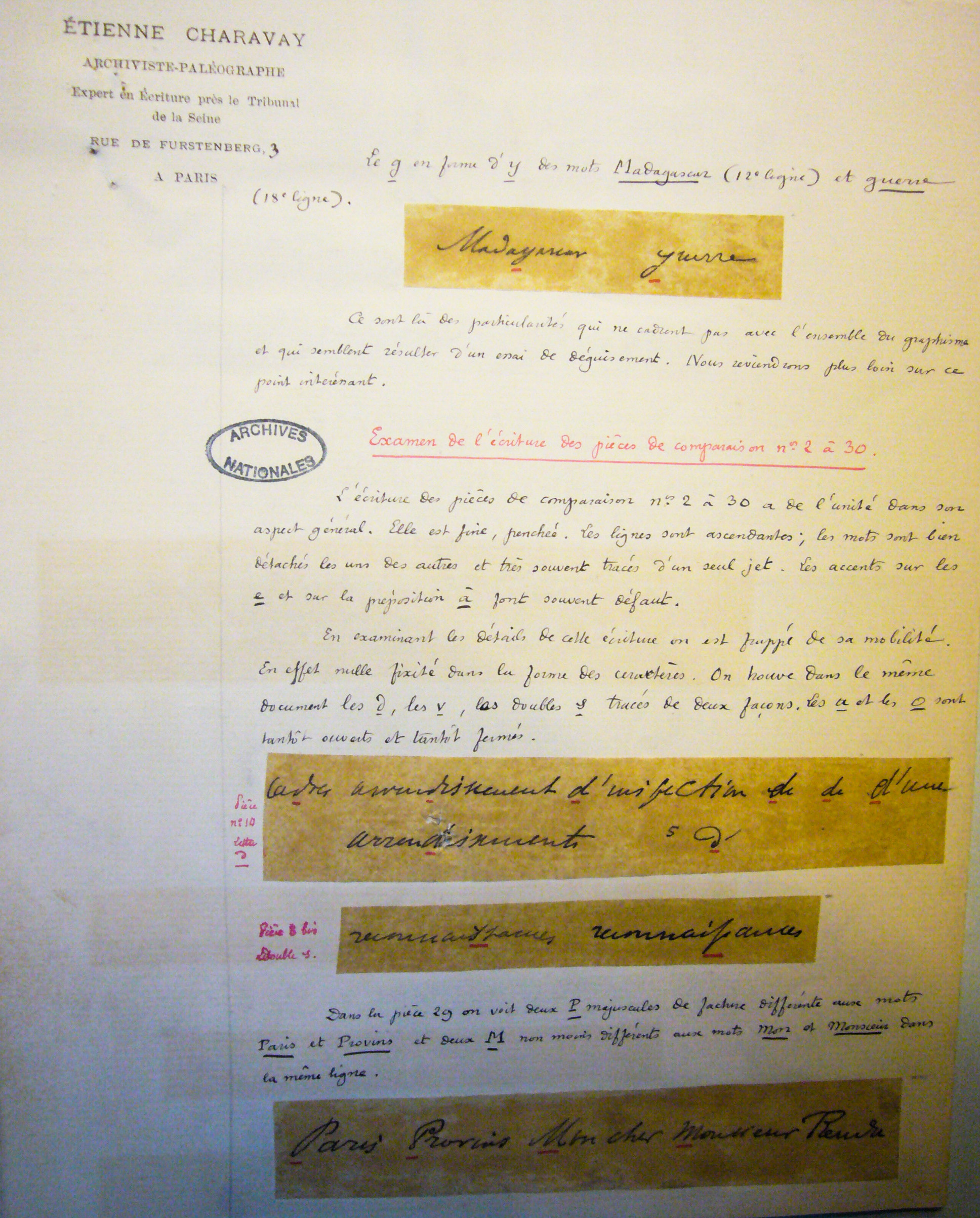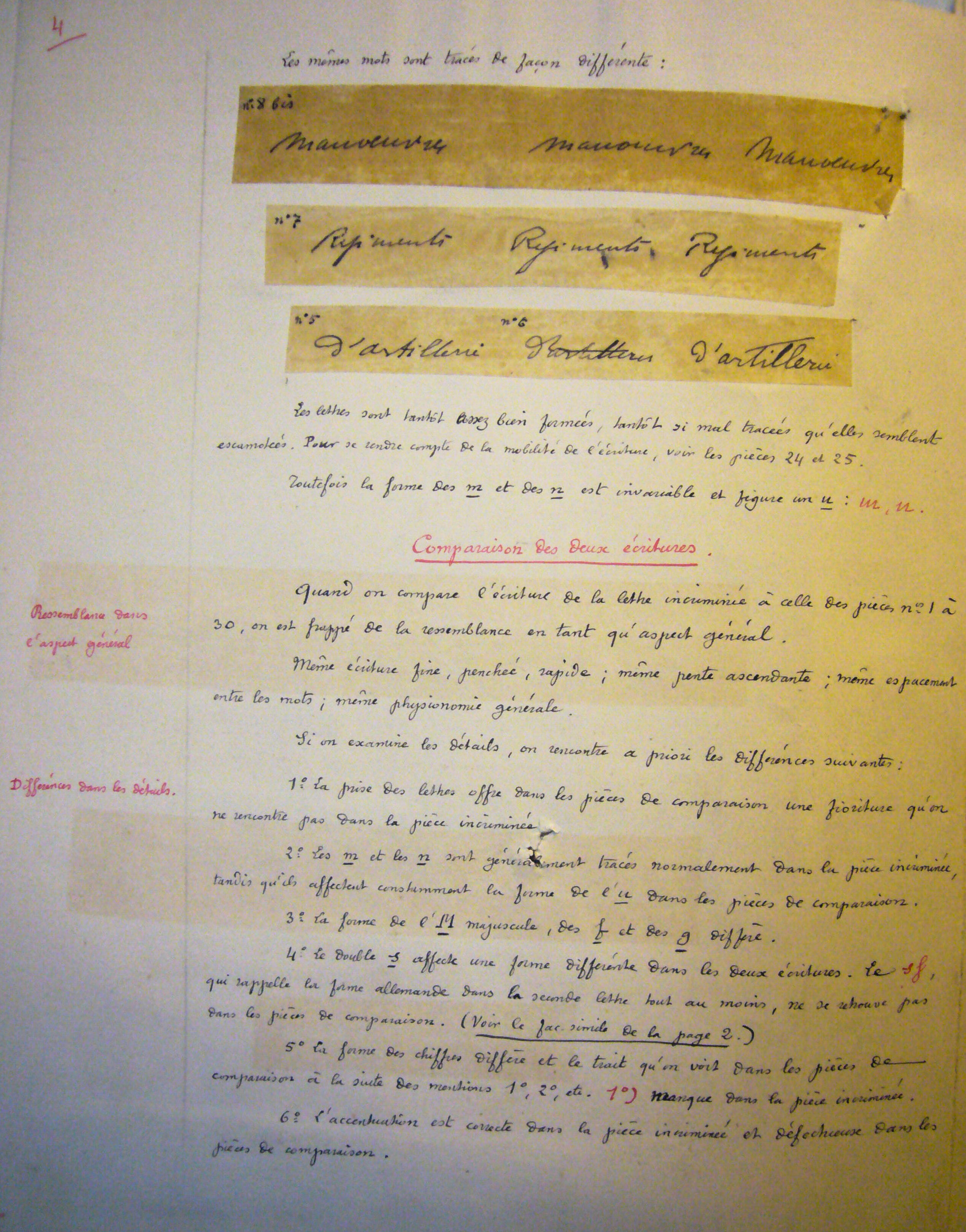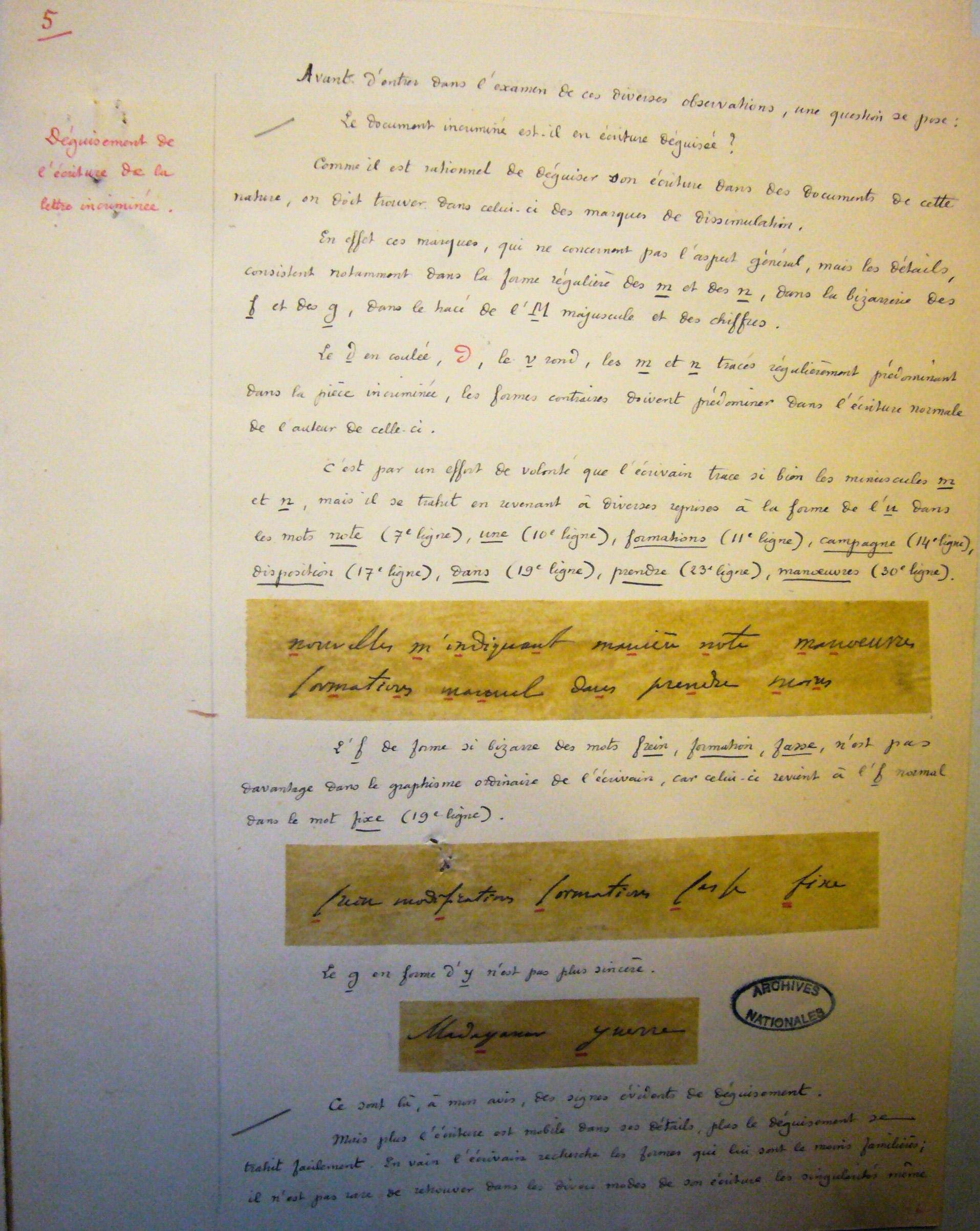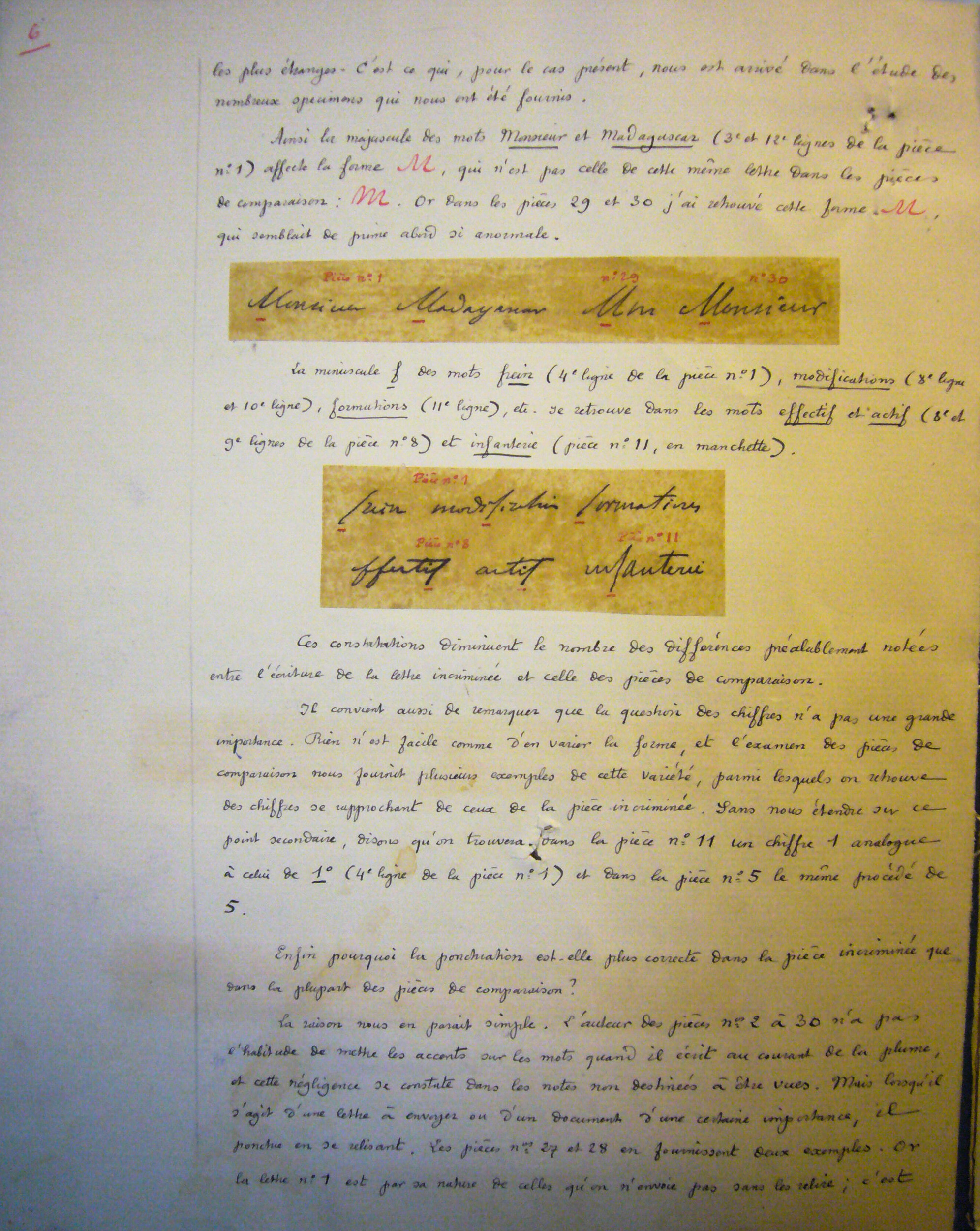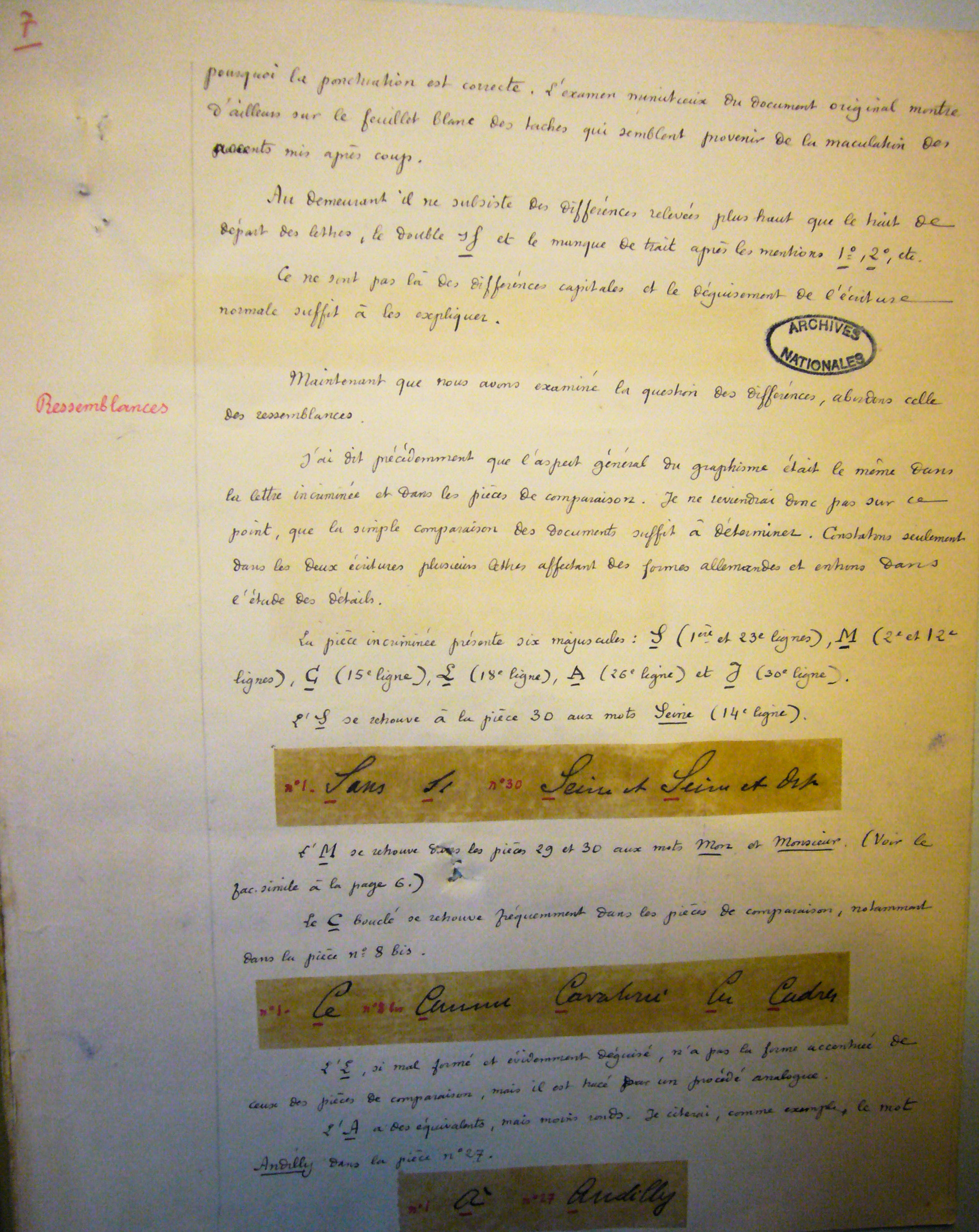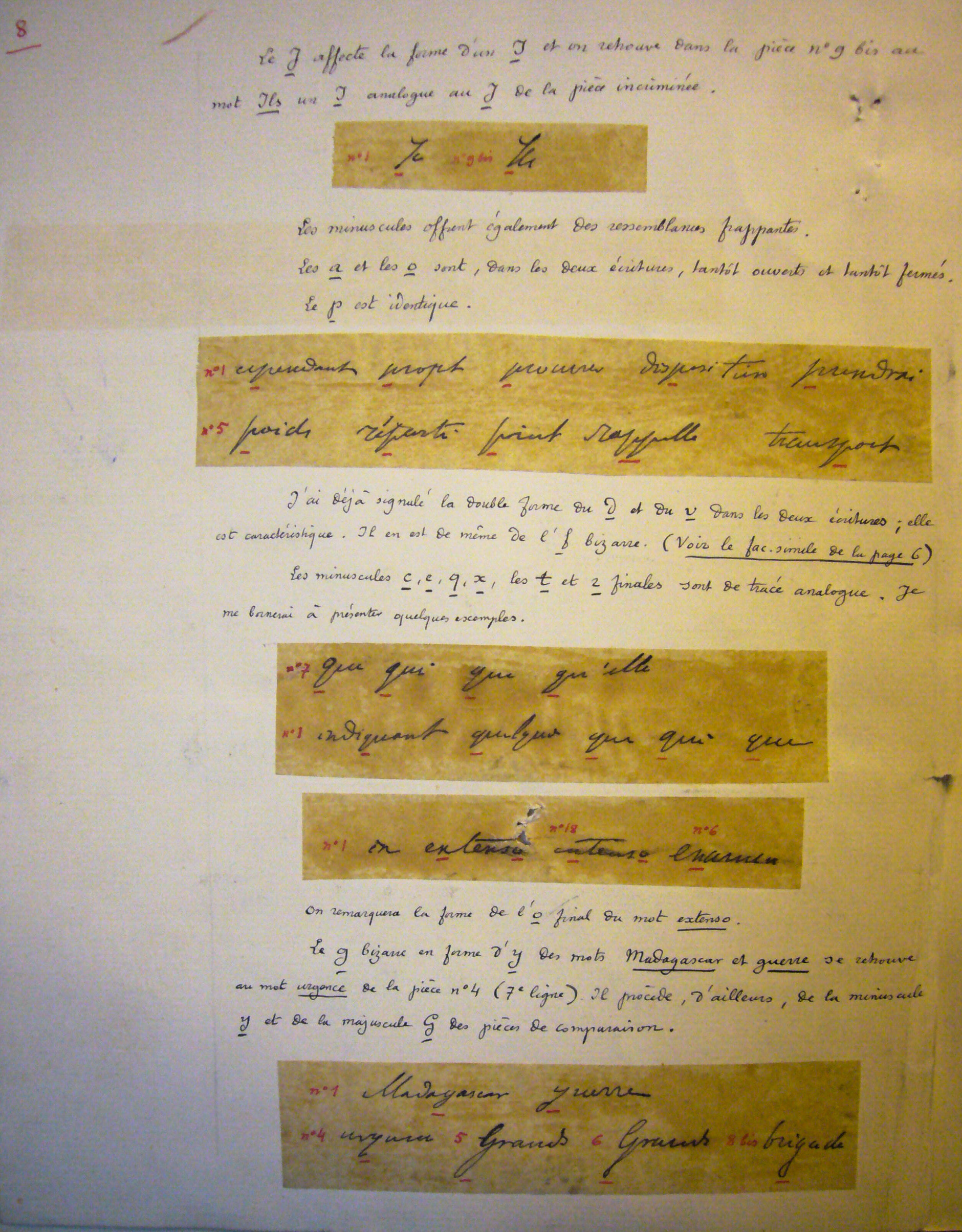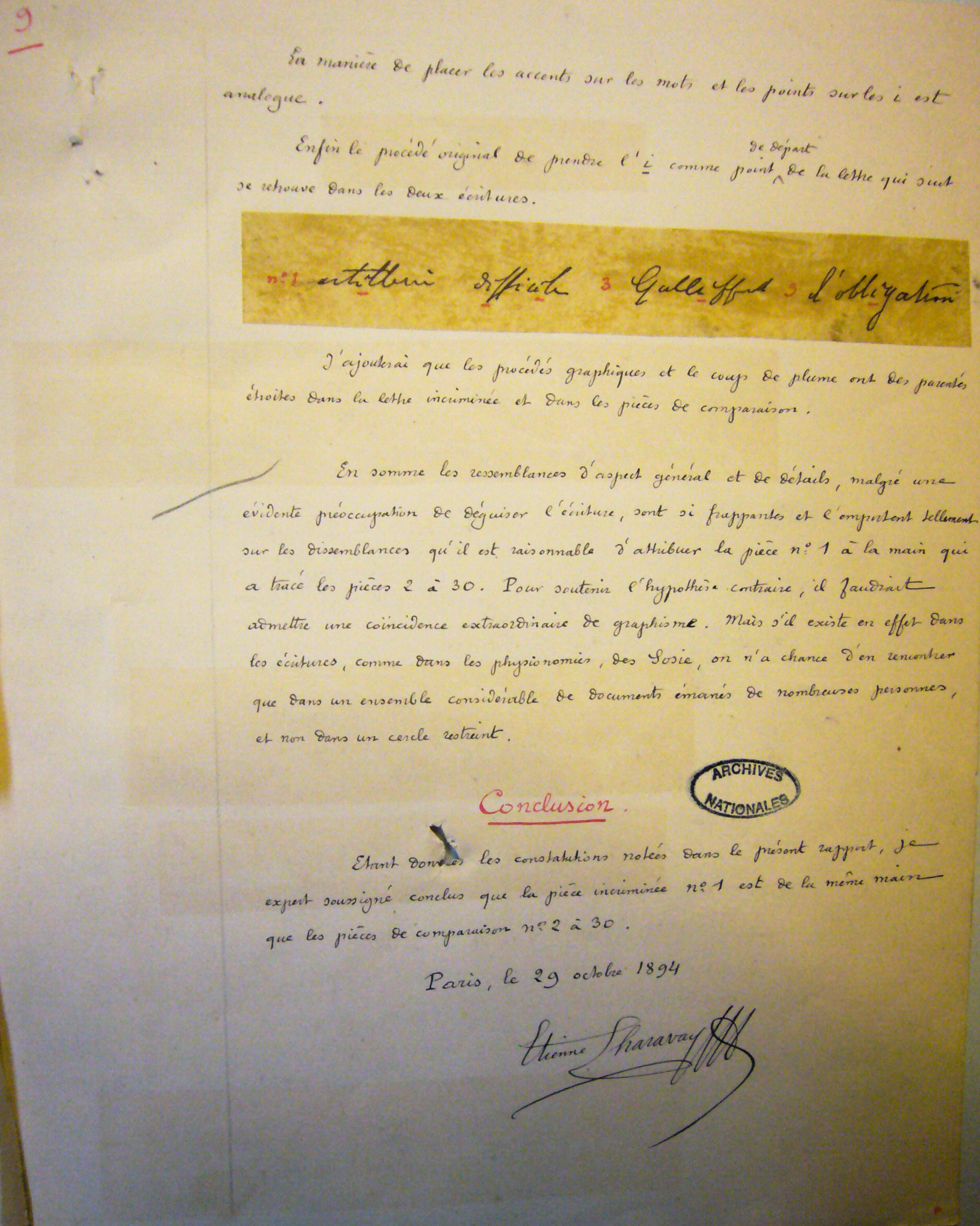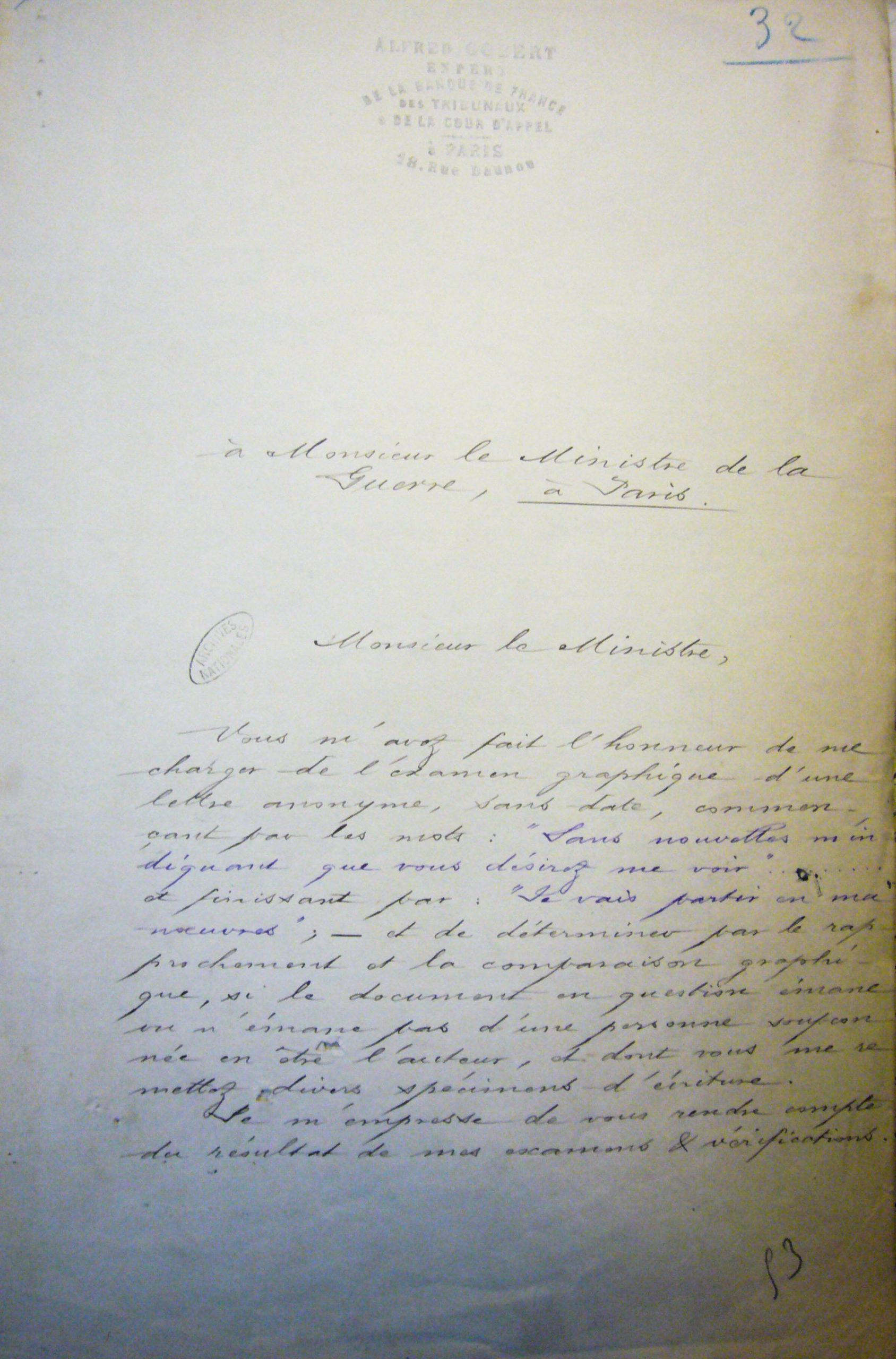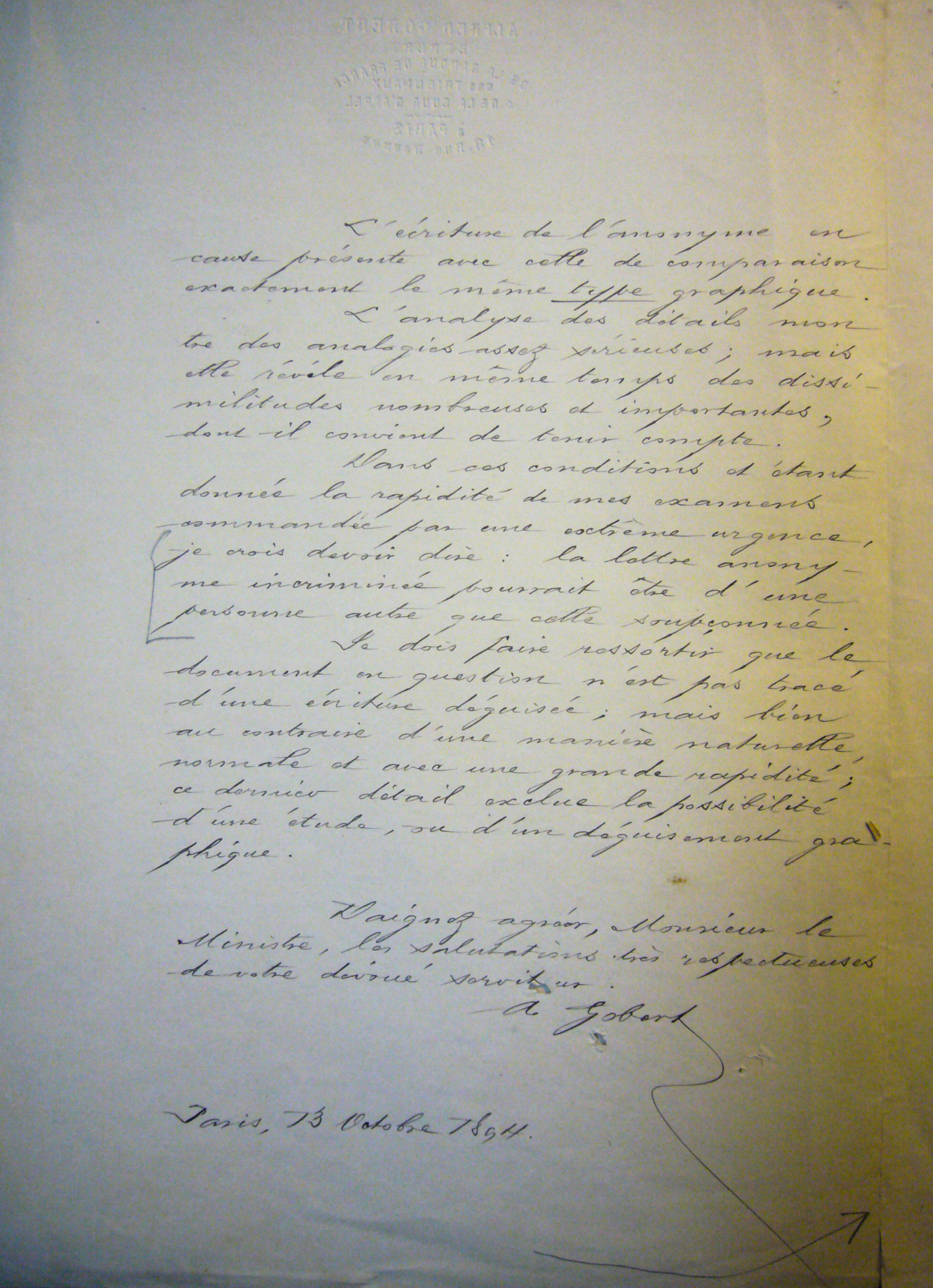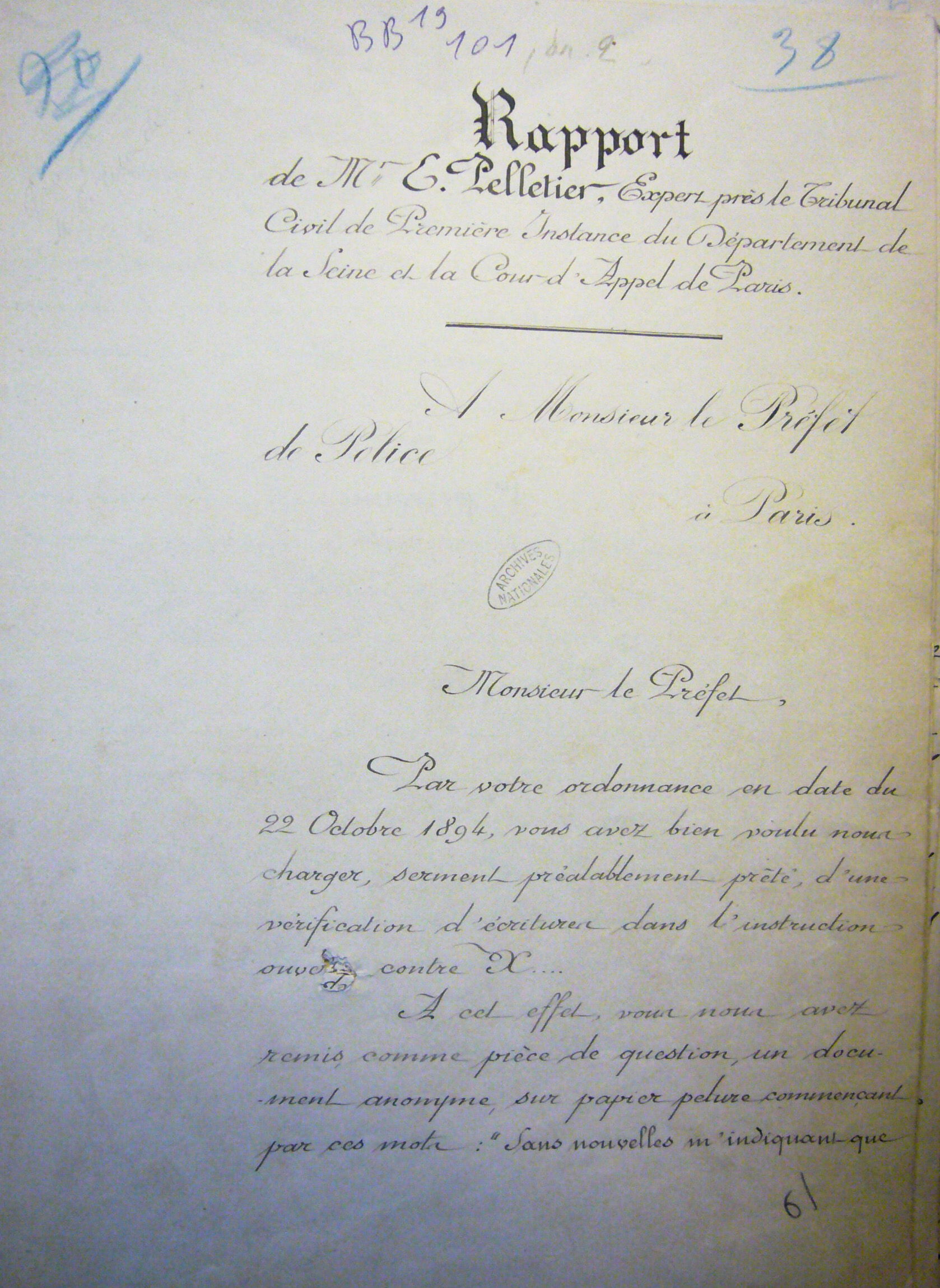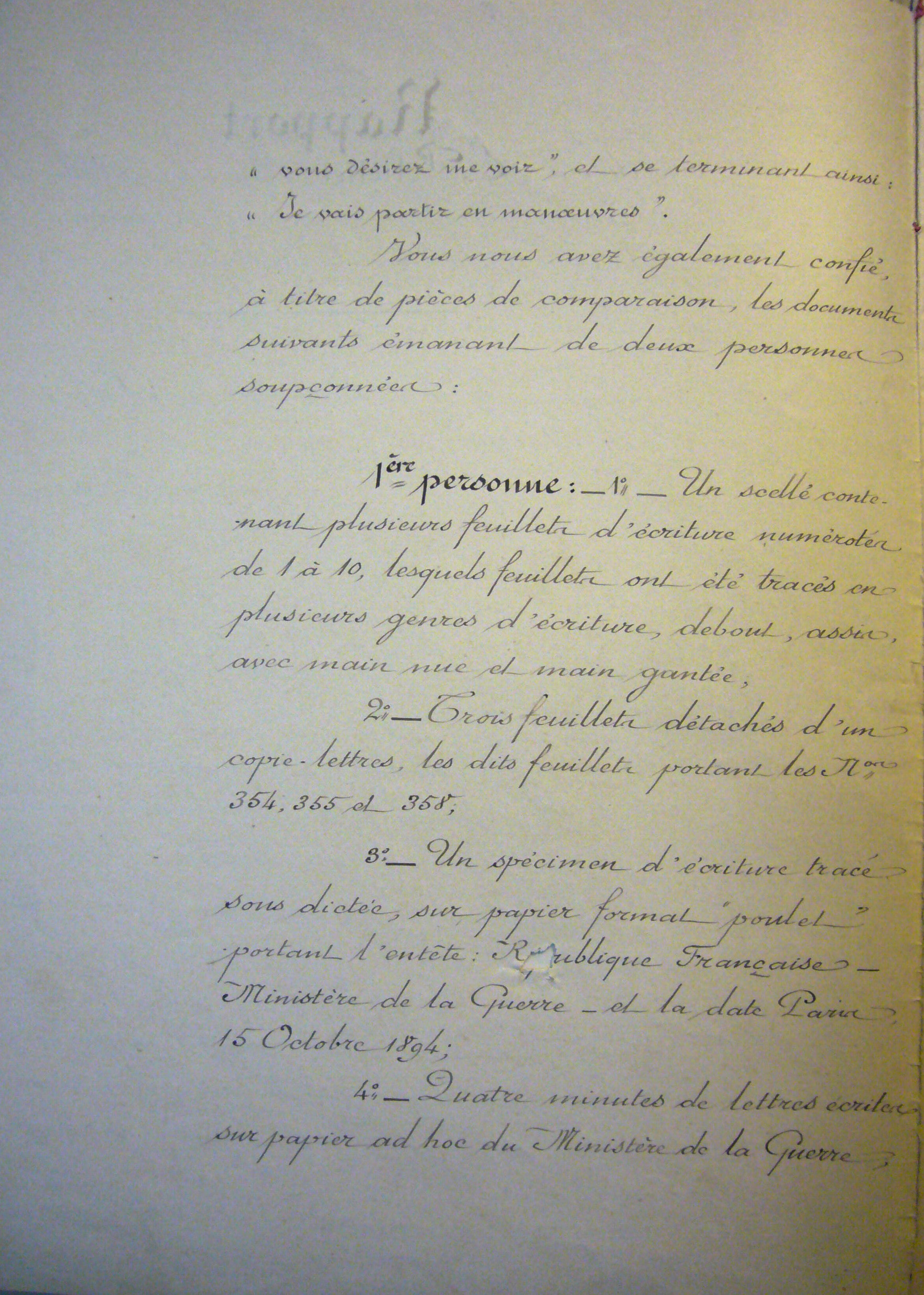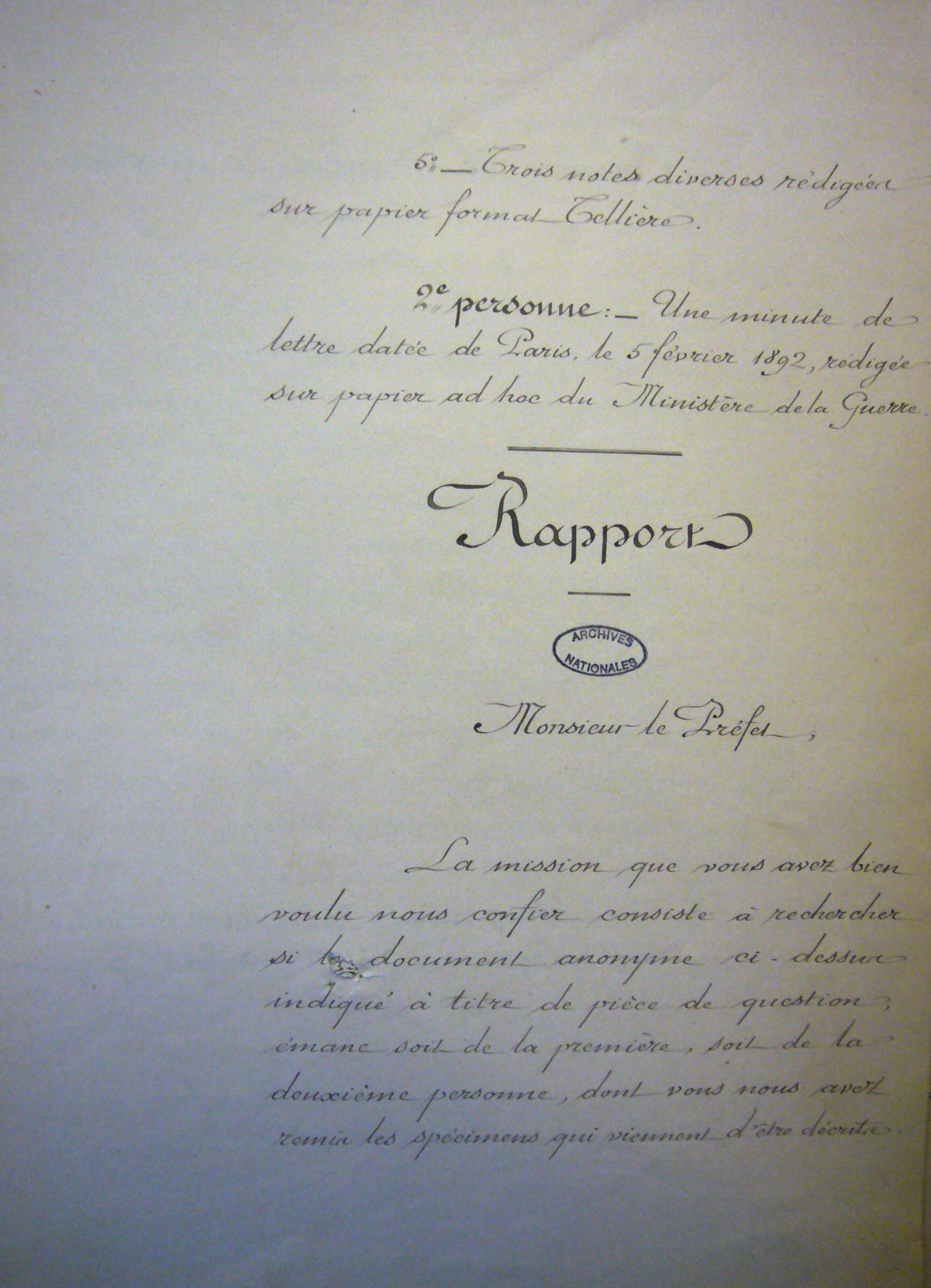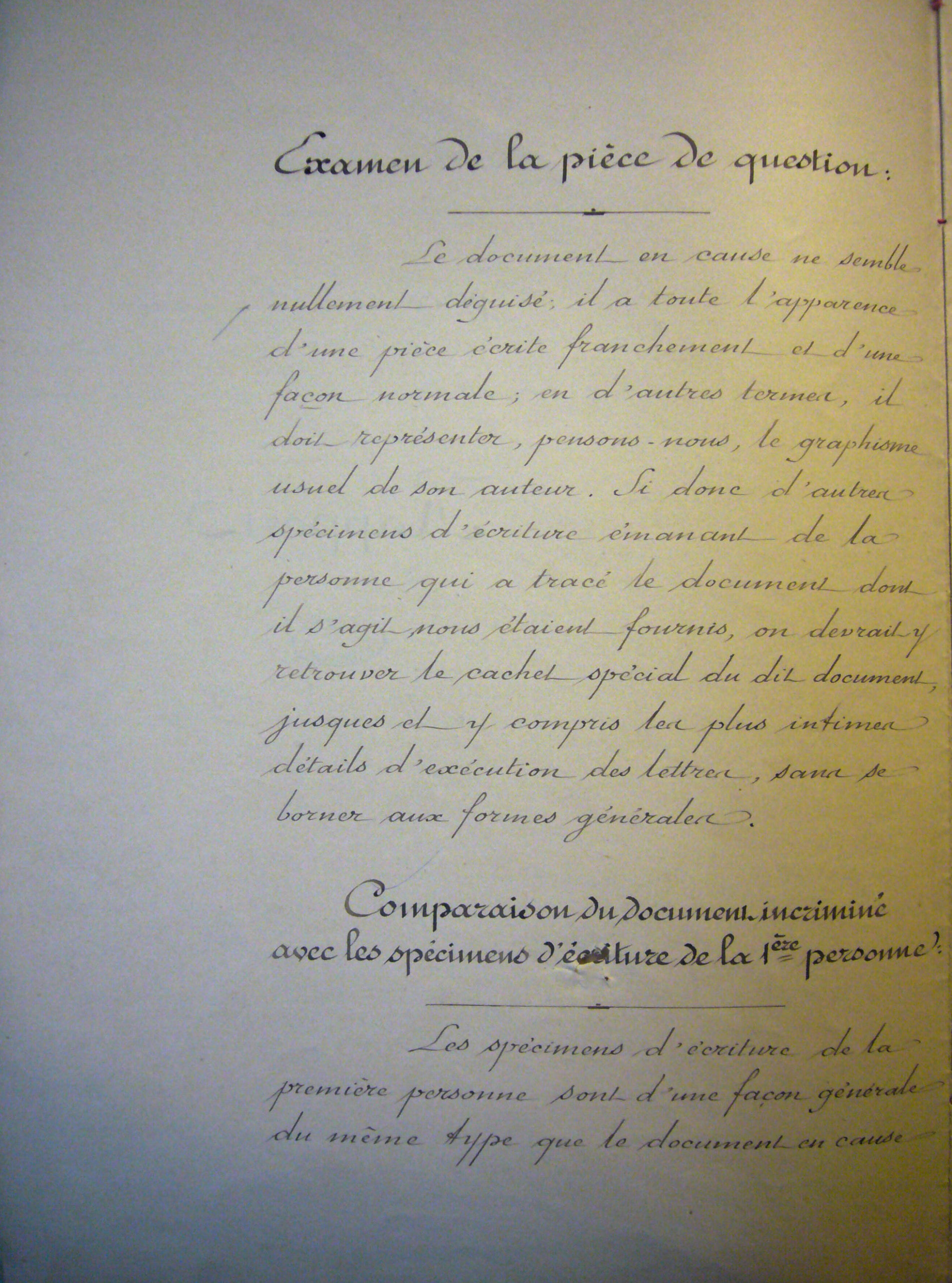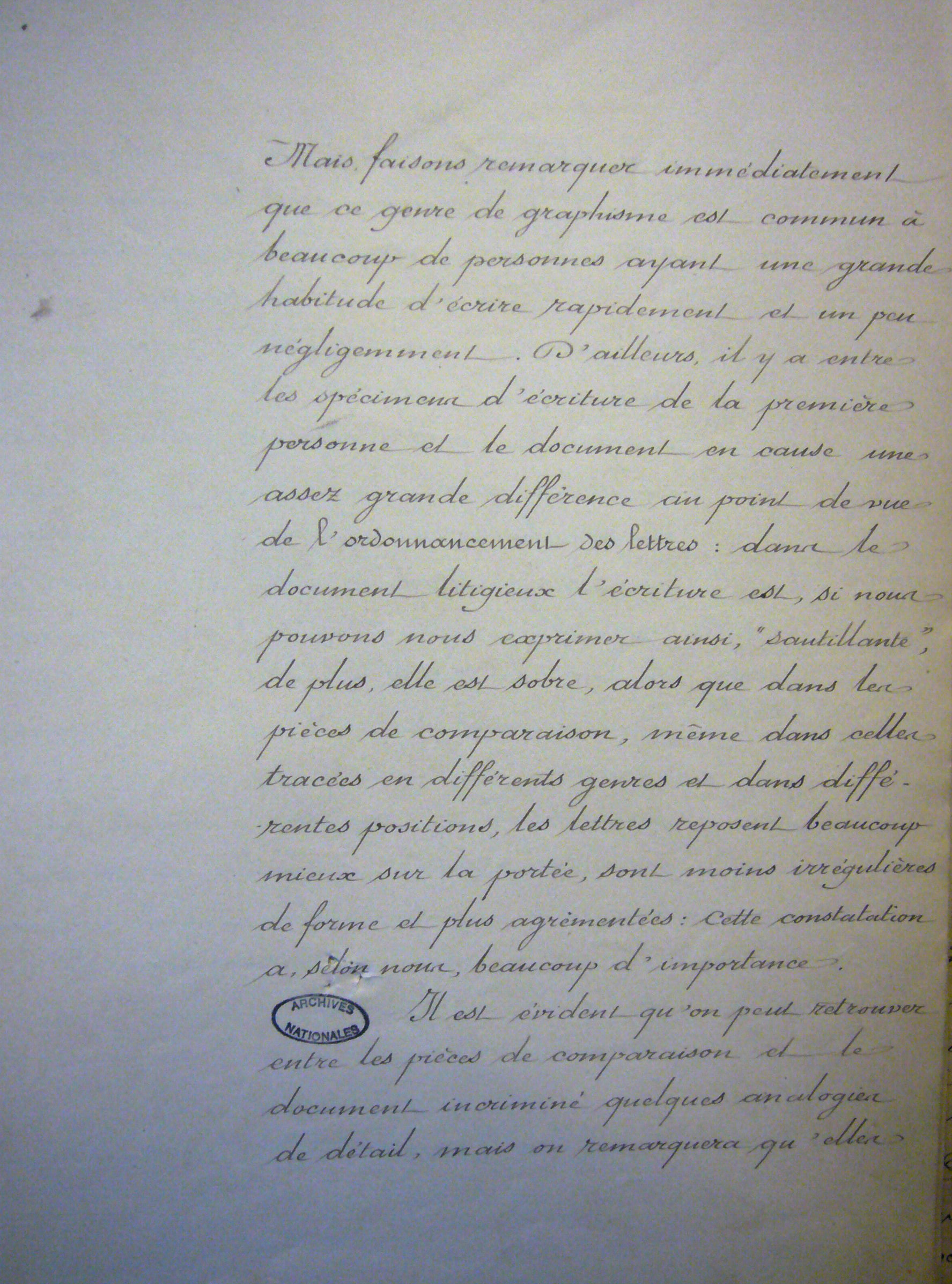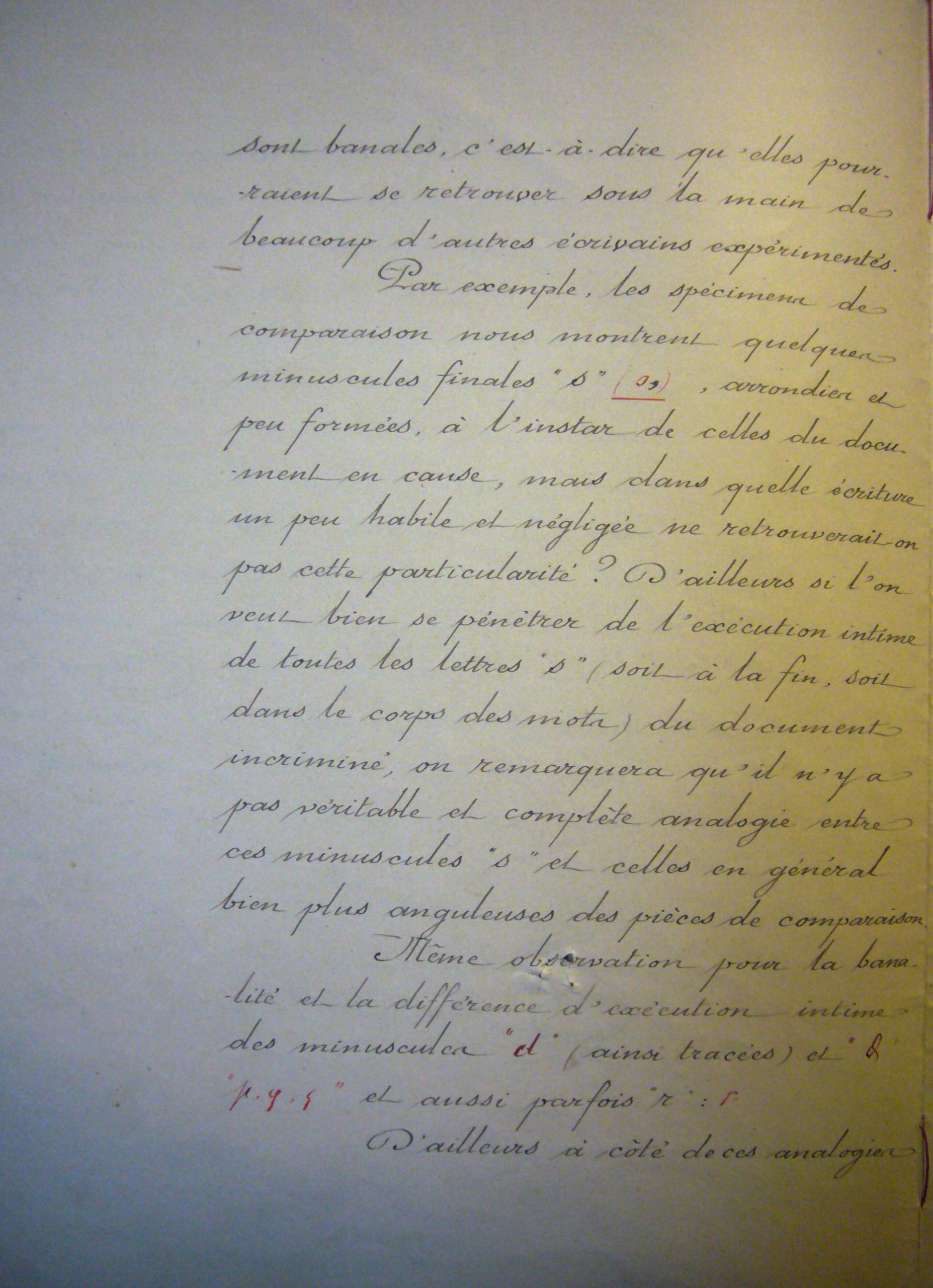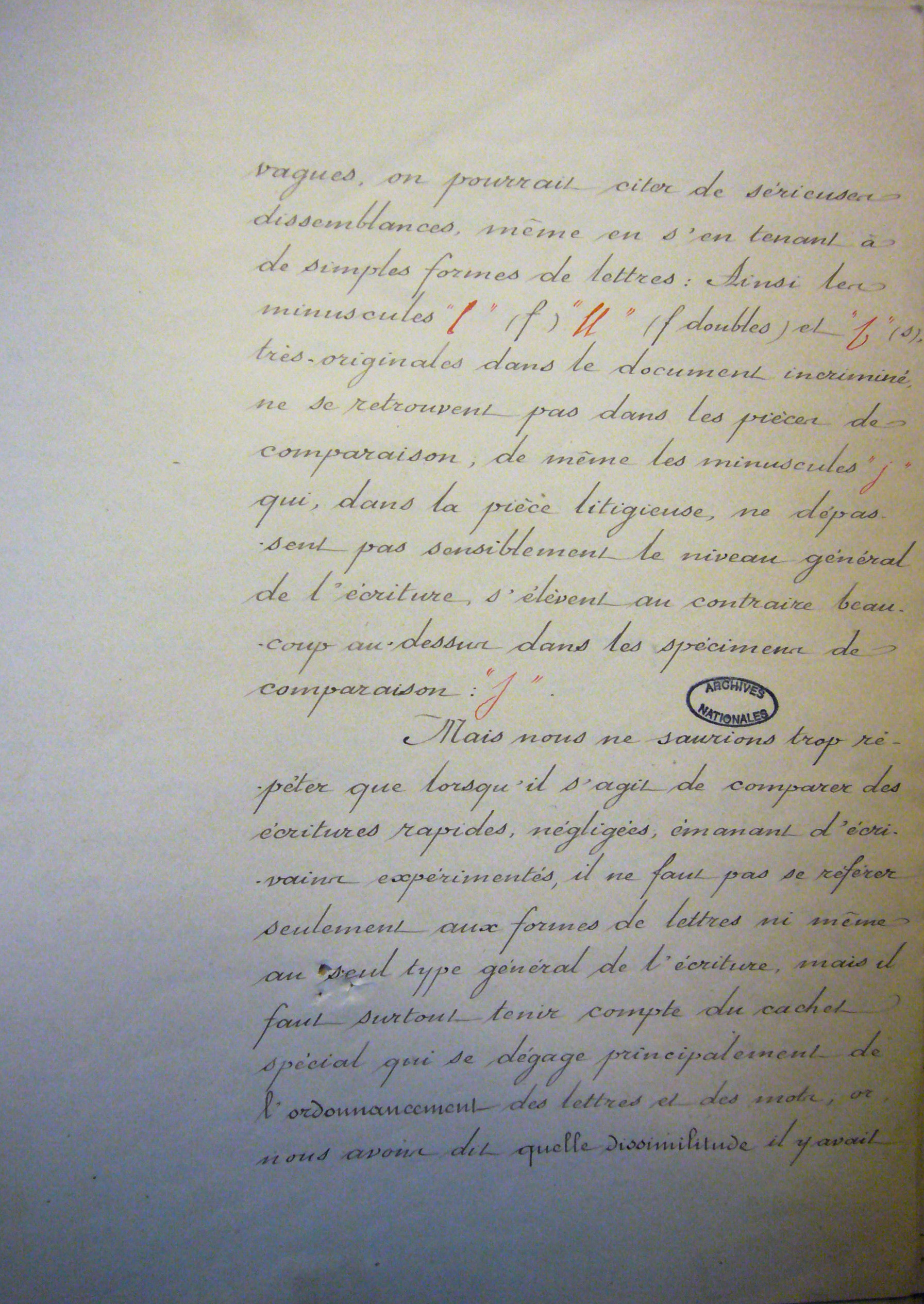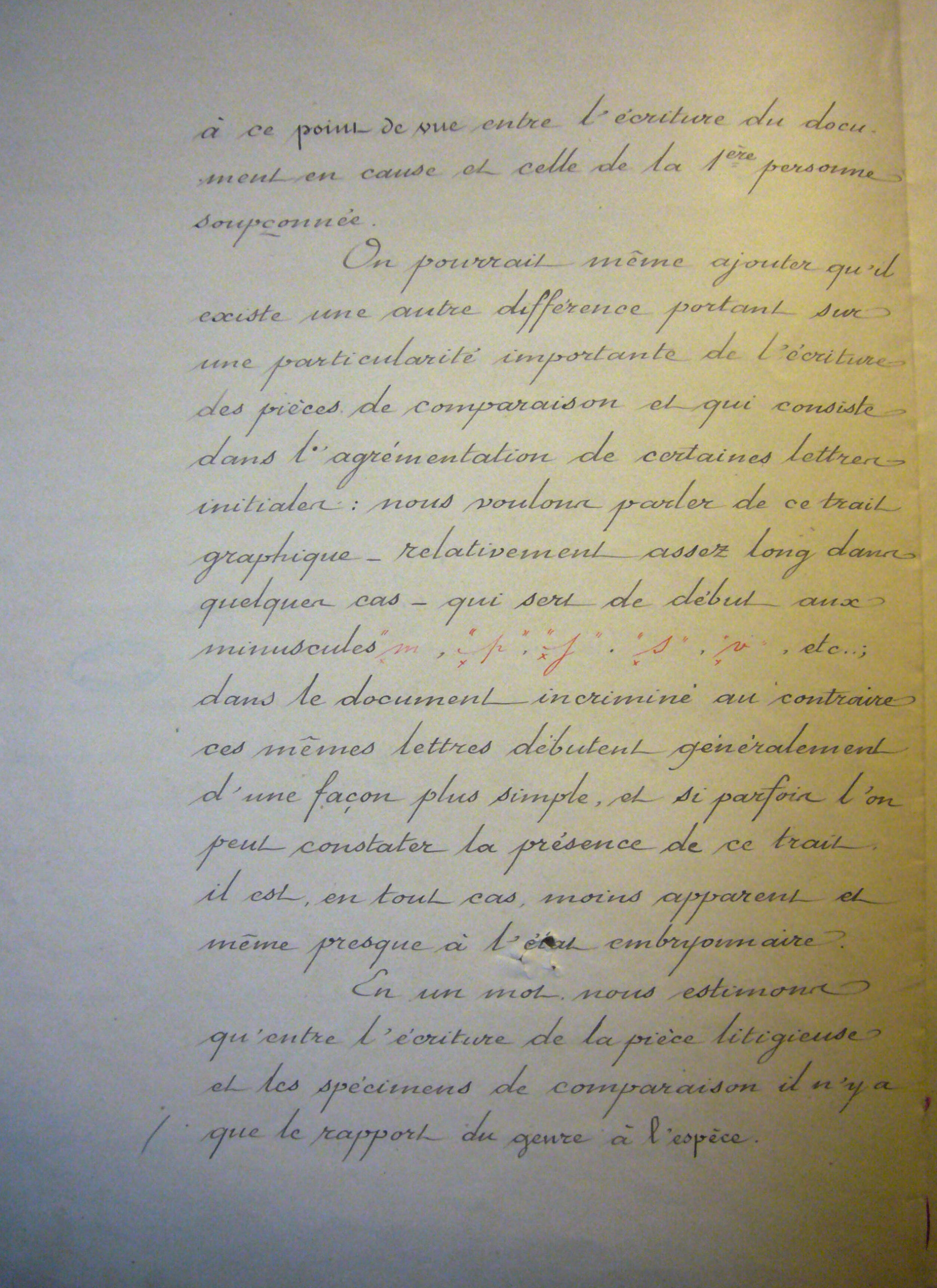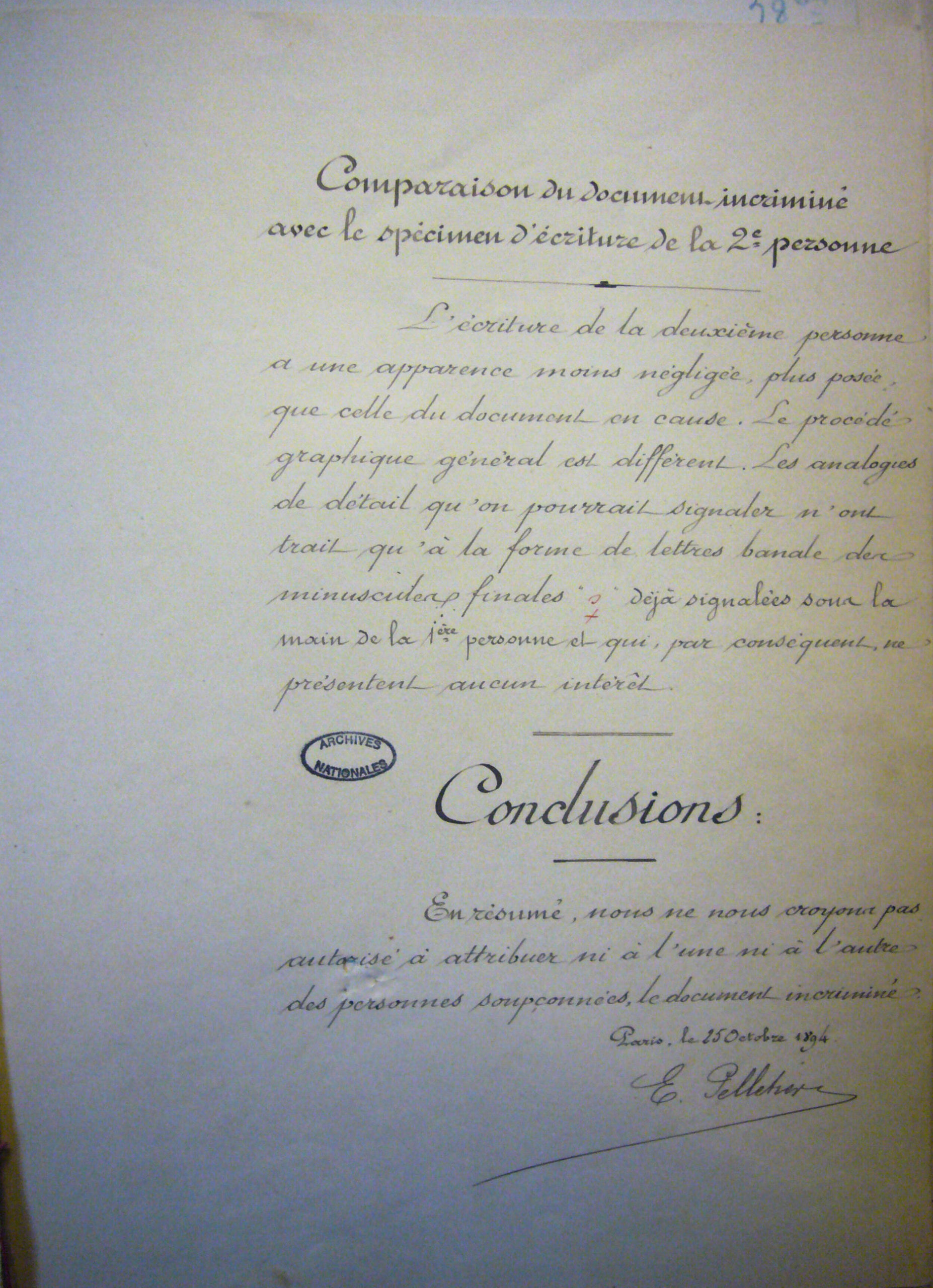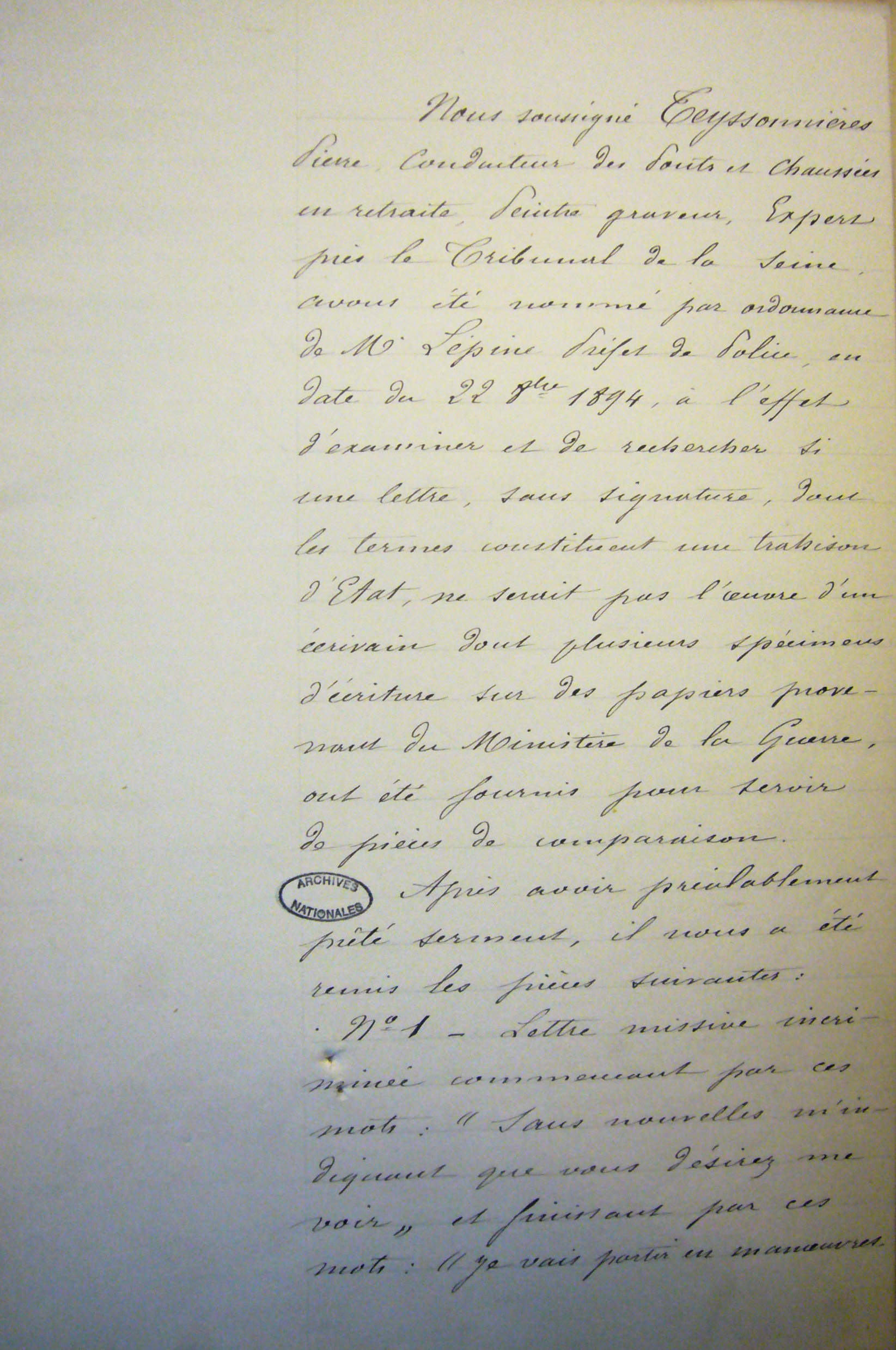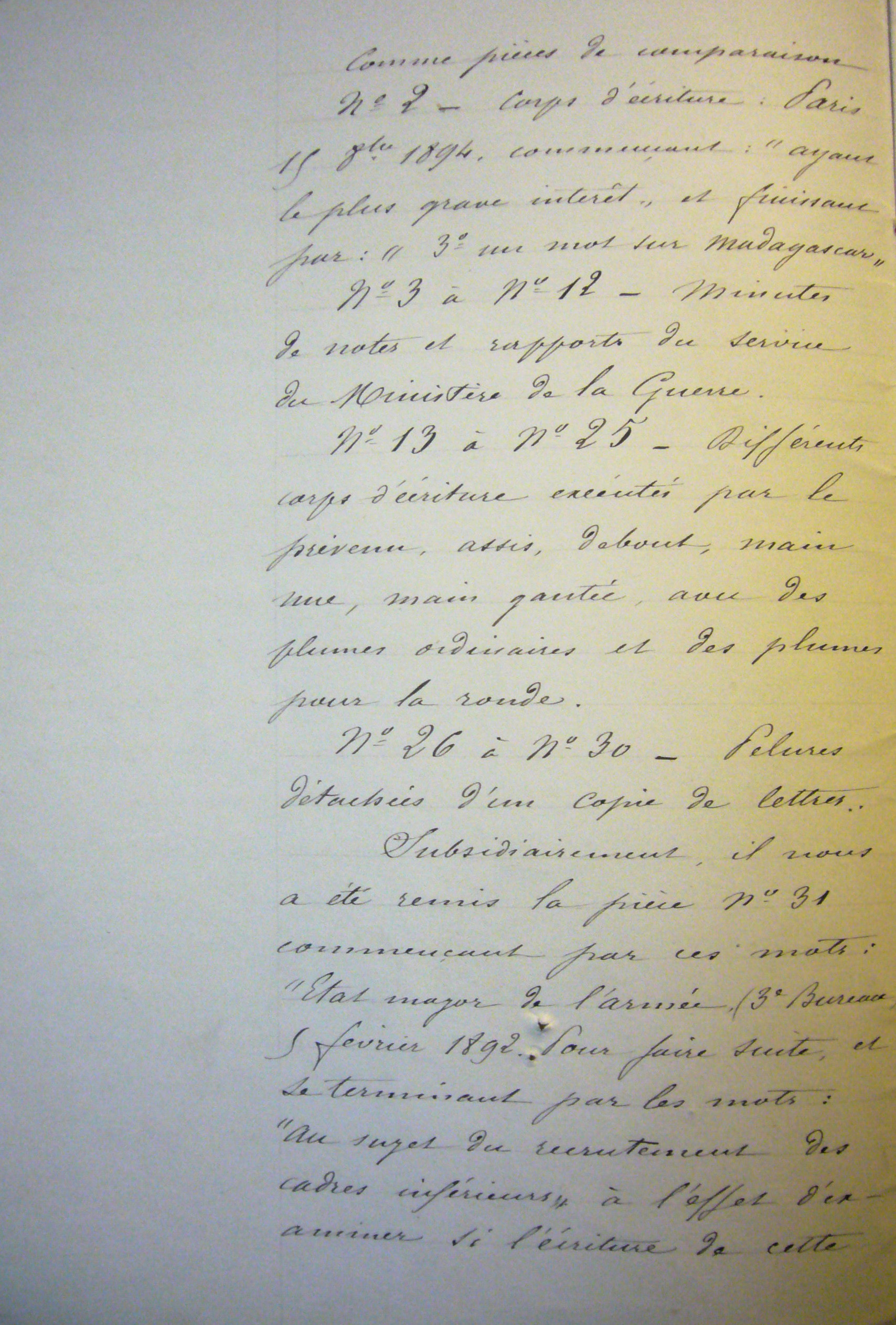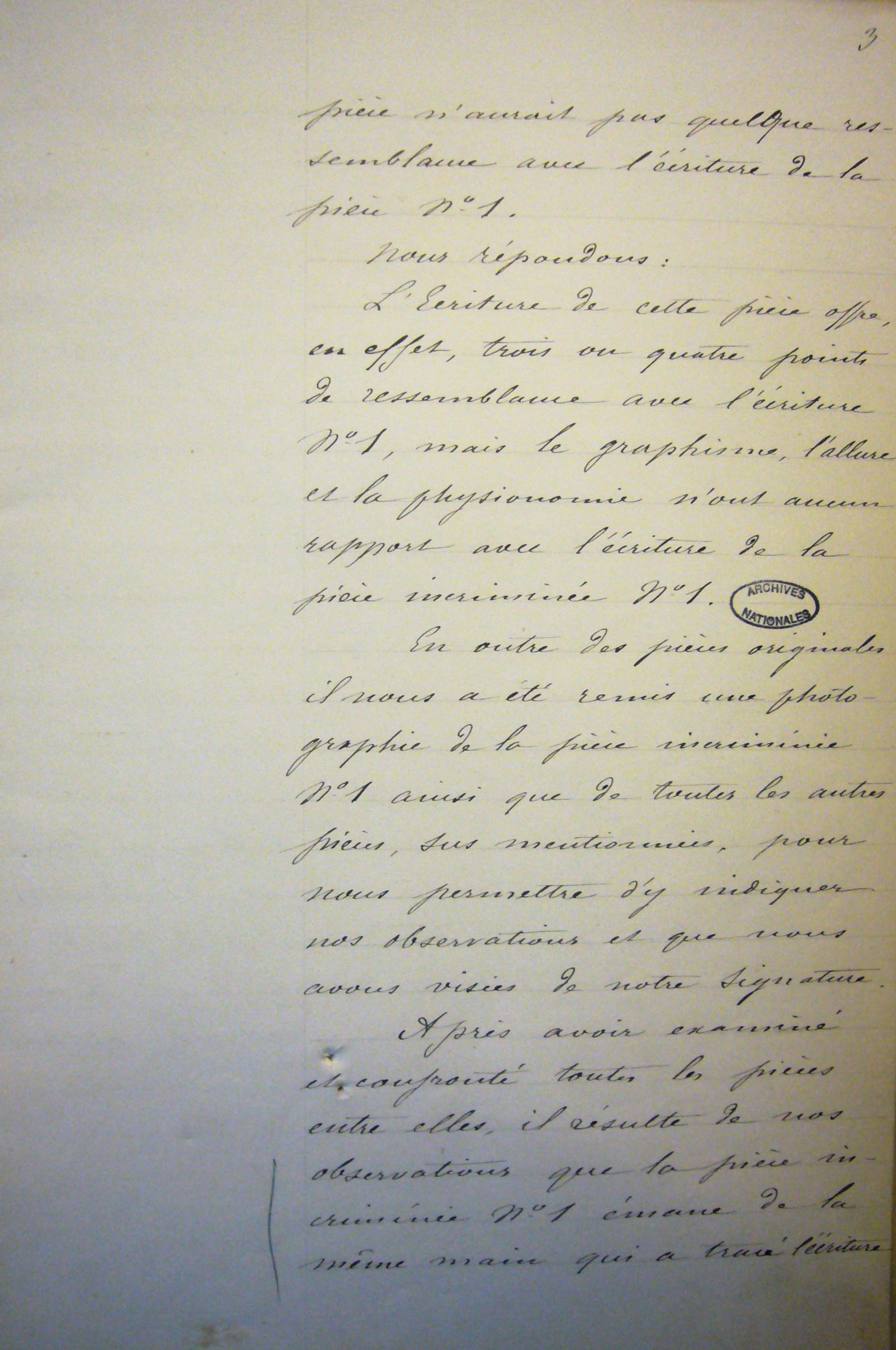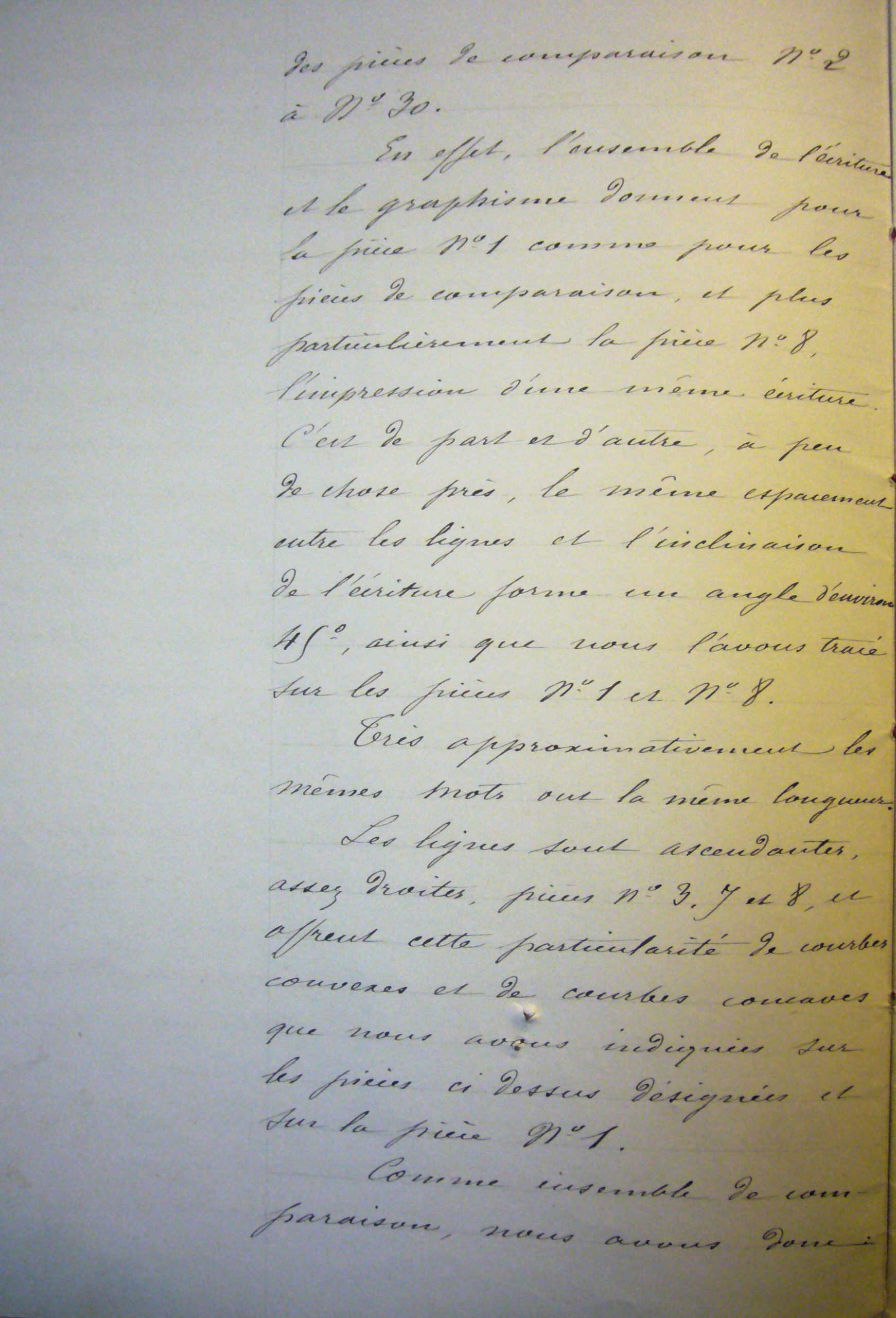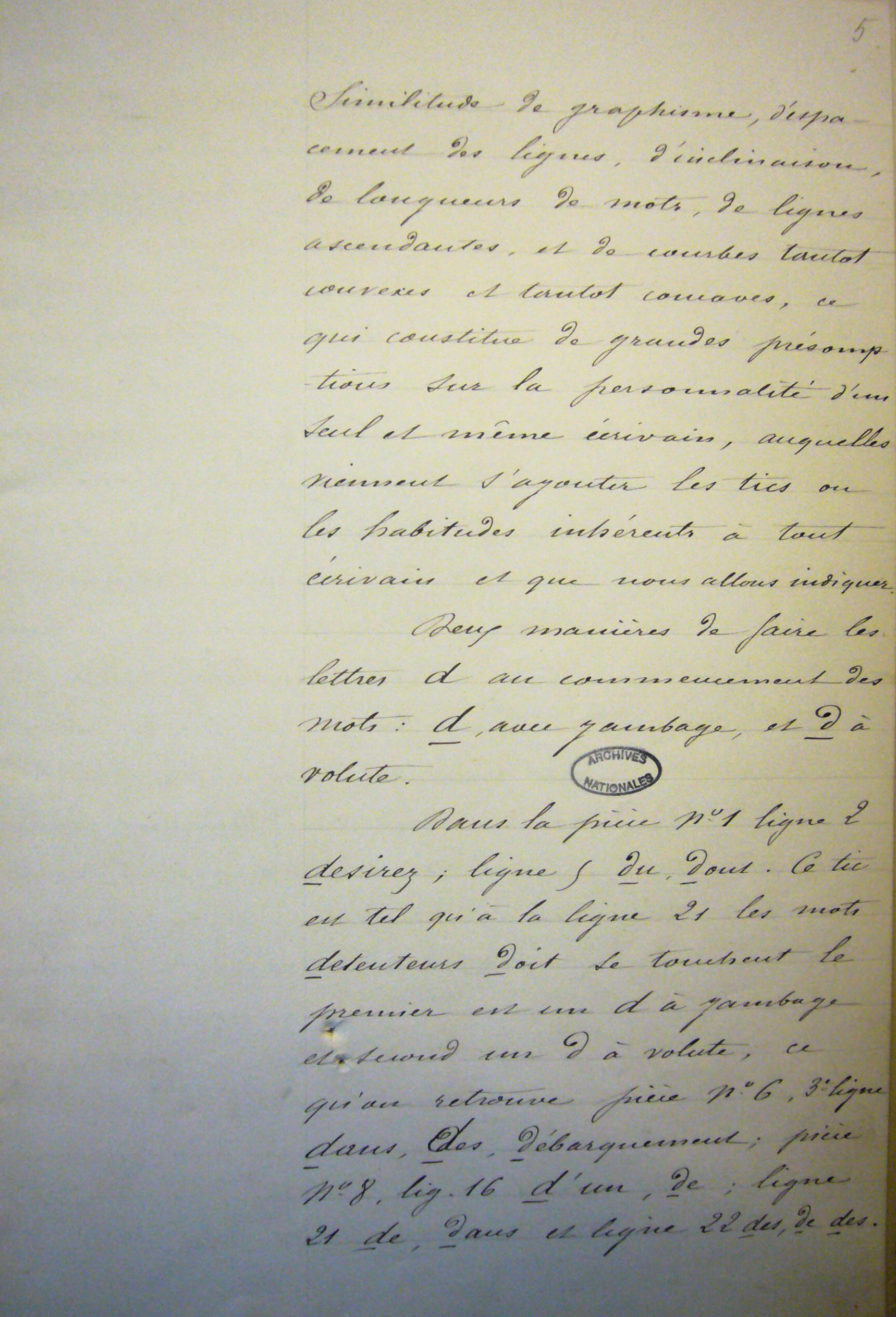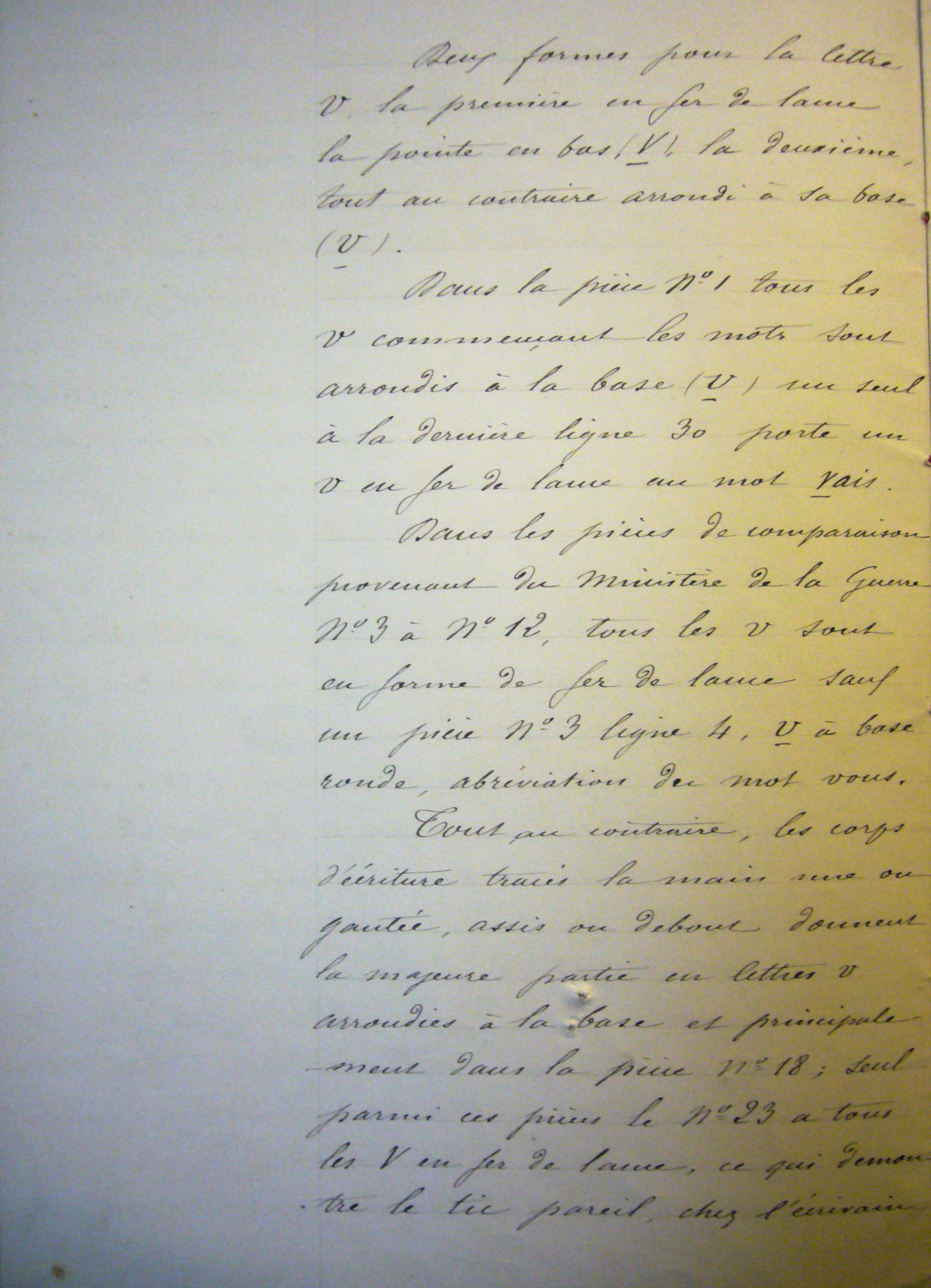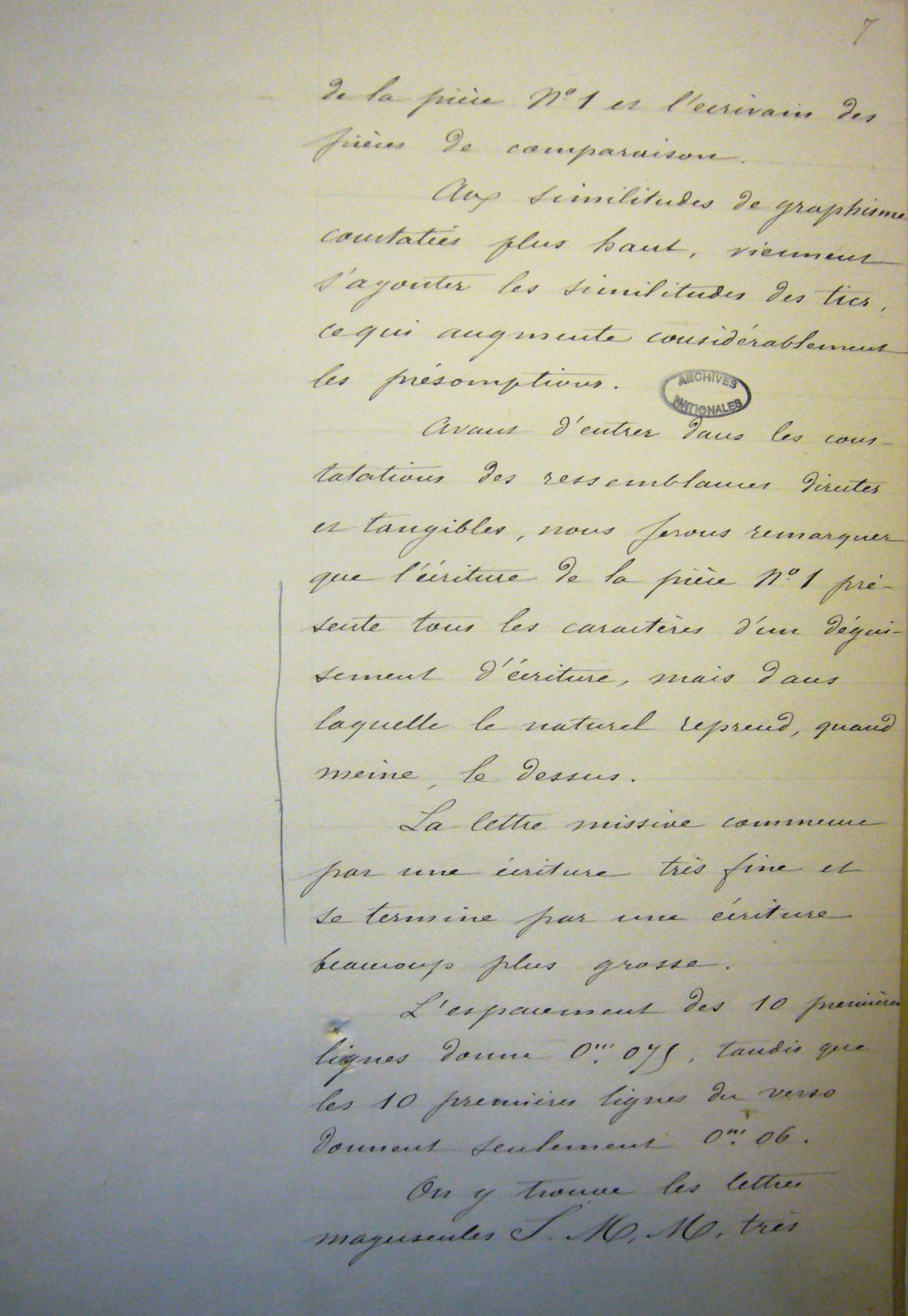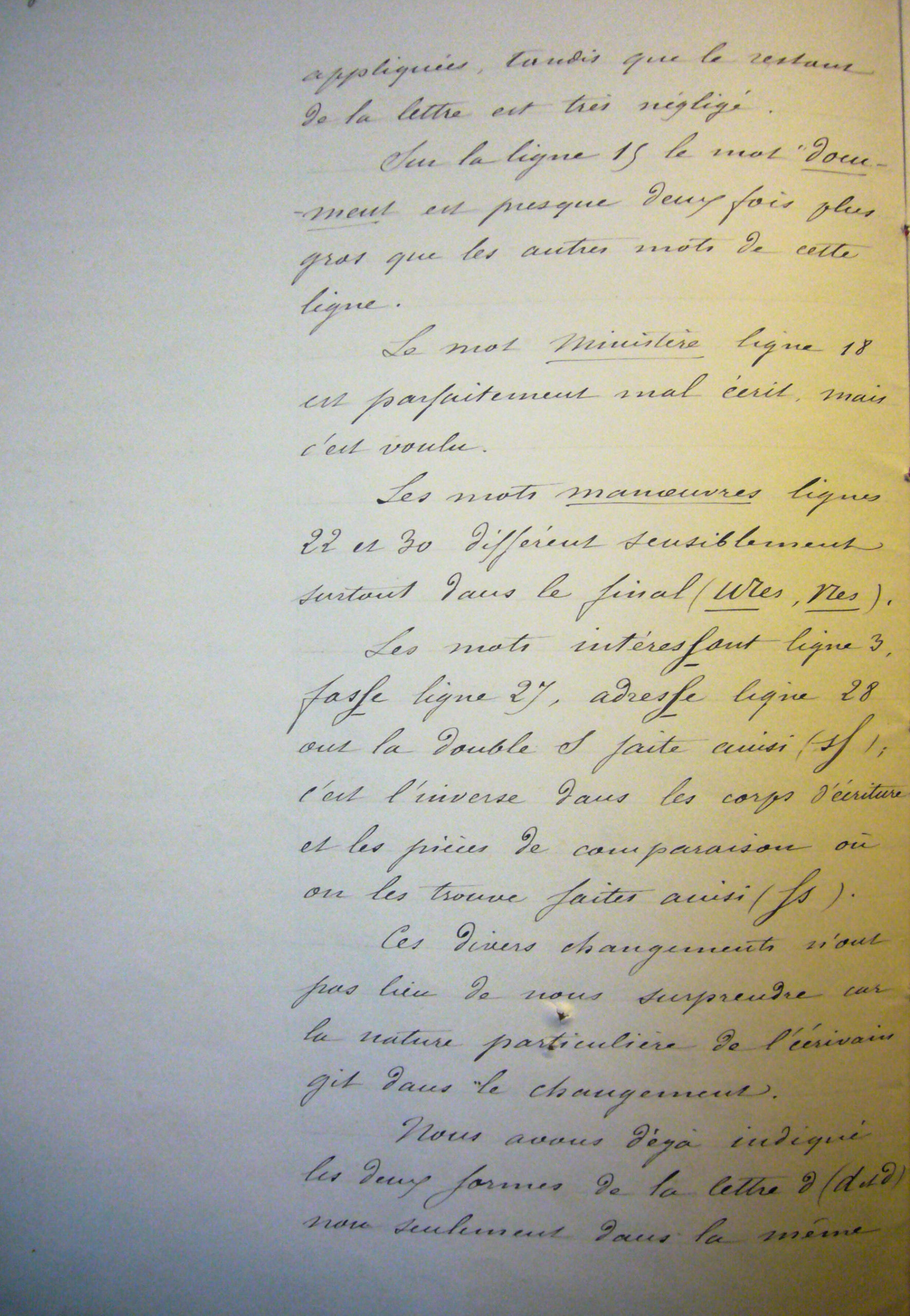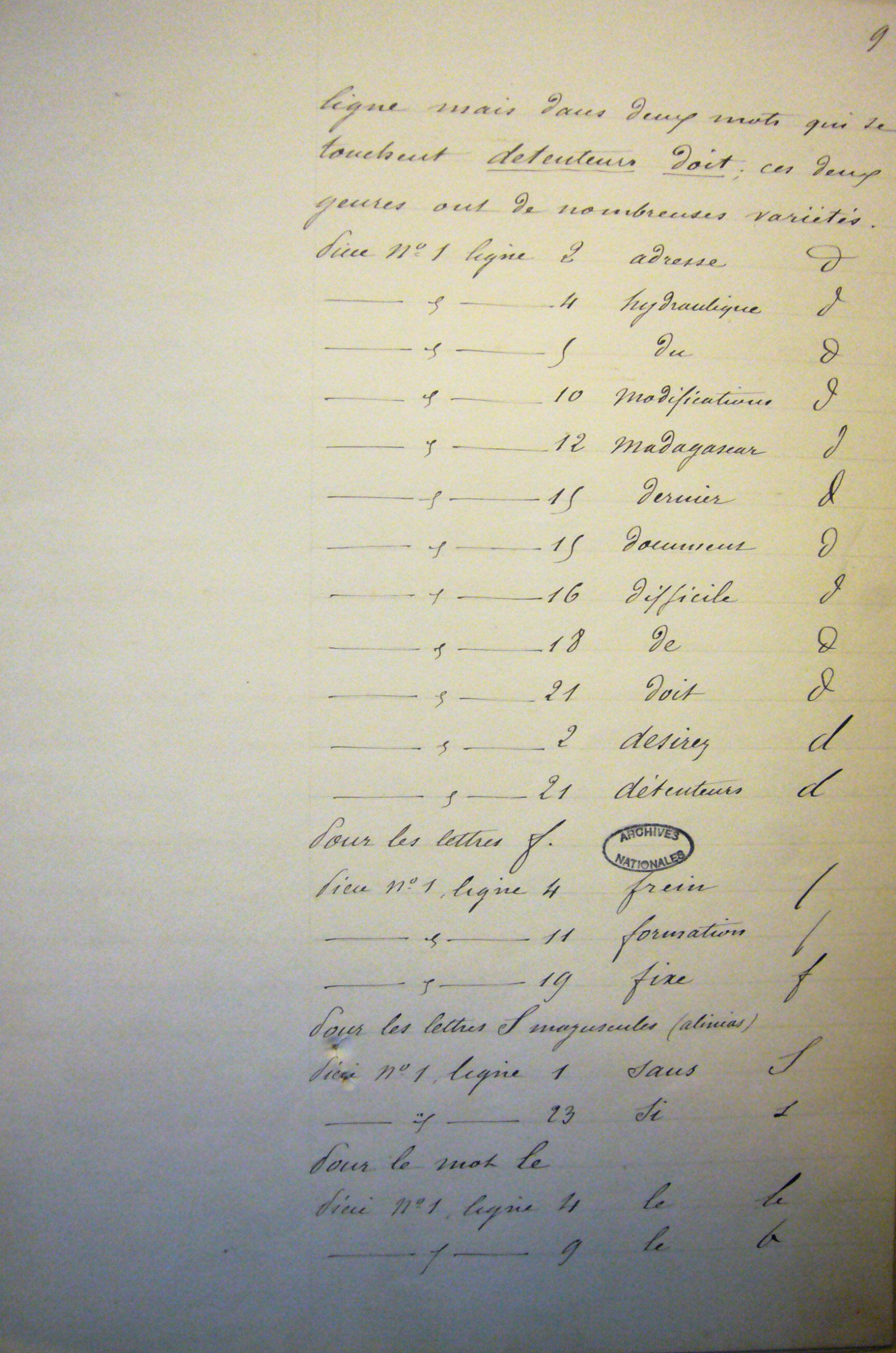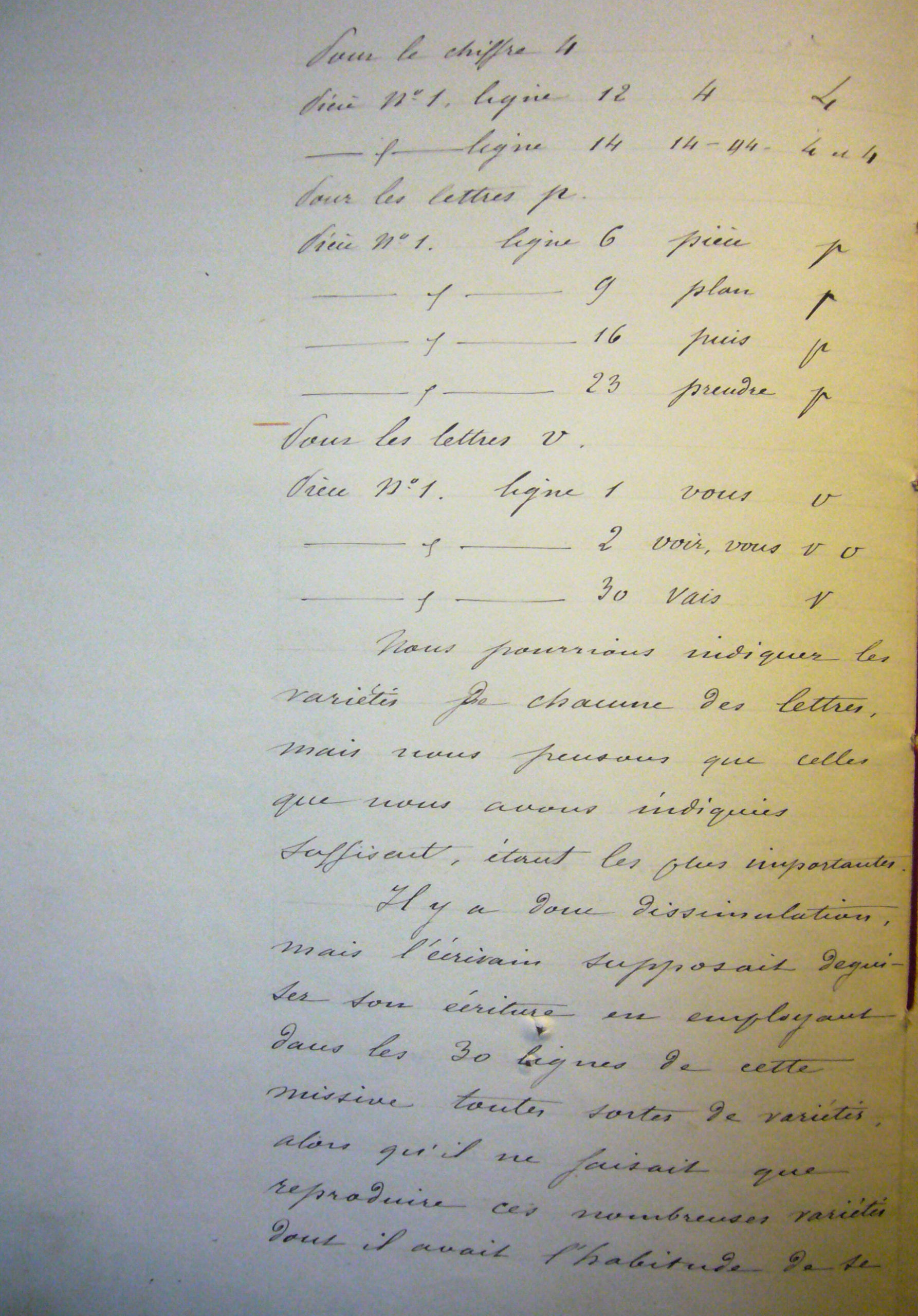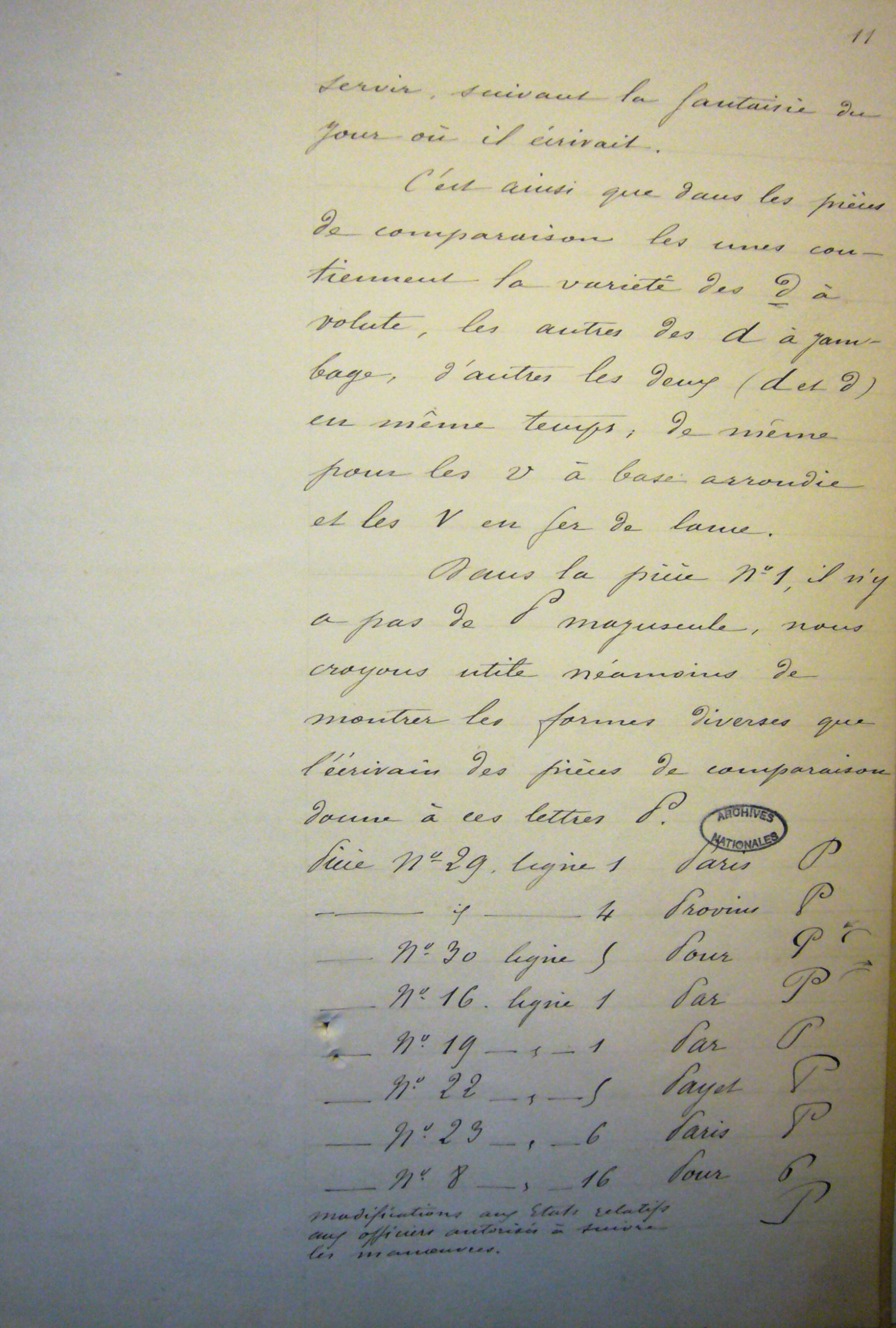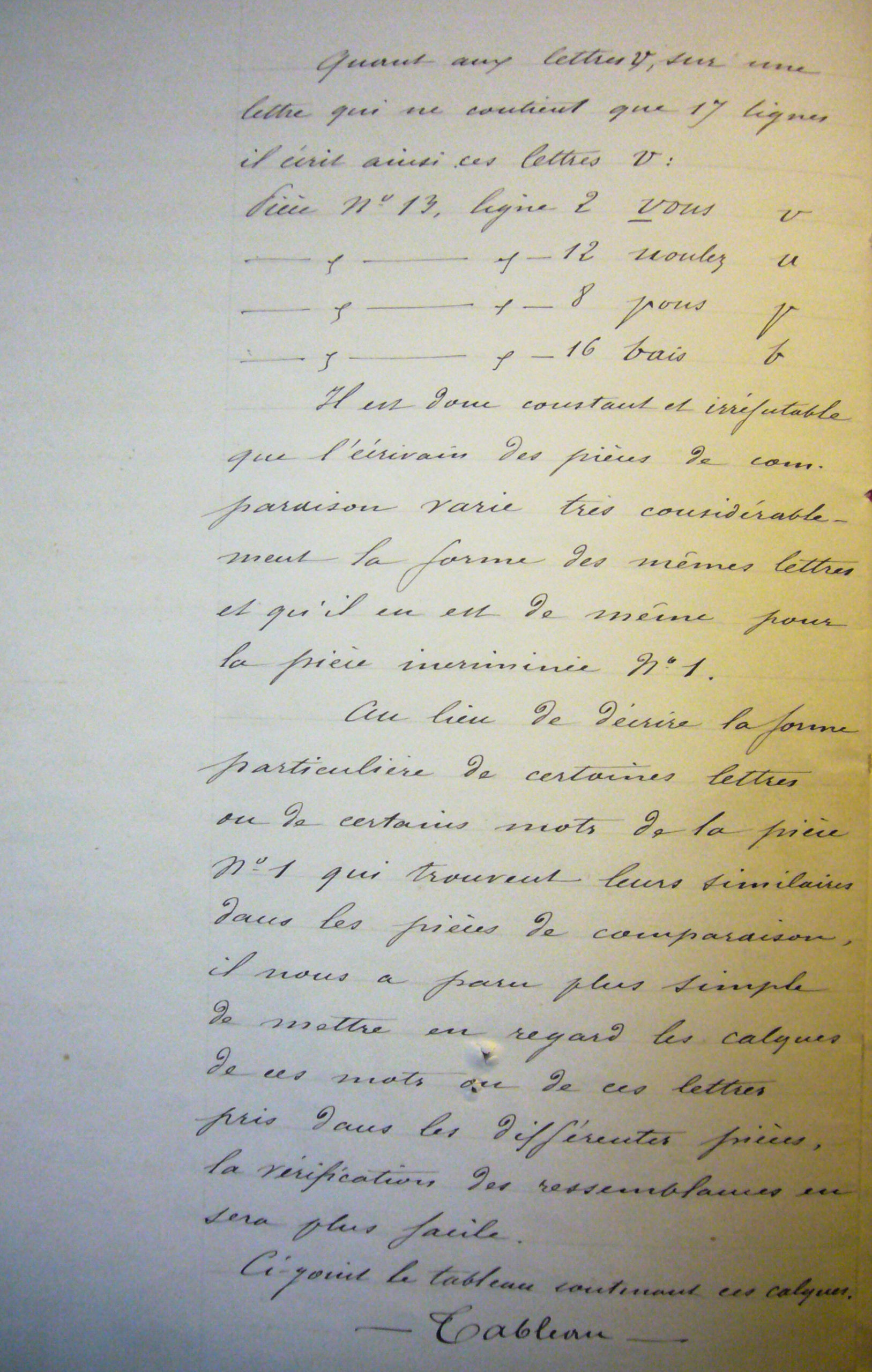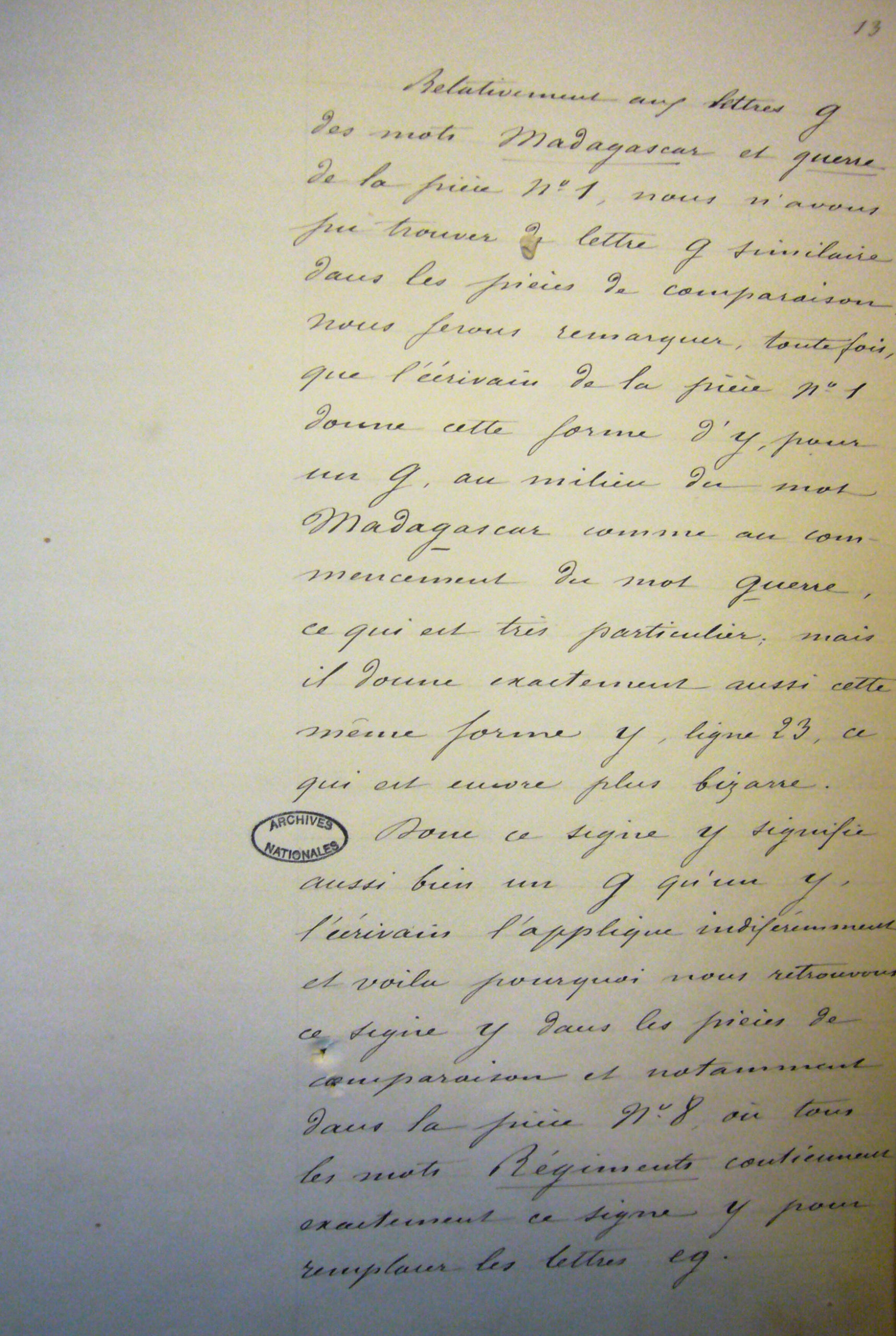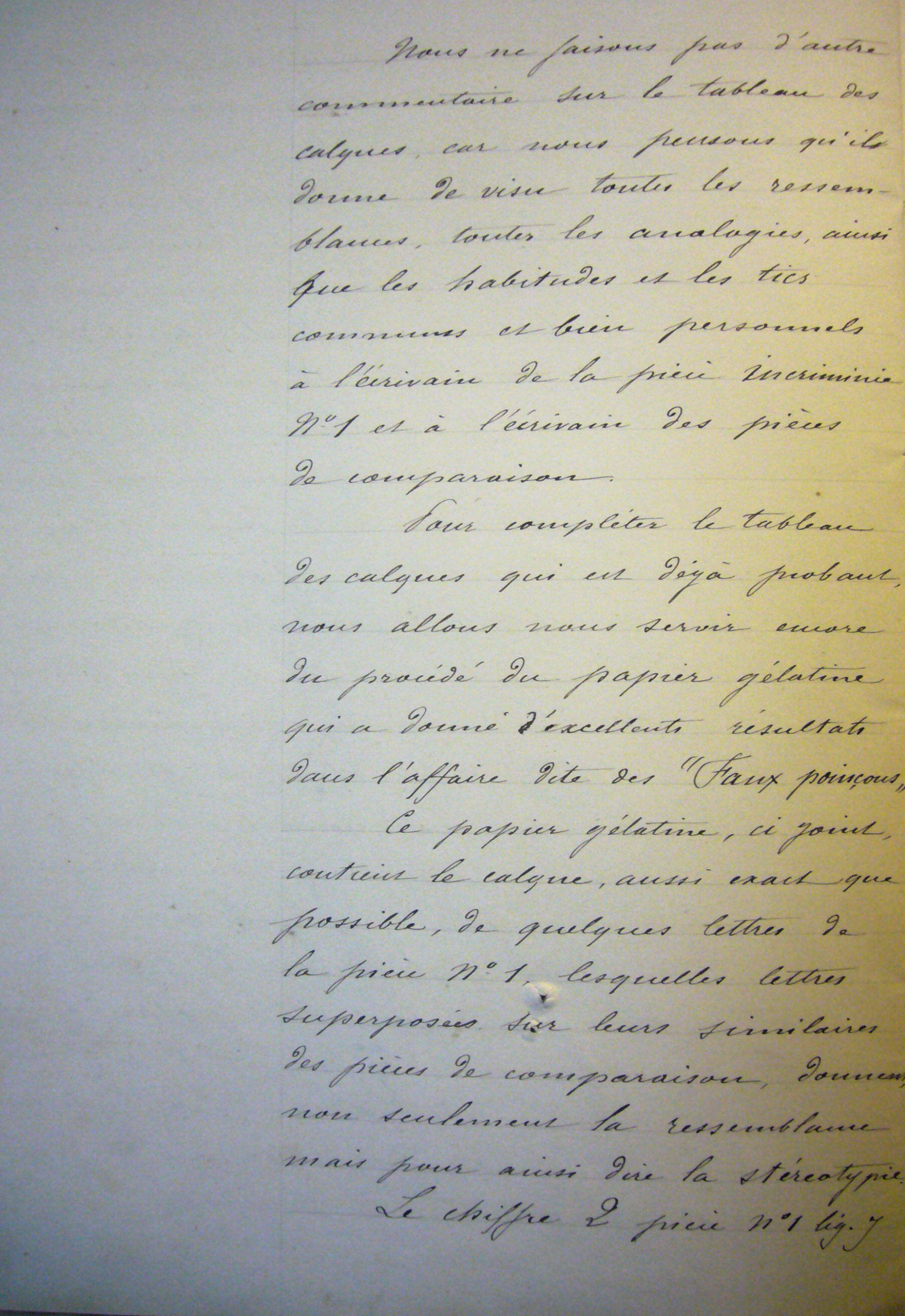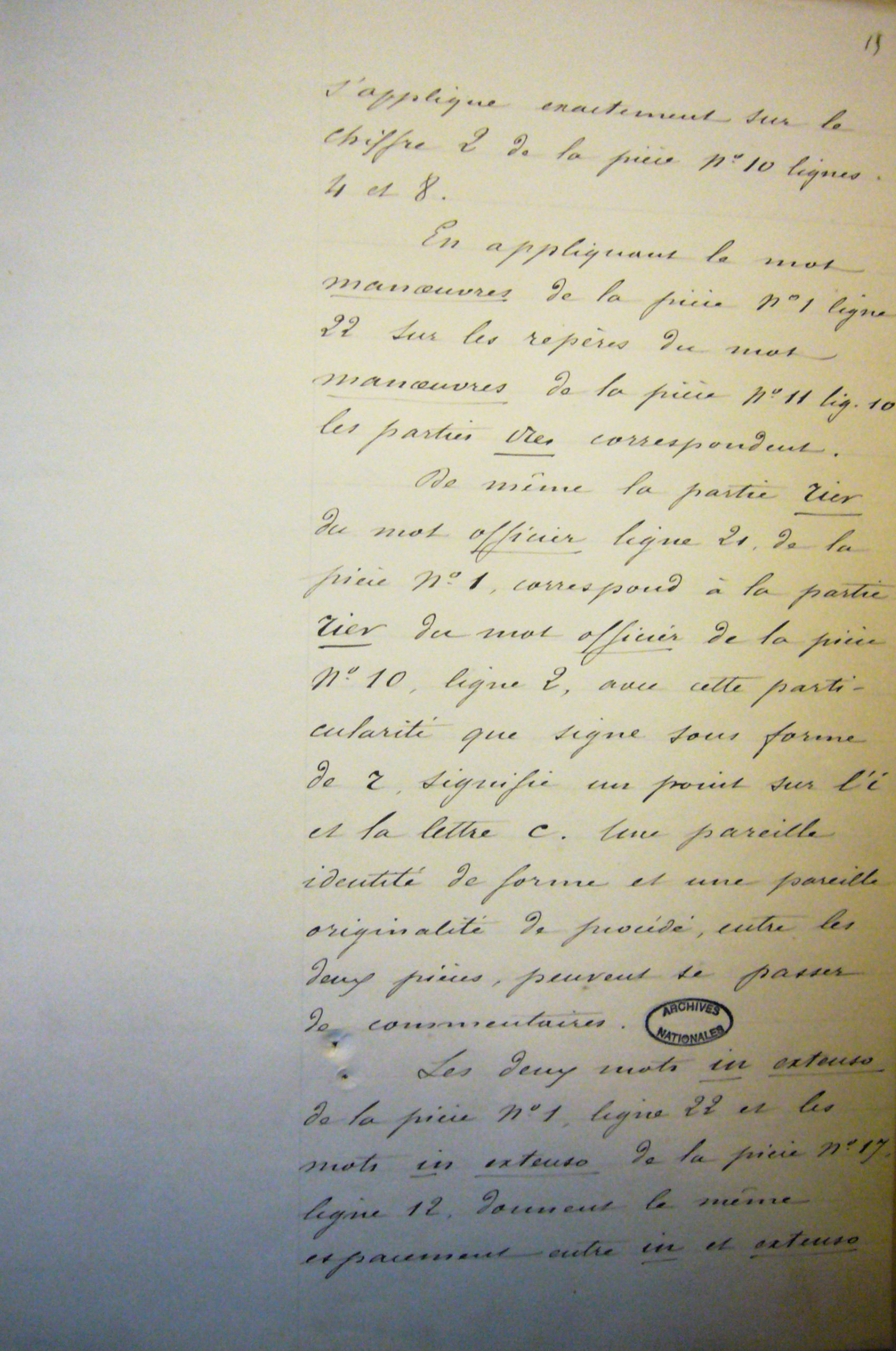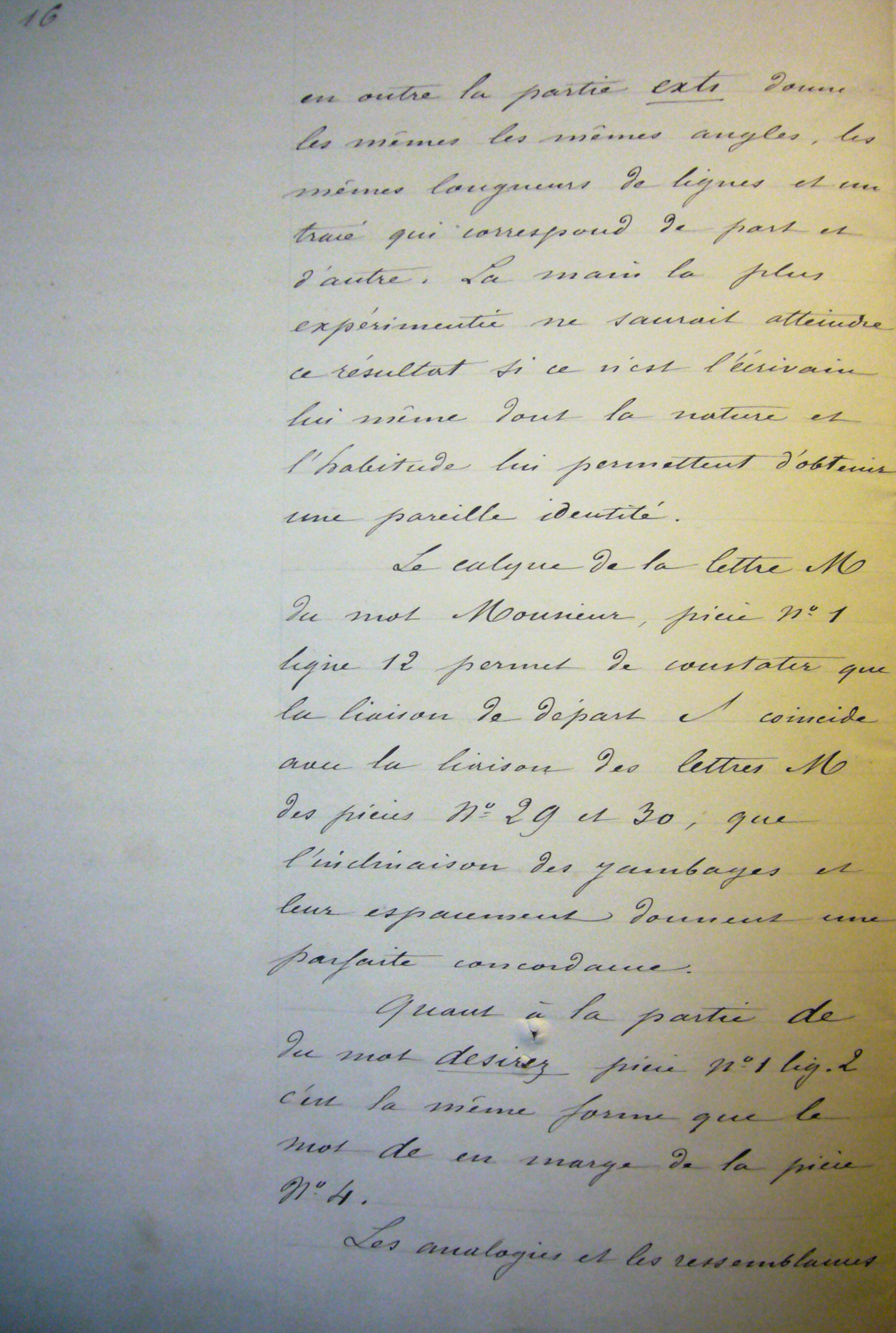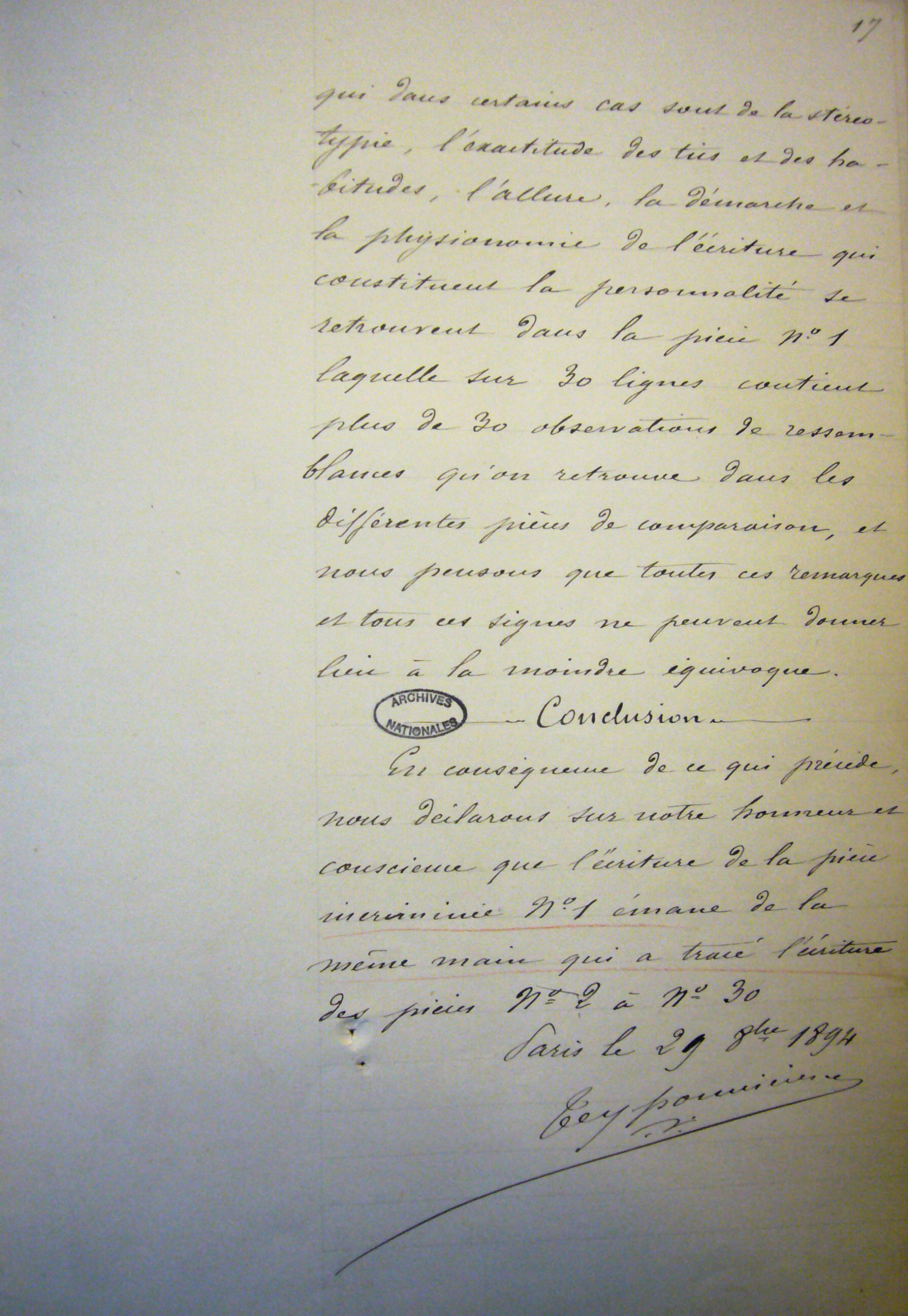Nous les avons déjà données mais il était intéressant de les regrouper ici :
Le bordereau est-il parvenu à Schwartzkoppen ?
Dans nos réflexions, qui sont aussi une réponse, relatives à ce que nous voulons considérer (et continuer à considérer) comme des « thèses fantaisistes », la question ne se pose pas : le bordereau est arrivé par la voie ordinaire… Elle ne se pose pas non pas parce que nous considérons qu’elle n’a pas à se poser ou parce que nous refusons qu’elle le soit mais uniquement parce que tous les éléments qui sont toujours mis en avant pour « prouver » le contraire (que le bordereau ne serait jamais parvenu à Schwartzkoppen) ne résistent guère à l’examen.
Compte rendu du D. (An Officer and a Spy) de Robert Harris
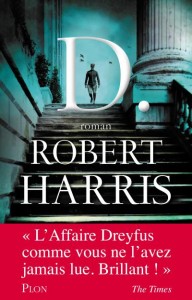 Que « les historiens ne s’en offusquent pas », écrit Gilles Heuré dans son compte rendu du livre de Robert Harris, mais « il est bien naturel que l’affaire Dreyfus, tombée dans le domaine public de l’histoire et déjà évoquée en leur temps par Roger Martin du Gard, Proust ou Octave Mirbeau, puisse faire aujourd’hui l’objet d’un roman. » Nous ne nous en offusquons pas mais avons en effet quelque méfiance de principe et d’autant plus que le projet de ce nouveau D. dû à Robert Harris n’est pas d’utiliser l’Affaire comme toile de fond mais de faire de l’Affaire un roman, autrement dit de nous donner à lire LE roman de l’Affaire Dreyfus. Inévitable donc, comme pour les adaptations cinématographiques, que l’événement soit simplifié, que certains acteurs soient oubliés quand d’autres trouvent une importance qu’ils n’ont jamais eue et que la dimension psychologique qui supporte la trame narrative trace des portraits qui ne sont pas toujours conformes. Le roman obéit à des règles que l’histoire ne connaît pas… En une note liminaire, l’auteur nous prévient d’ailleurs des libertés qu’il a pu prendre avec l’histoire. Et sur cette base, il nous livre en effet un roman passionnant, facile et agréable à lire, bien mené et haletant. Et de plus, relativement au sujet qui est le sien et à travers les pièces qu’il cite régulièrement, un roman bien documenté. Mais cela importe-t-il puisqu’il s’agit d’un roman ? Nous sommes là dans toute l’ambivalence qui est celle de cet objet tout à fait particulier et peu identifié. Il est un roman et peut donc faire ce qu’il veut de l’histoire réelle qui en est à l’origine tout en étant la narration d’un fait historique, documenté, fondé en partie sur un travail archivistique, et reposant sur la trame, les épisodes et les caractères de l’événement qui en est son sujet et dont l’auteur nous garantit d’ailleurs, en son liminaire, la « réalité » et le caractère « véridique ». « L’affaire Dreyfus comme vous ne l’avez jamais lue », nous dit l’argument marketing de la couverture. Roman d’histoire plus que roman historique donc ? Et dans ce cas – et je ne peux m’empêcher de penser au lecteur peu familier qui lira ici moins un roman d’Harris (tout en le lisant parce qu’il est un roman d’Harris) qu’un roman sur l’Affaire – D. demeure tout à fait problématique.
Que « les historiens ne s’en offusquent pas », écrit Gilles Heuré dans son compte rendu du livre de Robert Harris, mais « il est bien naturel que l’affaire Dreyfus, tombée dans le domaine public de l’histoire et déjà évoquée en leur temps par Roger Martin du Gard, Proust ou Octave Mirbeau, puisse faire aujourd’hui l’objet d’un roman. » Nous ne nous en offusquons pas mais avons en effet quelque méfiance de principe et d’autant plus que le projet de ce nouveau D. dû à Robert Harris n’est pas d’utiliser l’Affaire comme toile de fond mais de faire de l’Affaire un roman, autrement dit de nous donner à lire LE roman de l’Affaire Dreyfus. Inévitable donc, comme pour les adaptations cinématographiques, que l’événement soit simplifié, que certains acteurs soient oubliés quand d’autres trouvent une importance qu’ils n’ont jamais eue et que la dimension psychologique qui supporte la trame narrative trace des portraits qui ne sont pas toujours conformes. Le roman obéit à des règles que l’histoire ne connaît pas… En une note liminaire, l’auteur nous prévient d’ailleurs des libertés qu’il a pu prendre avec l’histoire. Et sur cette base, il nous livre en effet un roman passionnant, facile et agréable à lire, bien mené et haletant. Et de plus, relativement au sujet qui est le sien et à travers les pièces qu’il cite régulièrement, un roman bien documenté. Mais cela importe-t-il puisqu’il s’agit d’un roman ? Nous sommes là dans toute l’ambivalence qui est celle de cet objet tout à fait particulier et peu identifié. Il est un roman et peut donc faire ce qu’il veut de l’histoire réelle qui en est à l’origine tout en étant la narration d’un fait historique, documenté, fondé en partie sur un travail archivistique, et reposant sur la trame, les épisodes et les caractères de l’événement qui en est son sujet et dont l’auteur nous garantit d’ailleurs, en son liminaire, la « réalité » et le caractère « véridique ». « L’affaire Dreyfus comme vous ne l’avez jamais lue », nous dit l’argument marketing de la couverture. Roman d’histoire plus que roman historique donc ? Et dans ce cas – et je ne peux m’empêcher de penser au lecteur peu familier qui lira ici moins un roman d’Harris (tout en le lisant parce qu’il est un roman d’Harris) qu’un roman sur l’Affaire – D. demeure tout à fait problématique.
Journaux de l’Affaire Dreyfus
Deux petites séries de cartes postales sur la presse de la fin du XIXe siècle….
« L’Histoire-canon ». Au sujet de quelques ouvrages « du doute et du soupçon »
Georges Sorel, dans La Révolution dreyfusienne, écrit que « l’affaire Dreyfus ne mérite vraiment d’être racontée en détail que dans la forme du roman-feuilleton[1] ». Elle s’y prête assurément en ce qu’elle en contient tous les ingrédients : des personnages fortement typés, des héros et des traîtres, des morts énigmatiques, de constants rebondissements, des secrets et des révélations qui ne pouvaient qu’exciter les imaginations. Exciter l’imagination, sans doute, mais aussi le goût de la réclame de quelques-uns qui se fixèrent la mission de nous dire ce que nous ne savons pas et qui à vrai dire ne nous intéresse que rarement. Aux « mystères » qui existent, et qui sont assurément à relativiser, il fallait donc en ajouter d’autres pour découvrir quelques vérités cachées et dire le fin mot de l’histoire. Reprenons donc la lecture de ces trop nombreux ouvrages « du doute et du soupçon », comme le dit très justement Vincent Duclert, « élucubrations les plus futiles proférées du haut de l’érudition la plus revendiquée et la moins solide sur les “mystères cachés” de l’Affaire et de Dreyfus »[2].

 Dans ce qui deviendra une course effrénée à la révélation, celui qui ouvrit la voie fut, dans les années 30, Henri Mazel, poète symboliste, chantre de l’Idéalisme, partisan d’un arisme pré-fasciste et directeur de la revue L’Ermitage au début des années 1890. En 1934, il publia une Histoire et psychologie de l’affaire Dreyfus qui, tout en reprenant à l’antienne un certain nombre de refrains antidreyfusards[3] pour en arriver à dire qu’il n’y avait « rien eu de monstrueux dans l’erreur judiciaire dont le malheureux capitaine a été victime » (p. 205), avait pour but de permettre d’« obtenir définitivement [la] réconciliation » (p. 199 et 207). Sans poser la moindre hypothèse – ce qui est une constante du genre –, il révélait qu’il n’y avait pas eu trahison mais « une très subtile mystification machinée par M. de Schwartzkoppen ». Pourquoi ? Simplement pour « jouer un tour » – et quel tour ! – à Sandherr et à Esterhazy, agent de la Section de statistique, qui avaient tenté à ses dépens une intox… Voilà, c’est tout. Quelles preuves venaient étayer une telle thèse ? Aucune à vrai dire, si ce n’est que pour Mazel, et il en faisait une démonstration peu concluante, il était évident que le bordereau ne pouvait ni émaner d’un espion ni d’un officier français. Une intox, donc, qui pouvait expliquer l’usage du papier pelure, la thèse de la forgerie avancée par la plupart des experts, etc. Rien de plus.
Dans ce qui deviendra une course effrénée à la révélation, celui qui ouvrit la voie fut, dans les années 30, Henri Mazel, poète symboliste, chantre de l’Idéalisme, partisan d’un arisme pré-fasciste et directeur de la revue L’Ermitage au début des années 1890. En 1934, il publia une Histoire et psychologie de l’affaire Dreyfus qui, tout en reprenant à l’antienne un certain nombre de refrains antidreyfusards[3] pour en arriver à dire qu’il n’y avait « rien eu de monstrueux dans l’erreur judiciaire dont le malheureux capitaine a été victime » (p. 205), avait pour but de permettre d’« obtenir définitivement [la] réconciliation » (p. 199 et 207). Sans poser la moindre hypothèse – ce qui est une constante du genre –, il révélait qu’il n’y avait pas eu trahison mais « une très subtile mystification machinée par M. de Schwartzkoppen ». Pourquoi ? Simplement pour « jouer un tour » – et quel tour ! – à Sandherr et à Esterhazy, agent de la Section de statistique, qui avaient tenté à ses dépens une intox… Voilà, c’est tout. Quelles preuves venaient étayer une telle thèse ? Aucune à vrai dire, si ce n’est que pour Mazel, et il en faisait une démonstration peu concluante, il était évident que le bordereau ne pouvait ni émaner d’un espion ni d’un officier français. Une intox, donc, qui pouvait expliquer l’usage du papier pelure, la thèse de la forgerie avancée par la plupart des experts, etc. Rien de plus.
 Le deuxième ouvrage de cette série, Les Côtés mystérieux de l’affaire Dreyfus, parut trois ans plus tard. L’auteur, Armand Charpentier, dreyfusard émérite, y présentait une thèse – qui rencontrera un certain succès – qui devait permettre d’expliquer les fameuses zones d’ombres, à son point de vue nombreuses, de l’Affaire. Comment expliquer que coïncident si parfaitement la date (juillet 1894) à laquelle, selon les dires d’Esterhazy, Sandherr lui avait demandé d’entrer en relation avec les allemands[4] et celle donnée par Schwartzkoppen dans ses Carnets[5] ? Comment expliquer que Schwartzkoppen ait pu soutenir, toujours dans ses Carnets, n’avoir jamais reçu le bordereau ? Pourquoi, après avoir encouragé Picquart, quand il découvrit Esterhazy, à continuer son enquête, Gonse et Boisdeffre lui demandèrent-ils, tout à coup, fin août 1896, de l’abandonner ? Pourquoi les hommes de l’État-major décidèrent-ils, l’année suivante, de venir en aide à Esterhazy et de le protéger ? Pourquoi Boisdeffre avait-il parlé à Judet de la « valeur » des « service rendus » par Esterhazy et lui avait avoué ne pas connaître « le premier mot de l’Affaire » ? Qu’étaient ces preuves inconnues dont avait parlé le même Boisdeffre à Du Paty ? Et qu’étaient ces documents que Sandherr gardait « par devers [lui] » dont Henry avait parlé au procès Zola ? Étaient-ils les mêmes que ceux de ce dossier dont Sandherr avait dit à Du Paty, sans vouloir le lui montrer, qu’il « ne verra[it] jamais le jour[6] » ? Et ne pouvait-on croire Esterhazy qui, les dernières années, avait affirmé à tous et sans se lasser jamais qu’il avait écrit le bordereau sur les ordres et sous la dictée de Sandherr ? Pourquoi, encore, la veuve Henry avait-elle dit à Charpentier qu’elle jugeait « impossible que l’on puisse pour l’Histoire, faire un récit exact [de l’Affaire] avec des éléments trop pauvres et trop insuffisamment exacts[7] » ? Pour Charpentier, la réponse à toutes ces questions se trouvait dans la déposition de Wattinne faite à l’occasion de la seconde révision. Le gendre de Billot avait en effet raconté qu’à la question qu’il avait posée à Henry visant à savoir ce que pouvait avoir Sandherr « contre Dreyfus », il avait reçu pour réponse qu’il existait « quelque chose de particulier qu’[il] n’[avait] jamais connu », « une lettre venant d’Alsace et touchant quelqu’un de sa famille [de la famille de Dreyfus] ou de ses relations »[8]. Pour Charpentier, puisqu’il y avait un dossier dont Sandherr avait parlé à Henry et à Du Paty, cette lettre, perdue ou en tout cas depuis introuvable, devait en faire partie. Mais comment l’avait-il obtenue ? Et de qui ? Pour Charpentier, le correspondant de Sandherr, l’auteur de la « lettre d’Alsace », ne pouvait être qu’un de ses parents. Pourquoi ? Parce qu’ainsi seulement pouvait s’expliquer le secret, « secret qu’il n’eût pas gardé si les documents accusateurs lui avaient été adressés directement par un agent de contre-espionnage dont il n’aurait pas eu à cacher le nom ». Au terme d’une longue enquête en Alsace, Charpentier avait pu découvrir la trace d’un certain René Kullmann qui avait rendu « d’immenses services au 2e Bureau, tant que [son parent] Sandherr en [avait été] le chef ». Le parent était trouvé mais quel rapport avec Dreyfus ? Écoutons Charpentier raconter son histoire. Un jour de 1894, « un quelconque Dreyfus », nom « très répandu en Alsace », « voyageant dans l’Est français », aurait « pris quelques photographies de nos fortifications, en y ajoutant de menues notes » et aurait transmis le tout « à la police de Strasbourg, afin de se concilier les faveurs des autorités allemandes ». « Par une filière difficile à préciser [sic], ces notes, sur lesquelles figure le nom du voyageur Dreyfus, vont entre les mains de René Kullmann qui les envoie au colonel Sandherr. » Sandherr, découvrant cela, aurait cherché son traître et, commettant une erreur, porté ses soupçons sur le pauvre Dreyfus.
Le deuxième ouvrage de cette série, Les Côtés mystérieux de l’affaire Dreyfus, parut trois ans plus tard. L’auteur, Armand Charpentier, dreyfusard émérite, y présentait une thèse – qui rencontrera un certain succès – qui devait permettre d’expliquer les fameuses zones d’ombres, à son point de vue nombreuses, de l’Affaire. Comment expliquer que coïncident si parfaitement la date (juillet 1894) à laquelle, selon les dires d’Esterhazy, Sandherr lui avait demandé d’entrer en relation avec les allemands[4] et celle donnée par Schwartzkoppen dans ses Carnets[5] ? Comment expliquer que Schwartzkoppen ait pu soutenir, toujours dans ses Carnets, n’avoir jamais reçu le bordereau ? Pourquoi, après avoir encouragé Picquart, quand il découvrit Esterhazy, à continuer son enquête, Gonse et Boisdeffre lui demandèrent-ils, tout à coup, fin août 1896, de l’abandonner ? Pourquoi les hommes de l’État-major décidèrent-ils, l’année suivante, de venir en aide à Esterhazy et de le protéger ? Pourquoi Boisdeffre avait-il parlé à Judet de la « valeur » des « service rendus » par Esterhazy et lui avait avoué ne pas connaître « le premier mot de l’Affaire » ? Qu’étaient ces preuves inconnues dont avait parlé le même Boisdeffre à Du Paty ? Et qu’étaient ces documents que Sandherr gardait « par devers [lui] » dont Henry avait parlé au procès Zola ? Étaient-ils les mêmes que ceux de ce dossier dont Sandherr avait dit à Du Paty, sans vouloir le lui montrer, qu’il « ne verra[it] jamais le jour[6] » ? Et ne pouvait-on croire Esterhazy qui, les dernières années, avait affirmé à tous et sans se lasser jamais qu’il avait écrit le bordereau sur les ordres et sous la dictée de Sandherr ? Pourquoi, encore, la veuve Henry avait-elle dit à Charpentier qu’elle jugeait « impossible que l’on puisse pour l’Histoire, faire un récit exact [de l’Affaire] avec des éléments trop pauvres et trop insuffisamment exacts[7] » ? Pour Charpentier, la réponse à toutes ces questions se trouvait dans la déposition de Wattinne faite à l’occasion de la seconde révision. Le gendre de Billot avait en effet raconté qu’à la question qu’il avait posée à Henry visant à savoir ce que pouvait avoir Sandherr « contre Dreyfus », il avait reçu pour réponse qu’il existait « quelque chose de particulier qu’[il] n’[avait] jamais connu », « une lettre venant d’Alsace et touchant quelqu’un de sa famille [de la famille de Dreyfus] ou de ses relations »[8]. Pour Charpentier, puisqu’il y avait un dossier dont Sandherr avait parlé à Henry et à Du Paty, cette lettre, perdue ou en tout cas depuis introuvable, devait en faire partie. Mais comment l’avait-il obtenue ? Et de qui ? Pour Charpentier, le correspondant de Sandherr, l’auteur de la « lettre d’Alsace », ne pouvait être qu’un de ses parents. Pourquoi ? Parce qu’ainsi seulement pouvait s’expliquer le secret, « secret qu’il n’eût pas gardé si les documents accusateurs lui avaient été adressés directement par un agent de contre-espionnage dont il n’aurait pas eu à cacher le nom ». Au terme d’une longue enquête en Alsace, Charpentier avait pu découvrir la trace d’un certain René Kullmann qui avait rendu « d’immenses services au 2e Bureau, tant que [son parent] Sandherr en [avait été] le chef ». Le parent était trouvé mais quel rapport avec Dreyfus ? Écoutons Charpentier raconter son histoire. Un jour de 1894, « un quelconque Dreyfus », nom « très répandu en Alsace », « voyageant dans l’Est français », aurait « pris quelques photographies de nos fortifications, en y ajoutant de menues notes » et aurait transmis le tout « à la police de Strasbourg, afin de se concilier les faveurs des autorités allemandes ». « Par une filière difficile à préciser [sic], ces notes, sur lesquelles figure le nom du voyageur Dreyfus, vont entre les mains de René Kullmann qui les envoie au colonel Sandherr. » Sandherr, découvrant cela, aurait cherché son traître et, commettant une erreur, porté ses soupçons sur le pauvre Dreyfus.
[…] comment le prendre ?… Dire que des documents avaient été volés à la police de Strasbourg ? C’était impossible. Il est bien certain qu’en acceptant les renseignements que celui-ci lui envoyait, Sandherr avait dû s’engager sur l’honneur, non seulement à ne jamais le nommer, mais, même, à ne jamais indiquer la source d’où provenaient les renseignements. […]
Il fallait donc créer une pièce qui, tout en permettant d’arrêter Dreyfus, pût être montrée à l’officier de police judiciaire, à l’officier rapporteur et aux membres du conseil de guerre. Cette pièce fut la lettre-missive ou bordereau.
Et sur la base d’une idée trouvée dans un roman publié en feuilleton par Le Petit Journal de janvier à juillet 1894 – Les Deux frères de Louis Létang[9] –, et dont l’histoire a de curieux points communs avec l’Affaire, Sandherr et son collaborateur Henry auraient bâti tout un scénario dont Esterhazy, qui offrait l’avantage d’avoir une écriture proche de celle de Dreyfus, permettrait la réalisation. Sur les indications de Sandherr, Esterhazy aurait donc écrit le bordereau qui, déposé à l’ambassade d’Allemagne pendant une absence de Schwartzkoppen, aurait été récupéré par la « voie ordinaire ». Voilà donc pourquoi Esterhazy « ne commit aucun acte de trahison » et que, Sandherr mort, Henry s’était retrouvé le seul « détenteur du terrible secret » pour la protection duquel il manœuvra contre Picquart et commit tous ses faux[10].
Quel roman… Pourtant Charpentier ne doute guère et va même un peu plus loin encore :
[…] Évidemment, la version du voyageur n’est qu’une hypothèse et d’autres hypothèses peuvent être formulées. Mais, quelles qu’elles soient, on peut considérer comme certain que, vers la fin du printemps de 1894, Sandherr reçut de René Kullmann des documents sur l’un desquels figurait, vraisemblablement, le nom d’un « Dreyfus ».
D’autre part, il est bien certain que René Kullmann ne signait pas de son nom la correspondance secrète qu’il échangeait avec son cousin. Il avait dû prendre un pseudonyme. Or, […] la grand-mère du colonel Sandherr était une demoiselle Wilhelm. Il ne serait pas impossible que René Kullmann eût adopté ce nom pour signer ses lettres.
S’il en fut ainsi, la légende du fameux bordereau annoté de l’empereur d’Allemagne trouverait une explication plausible.
[…] Sans doute, sur l’annotation divulguée par la presse, le nom de Guillaume était orthographié « Wilhem » au lieu de « Wilhelm ». Mais, comme personne ne vit jamais cette annotation, il est fort probable que le premier journaliste qui en donna le texte commit la faute d’orthographe – qui ne fut peut-être qu’une erreur typographique – laquelle fut naturellement répétée par tous les journaux, puisqu’aucun texte ne permettait une vérification.
Ne cédons pas à l’irionie – facile – et contentons-nous de poser un certain nombre de questions qui demeurent sans réponse et entament considérablement cet ingénieux montage. Que justifie la piste du parent de Sandherr ? Quelle était cette obligation de tenir son nom secret ? Certes, si Charpentier donne quelques exemples d’Alsaciens qui avaient connu quelques ennuis avec les autorités allemandes pour leur activité d’espionnage[11], n’était-il pas possible à Henry et Sandherr d’être discrets, de ne rien révéler et de faire croire qu’elle émanait d’un des divers espions qui émargeaient à la Section de statistique ? N’aurait-il pas même été possible, comme pour le bordereau, de rester flou sur sa provenance dans l’acte d’accusation ? Et puis, surtout, n’était-il pas curieux pour taire cette source de préférer celle de l’ambassade qui constituait pourtant un acte bien plus grave ? Et, puisqu’il est question de l’ambassade, pourquoi se compliquer la vie en l’y déposant pour le récupérer ensuite ? N’était-il pas possible, s’il fallait absolument donner cette provenance, de conserver la pièce et de se contenter d’affirmer qu’elle avait été saisie rue de Lille ? Et pourquoi encore ne pas la signer simplement du nom de Dreyfus pour éviter toute discussion ? De même, si ce fameux dossier des « documents Z » – selon le nom que donne Charpentier au dossier contenant la « lettre d’Alsace » – était si terrible, pourquoi ne pas l’avoir joint au dossier secret de 1894 ? Pourquoi ne pas avoir mis Picquart et Boisdeffre dans la confidence dès le début et avoir laissé le second demander au premier d’enrichir le dossier ? Pourquoi aux premiers soupçons de Picquart ne pas lui avoir dit ce dont il retournait ? Soit par Henry, quand il fut au courant de la découverte de son chef ou par Gonse ou Boisdeffre quand – pour suivre la thèse de Charpentier – ils furent mis au courant par Henry ? Cela aurait évité bien des ennuis et Picquart, comme il l’avait dit au procès Zola, aurait « rempli [s]on devoir d’officier[12] ». De même, comment comprendre cette lettre insupportable qu’avait envoyée Henry à Picquart quand il remplissait sa mission en Tunisie, bien loin et ne risquant plus de gêner ? Quelle drôle d’idée, si la thèse de Charpentier avait été une réalité, de provoquer ainsi le disgracié et de lui donner une bonne raison de faire éclater une affaire qui aurait pu, sans cela, ne jamais voir le jour. Que penser encore de la lettre « Espérance » (et non « Speranza » comme le dit Charpentier p. 163) qu’ils envoyèrent à Esterhazy pour le prévenir ? Une lettre qui le laissait seul face à ses problèmes en lui disant que « c’[était] à [lui] maintenant de défendre [son] nom et l’honneur de [ses] enfants » ? N’aurait-il pas été plus simple, s’il fallait sauver cet ami, d’aller le voir dans sa province, de le mettre au courant de ce qui se tramait et de l’inviter à disparaître au plus vite ? Et pourquoi ne pas avoir mis Du Paty, que sa fantaisie rendait difficilement contrôlable, dans la confidence ? Pourquoi avoir fait écrire Esterhazy à Boisdeffre la lettre « p. de C. » si, comme le dit Charpentier, le chef d’État-major avait été informé par Henry à la fin du mois d’août ? Pourquoi ne pas lui avoir dit que Boisdeffre était au courant du « secret », comme l’indique le fait qu’Esterhazy envoya au chef d’État-major la lettre anonyme du 24 octobre pour vérifier que la protection venait d’en haut ? Et pourquoi lui avoir fait aussi écrire à Félix Faure au risque de tout compromettre ? Pourquoi lui avoir encore fait écrire, le 7 novembre, cette lettre à Picquart qui ne pouvait qu’engager l’ancien chef de la Section de statistique à passer à l’offensive tout en lui apprenant que l’homme qu’il avait soupçonné était au courant de son enquête ? Pourquoi encore n’avoir pas mis Pellieux et Ravary, consciencieusement stylés, au courant du « secret » ?
Nous pourrions ainsi multiplier à l’infini ces questions qui montrent le peu de solidité de la thèse de Charpentier. Mais si elle ne tient guère, cette thèse, qu’en est-il alors de ces fameuses zones d’ombres à l’origine de cet incroyable montage ? Reprenons les principales questions posées par Charpentier et voyons combien elles peuvent trouver aisément leur réponse sans être obligé d’échafauder ce véritable roman. Si la question de la coïncidence des dates entre les dires d’Esterhazy et les souvenirs de Schwartzkoppen peut être vite écartée – c’est bien le 20 juillet qu’eut lieu une première rencontre à laquelle Sandherr ne devait rien –, celle de l’affirmation de Schwartzkoppen selon laquelle il n’avait jamais reçu le bordereau est plus intéressante et assez facile à résoudre. Que vaut le témoignage de Schwartzkoppen à ce sujet ? Ne peut-on penser qu’il le reçut bien mais ne pouvait l’avouer sans reconnaître avoir été bien léger, bien inconséquent en confiant à sa corbeille à papier une lettre d’une telle importance ? Concernant le changement d’attitude de Gonse et de Boisdeffre, la réponse est simple. Mais avant d’y répondre une petite précision s’impose. Charpentier se trompe – à moins qu’il ne force les événements pour coller à sa thèse – quand il écrit : « Certain, désormais, de l’importance de sa découverte, Picquart en parle à de Boisdeffre, puis à Gonse. Ceux-ci le félicitent de façon discrète dont il a conduit son enquête et l’invitent à la poursuivre. Puis, insensiblement, vers la fin d’août, leur attitude se modifie. Gonse recommande à Picquart de ne pas mêler l’Affaire Dreyfus à l’Affaire Esterhazy, alors que le bon sens commanderait au contraire de procéder à une comparaison immédiate des trois écritures en cause. » Et c’est à ce moment, selon lui, qu’Henry, inquiet, informa ses chefs du secret de Sandherr (p. 161-162). Cela expliquant ceci. Charpentier bouleverse ici les événements. Ce fut le 5 août que la première fois Picquart parla à Boisdeffre de sa découverte. Mais il s’était bien gardé, prudent, de parler de sa conviction qu’Esterhazy était le véritable auteur du bordereau. C’est à la fin d’août qu’il la lui révéla et c’est le 3 septembre que pour la première fois il en parla à Gonse qui ne le félicita aucunement mais lui demanda au contraire et dès les premiers mots de distinguer les deux affaires. Il n’y a aucun mystère ici. Gonse ne changea donc aucunement d’avis et s’il lui fit cette demande ce n’était que parce qu’il ne voulait pas d’une enquête qui eût pu amener à la révision du procès Dreyfus. De même, si Henry avait parlé à ce moment à Gonse et Boisdeffre du fameux secret, comme le soutien Charpentier, comment expliquer que pour tenter d’entrer au ministère, démarche qu’il entreprenait depuis avril précédent, Esterhazy se fût adressé à des députés et pas directement à Henry auquel il aurait pu faire valoir – ce qui était bien dans sa manière – de sérieux arguments pour qu’il intervînt et intervînt vite auprès de ses chefs ? Mais Picquart avait commencé son enquête, pourrait répondre Charpentier, et Henry ne devait pas se brûler. Sans doute mais alors Henry n’aurait-il pas eu tout à fait intérêt à prendre contact avec son « ami » et lui demander, au nom de leur cher secret, de s’abstenir d’une démarche pour le moins dangereuse ? Autre question. Pourquoi Henry, Gonse, etc. défendirent-ils Esterhazy et machinèrent-ils ces rendez-vous de roman-feuilleton pour le sauver ? Pourquoi, comme le demande Charpentier, n’ont-ils pas « laissé les événements se dérouler d’eux-mêmes et attendu en toute tranquillité de connaître les faits sur lesquels l’honorable vice-président du Sénat appuierait sa requête » ? Pourquoi une telle inquiétude ? (p. 162-163). Mais tout simplement parce qu’ils étaient compromis, parce qu’une illégalité avait été commise en 1894, parce qu’Henry avait fait un faux témoignage au procès, parce qu’ils avaient promis à Mercier de ne jamais rien dire de ce qui s’était passé… Et pourquoi croire que si Boisdeffre, à Du Paty, Henry, au procès Zola, avait parlé de documents plus importants que le bordereau, ce ne pouvait être que parce que ces documents existaient ? Ne pouvait-il s’agir que de nouveaux mensonges qui avaient tout simplement pour but de faire comprendre que, si le dossier connu n’était guère probant, il existait de vraies, de graves preuves, de trop graves preuves pour les livrer au public ?
Non la thèse de Charpentier est décidément bien fragile. Mais restons encore un peu avec lui. Car en effet il ne s’en tient pas là. Dans la seconde partie de son livre, il développe une autre théorie relative à la mort d’Henry en partant de la juste remarque qu’il « n’avait aucune raison pour se tuer ». Rejetant la thèse du suicide et celle de la mort maquillée et de la fuite d’Henry, dont la presse s’était faite l’écho en 1905[13], il proposait une autre explication : « Ou bien ce fut l’apoplexie foudroyante, ce qui n’est pas impossible. Ou bien, [un] visiteur inconnu [dont il avait découvert l’existence] lui tendit “la boulette” fatale, car il ne fallait pas songer au revolver dont la présence en ses mains n’aurait pu se justifier. » Charpentier « inclin[ait] pour la boulette » en raison du mot incohérent destiné par Henry à sa femme, mot qui avait été retrouvé sur sa table et dans lequel il disait être sur le point d’aller « [s]e baigner dans la Seine ». Le mystérieux visiteur, une fois le poison ingéré, lui aurait tranché la gorge pour faire croire au suicide. Voilà ce qui selon Charpentier pouvait expliquer le fait qu’Henry, droitier, ait été retrouvé le rasoir, et le rasoir fermé, dans la main gauche. Le fait est mystérieux, c’est indéniable. Mais cela dit, il est difficile de suivre Charpentier dans sa théorie du « visiteur » qui ne repose que sur une hypothèse formulée par Esterhazy[14] et dans la raison qu’il donne de ce qu’il faut bien considérer comme un assassinat, à savoir la nécessité de protéger le secret des fameux « documents Z » (p. 288-289). Nous ne savons bien sûr pas ce qui s’est réellement passé ce 31 août 1898 dans la cellule 13 du Mont-Valérien. Mais nous serions assez enclin à préférer une solution que ne propose pas Charpentier, et que nous avons évoquée précédemment, celle du « suicide par suggestion ». Ne peut-on penser en effet que ne pas enlever à Henry son rasoir était en tout comparable au pistolet laissé à disposition de Dreyfus le jour de la dictée ? Nous serions bien là dans les manières de l’État-major… Mais demeure ce mystère du rasoir fermé (ou « à demi fermé », comme le corrigera Walter en 1903[15]) et de sa présence dans la main gauche d’un droitier…
 La curiosité suivante qui devait nous dire toute la vérité vit le jour en 1960. D’Esterhazy à Dreyfus,d’Henri Giscard d’Estaing, reprenait la thèse de Paléologue qui, dans son Journal de L’Affaire Dreyfus, avait, sans entrer dans les détails, proposé une « hypothèse constructive » qui expliquait selon lui toute l’affaire. Il n’y aurait pas eu un coupable mais trois : Esterhazy, son ami Weil et « un officier d’un très haut grade, qui, après avoir occupé pendant plusieurs années des fonctions importantes au ministère de la Guerre, exerce aujourd’hui un commandement de troupes » (p. 156). Paléologue, modeste, s’était contenté d’ouvrir la piste. Mais son éditeur, Plon, assurément pour en prolonger la vente – en « parfaire la thèse », comme le dit l’introduction du Giscard[16] –, éditera ce curieux D’Esterhazy à Dreyfus. Reposant sur une méconnaissance assez vertigineuse de l’Affaire, l’auteur expose, sans la moindre précaution, une thèse, exposition de « l’organisme » et non de « la tumeur », qui n’a pour but que de donner le nom que Paléologue avait gardé pour lui et qui permettrait d’établir « les vraies culpabilités de 1894[17] ». Esterhazy serait l’auteur du bordereau et le deuxième homme dont parle Paléologue, l’« officier d’un très haut grade », celui qui lui fournissait les documents et ne pouvait qu’appartenir à l’État-major, ne serait pas le général Rau, comme beaucoup le dirent[18] mais Mercier ! Et bien sûr tout cela n’aurait eu pour but que de protéger la fabrication du canon de 75, première occurrence de ce qui deviendra bientôt une véritable obsession. Critique avisé, Giscard corrigeait toutefois les erreurs du diplomate et entre autres celle de la complicité d’Henry dont Reinach – que Giscard s’obstine à nommer pour une raison que nous nous expliquons mal « Bernard Lazare » – avait fait l’axe de sa lecture de l’Affaire. La démonstration mérite d’être exposée[19]. Jusqu’au procès Zola, les défenseurs de Dreyfus avaient défendu une thèse simple : Dreyfus était innocent et Esterhazy coupable. Mais après la déposition de Pellieux – suffisante pour leur faire changer d’avis (!?) –, déposition qui établissait qu’Esterhazy n’avait pu être en mesure de livrer les documents énumérés au bordereau, ils avaient dû revoir leur copie. Bernard Reinach devait donc reprendre sa thèse et trouver un complice à Esterhazy, un complice qui devait bien sûr appartenir à l’État-major. Henry serait donc ce complice, thèse qui ne pourrait être contredite puisqu’Henry avait avoué son faux et s’était tué. Joseph Lazare en fera son « grand cheval de bataille », comme Zola d’ailleurs qui sur la base de « ce bagage sommaire […] enfla les effets oratoires de sa fameuse lettre “J’accuse” ». A-t-on compris ? En février 1898 (procès Zola), Zola et Reinach – que nous pouvons arrêter de nommer Lazare – portèrent toute la responsabilité sur Henry qui offrait l’avantage d’être mort depuis… sept mois plus tard… Et parce qu’en février 1898, ils avaient pris conscience de cela, Zola pourra en parler dans son « J’Accuse.. ! »… le mois précédent… Quant au petit bleu, il était l’œuvre des amis de Dreyfus… Comme l’écrit Giscard à propos de Charpentier : « Soyons magnanime et arrêtons-là un massacre trop facile…[20] »
La curiosité suivante qui devait nous dire toute la vérité vit le jour en 1960. D’Esterhazy à Dreyfus,d’Henri Giscard d’Estaing, reprenait la thèse de Paléologue qui, dans son Journal de L’Affaire Dreyfus, avait, sans entrer dans les détails, proposé une « hypothèse constructive » qui expliquait selon lui toute l’affaire. Il n’y aurait pas eu un coupable mais trois : Esterhazy, son ami Weil et « un officier d’un très haut grade, qui, après avoir occupé pendant plusieurs années des fonctions importantes au ministère de la Guerre, exerce aujourd’hui un commandement de troupes » (p. 156). Paléologue, modeste, s’était contenté d’ouvrir la piste. Mais son éditeur, Plon, assurément pour en prolonger la vente – en « parfaire la thèse », comme le dit l’introduction du Giscard[16] –, éditera ce curieux D’Esterhazy à Dreyfus. Reposant sur une méconnaissance assez vertigineuse de l’Affaire, l’auteur expose, sans la moindre précaution, une thèse, exposition de « l’organisme » et non de « la tumeur », qui n’a pour but que de donner le nom que Paléologue avait gardé pour lui et qui permettrait d’établir « les vraies culpabilités de 1894[17] ». Esterhazy serait l’auteur du bordereau et le deuxième homme dont parle Paléologue, l’« officier d’un très haut grade », celui qui lui fournissait les documents et ne pouvait qu’appartenir à l’État-major, ne serait pas le général Rau, comme beaucoup le dirent[18] mais Mercier ! Et bien sûr tout cela n’aurait eu pour but que de protéger la fabrication du canon de 75, première occurrence de ce qui deviendra bientôt une véritable obsession. Critique avisé, Giscard corrigeait toutefois les erreurs du diplomate et entre autres celle de la complicité d’Henry dont Reinach – que Giscard s’obstine à nommer pour une raison que nous nous expliquons mal « Bernard Lazare » – avait fait l’axe de sa lecture de l’Affaire. La démonstration mérite d’être exposée[19]. Jusqu’au procès Zola, les défenseurs de Dreyfus avaient défendu une thèse simple : Dreyfus était innocent et Esterhazy coupable. Mais après la déposition de Pellieux – suffisante pour leur faire changer d’avis (!?) –, déposition qui établissait qu’Esterhazy n’avait pu être en mesure de livrer les documents énumérés au bordereau, ils avaient dû revoir leur copie. Bernard Reinach devait donc reprendre sa thèse et trouver un complice à Esterhazy, un complice qui devait bien sûr appartenir à l’État-major. Henry serait donc ce complice, thèse qui ne pourrait être contredite puisqu’Henry avait avoué son faux et s’était tué. Joseph Lazare en fera son « grand cheval de bataille », comme Zola d’ailleurs qui sur la base de « ce bagage sommaire […] enfla les effets oratoires de sa fameuse lettre “J’accuse” ». A-t-on compris ? En février 1898 (procès Zola), Zola et Reinach – que nous pouvons arrêter de nommer Lazare – portèrent toute la responsabilité sur Henry qui offrait l’avantage d’être mort depuis… sept mois plus tard… Et parce qu’en février 1898, ils avaient pris conscience de cela, Zola pourra en parler dans son « J’Accuse.. ! »… le mois précédent… Quant au petit bleu, il était l’œuvre des amis de Dreyfus… Comme l’écrit Giscard à propos de Charpentier : « Soyons magnanime et arrêtons-là un massacre trop facile…[20] »
 En 1962, L’Enigme Esterhazy d’Henri Guillemin nous offrit une nouvelle thèse. Refusant celle de Marcel Thomas, « docilité […] au dogme posé par l’État-Major » (p. 259), il proposait l’hypothèse suivante : Sandherr aurait découvert que Saussier – l’« X » mystérieux de Paléologue, selon lui, – fournissait – sans doute au terme d’un chantage – les documents qu’Esterhazy livrait. Il aurait alors fait écrire à Esterhazy un bordereau reprenant des documents précédemment livrés dans le but que la photographie vînt sous les yeux de Saussier et qu’il comprît que tout étant découvert il lui faudrait à l’avenir « se montrer plus circonspect ». La seule chose qu’il n’avait pas prévue était que le zèle de d’Aboville découvrirait dans ce bordereau, ce faux document de trahison, la main d’un jeune stagiaire qui n’avait vraiment rien à y voir (p. 288-290). Cette hypothèse, cette « rêverie » comme la qualifie Guillemin lui-même (p. 290), reposait sur le fait que Saussier avait toujours été, en 1894, partisan de ne rien faire et qu’il n’avait pas jugé bon de faire arrêter Esterhazy en 1897. Le fait, exact, de 1894, ne prouve pas grand-chose : Hanotaux était du même avis et n’est pas complice pour cela. Mais ce n’est pas exactement de cette manière que le présente Guillemin : il parle, lui, d’une tentative « d’empêcher, en 1894, toute poursuite, toute enquête même, lorsque le bordereau a surgi » (p. 286). Si tel avait été le cas, pourquoi Saussier aurait-il signé l’ordre de mise en jugement ? Pourquoi avoir dit à Casimir-Perier, qui s’étonnait qu’il engageât les poursuites, que les conclusions du rapport ne lui « permettaient pas d’agir autrement » ? La décision lui incombait, à lui seul, et il était libre, s’il l’avait voulu, d’aller contre le rapporteur. La peur de la presse pouvait-elle suffire à expliquer une décision qui risquait de le perdre ? Et quel formidable sang-froid que celui d’un complice qui ajoutait : « d’ailleurs qu’importe ? Le conseil de guerre décidera »[21]. Il est vrai, toutefois, que Saussier ne fit rien en 1897 pour faire arrêter Esterhazy. Mais nous savons que s’il ne le fit pas c’est parce que Billot le refusait[22] ? Saussier avait-il vraiment beaucoup de chance ou Billot était-il aussi complice ?
En 1962, L’Enigme Esterhazy d’Henri Guillemin nous offrit une nouvelle thèse. Refusant celle de Marcel Thomas, « docilité […] au dogme posé par l’État-Major » (p. 259), il proposait l’hypothèse suivante : Sandherr aurait découvert que Saussier – l’« X » mystérieux de Paléologue, selon lui, – fournissait – sans doute au terme d’un chantage – les documents qu’Esterhazy livrait. Il aurait alors fait écrire à Esterhazy un bordereau reprenant des documents précédemment livrés dans le but que la photographie vînt sous les yeux de Saussier et qu’il comprît que tout étant découvert il lui faudrait à l’avenir « se montrer plus circonspect ». La seule chose qu’il n’avait pas prévue était que le zèle de d’Aboville découvrirait dans ce bordereau, ce faux document de trahison, la main d’un jeune stagiaire qui n’avait vraiment rien à y voir (p. 288-290). Cette hypothèse, cette « rêverie » comme la qualifie Guillemin lui-même (p. 290), reposait sur le fait que Saussier avait toujours été, en 1894, partisan de ne rien faire et qu’il n’avait pas jugé bon de faire arrêter Esterhazy en 1897. Le fait, exact, de 1894, ne prouve pas grand-chose : Hanotaux était du même avis et n’est pas complice pour cela. Mais ce n’est pas exactement de cette manière que le présente Guillemin : il parle, lui, d’une tentative « d’empêcher, en 1894, toute poursuite, toute enquête même, lorsque le bordereau a surgi » (p. 286). Si tel avait été le cas, pourquoi Saussier aurait-il signé l’ordre de mise en jugement ? Pourquoi avoir dit à Casimir-Perier, qui s’étonnait qu’il engageât les poursuites, que les conclusions du rapport ne lui « permettaient pas d’agir autrement » ? La décision lui incombait, à lui seul, et il était libre, s’il l’avait voulu, d’aller contre le rapporteur. La peur de la presse pouvait-elle suffire à expliquer une décision qui risquait de le perdre ? Et quel formidable sang-froid que celui d’un complice qui ajoutait : « d’ailleurs qu’importe ? Le conseil de guerre décidera »[21]. Il est vrai, toutefois, que Saussier ne fit rien en 1897 pour faire arrêter Esterhazy. Mais nous savons que s’il ne le fit pas c’est parce que Billot le refusait[22] ? Saussier avait-il vraiment beaucoup de chance ou Billot était-il aussi complice ?
 Il faudra attendre dix ans pour découvrir la nouvelle thèse et lire L’Affaire Dreyfus. La Clé du mystère de Michel de Lombarès[23]. Variation des précédents, il revenait sur la thèse du « troisième homme » qui pour lui, indiscutablement, ne pouvait être que Saussier. Aucune trahison ici, mais, à nouveau, une histoire de renseignements sur fond d’intox qui avait pour but de protéger l’inévitable canon de 75. Pour aider Saussier à en savoir plus sur les avancées de l’artillerie allemande qui développait de son côté un nouveau canon, son ami et ancien ordonnance Weil aurait eu l’idée de faire appel à Esterhazy et de lui faire proposer ses services à Schwartzkoppen. « […] on verrait bien, d’après les questions qui lui seraient posées, où en sont les études de canon à tir rapide en Allemagne. » Saussier n’aurait eu qu’à « donner son accord » et « fournir, de temps en temps, quelques documents, quelques renseignements, qui pourront être périmés ou faux, pourvu qu’ils soient vraisemblables ». Et ce faisant Saussier ne pourrait que « faire œuvre utile en fournissant de tels renseignements dans le cadre de la campagne d’intoxication que commence le directeur de l’Artillerie pour tromper le Grand État-Major allemand sur nos études de canons à long recul » (p. 36-37). A cette nouvelle thèse, Lombarès, sentant qu’il serait difficile d’y faire coïncider le bordereau, venait en ajouter une autre : le fameux document ne serait pas l’œuvre d’Esterhazy mais celui du S.R. allemand qui voulait ainsi vérifier une dénonciation récente au sujet de la manière dont le S.R. français obtenait ses informations et, donc, s’assurer que la corbeille à papiers de Schwartzkoppen n’en était pas la source. Si les renseignements obtenus étaient exacts, le bordereau, imitant l’écriture d’Esterhazy et parlant de documents récemment livrés, parviendrait, « par la voie dénoncée, au S.R. français. Ce service reprochera cette imprudente lettre à Esterhazy. Ce dernier niera en être l’auteur. On ne le croira pas. Au cas, bien improbable, où on le croirait, on comprendrait qu’il est “brûlé” et que, par un juste retour des choses, la corbeille à papiers de Schwartzkoppen est devenue une source d’intoxication. Dans tous les cas, Esterhazy sera tellement surpris qu’il réagira inévitablement, d’une manière ou d’une autre, auprès de Schwartzkoppen. Le contre-espionnage allemand aura ainsi, d’un même coup, vérifiés les renseignements de la [dénonciation] et démontré aux services de l’espionnage que leur prétendu traître n’est qu’un agent du S.R. français » (p. 239).
Il faudra attendre dix ans pour découvrir la nouvelle thèse et lire L’Affaire Dreyfus. La Clé du mystère de Michel de Lombarès[23]. Variation des précédents, il revenait sur la thèse du « troisième homme » qui pour lui, indiscutablement, ne pouvait être que Saussier. Aucune trahison ici, mais, à nouveau, une histoire de renseignements sur fond d’intox qui avait pour but de protéger l’inévitable canon de 75. Pour aider Saussier à en savoir plus sur les avancées de l’artillerie allemande qui développait de son côté un nouveau canon, son ami et ancien ordonnance Weil aurait eu l’idée de faire appel à Esterhazy et de lui faire proposer ses services à Schwartzkoppen. « […] on verrait bien, d’après les questions qui lui seraient posées, où en sont les études de canon à tir rapide en Allemagne. » Saussier n’aurait eu qu’à « donner son accord » et « fournir, de temps en temps, quelques documents, quelques renseignements, qui pourront être périmés ou faux, pourvu qu’ils soient vraisemblables ». Et ce faisant Saussier ne pourrait que « faire œuvre utile en fournissant de tels renseignements dans le cadre de la campagne d’intoxication que commence le directeur de l’Artillerie pour tromper le Grand État-Major allemand sur nos études de canons à long recul » (p. 36-37). A cette nouvelle thèse, Lombarès, sentant qu’il serait difficile d’y faire coïncider le bordereau, venait en ajouter une autre : le fameux document ne serait pas l’œuvre d’Esterhazy mais celui du S.R. allemand qui voulait ainsi vérifier une dénonciation récente au sujet de la manière dont le S.R. français obtenait ses informations et, donc, s’assurer que la corbeille à papiers de Schwartzkoppen n’en était pas la source. Si les renseignements obtenus étaient exacts, le bordereau, imitant l’écriture d’Esterhazy et parlant de documents récemment livrés, parviendrait, « par la voie dénoncée, au S.R. français. Ce service reprochera cette imprudente lettre à Esterhazy. Ce dernier niera en être l’auteur. On ne le croira pas. Au cas, bien improbable, où on le croirait, on comprendrait qu’il est “brûlé” et que, par un juste retour des choses, la corbeille à papiers de Schwartzkoppen est devenue une source d’intoxication. Dans tous les cas, Esterhazy sera tellement surpris qu’il réagira inévitablement, d’une manière ou d’une autre, auprès de Schwartzkoppen. Le contre-espionnage allemand aura ainsi, d’un même coup, vérifiés les renseignements de la [dénonciation] et démontré aux services de l’espionnage que leur prétendu traître n’est qu’un agent du S.R. français » (p. 239).
Le problème est que rien n’étaye une telle thèse. Rien ne dit que l’auteur de la dénonciation, la femme Millescamps, ait parlé du « ramassage de papiers dans la corbeille de l’attaché militaire », comme le soutient avec assurance Lombarès (p. 238). Dans un rapport à Münster de 1896, Schwartzkoppen, revenant sur l’affaire, avait expliqué que la Millescamps avait « racont[é] toutes sortes de choses, d’allure invraisemblable, sur la façon dont l’ambassade d’Allemagne et son personnel étaient observés par des agents secrets français ». Il avait dit cela mais n’en avait pas dit plus. Et toutes les recherches faites à la suite n’avaient rien donné[24]. Peut-être que Schwartzkoppen mentait ici, objecterait Lombarès, ne pouvant dire à Münster avec quelle facilité il était possible de se procurer des documents confidentiels à l’ambassade. Ou peut-être refusait-il d’entendre la vérité et disqualifiait-il (« une allure invraisemblable ») une telle dénonciation dont la réalité serait bien trop extraordinaire. Cela serait vraisemblable mais on comprend mal, dans ce cas, si la Millescamps avait en effet parlé de la corbeille, que l’attaché militaire ait pu continuer à la remplir si consciencieusement de documents qui continueront, bien après le bordereau, à venir garnir les dossiers de la Section de statistique… D’autre part, on comprend mal la « démonstration » de Lombarès. Si Esterhazy était en effet un agent du S.R. français, réagir, prendre contact avec Schwartzkoppen, était le plus sûr moyen d’avouer sa véritable appartenance. Il était clair que, puisque le postulat était que le bordereau mentionnait des pièces déjà livrées, il ne pouvait que s’agir d’une intox. Esterhazy et ses employeurs l’eussent assurément compris et la consigne n’eût pu être que de ne surtout pas se manifester. Et quel danger représentait pour les allemands une telle stratégie si la Millescamps avait menti ou si Esterhazy était un authentique traître et non un agent double. Le S.R. allemand aurait ainsi rendu un fier service à son homologue français en lui révélant un fait d’importance, à savoir qu’il existait un traître dans l’armée française.
Mais le problème ne se posa pas puisque, comme nous le dit Lombarès, la manœuvre échoua : « contrairement à tout ce que le S.R. de Berlin pouvait raisonnablement imaginer, si Esterhazy était bien un agent double, il n’était pas un agent du S.R. » (p. 239). Suivant cette méthode on peut avancer tout et n’importe quoi. Et sur quoi repose donc cette thèse ? Elle ne s’appuie – comme à chaque fois – sur aucun document et n’est qu’une explication censée répondre à une impossibilité : celle de la conception du bordereau par Esterhazy. Pour Lombarès, en effet, le bordereau ne peut en aucun cas être l’œuvre du « uhlan » et ce pour de multiples raisons : son inutilité, sa graphie, son style maladroit, l’état dans lequel il parvint à la Section de statistique, son papier, sa date et son texte (p. 224-232). Voyons cela. Inutile, le bordereau, ne faisant que récapituler des pièces qui y étaient jointes, l’était en effet mais le remarquer ne prouve pas grand-chose et le fait n’est peut-être finalement pas aussi curieux que Lombarès le pense. Il arrive souvent qu’on fasse parvenir à un correspondant un objet, un document quelconque, et que cet envoi soit accompagné d’un mot qui annonce ce que l’ouverture de l’enveloppe indiquerait d’elle-même. Cela s’appelle aussi de la politesse… Le second point – la graphie – est difficile à soutenir tant sont semblables les écritures d’Esterhazy et du bordereau. Et pour y parvenir, il faudrait que Lombarès ait d’autres arguments, moins naïfs dans tous les cas, que celui selon lequel « lorsque se posa la question d’Esterhazy, au procès de cet officier tous les experts consultés ont estimé que l’écriture du bordereau avait les caractères d’une imitation. Tous ! ». La question de la rédaction n’est pas plus convaincante. Esterhazy, cultivé, n’aurait pu commettre les impropriétés de langue, de mots et de tournures du bordereau. Certaines se retrouvent pourtant à l’identique dans sa correspondance. La question du papier est équivalente. Esterhazy possédait ce papier peu courant, comme le révéla l’enquête de la Cour de cassation et comme le sait aussi Lombarès. Alors ? « Un faussaire pouvait se procurer ce papier chez cet officier, ou chez son fournisseur »… Soit. Mais une nouvelle fois avec de tels arguments tout est possible. La date ? Comment, demande Lombarès, une lettre faite – si Esterhazy en était l’auteur – entre le 15 août et le 1er septembre, aurait-elle pu parvenir à la Section de statistique un mois plus tard ? Pourquoi l’agent aurait-il été « assez maladroit pour attendre grand mois avant de la faire parvenir » ? Cela serait douteux en effet. Mais pourquoi Schwartzkoppen, s’il a reçu le bordereau comme nous nous obstinons à le croire, aurait-il dû le jeter dès lecture ? N’aurait-il pu le garder, un jour, deux jours, quelques jours, une semaine, un mois même et le jeter plus tard ? Quant au texte, Lombarès voulait y voir un certain nombre de « véritables impossibilités dans l’hypothèse qui en fait l’œuvre du commandant Esterhazy ». Comment aurait-il pu écrire la première phrase (« Sans nouvelles m’indiquant… ») quand il allait et venait librement à l’ambassade ? Comment pouvait-il écrire « Je vous adresse », indiquant la livraison, et la livraison concomitante, alors que Schwartzkoppen a expliqué dans ses Carnets avoir reçu les documents en mains propres ? Pourquoi Esterhazy aurait-il donné entre parenthèse dans le bordereau la date du manuel de tir alors qu’elle figurait sur l’exemplaire qui lui transmettait ? Pourquoi, toujours à propos du manuel, avoir dire « je le prendrai », indiquant qu’il ne l’avait pas encore pris, alors qu’il le lui adressait ? Enfin, que signifiait la dernière phrase (« Je vais partir en manœuvres ») alors qu’il n’y se rendit pas à cette époque ? Autant d’impossibilités qui n’en sont pas. Aux manœuvres, il n’y alla pas fin août-début septembre 1894. Il n’y alla pas mais affirma à Schwartzkoppen y être allé quand, si on en croit les Carnets de l’attaché militaire, le 1er septembre, il lui avait dit revenir de celles de Sissonne dont il lui promettait la livraison des « observations qu’il y avait faites[25] ». Il n’y alla pas. Nous le savons, mais n’était-ce pas là un moyen, comme le dit Lombarès lui-même, d’« expliquer et valoriser » les observations en question ? N’est-ce pas aussi ainsi que peut s’expliquer la mention de la date du manuel dans le texte du bordereau ? Mais continuons. Comment expliquer la première phrase ? Sans doute qu’Esterhazy ne se gênait pas pour aller à l’ambassade. Mais ayant enfin obtenu l’accord de Schwartzkoppen, le 15 août, ne peut-on imaginer qu’il pouvait attendre que son nouvel employeur lui formulât quelque demande précise ? Comment put-il envoyer des documents avec le bordereau si Schwartzkoppen par ailleurs affirma les avoir reçu des mains d’Esterhazy lors d’une de ses visites ? Nous l’avons dit… et nous le répétons. Schwartzkoppen pouvait-il assumer aux yeux du monde, pour des mémoires qui feraient peut-être un jour l’objet d’une édition, de bien coupables négligences, négligences qui plus est, par la répétition, frôlaient la bêtise ?… Demeure la question du « je le prendrai ». En aucun cas, il ne signifie qu’Esterhazy ne l’avait pas encore, ce qui en effet serait curieux dans une lettre qui disait l’envoyer. Il suffit de lire le texte du bordereau pour comprendre que Lombarès à mal lu… ou a voulu lire ce qui pouvait servir son propos. Rappelons-nous le passage en question : « Ce dernier document est extrêmement difficile à se procurer et je ne puis l’avoir à ma disposition que peu de jours. Le ministère de la Guerre en a envoyé un nombre fixe dans les corps, et ces corps en sont responsables. Chaque officier détenteur doit remettre le sien après les manœuvres. Si donc vous voulez y prendre ce qui vous intéresse et le tenir à ma disposition après. Je le prendrai. A moins que vous ne vouliez que je le fasse copier in extenso et ne vous en adresse la copie. » « Je le prendrai » a ici le sens de « je le récupérerai », une fois, comme le dit la phrase précédente, que son correspondant en aura fini avec le document en question. Et ce dans le cas, Esterhazy devant le rendre le plus vite possible, n’en copier qu’une partie pourrait suffire à l’attaché militaire. Dans le cas où il souhaiterait l’avoir intégralement, Esterhazy lui proposait de le reprendre vite et de s’arranger pour le faire copier… Comment peut-on lire ici autre chose ? Parmi tous ces arguments qui n’en sont pas, le seul qui pourrait êtrelearguments qui n’portent jamais sur le fond et ne résistent pas longtemps à la critique recevable est celui des déchirures. Elles sont en effet curieuses et ne ressemblent que peu à celles des autres documents issus de la voie ordinaire. Mais si cela est, indubitablement, ce n’est guère suffisant pour en faire la preuve qui pourrait expliquer une autre origine au bordereau que la corbeille de l’attaché militaire.
 En 1985, Lombarès réédita son ouvrage sous le titre L’Affaire Dreyfus[26]. La suppression de la seconde partie du titre de la première édition (La Clé du mystère) pouvait laisser espérer plus de mesure comme, dans l’introduction, l’aveu d’erreurs commises (p. 11). Mais il ne fallait pas le lire trop vite. Ces erreurs n’étaient à son point de vue que « de détail » et à bien y réfléchir ce nouveau titre était pire encore qui présentait cette seconde édition comme une histoire ou un essai. En fait, à l’exception de menues corrections, cette édition n’était que la reprise de la précédente, augmentée de trois chapitres qui, affirmait l’auteur avec sérieux, venaient sur la base de publications récentes confirmer son hypothèse, « la seule en accord avec tout ce qu’on savait de cette histoire » (p. 215). Voyons rapidement ce qui pouvait justifier autant d’assurance. Dans ses souvenirs, Mathieu, on s’en souvient, raconte ses expériences avec la voyante Léonie[27]. Lors d’une des séances, elle fit une déclaration dans laquelle Lombarès trouve une confirmation de sa thèse : « Interrogée, poussée par nous, elle déclara que cette pièce [le bordereau] était une copie, un décalque fait à Metz, rapporté par Greber [un agent allemand], dans un but qu’elle ignorait, à l’ambassade allemande à Paris, où elle avait été volée par un agent français.[28] » Et Lombarès, après avoir cité – inexactement –, de commenter : « Cette fois c’était clair, du moins pour nous, car, on le voit, cette phrase écrite dès 1895, résumait parfaitement notre hypothèse. » (p. 197). La preuve est donc une vision de voyante ? Est-ce sérieux ? Et puis si on veut bien prendre le passage entier dont est extraite la citation on verra qu’en aucun cas, comme elle pourrait à elle seule le faire croire, elle ne vient conforter la thèse d’une intox du SR allemand. La citation ne dit pas qui est à l’origine du document et peut faire croire, prise seule, hors de son contexte, que copiée à Metz elle était l’œuvre des Allemands. Mais ce que disait Léonie était tout autre. Citons le passage qui introduit celui sélectionné par Lombarès : « Ainsi elle prétendait que le coupable était un officier du ministère de la Guerre dont elle ne trouvait pas le nom, en relations avec un agent allemand du nom de Greber. Celui-ci apportait à Metz les documents, livrés par cet officier, d’où ils étaient expédiés à Berlin. » Voilà qui ne résume rien et contredit tout… Lombarès ne pouvait trouver meilleure source et meilleure définition de sa manière de travailler. Ce n’est pas de l’histoire que font ces auteurs mais bien de la divination.
En 1985, Lombarès réédita son ouvrage sous le titre L’Affaire Dreyfus[26]. La suppression de la seconde partie du titre de la première édition (La Clé du mystère) pouvait laisser espérer plus de mesure comme, dans l’introduction, l’aveu d’erreurs commises (p. 11). Mais il ne fallait pas le lire trop vite. Ces erreurs n’étaient à son point de vue que « de détail » et à bien y réfléchir ce nouveau titre était pire encore qui présentait cette seconde édition comme une histoire ou un essai. En fait, à l’exception de menues corrections, cette édition n’était que la reprise de la précédente, augmentée de trois chapitres qui, affirmait l’auteur avec sérieux, venaient sur la base de publications récentes confirmer son hypothèse, « la seule en accord avec tout ce qu’on savait de cette histoire » (p. 215). Voyons rapidement ce qui pouvait justifier autant d’assurance. Dans ses souvenirs, Mathieu, on s’en souvient, raconte ses expériences avec la voyante Léonie[27]. Lors d’une des séances, elle fit une déclaration dans laquelle Lombarès trouve une confirmation de sa thèse : « Interrogée, poussée par nous, elle déclara que cette pièce [le bordereau] était une copie, un décalque fait à Metz, rapporté par Greber [un agent allemand], dans un but qu’elle ignorait, à l’ambassade allemande à Paris, où elle avait été volée par un agent français.[28] » Et Lombarès, après avoir cité – inexactement –, de commenter : « Cette fois c’était clair, du moins pour nous, car, on le voit, cette phrase écrite dès 1895, résumait parfaitement notre hypothèse. » (p. 197). La preuve est donc une vision de voyante ? Est-ce sérieux ? Et puis si on veut bien prendre le passage entier dont est extraite la citation on verra qu’en aucun cas, comme elle pourrait à elle seule le faire croire, elle ne vient conforter la thèse d’une intox du SR allemand. La citation ne dit pas qui est à l’origine du document et peut faire croire, prise seule, hors de son contexte, que copiée à Metz elle était l’œuvre des Allemands. Mais ce que disait Léonie était tout autre. Citons le passage qui introduit celui sélectionné par Lombarès : « Ainsi elle prétendait que le coupable était un officier du ministère de la Guerre dont elle ne trouvait pas le nom, en relations avec un agent allemand du nom de Greber. Celui-ci apportait à Metz les documents, livrés par cet officier, d’où ils étaient expédiés à Berlin. » Voilà qui ne résume rien et contredit tout… Lombarès ne pouvait trouver meilleure source et meilleure définition de sa manière de travailler. Ce n’est pas de l’histoire que font ces auteurs mais bien de la divination.
 Entre les deux éditions du Lombarès, parut en 1975 Dreyfus ou l’intolérable vérité de Jean Cherasse et Patrice Boussel[29], reprise et complément du « film-débat » sorti l’année précédente. Parallèlement aux commentaires et déclarations, extraites du documentaire, de François Mitterrand, Michel Debré, Alain Krivine, François Brigneau, Edgar Faure, Jean-Pierre Bloch, Daniel Mayer, Marcel Thomas et Henri Guillemin, Jean Chérasse, agrégé d’histoire, ancien élève de l’ENS, y proposait une « hypothèse originale » déjà présente dans son film. Selon lui, l’affaire Dreyfus était un « téléscopage » entre deux affaires : une affaire française et une affaire allemande. Du côté français, elle était une machination antisémite montée par le commandant Biot, journaliste de La Libre Parole et un des promoteurs de la campagne de 1892 contre la présence des juifs dans l’armée. Une machination qui avait pour but de « non seulement porter atteinte à la politique républicaine des Juifs, mais aussi et surtout discréditer le régime de la Troisième République avec un scandale touchant à la Défense nationale et à ce mythe de la “revanche” qui traumatisait littéralement les Français ». L’idée était « de trouver un officier juif alsacien […] et promis à un très bel avenir (c’est-à-dire un saint-cyrien ou un polytechnicien) ; d’observer attentivement son comportement s’il accédait à un des plus hauts niveaux du ministère de la Guerre (état-major de l’armée par exemple) : et de lui “coller une vilaine affaire d’espionnage sur le dos” ». C’est ainsi qu’aurait été choisi Dreyfus. Mais pour que son plan pût réussir, il fallait « disposer au ministère ou à l’état-major des “hautes oreilles favorables” sinon des complicités de premier ordre ». Mercier fut le premier conquis, contre la promesse du soutien de la presse de droite, puis Gonse, Henry, Lauth, Boisdeffre et « probablement bien d’autres ». Sur la base du roman de Louis Létang – encore une fois –, ils machinèrent donc l’affaire et il ne restait plus qu’à piéger la victime choisie, ce dont fut chargé d’Aboville, ami de Biot avec lequel « il allait souvent à la chasse ». Mais Esterhazy ? Et c’est là que commençait la seconde affaire, l’affaire « allemande ». Et Chérasse, pour l’expliquer, de reprendre la thèse de Lombarès (p. 193-200). Il n’est assurément pas nécessaire de commenter cette nouvelle variation de ce que Vincent Duclert appelle drôlement l’« histoire-canon[30] ». Juste deux remarques toutefois. Chérasse, pour expliquer l’affaire « française », affirme que « la “conquête” de Mercier » est un « fait historique ». Dommage que, suivant le procédé de tous ses prédécesseurs et suiveurs, il se contenta de cette simple affirmation. Il eût été intéressant de savoir à quoi il pouvait bien penser et sur quoi pouvait reposer une telle certitude… D’autre part, à propos du « télescopage », on ne peut s’empêcher de noter quelle fut la chance des bourreaux de Dreyfus. Si les allemands n’avaient pas eu la formidable idée d’intoxiquer le S.R. français, Biot et ses amis auraient sans doute pu attendre encore longtemps pour mettre leur plan à exécution…ry, Lauth, Boisdeffre et « e
Entre les deux éditions du Lombarès, parut en 1975 Dreyfus ou l’intolérable vérité de Jean Cherasse et Patrice Boussel[29], reprise et complément du « film-débat » sorti l’année précédente. Parallèlement aux commentaires et déclarations, extraites du documentaire, de François Mitterrand, Michel Debré, Alain Krivine, François Brigneau, Edgar Faure, Jean-Pierre Bloch, Daniel Mayer, Marcel Thomas et Henri Guillemin, Jean Chérasse, agrégé d’histoire, ancien élève de l’ENS, y proposait une « hypothèse originale » déjà présente dans son film. Selon lui, l’affaire Dreyfus était un « téléscopage » entre deux affaires : une affaire française et une affaire allemande. Du côté français, elle était une machination antisémite montée par le commandant Biot, journaliste de La Libre Parole et un des promoteurs de la campagne de 1892 contre la présence des juifs dans l’armée. Une machination qui avait pour but de « non seulement porter atteinte à la politique républicaine des Juifs, mais aussi et surtout discréditer le régime de la Troisième République avec un scandale touchant à la Défense nationale et à ce mythe de la “revanche” qui traumatisait littéralement les Français ». L’idée était « de trouver un officier juif alsacien […] et promis à un très bel avenir (c’est-à-dire un saint-cyrien ou un polytechnicien) ; d’observer attentivement son comportement s’il accédait à un des plus hauts niveaux du ministère de la Guerre (état-major de l’armée par exemple) : et de lui “coller une vilaine affaire d’espionnage sur le dos” ». C’est ainsi qu’aurait été choisi Dreyfus. Mais pour que son plan pût réussir, il fallait « disposer au ministère ou à l’état-major des “hautes oreilles favorables” sinon des complicités de premier ordre ». Mercier fut le premier conquis, contre la promesse du soutien de la presse de droite, puis Gonse, Henry, Lauth, Boisdeffre et « probablement bien d’autres ». Sur la base du roman de Louis Létang – encore une fois –, ils machinèrent donc l’affaire et il ne restait plus qu’à piéger la victime choisie, ce dont fut chargé d’Aboville, ami de Biot avec lequel « il allait souvent à la chasse ». Mais Esterhazy ? Et c’est là que commençait la seconde affaire, l’affaire « allemande ». Et Chérasse, pour l’expliquer, de reprendre la thèse de Lombarès (p. 193-200). Il n’est assurément pas nécessaire de commenter cette nouvelle variation de ce que Vincent Duclert appelle drôlement l’« histoire-canon[30] ». Juste deux remarques toutefois. Chérasse, pour expliquer l’affaire « française », affirme que « la “conquête” de Mercier » est un « fait historique ». Dommage que, suivant le procédé de tous ses prédécesseurs et suiveurs, il se contenta de cette simple affirmation. Il eût été intéressant de savoir à quoi il pouvait bien penser et sur quoi pouvait reposer une telle certitude… D’autre part, à propos du « télescopage », on ne peut s’empêcher de noter quelle fut la chance des bourreaux de Dreyfus. Si les allemands n’avaient pas eu la formidable idée d’intoxiquer le S.R. français, Biot et ses amis auraient sans doute pu attendre encore longtemps pour mettre leur plan à exécution…ry, Lauth, Boisdeffre et « e
 En 1988, parut, plus confidentielle, une nouvelle thèse due à Max Guermann, « La “terrible” verité », publiée dans Les Cahiers naturalistes[31]. L’auteur y développe la thèse d’un montage de la Section de statistique dans le but de se débarrasser de Schwartzkoppen et de l’officine d’espionnage qu’il avait fait de l’ambassade d’Allemagne. Dans cette nouvelle thèse, Dreyfus n’aurait été ainsi que la victime, finalement pratique, de la ressemblance de son écriture avec celle du bordereau, découverte qui contraria l’ingénieux montage. Admettons et pour l’admettre faisons confiance à Esterhazy sur les déclarations duquel repose l’essentiel de l’argumentation. Mais ce faisant regrettons que l’auteur ne nous dise rien de la manière dont la création et la révélation du bordereau eût pu permettre d’atteindre son but si en Dreyfus n’avait pas été reconnu dans le bordereau le scripteur qu’il n’était pas. Sa découverte « a bouleversé le scénario original ». Certes, mais quel était-il ce scénario ? Qu’aurait permis d’obtenir cette pièce qui, comme le dit l’auteur lui-même, « précarité d[e la] combinaison », était pour le moins « un document douteux, ni daté, ni signé, sans destinataire désigné » (p. 53) ? Rien ne nous en est dit. S’il s’agissait de se débarrasser de l’attaché militaire, n’était-il pas plus simple de sortir sa correspondance intime, celle avec Panizzardi, dont la Section de statistique avait quelques pièces pour le moins édifiantes plutôt que d’échafauder ce plan compliqué, incomplet et tellement risqué ?
En 1988, parut, plus confidentielle, une nouvelle thèse due à Max Guermann, « La “terrible” verité », publiée dans Les Cahiers naturalistes[31]. L’auteur y développe la thèse d’un montage de la Section de statistique dans le but de se débarrasser de Schwartzkoppen et de l’officine d’espionnage qu’il avait fait de l’ambassade d’Allemagne. Dans cette nouvelle thèse, Dreyfus n’aurait été ainsi que la victime, finalement pratique, de la ressemblance de son écriture avec celle du bordereau, découverte qui contraria l’ingénieux montage. Admettons et pour l’admettre faisons confiance à Esterhazy sur les déclarations duquel repose l’essentiel de l’argumentation. Mais ce faisant regrettons que l’auteur ne nous dise rien de la manière dont la création et la révélation du bordereau eût pu permettre d’atteindre son but si en Dreyfus n’avait pas été reconnu dans le bordereau le scripteur qu’il n’était pas. Sa découverte « a bouleversé le scénario original ». Certes, mais quel était-il ce scénario ? Qu’aurait permis d’obtenir cette pièce qui, comme le dit l’auteur lui-même, « précarité d[e la] combinaison », était pour le moins « un document douteux, ni daté, ni signé, sans destinataire désigné » (p. 53) ? Rien ne nous en est dit. S’il s’agissait de se débarrasser de l’attaché militaire, n’était-il pas plus simple de sortir sa correspondance intime, celle avec Panizzardi, dont la Section de statistique avait quelques pièces pour le moins édifiantes plutôt que d’échafauder ce plan compliqué, incomplet et tellement risqué ?
 Après quelques années d’accalmie, le virus reparut. Les commémorations à venir relancèrent une machine qu’on avait pu espérer avoir disparu. En 1993, Ida-Marie Frandon publia un curieux ouvrage qui offrait de faire le point sur la lassante question du canon de 75 : L’Affaire et le grand secret. Le Capitaine Dreyfus ou l’épopée du 75[32]. La thèse est connue : pour protéger le formidable canon Esterhazy aurait été envoyé par la Section de statistique à Schwartzkoppen pour lui donner de faux renseignements et l’engager sur la voie du canon de 120. Aucun argument n’étant avancé, il n’y guère plus à dire, à part toutefois une vraie nouveauté, pas plus soutenue, selon laquelle Dreyfus, « courageux, patriote, prisonnier d’apparences ambiguës », aurait accepté une « culpabilité temporaire » (p. 52-53). Cette dernière thèse, qui sera développée en 2000 par Jean-François Deniau, ne nécessite guère d’autre réponse que celle que nous avons donnée ailleurs[33] – et que nous reprendrons à la suite – et qui permet de comprendre la manière de procéder et l’ordre de preuves douteuses convoqué pour servir cette impossible thèse.
Après quelques années d’accalmie, le virus reparut. Les commémorations à venir relancèrent une machine qu’on avait pu espérer avoir disparu. En 1993, Ida-Marie Frandon publia un curieux ouvrage qui offrait de faire le point sur la lassante question du canon de 75 : L’Affaire et le grand secret. Le Capitaine Dreyfus ou l’épopée du 75[32]. La thèse est connue : pour protéger le formidable canon Esterhazy aurait été envoyé par la Section de statistique à Schwartzkoppen pour lui donner de faux renseignements et l’engager sur la voie du canon de 120. Aucun argument n’étant avancé, il n’y guère plus à dire, à part toutefois une vraie nouveauté, pas plus soutenue, selon laquelle Dreyfus, « courageux, patriote, prisonnier d’apparences ambiguës », aurait accepté une « culpabilité temporaire » (p. 52-53). Cette dernière thèse, qui sera développée en 2000 par Jean-François Deniau, ne nécessite guère d’autre réponse que celle que nous avons donnée ailleurs[33] – et que nous reprendrons à la suite – et qui permet de comprendre la manière de procéder et l’ordre de preuves douteuses convoqué pour servir cette impossible thèse.
 En 1994, en annonce au centenaire du début de l’affaire Dreyfus, parut Un secret bien gardé. Histoire militaire de l’affaire Dreyfus par Jean Doise[34], livre tout à fait impressionnant sur les questions relative à la chose militaire et dont on peut juste regretter que son auteur ait cru bon y mêler l’Affaire. Variation de la plupart des ouvrages que nous venons de voir et plus particulièrement du Charpentier, dont il reprend tous les arguments (p. 44-46), il repose sur le postulat de la lettre d’Alsace qu’il entremêle avec la question de l’intox montée pour protéger le 75. Sandherr ayant reçu des informations en provenance d’Alsace sur la trahison d’un nommé Dreyfus, aurait décidé de mettre hors d’état de nuire le stagiaire ainsi nommé et, confiant le travail à Henry, aurait fait fabriquer pour cela le bordereau pour lequel Esterhazy aurait prêté son écriture. Coup double, le bordereau permettait de se débarrasser du traître et de crédibiliser l’informateur Esterhazy. Coup double et même coup triple dans la mesure où la mention du 120 dans le bordereau devait permettre de concentrer l’attention des allemands sur le 120 qui y était mentionné (p. 46, 55-57). Pour Mercier, tout à ses préoccupations relatives au nouveau canon, peu importait finalement que Dreyfus ait trahi. S’il fallait, à tout prix, l’arrêter, le faire juger et condamner, c’était à ses yeux pour le mettre hors d’état de nuire et l’empêcher de parler un jour du 75. Ainsi s’explique pour Doise l’empressement et le peu de souci de la légalité qui furent ceux de Mercier dans le traitement de l’affaire naissante (p. 63-64 et 179). Le montage est ingénieux et à vrai dire plus convaincant et mieux fondé que les précédents. Seulement, il ne repose sur rien et Doise n’avance pas la moindre preuve qui permette de fonder une thèse qui n’est qu’une suite d’affirmations et se heurte à toutes les objections que nous avons déjà soulevées au sujet des ouvrages de ses prédécesseurs. Page 44, l’auteur regrette que la « lettre d’Alsace » ait été « niée ou négligée par la plupart des dreyfusologues », expliquant ainsi pourquoi « ils ont mal interprétés la suite ». Mais comment ne pas négliger – et ne pas nier – une lettre que rien n’atteste, que personne n’a vue, qui aurait disparu si tant est qu’elle ait existé et dont la seule mention un peu tangible est due à Charpentier dans un travail dont nous avons vu ce qu’on pouvait en attendre ? L’histoire ne peut se faire sur d’uniques hypothèses, des spéculations, sur l’absence d’archives et le parti pris de ne pas les consulter, sur une bibliographie étique et discutable et, plus largement, sur une vision tout autant myope qu’astigmate de l’événement qui ne pourrait être compris qu’à la lumière des questions militaires et plus particulièrement de celle liées à l’artillerie[35].
En 1994, en annonce au centenaire du début de l’affaire Dreyfus, parut Un secret bien gardé. Histoire militaire de l’affaire Dreyfus par Jean Doise[34], livre tout à fait impressionnant sur les questions relative à la chose militaire et dont on peut juste regretter que son auteur ait cru bon y mêler l’Affaire. Variation de la plupart des ouvrages que nous venons de voir et plus particulièrement du Charpentier, dont il reprend tous les arguments (p. 44-46), il repose sur le postulat de la lettre d’Alsace qu’il entremêle avec la question de l’intox montée pour protéger le 75. Sandherr ayant reçu des informations en provenance d’Alsace sur la trahison d’un nommé Dreyfus, aurait décidé de mettre hors d’état de nuire le stagiaire ainsi nommé et, confiant le travail à Henry, aurait fait fabriquer pour cela le bordereau pour lequel Esterhazy aurait prêté son écriture. Coup double, le bordereau permettait de se débarrasser du traître et de crédibiliser l’informateur Esterhazy. Coup double et même coup triple dans la mesure où la mention du 120 dans le bordereau devait permettre de concentrer l’attention des allemands sur le 120 qui y était mentionné (p. 46, 55-57). Pour Mercier, tout à ses préoccupations relatives au nouveau canon, peu importait finalement que Dreyfus ait trahi. S’il fallait, à tout prix, l’arrêter, le faire juger et condamner, c’était à ses yeux pour le mettre hors d’état de nuire et l’empêcher de parler un jour du 75. Ainsi s’explique pour Doise l’empressement et le peu de souci de la légalité qui furent ceux de Mercier dans le traitement de l’affaire naissante (p. 63-64 et 179). Le montage est ingénieux et à vrai dire plus convaincant et mieux fondé que les précédents. Seulement, il ne repose sur rien et Doise n’avance pas la moindre preuve qui permette de fonder une thèse qui n’est qu’une suite d’affirmations et se heurte à toutes les objections que nous avons déjà soulevées au sujet des ouvrages de ses prédécesseurs. Page 44, l’auteur regrette que la « lettre d’Alsace » ait été « niée ou négligée par la plupart des dreyfusologues », expliquant ainsi pourquoi « ils ont mal interprétés la suite ». Mais comment ne pas négliger – et ne pas nier – une lettre que rien n’atteste, que personne n’a vue, qui aurait disparu si tant est qu’elle ait existé et dont la seule mention un peu tangible est due à Charpentier dans un travail dont nous avons vu ce qu’on pouvait en attendre ? L’histoire ne peut se faire sur d’uniques hypothèses, des spéculations, sur l’absence d’archives et le parti pris de ne pas les consulter, sur une bibliographie étique et discutable et, plus largement, sur une vision tout autant myope qu’astigmate de l’événement qui ne pourrait être compris qu’à la lumière des questions militaires et plus particulièrement de celle liées à l’artillerie[35].
 L’année 2000 fut riche en suprises. Deux volumes parurent, celui d’Armand Israël, dont il sera question à la suite, et le chapitre de Jean-François Deniau dans Le Bureau des secrets perdus[36]. Dans ce livre, l’ancien ministre, académicien-rameur, développa une thèse selon laquelle toute l’Affaire s’expliquerait par la nécessité pour le SR français de « cacher aux Allemands que nous sommes peut-être en train de découvrir l’arme absolue en matière d’artillerie de campagne », à savoir le prodigieux 75 (p. 23). Mais ce que n’avaient pas prévus les responsables de l’intox – Mercier, Saussier, Deloye –, c’est qu’apparaîtrait un jour un bordereau – oeuvre du SR allemand (p. 52-53) – qui les obligerait à agir pour ne pas éveiller les soupçons des Allemands. Mais là où la thèse est originale – quoi qu’empruntée à Frandon –, c’est que selon notre auteur, Dreyfus aurait été mis dans la confidence et, patriote, aurait accepté de se sacrifier pour le pays (p. 42). « Il n’est pas seulement un innocent injustement condamné : c’est désormais un officier français en service commandé » (p. 43). Ainsi s’explique le « détachement » (!!!???) du capitaine (p. 43), sa certitude que l’Affaire serait réglée dans quelques années (p. 42). Mais l’ultime preuve, le « témoignage aussi poignant qu’irrécusable », est ce « pacte » dont le capitaine parla souvent et qui le liait à Casimir-Perier. Et de citer, en argument définitif à sa démonstration, un extrait d’une de ses lettres au président de la République, qui dit : « C’est pourquoi dans ma dernière lettre, je vous disais, Monsieur le Président, que pour moi, s’il fallait une victime innocente, sacrifiée sur l’autel de la patrie, oh ! que je le sois, que l’on fasse vite, mais que l’on sache pourquoi je succombe… » (p. 57). Qu’on remette cette citation dans son contexte pour voir qu’il s’agit de tout autre chose :
L’année 2000 fut riche en suprises. Deux volumes parurent, celui d’Armand Israël, dont il sera question à la suite, et le chapitre de Jean-François Deniau dans Le Bureau des secrets perdus[36]. Dans ce livre, l’ancien ministre, académicien-rameur, développa une thèse selon laquelle toute l’Affaire s’expliquerait par la nécessité pour le SR français de « cacher aux Allemands que nous sommes peut-être en train de découvrir l’arme absolue en matière d’artillerie de campagne », à savoir le prodigieux 75 (p. 23). Mais ce que n’avaient pas prévus les responsables de l’intox – Mercier, Saussier, Deloye –, c’est qu’apparaîtrait un jour un bordereau – oeuvre du SR allemand (p. 52-53) – qui les obligerait à agir pour ne pas éveiller les soupçons des Allemands. Mais là où la thèse est originale – quoi qu’empruntée à Frandon –, c’est que selon notre auteur, Dreyfus aurait été mis dans la confidence et, patriote, aurait accepté de se sacrifier pour le pays (p. 42). « Il n’est pas seulement un innocent injustement condamné : c’est désormais un officier français en service commandé » (p. 43). Ainsi s’explique le « détachement » (!!!???) du capitaine (p. 43), sa certitude que l’Affaire serait réglée dans quelques années (p. 42). Mais l’ultime preuve, le « témoignage aussi poignant qu’irrécusable », est ce « pacte » dont le capitaine parla souvent et qui le liait à Casimir-Perier. Et de citer, en argument définitif à sa démonstration, un extrait d’une de ses lettres au président de la République, qui dit : « C’est pourquoi dans ma dernière lettre, je vous disais, Monsieur le Président, que pour moi, s’il fallait une victime innocente, sacrifiée sur l’autel de la patrie, oh ! que je le sois, que l’on fasse vite, mais que l’on sache pourquoi je succombe… » (p. 57). Qu’on remette cette citation dans son contexte pour voir qu’il s’agit de tout autre chose :
Le martyre devient trop grand, Monsieur le Président, car non seulement je suis innocent de ce crime abominable, mais contre vents et marées, dans les pires supplices, je n’ai jamais oublié aucun de mes devoirs, devoirs si multiples, tant vis-à-vis de ma famille, que je devais soutenir de mon inébranlable volonté, que vis-a-vis de la patrie.
Oui, Monsieur le Président, j’ai voulu la lumière, je la veux, je veux la vérité de toutes les forces de mon âme, de toutes les forces d’un cœur horriblement mutilé et blessé, je la veux par tous les moyens, mais pour la patrie et par la patrie.
Et alors, Monsieur le Président, il vous est impossible de vous figurer l’horrible détresse de mon âme quand, avec la conscience sûre d’avoir toujours et partout rempli tous mes devoirs, et je défie qui que ce soit d’en apporter une preuve contraire, je vois chaque mois arriver de nouvelles mesures de sûreté, qui donnent lieu, je le vois, je le sens, étant donné la situation, aux hypothèses les plus atroces, les plus infamantes.
C’est pourquoi dans ma dernière lettre, je vous disais, Monsieur le Président, que pour moi, s’il fallait une victime innocente, sacrifiée sur l’autel de la patrie, oh ! que je le sois, que l’on fasse vite, mais que l’on sache pourquoi je succombe…
Si je suis encore debout, dans une situation aussi atroce, supportée depuis longtemps, sous un pareil climat, le cerveau halluciné, le cœur malade, c’est pour ma chère femme, c’est pour mes pauvres enfants, mes pauvres petits martyrs, qui grandissent déshonorés[37]…
Il n’est bien question ici que de la double promesse faite, en premier lieu, au président de taire l’origine du bordereau et, en second lieu, à sa famille de vivre jusqu’à la réhabilitation. Et pour comprendre le sens exact de la phrase qui ne peut en aucun cas permettre l’interprétation forcée qu’en fait Deniau, « s’il fallait une victime innocente, sacrifiée sur l’autel de la patrie, oh ! que je le sois, que l’on fasse vite, mais que l’on sache pourquoi je succombe… », rien n’était plus simple que de se référer à la lettre précédente, ainsi que le capitaine lui-même nous invite à le faire. Dans cette supplique du 8 juillet 1897, il écrivait :
Ma vie, Monsieur le Président, je n’en parlerai pas. Aujourd’hui comme hier, elle appartient à mon pays. Ce que je lui demande simplement comme une faveur suprême, c’est de la prendre vite, de ne pas me laisser succomber aussi lentement par une agonie atroce, sous tant de supplices infamants que je n’ai pas mérités, que je ne mérite pas.
Mais ce que je demande aussi à mon pays, c’est de faire faire la lumière pleine et entière sur cet horrible drame ; car mon honneur ne lui appartient pas, c’est le patrimoine de mes enfants, c’est le bien propre de deux familles[38].
 Mais le chef d’œuvre dans le domaine est assurément le second volume de cette année 2000, Les Vérités cachées de l’affaire Dreyfus, publié par Armand Israël[39]. En dehors de ce titre qui à lui seul est une promesse, le livre d’Armand Israël semble offrir toutes les garanties de la scientificité : un éditeur prestigieux, un préfacier directeur des Archives de la Préfecture de Police et une recherche menée, sous la direction de l’auteur, par « une équipe de chercheurs » et reposant sur « l’exploitation de fonds d’archives jusqu’alors inaccessibles » (quatrième de couverture). Pourtant, on est rapidement frappé par le nombre d’erreur de faits, de noms, de dates, de contradictions d’une page à l’autre qui en font une véritable moulinette de l’approximation. Sous la forme d’une histoire de l’événement, il aborde, pour les corriger, trois points essentiels : le bordereau, son origine et son histoire, la mort d’Henry dont il a en toute simplicité découvert l’identité de l’assassin et le pacte secret passé à l’époque du procès de Rennes entre la famille Dreyfus et le gouvernement. Commençons par le bordereau. Deloye, Boisdeffre et Gonse auraient mis au point un projet visant à protéger les secrets de conception du… nouveau 75. Pour ce faire, Gonse, aurait convoqué Sandherr qui, avec l’aide d’Henry et d’Esterhazy, auraient conçu un plan complexe dans le but d’intoxiquer les allemands. « La découverte d’une affaire d’espionnage d’une telle importance », auraient pensé Gonse et ses comparses, n’aurait pu que faire « du bruit et il suffira à l’État-major français de feindre une grande inquiétude pour que l’information présentée par le bordereau prenne une importance capitale aux yeux de l’Allemagne. Pendant que celle-ci se préoccupera du frein du 120, la France aura le champ libre pour fabriquer sa véritable arme secrète : le canon de 75 » (p. 80). Sandherr aurait donc envoyé Esterhazy chez Schwartzkoppen. Seulement, un problème de taille se serait rapidement posé. Comment en effet, nous explique l’auteur, un simple officier de troupes pouvait-il livrer des informations d’une telle importance (p. 83) ? Les attachés militaires, « au fil du temps » (un peu moins de deux mois !?), commençant à s’interroger, il devenait nécessaire, pour que l’intox se fît, de faire taire leurs soupçons. C’est pour cela que Gonse, Henry, Deloye, demandèrent à Esterhazy « d’écrire sous leur dictée une offre de renseignements (le bordereau) […], laissant entendre que ses informations proviennent de l’État-Major par l’intermédiaire d’un officier félon infiltré dans les lieux » (p. 83-84). Et qui mieux que Dreyfus, alsacien, artilleur, juif, pourra incarner ce fournisseur (p. 84) ? Esterhazy se plia donc à la demande de ses chefs mais « Henry a exigé qu’[il] en recopie une deuxième afin d’en conserver le double, “pour mémoire”. » Pour ce faire, « Esterhazy utilise une technique habituelle à l’époque : un papier calque, aussi appelé papier pelure. C’est en fait ce double qui servira à la machination, et c’est son original, conservé par Henry, que l’on tiendra pour le bordereau annoté (faussement annoté) par Guillaume II, encore désigné sous les termes de « document libérateur » ou « bordereau impérial ». « Esterhazy était si intimement convaincu de la protection inconditionnelle de ses chefs, explique l’auteur, qu’il n’a même pas cherché à dissimuler son écriture de ce deuxième bordereau. Il est cependant très probable qu’il a contrefait son écriture sur le premier bordereau, croyant que seul ce dernier document – non sa copie – serait utilisé, et dans le secret des chancelleries uniquement » (p. 85). La chose est pour le moins bien compliquée et pose une véritable question. Comment cela aurait-il pu être possible puisqu’à en croire l’auteur le bordereau ne serait jamais parvenu à Schwartzkoppen, comme l’indique l’absence d’enveloppe, le fait qu’il n’ait pas été froissé, les déchirures pour le moins curieuses et, surtout, le fait que l’attaché militaire ait dit dans ses souvenirs ne pas l’avoir reçu (p. 86-87) ? Si le bordereau ne lui est pas parvenu, comment Schwartzkoppen aurait-il pu être intoxiqué ? Ce ne put donc être que le 10 novembre 1896, quand Schwartzkoppen découvrit Le Matin et le fac-simile du bordereau, que commença l’intox ? Et de même comment aurait-il pu être rassuré sur la provenance des informations d’Esterhazy ? Pour que cela fût, Esterhazy se devait absolument d’en informer Schwartzkoppen. Il est clair que lui rendant visite le 3 novembre 1894, après la diffusion de la nouvelle de l’arrestation d’un traître à l’État-major, il n’aurait certainement pas laissé passer cette occasion de « faire taire les soupçons ». Pourquoi alors Schwartzkoppen n’en dit-il pas le moindre mot dans ses Carnets ? Pourquoi n’y évoque-t-il pas les soupçons que lui prête M. Israël ? Comment put-il se contenter de noter « qu’interrogé sur l’arrestation de Dreyfus [Esterhazy] n’a pu m’en donner aucune explication[40] ». Mais la principale objection n’est pas là. Comment peut-on imaginer que Sandherr et Henry aient pu imaginer un stratagème si compliqué qui ne pouvait que les desservir et réellement, cette fois, discréditer Esterhazy ? Certes, Esterhazy avait donc un informateur infiltré à l’État-Major… mais il ne l’avait plus… il avait été arrêté, incarcéré et attendait son jugement… A moins, bien sûr, que toute cette mise en scène bien compliquée n’ait eu pour but que de faire passer le seul bordereau. Mais, et nous en revenons au point de départ, encore eût-il fallu que ce fameux bordereau arrivât entre les mains de Schwartzkoppen. Et cela M. Israël le conteste. Passons au « bordereau annoté ». Le montage est ingénieux mais ne tient pas plus. Sans s’attarder sur le « document libérateur » qui ne fut jamais le « bordereau annoté », il est difficile de croire à la possibilité d’un tel stratagème. Quelle complication et quelle épaisse bêtise que celle d’hommes qui voulant perdre Dreyfus gardent le document à l’écriture contrefaite (qui doit sans doute imiter son écriture) et livrent celle qui est de l’écriture « naturelle » d’Esterhazy !!! Et quelle drôle d’idée que d’utiliser du papier pelure dans le but de « doubler le plus précisément possible ce document » pour finalement ne pas le faire…
Mais le chef d’œuvre dans le domaine est assurément le second volume de cette année 2000, Les Vérités cachées de l’affaire Dreyfus, publié par Armand Israël[39]. En dehors de ce titre qui à lui seul est une promesse, le livre d’Armand Israël semble offrir toutes les garanties de la scientificité : un éditeur prestigieux, un préfacier directeur des Archives de la Préfecture de Police et une recherche menée, sous la direction de l’auteur, par « une équipe de chercheurs » et reposant sur « l’exploitation de fonds d’archives jusqu’alors inaccessibles » (quatrième de couverture). Pourtant, on est rapidement frappé par le nombre d’erreur de faits, de noms, de dates, de contradictions d’une page à l’autre qui en font une véritable moulinette de l’approximation. Sous la forme d’une histoire de l’événement, il aborde, pour les corriger, trois points essentiels : le bordereau, son origine et son histoire, la mort d’Henry dont il a en toute simplicité découvert l’identité de l’assassin et le pacte secret passé à l’époque du procès de Rennes entre la famille Dreyfus et le gouvernement. Commençons par le bordereau. Deloye, Boisdeffre et Gonse auraient mis au point un projet visant à protéger les secrets de conception du… nouveau 75. Pour ce faire, Gonse, aurait convoqué Sandherr qui, avec l’aide d’Henry et d’Esterhazy, auraient conçu un plan complexe dans le but d’intoxiquer les allemands. « La découverte d’une affaire d’espionnage d’une telle importance », auraient pensé Gonse et ses comparses, n’aurait pu que faire « du bruit et il suffira à l’État-major français de feindre une grande inquiétude pour que l’information présentée par le bordereau prenne une importance capitale aux yeux de l’Allemagne. Pendant que celle-ci se préoccupera du frein du 120, la France aura le champ libre pour fabriquer sa véritable arme secrète : le canon de 75 » (p. 80). Sandherr aurait donc envoyé Esterhazy chez Schwartzkoppen. Seulement, un problème de taille se serait rapidement posé. Comment en effet, nous explique l’auteur, un simple officier de troupes pouvait-il livrer des informations d’une telle importance (p. 83) ? Les attachés militaires, « au fil du temps » (un peu moins de deux mois !?), commençant à s’interroger, il devenait nécessaire, pour que l’intox se fît, de faire taire leurs soupçons. C’est pour cela que Gonse, Henry, Deloye, demandèrent à Esterhazy « d’écrire sous leur dictée une offre de renseignements (le bordereau) […], laissant entendre que ses informations proviennent de l’État-Major par l’intermédiaire d’un officier félon infiltré dans les lieux » (p. 83-84). Et qui mieux que Dreyfus, alsacien, artilleur, juif, pourra incarner ce fournisseur (p. 84) ? Esterhazy se plia donc à la demande de ses chefs mais « Henry a exigé qu’[il] en recopie une deuxième afin d’en conserver le double, “pour mémoire”. » Pour ce faire, « Esterhazy utilise une technique habituelle à l’époque : un papier calque, aussi appelé papier pelure. C’est en fait ce double qui servira à la machination, et c’est son original, conservé par Henry, que l’on tiendra pour le bordereau annoté (faussement annoté) par Guillaume II, encore désigné sous les termes de « document libérateur » ou « bordereau impérial ». « Esterhazy était si intimement convaincu de la protection inconditionnelle de ses chefs, explique l’auteur, qu’il n’a même pas cherché à dissimuler son écriture de ce deuxième bordereau. Il est cependant très probable qu’il a contrefait son écriture sur le premier bordereau, croyant que seul ce dernier document – non sa copie – serait utilisé, et dans le secret des chancelleries uniquement » (p. 85). La chose est pour le moins bien compliquée et pose une véritable question. Comment cela aurait-il pu être possible puisqu’à en croire l’auteur le bordereau ne serait jamais parvenu à Schwartzkoppen, comme l’indique l’absence d’enveloppe, le fait qu’il n’ait pas été froissé, les déchirures pour le moins curieuses et, surtout, le fait que l’attaché militaire ait dit dans ses souvenirs ne pas l’avoir reçu (p. 86-87) ? Si le bordereau ne lui est pas parvenu, comment Schwartzkoppen aurait-il pu être intoxiqué ? Ce ne put donc être que le 10 novembre 1896, quand Schwartzkoppen découvrit Le Matin et le fac-simile du bordereau, que commença l’intox ? Et de même comment aurait-il pu être rassuré sur la provenance des informations d’Esterhazy ? Pour que cela fût, Esterhazy se devait absolument d’en informer Schwartzkoppen. Il est clair que lui rendant visite le 3 novembre 1894, après la diffusion de la nouvelle de l’arrestation d’un traître à l’État-major, il n’aurait certainement pas laissé passer cette occasion de « faire taire les soupçons ». Pourquoi alors Schwartzkoppen n’en dit-il pas le moindre mot dans ses Carnets ? Pourquoi n’y évoque-t-il pas les soupçons que lui prête M. Israël ? Comment put-il se contenter de noter « qu’interrogé sur l’arrestation de Dreyfus [Esterhazy] n’a pu m’en donner aucune explication[40] ». Mais la principale objection n’est pas là. Comment peut-on imaginer que Sandherr et Henry aient pu imaginer un stratagème si compliqué qui ne pouvait que les desservir et réellement, cette fois, discréditer Esterhazy ? Certes, Esterhazy avait donc un informateur infiltré à l’État-Major… mais il ne l’avait plus… il avait été arrêté, incarcéré et attendait son jugement… A moins, bien sûr, que toute cette mise en scène bien compliquée n’ait eu pour but que de faire passer le seul bordereau. Mais, et nous en revenons au point de départ, encore eût-il fallu que ce fameux bordereau arrivât entre les mains de Schwartzkoppen. Et cela M. Israël le conteste. Passons au « bordereau annoté ». Le montage est ingénieux mais ne tient pas plus. Sans s’attarder sur le « document libérateur » qui ne fut jamais le « bordereau annoté », il est difficile de croire à la possibilité d’un tel stratagème. Quelle complication et quelle épaisse bêtise que celle d’hommes qui voulant perdre Dreyfus gardent le document à l’écriture contrefaite (qui doit sans doute imiter son écriture) et livrent celle qui est de l’écriture « naturelle » d’Esterhazy !!! Et quelle drôle d’idée que d’utiliser du papier pelure dans le but de « doubler le plus précisément possible ce document » pour finalement ne pas le faire…
Tout cela est ridicule, certes. Mais voyons quand même les preuves avancées par l’auteur. La première tient au vocabulaire et n’a que pour but de prouver qu’Henry en est le scripteur. Lisons : « Seul un homme peu cultivé comme Henry a pu commettre ces incorrections. C’est notamment le signe que Sandherr, homme de lettres brillant [ce qui mériterait une explication], n’a pas participé à la rédaction même s’il l’a inspirée. Sans doute s’est-il contenté de préparer le texte dicté par Henry, sans en corriger le vocabulaire qui, pensait-il, ne choquerait pas de la part d’un Alsacien comme Dreyfus. » (p. 86-87) Nous touchons là au comique. Les Alsaciens, à l’époque comme aujourd’hui, parlent parfaitement français et cela surtout quand ils sont polytechniciens. Il est douteux, d’autre part, que Sandherr, lui-même Alsacien – et pourtant présenté comme un « homme de lettres brillant » –, ait pu se dire une chose pareille. Mais passons. La deuxième et la troisième preuves sont sérieuses, qualifiées d’« indiscutables » (p. 92). Henry ayant découvert le bordereau en premier et connaissant Esterhazy depuis vingt ans, il aurait pu, reconnaissant l’écriture de son ami, le détruire. Sans doute, mais à condition que les deux anciens collègues soient restés en relations après 1880, ce qui reste à prouver. L’autre preuve, tout aussi « indiscutable », est plus sérieuse et nous permet de comprendre la méthode. M. Israël cite un rapport de police signé de l’agent Flor qui précise que « Le seul traître de l’État-Major était Henry ayant pour agent Esterhazy et Lemercier-Picard, chargés des communications avec Schwartzkoppen. […] le bordereau fut écrit par Esterhazy agissant par intermédiaire […] sous ordre de Sandherr » (p. 92). Nous savons ce que valent les rapports de police et qu’il faut toujours les prendre avec précaution. Mais surtout, si on veut leur donner quelque crédit, encore faut-il les lire avec attention et les citer en en respectant le texte. En effet, quand on regarde l’original – reproduit en fac-similé ! –, on lit :
Observer assure seul traître état major fut Henry ayant pour agent Esterhazy et Lemercier-Picard chargés des communications avec Schwartzkoppen Bordereau accompagne pièces livrées par Esterhazy il fut écrit par Esterhazy, agissant par intermédiaire et trouvé chez Schwarzkoppen par un agent français qui le porta à commandant Cordier sous ordre de Sandherr. (p. 92)
Passons sur la mauvaise transcription pour nous intéresser aux coupures opérées dans le texte. Le premier mot, « Observer », manque. Il est le titre du périodique anglais. Voilà déjà qui écroule la preuve : le rapport révélateur n’est qu’une vulgaire note de lecture… De plus, la seconde coupe donne un tout autre sens au texte. Disparaît non seulement le fait qu’il fut « trouvé chez Schwartzkoppen », ce qui contredirait la thèse du bordereau jamais sorti de la Section de Statistique, mais encore la phrase relative à Cordier, qui, dans l’original indique juste que Cordier était sous les ordres directs de Sandherr (« qui le porta à commandant Cordier sous ordre de Sandherr »), devient ici la preuve de la participation de Sandherr au complot (« le bordereau fut écrit par Esterhazy agissant par intermédiaire […] sous ordre de Sandherr »).
Concernant le deuxième point, la mort d’Henry, l’auteur a trouvé son assassin : Cesti, que nous avons rencontré auparavant. L’auteur a retrouvé aux archives de la Préfecture de Police un rapport selon lequel un tout à fait obscur régisseur de théâtre affirmait « avoir les preuves que le lieutenant-colonel Henry a été assassiné par Lionel de Cesti » (p. 256 et 257). La preuve est maigre et nous savons, quitte à nous répéter, ce que vaut ce genre de document. Si on devait en croire les rapports de police, Dreyfus aurait été joueur, aurait collectionné les maîtresses, aurait fréquenté des officiers allemands en Belgique, le Syndicat dirigé d’Allemagne aurait existé et distribué des millions à poignées, les dreyfusards auraient été les salariés d’une cause à laquelle ils ne croyaient pas, ou, pour citer un rapport qui se trouve aux Archives nationales, Picquart descendrait « d’un juif du Palatinat nommé Spitzer (traduction : qui pique) », Bernard Lazare serait « un ancien rabbin de Koenigsberg », Zola descendrait « d’un juif dalmate, émigré à Venise »[41], etc. Que Cesti soit mentionné dans un rapport de police ne prouve donc pas grand-chose. Qu’il fut un escroc, qu’il eut des rapports avec Drumont, qu’il fut interrogé par Laurent-Atthalin et que son dossier à la Préfecture de Police soit curieusement vide entre 1898 et 1917 (p. 257-270) n’y ajoute rien. Pourtant il y avait bien une solution pour être définitivement fixé. L’auteur nous la révèle : « […] il nous manquait malgré tout un maillon pour reconstituer la chaîne de nos déductions : il fallait rechercher si une quelconque relation avait pu exister entre Cesti et les grands acteurs de l’Affaire […]. » Et il ajoute : « Cette démarche nous a semblé vouée à l’échec jusqu’à ce que nous découvrions un interrogatoire mené par le général de Pellieux, chargé de l’enquête sur Esterhazy, dans lequel Cesti raconte qu’il a tenté de piéger Mathieu Dreyfus sur ordre de la Section de Statistique » (p. 270). Cesti agent d’Henry… Et l’auteur souligne et donne en note une référence : « Cassation V. II, p. 101, interrogatoire du 25 novembre 1897 ». Et un peu plus loin : « […] Selon Esterhazy, c’est Henry lui-même qui a envoyé Cesti dans la famille Dreyfus » ; et en note une nouvelle référence : Reinach V. III, p. 103. » Et de conclure : « […] Cesti, homme de main de l’État-Major, de la Section de Statistique et de tous ceux qui le payaient, a, sur ordre, assassiné Henry et tenté de maquiller le crime en suicide. » (p. 270). Reconstituons la méthode. Si nous ouvrons le Reinach aux références données, nous pouvons lire que « […] c’était Henry qui avait envoyé cet aventurier [Cesti] aux Dreyfus ». En note, une référence : « Voir t. II, p. 183 ». Si on s’y reporte, on peut lire que « Mathieu avait supposé que Cesti lui était envoyé, par le bureau des Renseignements, pour lui tendre quelque piège ». Ici une nouvelle note qui dit que « Cesti raconta sa tentative à Henry, qui en informa Esterhazy ; celui-ci en parla à Pellieux ». (cass., II, 101, interrogatoire du 25 novembre 1897) ». L’auteur peut donc écrire avoir découvert « un interrogatoire mené par le général Pellieux, chargé de l’enquête sur Esterhazy, dans lequel Cesti raconte qu’il a tenté de piéger Mathieu Dreyfus sur ordre de la Section de Statistique » et, sans vérification, reproduire la note de Reinach. Et c’est là qu’apparaît le problème de méthode qui fait de ce livre, dont les bonnes intentions sont incontestables, un bien curieux travail. Si l’auteur était allé à la source qu’il indique, la source Pellieux, il aurait pu lire : « […] l’un des agents les plus actifs dans les bas-fonds du syndicat, est le nommé Cesti, compromis dans les affaires Lebaudy. […] Il a eu, il y a quelques temps, un dossier Dreyfus entre les mains, qu’il a fait copier, à la machine à écrire, par une dactylographe, dont je saurai bientôt le nom. Il a eu aussi, entre les mains, une série de lettres soi-disant à moi adressées par une espionne, de différents points de la frontière. » La déposition n’est donc pas de Cesti, mais d’Esterhazy et, surtout, Cesti y est présenté non comme un « agent de la Section de Statistique » mais comme un allié des Dreyfus. Et quant à l’instruction Pellieux, consultable aux Archives nationales, elle ne contient pas la moindre déposition de Cesti… et pour cause… La boucle que l’auteur annonçait « bouclée » se déboucle.
Quant au troisième point, le pacte entre le gouvernement et la famille Dreyfus, il est le suivant. Pour satisfaire l’armée et permettre à l’innocent de ne pas rester en prison, Waldeck-Rousseau va « convaincre Alfred Dreyfus de se reconnaître coupable en échange de sa grâce » (p. 318).
Alfred Dreyfus, d’abord réticent à cette idée, n’a accepté cette solution que pour sauver l’Armée. A ses yeux, l’honneur de l’Armée française compte plus que le sien.
Par dévouement à sa patrie, Alfred Dreyfus taira même toute sa vie l’existence de ce pacte, sans jamais répondre à ceux qui trouvaient inacceptable son silence. (p. 321).
Pour soutenir l’insoutenable, l’auteur se fonde sur les « archives de Maître Labori », intitulées en note : “Notes manuscrites” de Labori, recueillies par sa femme Marguerite » (p. 322) et données dans la section « Les archives » de la bibliographie (p. 489). On n’aura compris qu’il ne s’agit pas d’archives, ici, mais de l’ouvrage de Marguerite-Fernand Labori[42] qui, curieusement, manque dans la partie « Sources bibliographiques ». Ce sont sans doute là « les fonds d’archives jusqu’alors inaccessibles » annoncés par le quatrième de couverture[43]… Est-il nécessaire de préciser les problèmes que posent l’ouvrage de Marguerite-Fernand Labori[44] et donc sur la thèse qu’il défend et qui est reprise ici, en toute tranquillité, sans recul ni esprit critique ?
 En 2008, ce fut au tour de Franck Ferrand de nous donner son point de vue sur l’Affaire dans son Histoire interdite. Révélations sur l’histoire de France[45]. En 30 pages qui accumulent les approximations, les erreurs et les naïvetés (on notera le superbe : « cette pièce prendra le nom de faux Henry, ce qui nous en dit long, déjà, sur son authenticité…), il reprenait la thèse du troisième homme, occasion de fustiger la « vulgate » de « l’histoire officielle ». Passons.
En 2008, ce fut au tour de Franck Ferrand de nous donner son point de vue sur l’Affaire dans son Histoire interdite. Révélations sur l’histoire de France[45]. En 30 pages qui accumulent les approximations, les erreurs et les naïvetés (on notera le superbe : « cette pièce prendra le nom de faux Henry, ce qui nous en dit long, déjà, sur son authenticité…), il reprenait la thèse du troisième homme, occasion de fustiger la « vulgate » de « l’histoire officielle ». Passons.
Tous ces ouvrages, qui procèdent – nous voulons le croire – de louables intentions, posent toutefois de sérieux problèmes. Le premier, on l’a vu, est un problème de méthode. Le recours aux sources secondaires, voire aux sources de seconde main, ne peut permettre d’avoir une lecture claire, et surtout une lecture exacte, de l’Affaire et ouvre la porte à toutes les interprétations dont le principal défaut est de ne reposer sur rien d’autre que sur la capacité d’imagination de celui qui écrit. On ne peut travailler sur l’Affaire en faisant l’économie d’un sérieux travail archivistique et sans avoir au moins lu la totalité des procédures au cours desquelles les différents acteurs s’exprimèrent, se contredirent, se corrigèrent, etc. Le deuxième problème est un problème de parti pris qui dépasse très largement la question historienne stricto sensu. Le ton péremptoire qui caractérise tous ces travaux, la grille de lecture mise en place et dans laquelle tout doit entrer, quitte à en étirer ce qui est trop court, à en couper ce qui dépasse – une manière d’écrire l’histoire comme Procuste concevait l’hospitalité qu’il offrait à ceux qu’il rencontrait sur son chemin –, relève d’une simple question d’honnêteté intellectuelle. Enfin, le troisième problème, qui est plus sérieux celui-là, est que cette nécessité de trouver d’autres raisons que le simple engrenage fatal de l’erreur devenu crime pour ne pas se dédire, que cette manie de l’intox, du sacrifice volontaire, etc., constitue une manière de légitimation de la politique de l’État-major[46], pire même une proclamation d’innocence qui n’est jamais qu’une nouvelle forme, d’une manière douce et recevable dans le propos, de la défense antidreyfusarde de la raison d’État. On ne remet plus en question l’innocence de Dreyfus mais on continue d’excuser le crime dont il fut victime par des « raisons supérieures » face auxquelles les libertés individuelles ne pouvaient, ne peuvent et ne pourront jamais avoir de poids.
Philippe oriol
[1] Georges Sorel, La Révolution dreyfusienne, Paris, Librairie des sciences politiques et sociales Marcel Rivière, 1909, p. 9.
[2] Vincent Duclert, Alfred Dreyfus. L’honneur d’un patriote, Paris, Fayard, 2006, p. 999.
[3] A propos de l’arrêt de 1906 : « En fuyant les débats, Dreyfus semblait, une seconde fois, se reconnaître coupable ! » (p. 197).
[4] Lettre d’Esterhazy à Carrière du 6 août 1899 publiée dans La Révision du Procès de Rennes. Enquête de la Chambre criminelle de la Cour de cassation (5 mars 1904-19 novembre 1904), 3 vol., Paris, Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen, 1908, t. III, p. 681.
[5] Les Carnets de Schwartzkoppen (la vérité sur Dreyfus), Paris, Rieder, 1930, p. 5.
[6] Déposition Du Paty à l’occasion de la seconde révision dans La Révision du Procès de Rennes. Enquête de la Chambre criminelle de la Cour de cassation (5 mars 1904-19 novembre 1904), op. cit., t. II, p. 720-721.
[7] Lettre de Berthe Henry à Charpentier du 15 décembre 1935 citée dans Armand Charpentier, Les Côtés mystérieux de l’affaire Dreyfus, op. cit., p. 139. Voir aussi la lettre du 2 juin, p. 136.
[8] Déposition Wattinne dans La Révision du Procès de Rennes. Enquête de la Chambre criminelle de la Cour de cassation (5 mars 1904-19 novembre 1904), op. cit., t. II, p. 605-606.
[9] Publié l’année suivante chez Calmann-Lévy.
[10] Armand Charpentier, Les Côtés mystérieux de l’affaire Dreyfus, op. cit., p. 180-214.
[11] Ibid., p. 207, note 1.
[12] Déposition Picquart dans L’Affaire Dreyfus. Le Procès Zola devant la Cour d’Assises de la Seine et la Cour de Cassation (7 février-23 février – 31 mars-2 avril 1898. Compte rendu sténographique « in extenso », Paris, Stock, 1998, p. 346-347.
[13] Articles reproduits p. 267-271 du livre de Charpentier.
[14] « La Déposition d’Esterhazy devant le Consul général de France à Londres. Texte publié par “L’Indépendance belge” » dans Commandant Esterhazy. Dépositions et explications complètes, Bruxelles, G. Fischlin, 1901, p. 101.
[15] « Note » de Walter du 7 mai 1903, AN BB19 75.
[16] Il enseignant de voir sur les rabats de la jaquette un argus du livre de Paléologue…
[17] Maurice Paléologue, Journal de l’affaire Dreyfus,Paris, Plon, 1955, p. 271.
[18] Est-ce à lui que pensait Paléologue, comme nous l’indiquerait Legrand-Girarde (Un quart de siècle au service de la France, Paris, Presses Littéraires de France, 1954, p. 461) qui note en 1904 cette conviction des Affaire étrangères ? Une conviction qu’il qualifie de « haut délire, ou alors… » Ou pensait-il à Saussier, comme l’aurait confirmé son « hréritière » (Michel de Lombarès, L’Affaire Dreyfus. La Clé du mystère, Paris, Robert Laffont, Les ombres de l’histoire, 1972, p. 12-13).
[19] On la trouve aux pages 67-69.
[20] P. 113.
[21] Maurice Paléologue, Journal de l’Affaire Dreyfus, op. cit., p. 29.
[22] Sur ce fait, peu connu, voir notre Histoire de l’Affaire Dreyfus à paraître en 2013 aux Belles Lettres.
[23] Michel de Lombarès, L’Affaire Dreyfus. La Clé du mystère, Paris, Robert Laffont, Les ombres de l’histoire, 1972. La thèse exposée dans ce livre était la reprise très largement augmentée d’un article, « L’Affaire Dreyfus. Aperçu général. Aperçus nouveaux », publié dans la Revue de Défense nationale, juillet 1969, p. 1125-1143.
[24] Maurice Baumont, Aux sources de l’Affaire Dreyfus. L’Affaire Dreyfus d’après les archives diplomatiques, Paris, Les Productions de Paris, 1959, p. 22-23.
[25] Les Carnets de Schwartzkoppen (la vérité sur Dreyfus), op. cit., p. 19.
[26] Michel de Lombarès, L’Affaire Dreyfus, Paris/Limoges, Lavauzelle, 1985.
[27] Cf. supra, p. ???????????
[28] Mathieu Dreyfus, L’Affaire telle que je l’ai vécue, Paris, Grasset, 1978, p. 50.
[29] Jean Cherasse et Patrice Boussel, Dreyfus ou l’intolérable vérité, Paris, Pygmalion, 1975.
[30] Vincent Duclert, Dreyfus au Panthéon. Voyage au cœur de la République, op. cit., p. 275.
[31] Max Guermann, « La “terrible” vérité », Les Cahiers naturalistes, n° 62, 1988, p. 35-57.
[32] Ida-Marie Frandon, L’Affaire et le grand secret. Le Capitaine Dreyfus ou l’épopée du 75, Fontainebleau, L’Auteur, 1993.
[33] Dans notre Histoire de l’affaire Dreyfus, op. cit., p. 301-303.
[34] Jean Doise, Un secret bien gardé. Histoire militaire de l’affaire Dreyfus, Paris, Seuil, 1994.
[35] Voir à ce sujet l’excellent et salutaire article de Vincent Duclert, « L’Affaire Dreyfus et le tournant critique », Annales. Histoire, Sciences sociales, 50e année, n° 3, 1995, p. 563-578.
[36] Jean-François Deniau, Le Bureau des secrets perdus, Paris, Odile Jacob, 2000, p. 17-72.
[37] Lettre de Dreyfus au Président de la République du 5 octobre 1897 (lettre dont une copie figurait sous le numéro 106 dans le dossier secret : « Dossier secret Dreyfus », AN BB19 118 et MAHJ, 97.17.61.1. Il en existe aussi une copie dans les papiers Esterhazy conservées à la BNF, n.a.fr. 16464).
[38] Lettre de Dreyfus au Président de la République du 8 juillet 1897, dans Alfred Dreyfus, Cinq années de ma vie, op. cit., p. 228. Citée dans La Révision du procès Dreyfus. Débats de la Cour de cassation, op. cit., p. 324. Sur cette question du « pacte », voir notre Histoire de l’affaire Dreyfus, op. cit., p. 298-308.
[39] Armand Israël, Les Vérités cachées de l’affaire Dreyfus, Paris, Albin Michel, 2000.
[40] Les Carnets de Schwartzkoppen (la vérité sur Dreyfus), op. cit., p. 127.
[41] « Information du 20 février 1898 », AN BB19 114.
[42] Marguerite-Fernand Labori, Labori. Ses notes manuscrites. Sa vie, Paris/Neuchatel, Éditions Victor Attinger, 1947.
[43] Encore les « Archives juives » qui sont la revue du même nom publiée par Liana Lévi.
[44] Nous reviendrons longuement sur cette question dans notre Histoire à paraître.
[45] Franck Ferrand, L’Histoire interdite. Révélations sur l’histoire de France, Paris, Tallandier, 2008.
[46] Vincent Duclert, « L’Affaire Dreyfus et le tournant critique », Annales. Histoire, Sciences sociales, 50e année, n° 3, 1995, p. 563-578.
L’Affaire Dreyfus. Nouvelle réplique au camp dreyfusard [sic] par Adrien Abauzit
 Adrien Abauzit vient de rééditer l’exploit : écrire sur l’Affaire sur la base d’un corpus minimal dont il ne retient que ce qui « colle » avec sa « thèse », dont il oublie, avec une constance obstinée, ce qui viendrait la contredire et propose au final des interprétations forcées qui feront plaisir à ses lecteurs habituels, ceux qui veulent, parce qu’il le faut, que Dreyfus soit coupable.
Adrien Abauzit vient de rééditer l’exploit : écrire sur l’Affaire sur la base d’un corpus minimal dont il ne retient que ce qui « colle » avec sa « thèse », dont il oublie, avec une constance obstinée, ce qui viendrait la contredire et propose au final des interprétations forcées qui feront plaisir à ses lecteurs habituels, ceux qui veulent, parce qu’il le faut, que Dreyfus soit coupable.
Dans notre critique (voir ici), nous étions gardés, parce que nous refusons de nous placer sur le terrain qu’Adrien Abauzit a choisi et qui lui permet par exemple de qualifier le grand historien qu’est le regretté Marcel Thomas de « faussaire », d’entrer dans les arguments ad personam – qu’il confond avec les arguments ad hominem. Nous ne nous étions occupés que du livre, en disant et en montrant quelle farce il était et de quelles grosses ficelles il était fait… Ce parti pris, nous le conserverons – en montant et démontrant plutôt qu’en assénant –, mais il faut convenir qu’entre lui et nous il y a un monde et sans doute plusieurs qui ne sont pas que la République. Ainsi, quand nous répondons à ses « démonstrations », nous donnons son texte intégral et le commentons (voir ici). Adrien Abauzit, lui, quand il nous répond, ne donne que son texte (revu ; il s’agit de la réponse qu’il avait publié il y a deux ans et demi sur le site de sa maison d’édition), faisant quelques allusions choisies à nos objections (qui comptent 142 000 signes, tout de même), et écartant bien sûr tout ce à quoi il serait bien en peine de répondre… À ces objections, qui réduisent en fines particules les miettes qui composent sa thèse, il se contente d’opposer une petite note infrapaginale qui indique sa manière de mener la discussion et la controverse : « J’ajoute que la SIHAD a fait par la suite une “Réponse à ma réplique”. N’étant pas de ceux qui pensent que le dernier qui parle est forcément celui qui a raison, je n’ai pas jugé utile d’y répondre au moment de sa publication, d’autant que ma réplique initiale se suffit à elle-même [sic]. Je profite de cette publication pour finalement apporter quelques éléments de réponse nouveaux, car certains arguments de la SIHAD valent vraiment le détour… » La chose est pratique… Mais peu importe et répondons aux « nouveaux éléments de réponse », bien rares à vrai dire, en signalant tous ceux, si nombreux, qu’il a écartés…
L’introduction (p. 9-10 de ce nouveau livre). Adrien Abauzit est satisfait que la SIHAD ait été « contraint[e] de se rabaisser de répondre à l’hurluberlu qu'[il est] supposé être ». « Grande victoire », se réjouit-il, puisque ‘le système [c’est nous] a alors dû renoncer à sa principale arme : l’invisiblisation ». Contrainte ? Devoir ? Mais pourquoi ? Nous n’avons répondu, et contre l’avis de certains qui estiment qu’on ne répond pas aux « hurluberlus », que parce que nous l’avons décidé et parce que telle la mission que s’est fixée la SIHAD. Ni la prétendue « qualité » d’un travail, ni la Providence ne nous ont forcé la main… Maintenant, quant à dire qu’Adrien Abauzit et nous « sommes maintenant sur le même champ de bataille », c’est possible… mais il est clair, comme nous l’expliquions précédemment, que nous ne nous battons pas avec les mêmes armes et que nous refusons avec obstination de nous servir de celles qu’il affectionne.
P. 11 et 12. Où nous expliquons à Adrien Abauzit ce qu’est un historien et qu’un historien, s’il est historien, ne peut-être dreyfusard ou antidreyfusard… pas de « nouveaux éléments de réponse » d’Adrien Abauzit.
P. 12. Où nous expliquons à Adrien Abauzit qu’il ne nous intéresse que comme auteur d’un livre sur l’Affaire… pas de « nouveaux éléments de réponse » d’Adrien Abauzit.
P. 12-13. Où nous expliquons à Adrien Abauzit que dire que « la SIHAD » est [en 2018] en contradiction avec Demange [en 1899] » est plutôt rassurant et où nous lui expliquons ce qu’est le métier d’historien… pas de « nouveaux éléments de réponse » d’Adrien Abauzit.
P. 13-14. Où nous montrons à Adrien Abauzit qu’en n’aucun cas nous ne l’avons « godwinisé » et où nous profitons de l’occasion pour lui expliquer ce qu’est le « point Godwin »… pas de « nouveaux éléments de réponse » d’Adrien Abauzit.
P. 14. Où nous expliquons à Adrien Abauzit que nous n’avons jamais tenté de le disqualifier sur la base de ses précédents travaux en défense de Pétain… pas de « nouveaux éléments de réponse » d’Adrien Abauzit.
P. 15. Où nous expliquons à Adrien Abauzit le peu d’intérêt que nous portons au fait qu’il soit ou ne soit pas historien mais qu’en faisant un livre d’histoire il fait œuvre d’historien… pas de « nouveaux éléments de réponse » d’Adrien Abauzit.
P. 15-18. Ajout d’Adrien Abauzit au texte préalablement publié sur le site de sa maison d’édition. Adrien Abauzit constate à juste titre notre « condition de non-juriste » et soutient que ce cruel manque nous enlèverait « toute qualité pour apprécier au mieux l’affaire Dreyfus, dont le cœur est tout de même une série de procédure judiciaire ». Que dire ? On ne peut donc travailler sur l’armée sans être militaire, sur la culture du blé en Ouzbékistan sans être agriculteur ou ouzbek ou sur les crimes sans être un assassin ? Peu importe… Adrien Abauzit nous le prouve en allant commenter les travaux de deux historiens « dreyfusards » (nous avons essayé, sans avoir de « nouveaux éléments de réponse », en liminaire à notre réponse, de lui expliquer que « dreyfusard » et « antidreyfusard » sont des concepts qui n’ont plus cours aujourd’hui, que nous n’étions qu’historiens et que le fait de nous accorder sur l’innocence de Dreyfus parce qu’elle était une réalité et la vérité historique ne faisait pas de nous des « dreyfusards » mais très exactement des historiens), Vincent Duclert et Bertrand Joly, et nous donne un petit TD de droit sur le cas de l’article 445 du code d’instruction criminelle et, à la suite de l’Action française, de sa falsification par la Cour de cassation pour réhabiliter Dreyfus. Malheureux historiens qui ignorent ce que sait l’avocat, à savoir que l’article 111-4 du code pénal affirme que « la loi pénale est d’interprétation stricte ». C’est vrai… seulement c’est oublier l’interprétation téléologique qui permet au juge, quand le texte n’est pas clair, de rechercher l’intention du législateur, d’extraire l’esprit du texte – la fameuse ratio legis – et d’y subordonner sa lettre. Manque de clarté, donc, ou absurdité de l’interprétation littérale. Et c’est justement le cas dans lequel nous nous trouvons avec ce fameux 445, dans le cadre précis qu’est celui de l’Affaire. Expliquons un peu. L’article 445 dit que « Si l’annulation de l’arrêt à l’égard d’un condamné vivant ne laisse rien subsister qui puisse être qualifié de crime ou délit, aucun renvoi ne sera prononcé », autrement dit, si Dreyfus est vivant, et qu’il n’y a pas crime, c’est-à-dire pas trahison, le renvoi devant un nouveau conseil de guerre ne sera pas prononcé. Mais il y a bien trahison. Donc, dans l’absolu, la Cour de cassation ne peut juger au fond, c’est-à-dire casser sans renvoi… Dreyfus est vivant, le crime existe, il y a donc à juger et il doit donc y avoir renvoi… Seulement, le cas qui est le nôtre ici est absurde et ouvre donc la porte à cette recherche de la ratio legis et par conséquent à l’interprétation téléologique. Absurde en effet – s’il est encore nécessaire de l’expliquer – parce les nouveaux juges militaires appelés à se prononcer sur le cas Dreyfus n’auraient pu que, soit entériner purement et simplement l’arrêt rendu par la Cour de cassation qui disait Dreyfus innocent, soit, en ne le suivant pas, condamner un homme dont l’innocence avait été solennellement prononcée par la juridiction suprême. Il est clair, comme l’écrit Baudouin dans son réquisitoire, qu’en « disposant qu’il n’y a pas lieu à renvoi, s’il ne subsiste rien qui puisse être qualifié crime ou délit, le législateur n’a pas entendu se placer à un point de vue abstrait. Il a eu évidemment en vue, comme le texte l’indique, le condamné en faveur de qui la condamnation est ordonnée[1] ». Voilà précisément ce qu’est une interprétation téléologique. N’eût-il pas en effet été absurde de voir Dreyfus jugé pour un crime qu’il n’avait pas commis simplement parce que le crime existait ? Qu’eût été en effet un tel procès où il n’y aurait plus rien à juger sinon le crime ?
Voilà donc une bien drôle de manière de discuter en ne donnant qu’une partie de l’information et en l’assurant par la simple affirmation d’une expertise qui, au final, semble plus que discutable.
Et quant à la fable de la falsification du 445 par la Cour de cassation, plutôt que de s’en tenir à Dutrait-Crozon et aux quelques autres qui s’en revendiquent ou tentent de maintenir vivante sa flammette, Adrien Abauzit aurait pu se reporter au texte de l’arrêt et constater que si la mise au clair de l’interprétation de la loi en était donnée à la fin des attendus (« Attendu, en dernière analyse, que de l’accusation portée contre Dreyfus rien ne reste debout ; et que l’annulation du jugement du Conseil de guerre ne laisse rien subsister qui puisse, à sa charge, être qualifié crime ou délit »), le texte dans sa forme originale était lui aussi donné textuellement dans la première partie (« si l’annulation prononcée à l’égard d’un condamné vivant ne laisse rien subsister qui puisse être qualifié crime ou délit, aucun renvoi ne sera prononcé »). Quel faux serait donc celui qui donnerait, avant le texte falsifié, le texte original, livrant ainsi lui-même la clé de la supercherie ?
P. 18. Où nous expliquons à Adrien Abauzit que nous n’avons pas à son propos usé d’attaques ad hominem ou ad personam et quelle différence il existe entre ces deux concepts… pas de « nouveaux éléments de réponse » d’Adrien Abauzit.
P. 18-20. Où nous expliquons à Adrien Abauzit qu’il n’est pas niable que son corpus de travail soit partiel et partial et, sur un exemple précis (parmi cent), que le peu de sérieux de sa recherche et sa méconnaissance du corpus lui font avancer hardiment des accusations pour le moins non fondées… pas de « nouveaux éléments de réponse » d’Adrien Abauzit mais un petit ajout en forme de nouvelles justifications, liste des auteurs qu’il dit avoir lus et dans lesquels il n’a « pas trouvé […] de faits nouveaux venant bouleverser les débats du procès de Rennes ». Adrien Abauzit a donc dû lire trop vite ou oublier des pages…
P. 20-21. Où nous expliquons à Adrien Abauzit pourquoi les sources qu’il considère comme « solides » ne le sont pas et combien il aurait gagné à lire quelques auteurs qu’il ignore… pas de « nouveaux éléments de réponse » d’Adrien Abauzit.
P. 21-23. Où nous expliquons à Adrien Abauzit qu’on ne peut espérer faire un travail sérieux sur un sujet qui appartient à l’histoire en faisant l’économie du travail sur les archives… Enfin de « nouveaux éléments de réponse » d’Adrien Abauzit à propos de la promesse faite à Picquart de se montrer bon soldat et de bien se tenir au procès Zola (ces « éléments » se trouvent p. 25-26). Adrien Abauzit nous considère comme fort gênés par la « nullité des explications de Picquart au procès Zola » et qualifie de « lapin sortant d’un chapeau » notre explication sur l’attitude de Picquart à ce moment et les raisons que nous proposons en hypothèse à cette déposition qui n’est pas nulle mais qui ne dit rien de ce qu’elle pouvait dire. Cet « élément de réponse » prouve juste qu’Adrien Abauzit est indiscutablement passé à côté d’un certain nombre de lectures qui, sur la base d’un travail sur les archives, étaient cette hypothèse. Il prouve aussi une manière qui consiste à rejeter par principe, et sans savoir de quoi il s’agit, tout information quand elle ne colle pas avec la thèse qu’il a a défendre.
P. 23-25. Où nous expliquons à Adrien Abauzit que le travail « de juriste » qu’il revendique avoir fait sur un sujet d’histoire ne peut se faire qu’au prix d’une vraie connaissance de son dossier et, une nouvelle fois, qu’on ne peut espérer faire un travail sérieux sur un sujet qui appartient à l’histoire en faisant l’économie du travail sur les archives… Ajout d’Adrien Abauzit qui règle ses comptes avec Monique Delcroix qui défend la même thèse que lui mais a peu de considération pour son travail et nous adresse – après avoir ignoré toutes nos démonstrations dont la liste déjà longue ne fait que commencer – le reproche de n’avoir pas répondu à deux questions. Allons-y alors, comme disait l’autre. Adrien Abauzit demande tout d’abord : « sur quelle base Marcel Thomas a-t-il osé écrire que Souffrain avait un alibi dans L’Affaire sans Dreyfus» ? Et il demande ensuite : « Et quels éléments par la suite lui ont fait admettre sa présence sur les lieux du crime ? » Nous ne pouvons pas répondre à la première question parce que nous ne sommes pas Marcel Thomas mais nous pourrions toutefois proposer qu’il le déduisait sans doute du fait, comme nous l’avons expliqué dans notre réponse à Adrien Abauzit, que Souffrain ne fut jamais inquiété et que la plainte qu’avait déposée Picquart contre lui fut classée sans suite. Quant à la seconde question, la réponse en est sans doute que Marcel Thomas n’avait pas pris connaissance en 1961 du rapport qui se trouve dans le BB19 123 et qui le dit (et qui d’ailleurs ne prouve rien quant à la culpabilité du Souffrain en question). Mais Adrien Abauzit aurait dû comprendre quelque chose de remarquable ici, c’est que Marcel Thomas, historien digne de ce nom, n’hésitait pas à revenir sur ce qu’il avait pu écrire et que son souci de vérité – celui qui est commandé par le fait qu’il soit historien – l’obligeait à le faire.
P. 27. Où nous expliquons une nouvelle fois à Adrien Abauzit qu’il ne peut se targuer d’avoir travaillé sur les procédures et les procès quand il en ignore la moitié et qu’on ne peut espérer faire un travail sérieux sur un sujet qui appartient à l’histoire en faisant l’économie du travail sur les archives… pas de « nouveaux éléments de réponse » d’Adrien Abauzit.
P. 27-28. Où nous expliquons à Adrien Abauzit pourquoi son travail manque cruellement de rigueur et où nous le lui montrons à travers quelques exemples significatifs… pas de « nouveaux éléments de réponse » d’Adrien Abauzit.
P. 28. Où nous expliquons à deux reprises à Adrien Abauzit qu’il ne peut sérieusement soutenir que les correspondances, mémoires, souvenirs qu’il n’a pas lus ne pouvaient lui être d’aucun intérêt parce qu’ils n’étaient pas des pièces « contradictoirement débattu[e]s lors des différentes procédures »… pas de « nouveaux éléments de réponse » d’Adrien Abauzit et c’est dommage parce que comme on le verra bientôt (p. 40-51) ce n’est pas toujours dans les procédures qu’il trouve ses « preuves »…
P. 29-30. Où nous expliquons à Adrien Abauzit que nous ne lui avons pas fait le reproche d’adhérer à la théorie du complot… pas de « nouveaux éléments de réponse » d’Adrien Abauzit.
P. 30-33. Où nous expliquons à Adrien Abauzit toute la différence qui peut exister entre les dreyfusards de 1898 et les historiens de 2020… Un micro-élément de réponse qui ne change pas grand-chose au fond. Adrien Abauzit, en effet, sur le principe du « ce n’est pas moi c’est l’autre », ajoute un paragraphe pour signaler qu’Alain Pagès, dans son récent L’Affaire Dreyfus, vérités et légendes, emploie le mot de « complot » au sujet de l’armée. Mis à part le fait que la phrase citée, ainsi sortie de son contexte donne à comprendre autre chose que ce qu’elle dit (Alain Pagès ne parle que de la protection offerte à Esterhazy et rien de plus), nous rappelons à Adrien Abauzit ce que nous lui avons répondu : « Jaurès est Jaurès et Reinach est Reinach. Ce qu’ils ont put écrire ne regarde qu’eux et ne nous engage pas. Nous sommes historiens ». Et nous le disons aussi en ce qui concerne Alain Pagès et ajoutons que quand bien même il aurait par extraordinaire soutenu ce que lui fait dire Adrien Abauzit, il n’engagerait, se faisant, que lui-même. Alain Pagès écrit ce qu’il veut et les historiens, qu’Adrien Abauzit s’entête à qualifier de « dreyfusards », ne sont pas les soldats d’une petite armée et n’écrivent pas d’une même plume.
P. 33-35. Où nous expliquons à Adrien Abauzit que nous ne lui avons aucunement reproché de refuser de considérer que l’armée était antisémite… pas de réels « nouveaux éléments de réponse » d’Adrien Abauzit si ce n’est une petite modification remarquable. Nous avions corrigé une première fois (dans la critique de son premier ; voir ici) ce qu’avait écrit Adrien Abauzit au sujet du nombre d’officiers juifs dans l’armée. Il avait corrigé dans cette réplique pour se tromper une nouvelle fois : il ne s’agissait pas de 600 officiers, comme il l’écrivait, mais de 300. Lui ayant signalé dans notre réponse, Adrien Abauzit corrige à nouveau dans cette dernière version mais ne veut pas de notre chiffre, indiscutable. 300, ce n’est vraiment pas assez ! Il corrige donc son « 600 » en « plusieurs centaines » ! Et on ne peut lui en faire le reproche : 3, c’est « plusieurs », c’est indiscutable…
P. 35-36. Où nous expliquons à Adrien Abauzit, en synthèse, pourquoi son travail laisse pour le moins à désirer… pas de « nouveaux éléments de réponse » d’Adrien Abauzit si ce n’est qu’il va chercher à la rescousse Bertrand Joly qui constate à juste titre que dans la phénoménale bibliographie de l’affaire Dreyfus nombreux sont les ouvrages (et nous le disons souvent dans nos comptes rendus sur ce blog) sans intérêt et qui ne font que répéter inlassablement, compilations nouvelles de compilations anciennes, les mêmes choses, souvent approximatives quand elles ne sont pas fausses. Cette petite remarque amène deux réponse : 1. ce n’est pas parce qu’il y a du déchet qu’on peut se passer de lire et que, c’est l’évidence même, l’avoir lu pour savoir qu’un travail est défectueux. 2. « le doux ronron tranquille et conformiste » de ces ouvrages ne s’explique pas par la peur des « chercheurs de l’académisme républicain » de développer un propos hétérodoxe qui ruinerait leur carrière, comme nous l’expliquions dans notre réponse. C’est juste que nombreux sont ceux qui travaillent mal, ne vont jamais aux sources primaires ou si peu, se contentent de compiler, etc. Nous renvoyons une nouvelle fois aux critiques présentes sur ce même blog qui, s’il en était besoin, montrent combien est un fantasme cette idée un tantinet complotiste et paranoïde de l’entente entre les « chercheurs de l’académisme républicain » et de leur soumission craintive à un imaginaire diktat officiel.
P. 36. Où nous expliquons à Adrien Abauzit ce qu’est l’affaire du SHAT de 1994 qu’il évoque sans trop savoir de quoi il parle… pas de « nouveaux éléments de réponse » d’Adrien Abauzit et c’est dommage parce que ça lui aurait au moins permis de corriger la faute commise sur le nom de l’ancien chef du SHAT.
P. 37. Où nous proposons à Adrien Abauzit, à propos de la « minute Bayle », de considérer qu’il pourrait être envisageable de ne pas écarter par principe la possibilité que les hommes de l’État-major pussent ne pas être honnête et de bonne foi… pas de « nouveaux éléments de réponse » d’Adrien Abauzit.
P. 38. Où nous proposons à Adrien Abauzit, à propos de la « minute Bayle », d’envisager que l’équation : une pièce disparaît à tel endroit et Dreyfus est à tel endroit n’est pas suffisant pour constituer un indice de culpabilité… pas de « nouveaux éléments de réponse » d’Adrien Abauzit.
P. 38-39. Où nous proposons à Adrien Abauzit, à propos de la « minute Bayle », d’envisager que Dreyfus aurait pu peut-être ne pas être assez bête pour attirer l’attention sur lui en dérobant la pièce sur laquelle il travaillait… pas de « nouveaux éléments de réponse » d’Adrien Abauzit.
P. 39. Où nous proposons à Adrien Abauzit de ne pas se sentir obligé d’avoir recours à des considérations désobligeantes pour éluder la discussion… pas de « nouveaux éléments de réponse » d’Adrien Abauzit.
P. 39-40. Où nous proposons à Adrien Abauzit, à propos de la « minute Bayle », d’envisager que le lien qu’il y voit avec l’attribution de l’artillerie lourde à la 9e armée, coule d’une source dont l’eau n’est peut-être pas aussi claire que cela… pas de « nouveaux éléments de réponse » d’Adrien Abauzit.
P. 40. Où nous proposons à Adrien Abauzit, à propos de la « minute Bayle », d’envisager que partir du postulat que toute pièce révélée, découverte ou retrouvée par Targe, est un faux ne peut constituer, sauf pour lui, un argument… pas de « nouveaux éléments de réponse » d’Adrien Abauzit.
P. 40-51. Où nous proposons à Adrien Abauzit, à propos des pièces 26 et 267 du dossier secret, de tenter de considérer que les choses ne sont pas aussi simples qu’il le croit… De « nouveaux éléments de réponse » d’Adrien Abauzit qui méritent commentaires. Reprenons le dossier en reprenant tout d’abord les considérations d’Adrien Abauzit à notre propos. Il a trouvé une micro-faille et il s’y engouffre avec une joie dont nous ne voudrions en aucun cas le priver. Nous avons commis des imprécisions dans notre compte rendu, c’est vrai, et nous l’avons dit. Nous avons parlé « d’enregistrement des pièces » quand nous aurions dû parler de « transmission au ministre », pire même de « récupération par la Bastian » quand nous aurions dû parler « d’écriture par Panizzardi ». Parce que nous avons fait cela, dont nous reconnaissons la faute, la très grande faute, Adrien Abauzit nous accuse de « tronquer la vérité », de « dénaturer la problématique », constate « nos erreurs factuelles » et « nos erreurs de raisonnement ». S’il y trouve son plaisiri nous le lui concédons bien volontiers. Ensuite, reprenant la citation d’Henry que nous lui opposions et selon laquelle « les récoltes de la voie ordinaire livraient des pièces datant de “deux à trois jours” », il constate notre incapacité « d’en citer une seule ». Nous ne savions pas qu’il fallait que nous le fassions et à vrai dire nous ne pensions avoir à prouver une affirmation d’Henry. Naïvement nous pensions que le témoignage d’Henry – indiscutable, pourtant, le « premier sang français » ! – pouvait suffire. Et nous le pensions d’autant plus que nous y ajoutions les témoignages de Brücker et de la Bastian (qui n’ont pas retenu l’attention d’Adrien Abauzit ; trois témoignages tout de même !) qui parlent, pour le premier – nous étions encore imprécis ou tout au moins pas assez précis – , de livraisons au ministère le jour même, le lendemain et jamais plus de trois jours après la récolte et, pour la seconde, de « trois à quatre » livraisons par semaine, soit, donc, en moyenne, une livraison tous les deux jours. Un dernier témoignage d’ailleurs (« contradictoirement débattu ») de la principale intéressée, qui contredit pour le moins les mensonges de Gonse qu’Adrien Abauzit prend pour argent comptant dans son premier livre (p. 42-43). Maintenant qu’Adrien Abauzit se rassure. S’il nous fallait vraiment – pour une raison que nous ne expliquons pas – prouver les affirmations d’Henry, nous en serions bien en peine dans la mesure où les bordereaux de transmission ont disparu… Ensuite – autant il réagit d’ordinaire peu à nos réfutations, autant là il se montre prolixe –, Adrien Abauzit vient discuter notre hypothèse – en petites citations choisies qui sont isolées de l’ensemble et des développements qui les fondent – sur les déchirures qui pourraient indiquer la mise au rebut simultanée. Il discute et il le peut… c’est le propre de l’hypothèse d’ouvrir à la discussion. Les « sillons » sont différents, oui, très légèrement, mais en tenant compte que les surlignages visant à faire ressortir lesdites déchirures et ainsi à permettre de les voir sont faites à main levée, au crayon sous Photoshop, et donc assez imprécises – Adrien Abauzit, nous vous ouvrons ici votre porte de sortie. On conviendra toutefois, nous pensons, que « sillons » différents ou pas, la proximité incroyable des déchirures de deux documents tend à valider l’hypothèse de la simultanéité de la mise au rebut. Mais ce n’est sans doute qu’une impression…

Encore, Adrien Abauzit avance en argument les dimensions différentes des deux documents (tels que nous le voyons sur l’image juste donnée) et argue de la « logique » selon laquelle « sur une brève unité de temps, les courriers de service à service soient écrits sur le même format ». C’est possible, si ce n’est que la correspondance Panizzardi/Schwartzkoppen n’est pas une correspondance de « service à service » mais celle de deux amis, complices en espionnage, et que ces correspondances n’avaient vraiment rien d’officiel (et la petite note d’Adrien Abauzit, pour aider le lecteur malcomprenant, à propos des courriers officiels qui s’écrivent aujourd’hui sur des courrier A4 est d’une naïveté vraiment désarmante). Et il suffit de voir les lettres de Panizzardi à Schwartzkoppen, nombreuses dans le dossier secret, pour voir combien sont différents les papiers et les formats utilisés. Enfin, pour en finir avec ses considérations à notre propos, Adrien Abauzit nous reproche une « variation de dernière minute », à savoir notre proposition, qui ouvrait juste une possibilité, que Lauth eût pu, exceptionnellement, remplacer Henry si Henry ne pouvait rencontrer la Bastian. Écrire que « la SIHAD […] nous apprend que ce ne serait pas Henry, mais peut-être le commandant Lauth qui aurait vu madame Bastian… » n’est pas très honnête et il suffit de voir ce que nous avions écrit et qu’il reproduit en note pour comprendre que nous n’apprenions rien mais que nous envisagions une possibilité (« rien ne nous dit que Lauth n’ait pas pu exceptionnellement remplacer Henry pour aller soulager la Bastian de sa récolte… mais à vrai dire la question importe peu »).
Mais bref. Tout ça est sans intérêt puisqu’Adrien Abauzit a la « preuve décisive », l’argument « imparable » qui doit mettre fin à la discussion. Donnons-le ici : Henry – et pas Lauth – n’aurait pu récupérer les documents de la Bastian entre le 28 mars 1895, date d’écriture des pièces retenue par la Cour de cassation, et le 31 mars, veille de la transmission des pièces au ministre, parce qu’Henry était alors en permission. Et là, il n’y a plus rien à dire. De cette affirmation, décisive, imparable, il n’y a aucune autre trace que ce qu’en dit Cuignet (qui la fonde sur les registres de paiements de la SS aujourd’hui perdus) et Adrien Abauzit l’a tirée de son prédécesseur Amyot (qui ne donne pas sa source). Nous avions laissé, lors de notre réponse précédente, cet imparable argument de côté… dont on notera d’ailleurs et au passage qu’il n’est pas de ces pièces « contradictoirement débattu[e]s lors des différentes procédures » et qui du coup, si on devait suivre Adrien Abauzit dans cette curieuse argumentation, ne représentent pas le moindre intérêt : « comme si on pouvait y trouver des arguments nouveaux de première importance, non contradictoirement débattus lors des différentes procédures » (p. 28) !
Comme Adrien Abauzit fréquente peu les sources primaires, il nous a semblé de notre devoir de lui en dire un peu plus sur cette « preuve » et de lui donner les références que ne donne par son prédécesseur… Le témoignage existe bien et, nous le connaissons que trop, a été publié par Cuignet dans L’Éclair du 23 juin 1906 (« Le faux André et le rapport Moras »). Cuignet est particulièrement intéressé dans l’affaire puisqu’il est un des tenants de l’accusation, il n’est pas un témoin des plus fiables mais il a témoigné. Soit… mais une question nous taraude. Dans une première série en mars, dans le même journal, Cuignet avait déjà parlé de ces pièces et avait déjà discuté la question des dates qui sont, aux yeux d’Adrien Abauzit, la clé de toute explication. Il avait alors insisté sur le temps très court entre le 28 mars et le 1er avril pour que les documents passassent de l’ambassade italienne au cabinet du ministre et avait mis en avant un argument qui, s’il n’est pas imparable celui-là, est frappant : « Pour que ces débris parvinssent ensuite [le 29 mars] à Henry, il fallait », entre autres, « qu’Henry et la voie ordinaire se rejoignissent ». C’est d’une logique implacable mais ce n’est pas là qu’est l’intérêt de la chose. Il poursuit :
Supposons que toutes ces conditions aient été remplies dans la journée du 29 mars… C’était bien juste, mais enfin, admettons-le… Le 29 mars 1895 au soir, Henry est donc en possession de la pièce du télémètre.
Combien de temps a-t-il pour reconstituer la pièce ? Pour retrouver les fragments disséminés au milieu de cent ou cent cinquante autres fragments appartenant à des pièces différentes ?… Il a exactement à sa disposition une nuit et un jour, ou plutôt un jour, car il ne travaillait pas la nuit.
[…] Henry n’aurait eu à sa disposition que la journée du 30 pour reconstituer la pièce, retrouver ses fragments mélangés avec une multitude d’autres fragments. (« Le Faux André », L’Éclair, 8 mars 1906).
Henry est en possession le 29… Il ne dispose que d’un jour… Il n’aurait eu que la journée du 30… Mais alors Henry n’était pas en permission ? Comment expliquer que Cuignet, en juin 1906, pût affirmer qu’Henry était en permission dans la Marne entre le 23 et le 31 mars 1895 et ne pouvait donc pas se voir avec la Bastian, et que, quelques mois plus tôt, il parlait de sa présence à la SS précisément pendant la permission en question, parlait de sa rencontre avec la Bastian, etc. ? Cuignet avait-il oublié cette preuve imparable tout autant que définitive, en mars, lorsqu’il s’évertuait, épluchant le calendrier, à démontrer que les pièces 26 et 267 n’étaient pas arrivés en 1895 mais bien en 1894 ? La chose lui était-elle revenue, tout à coup, en juin ? Certainement pas puisque, comme il le disait dans l’article du 23 juin, il avait fait part de cette preuve « imparable » et tout autant « définitive », deux ans plus tôt, le 16 mai 1904, lors de son audition devant la Cour de cassation. Un témoignage donné mais qui aurait été caviardé par les magistrats « dreyfusards » et qui de ce fait n’apparaît nulle part… C’est si pratique et bien sûr vrai, puisque Cuignet le dit… Si Adrien Abauzit devait nous répondre – dans deux ans et à condition bien sûr qu’il ne passe pas tout cela sous silence –, il est probable qu’il nous dirait que Cuignet voulait ici démontrer l’impossibilité de la chose, dans l’absolu… Resterait à comprendre pourquoi, alors qu’il possédait une preuve « imparable », mieux même « définitive », il n’en parla pas quand le moment était propice – le moment de la rédaction du travail du rapporteur de la Cour de cassation –, et remplit des colonnes à démontrer l’impossibilité calendaire ? Pourquoi se perdre en discussion et ne pas donner, quand on l’a en mains, l’argument capital ? On conviendra qu’il eût été plus simple, plus logique, plus efficace, de dire, en mars, que la raison pour laquelle la pièce était arrivée en 1894, c’est que si elle était arrivée l’année suivante, entre le 28 mars, date de sa rédaction, et le 1er avril, date de sa transmission au ministre, Henry, en permission dans la Marne, en famille, ne pouvait la récupérer ? Pourquoi attendre que les travaux de la Cour de cassation soient pour ainsi dire achevés pour livrer une « preuve » tout à coup sortie du chapeau et que personne ne pourra voir puisque les vilains – manque de chance – l’ont supprimée ?
Adrien Abauzit nous dira peut-être aussi que ces articles de mars n’ont pas été « contradictoirement débattus lors des différentes procédures »… Mais il ne le fera pas parce que nous lui dirons que ceux de juin ne le furent pas non plus et qu’on est en droit de s’interroger sur la matérialité d’une partie de déposition absente – contrairement à ce qu’affirme Cuignet – du texte autographié de sa déposition devant la Cour de cassation, de la sténographie qui en fut publiée et qui est conforme (la vérification peut se faire en allant aux archives). Une preuve si peu « imparable » et si peu « définitive » que même Dutrait-Crozon, qui normalement ramassait tout, a préféré la laisser de côté. Nous savons que pour les antidreyfusards, les magistrats de la Cour de cassation étaient des menteurs et des faussaires, ne faisant pas figurer à la sténographie ce qui gênait l’innocence de Dreyfus et, à en croire Cuignet, faisaient même tenir aux témoins des propos qu’ils n’avaient pas tenus[2]. Mais si telle est la vérité – difficilement recevable, tout de même – il faudra alors qu’Adrien Abauzit réfléchisse à la question de ses sources et parte du principe que par définition tout ce qu’il tire des quelques procédures qu’il a lues, et surtout quand cela concerne l’accusation qui sont les parties qu’il utilise préférablement, n’a aucune valeur puisque les magistrats de la Cour de cassation ont bricolé les textes. Il est pour le moins paradoxal de soutenir d’un côté que seules les procédures ont de la valeur et d’un autre côté que leur sténographie en est falsifiée.
La question des dates reste donc entière et n’est pas réglée par une preuve qui n’est donc plus définitive puisqu’elle est loin d’être imparable. Alors ? Reprenons donc, et au pas de course, le dossier. Une première chose est sûre : les deux pièces se suivent, se complètent et ont été écrite au même moment. Une seconde chose est sûre : ces deux pièces sont arrivées le 1er avril 1895 à la SS puisqu’elles ont été enregistrées et recopiées par Gribelin à cette date. Donc, soit elles sont de 1894 et elles ont été oubliées pendant un an ; soit elles sont de 1895 et elles sont passés de l’ambassade d’Italie au cabinet du ministre en un temps en effet record.
Option 1 : 1894 (et donc les pièces sont à leur place dans le dossier secret[3]). Oubliées à la SS ? C’est impossible. Gribelin (dans une procédure, document indiscutable) le certifie, une pièce n’aurait pu demeurer un an à la SS sans être traitée et communiquée au ministre. Oubliées chez Schwartzkoppen alors ? Cela semble douteux mais c’est ce que pense Adrien Abauzit qui du coup nous donne une explication dont la pertinence n’échappera à personne : « Qu’y a-t-il de si exceptionnel qu’un document soit conservé ou oublié, même déchiré, sur le coin d’un bureau, enfoui par exemple sous d’autres documents ? »… À ce compte là oui, tout est possible et tout est explicable. Ceux qui penchent pour la thèse d’Adrien Abauzit et de ses prédécesseurs devront se contenter de cette seule explication parce qu’il n’y en a vraiment aucune autre.
Option 2 : 1895 (et donc nouveau faux d’Henry). Et nous reprenons (avec quelques éclaircissements) ce que nous écrivions dans notre réponse : Schwartzkoppen a eu les deux lettres le 28 (elles étaient urgentes comme en témoigne le contenu et et le fait qu’elles aient été apportées par le domestique de Panizzardi) ; il les lit, les déchire et les jette ; le 29 au petit matin, la Bastian les récupère ; ce même 29 ou le lendemain 30 mars, elle remet son cornet à Henry (qui n’est pas parti en une permission que rien n’atteste), cornet dont on ne sait s’il était important ou pas mais qui contient quoi qu’il en soit les deux lettres du 28 mars ; Henry, chez lui (le 29) ou au ministère (le 30), fait le tri, recolle les pièces, et le 30 ou le 1er aux premières heures du matin (laissons-le se reposer le dimanche 31) les donne à enregistrer, à copier, pour qu’elles soient transmises au ministre dans la même journée… c’est « serré » mais ça ne nous semble pas complètement délirant…
Au choix…
Nous ne savons plus si nous en avions parlé, mais tout à coup une petite idée nous vient à l’esprit. Si ces lettres étaient de 1894, il est quand même curieux qu’on ne les voie apparaître dans le dossier contre Dreyfus que fin 1897 et pas au procès de 1894… quand même, une lettre sur l’organisation des chemins de fer datant de l’époque où Dreyfus était attaché au bureau qui avait la question en charge était une indication bien plus probante de sa nécessaire culpabilité que la « lettre Davignon » ou le « Mémento Schwartzkoppen »…
51-52. Où nous expliquons à Adrien Abauzit que ce n’est pas parce que le livre d’Armand Israël considère que Dreyfus est innocent, que nous ne le considérons pas comme la catastrophe qu’il est… pas de « nouveaux éléments de réponse » d’Adrien Abauzit. Cela dit, pour revenir sur cette question, nous ne considérons en tout cas pas qu’Armand Israël soit de « mauvaise foi ». Nous disons juste que sa méconnaissance de l’histoire, de la discipline historique, de la méthode et du sujet qu’il traite font de son livre un bien mauvais livre susceptible de tromper les lecteurs peu informés.
52. Où nous proposons à Adrien Abauzit, à propos du « Memento Schwartzkoppen », la possibilité d’une autre lecture que, ne collant pas avec sa thèse, il écarte par principe… pas de « nouveaux éléments de réponse » d’Adrien Abauzit.
52-54. Où nous proposons à Adrien Abauzit, à propos de la « Lettre Davignon », la possibilité d’une autre lecture que, ne collant pas avec sa thèse, il écarte par principe… pas de « nouveaux éléments de réponse » d’Adrien Abauzit.
54-56. Où nous donnons à Adrien Abauzit, à propos de Guénée, des informations qu’il ignore et qui permettent de fonder le peu de crédibilité dont nous parlions… pas de « nouveaux éléments de réponse » d’Adrien Abauzit.
56-61. Où nous proposons à Adrien Abauzit, à propos de la dictée, de considérer que les évidences qui le frappent ne sont peut-être pas plus frappantes qu’évidentes… pas de « nouveaux éléments de réponse » d’Adrien Abauzit en dehors de trois petits paragraphes qui méritent encore un commentaire. Adrien Abauzit nous voit « indisposé[s] par l’aveu de maître Demange ». Il n’y a pas d’aveu de Demange mais ce que la rhétorique nomme une concession et notre indisposition ne nous paraît pouvoir n’être flagrante – et nous invitons à revenir à notre réponse (ici) – qu’à Adrien Abauzit qui a ses petits côtés Léonie et voit de la gêne où il n’y en a pas et des modifications d’écritures pour le moins difficiles à percevoir. Redonnons la reproduction de la dictée :

Et essayons d’y voir ce que voit Adrien Abauzit qui écrit, pour mémoire, dans son premier :
[…] on s’aperçoit aisément que les quatre premières lignes sont parfaitement droites, quoique très légèrement obliques. À partir de la cinquième ligne, qui arrive juste après le mot « manœuvres », les choses se gâtent. L’écriture, j’entends par là la disposition des mots, devient de plus en plus brouillonne, irrégulière. […] La modification de l’écriture de Dreyfus est encore plus manifeste à la ligne suivante « urgence par le porteur de la présente ». Chaque mot est écrit en dessous du mot qui le suit, accentuant encore le caractère oblique de la ligne.
La septième ligne est un petit peu plus droite.
Au final, à l’aspect harmonieux et droit des quatre premières lignes, qui s’achèvent par le mot du bordereau « manœuvres », succèdent trois autres lignes beaucoup plus brouillonnes. En divisant la première phrase [?] de la dictée en deux blocs, l’un comprenant les quatre premières lignes, l’autre comprenant les trois dernières, le contraste est très net.
Sauf à plaider une extraordinaire coïncidence, il n’est pas contestable qu’à partir du mot « manœuvres », Dreyfus tente de modifier son écriture. (p. 77-78).
Et pourquoi ? Parce que, dit Adrien Abauzit dans sa réplique :
Le texte dicté par du Paty, d’abord neutre, reprend progressivement des passages du bordereau. Lorsque Dreyfus s’en rend compte, il modifie son écriture, ce qui est le signe qu’il connaissait bien le bordereau.
Nous avouons – avec le manuscrit sous les yeux (qu’Adrien Aubauzit ne donne bien évidemment pas) –, que la chose ne nous saute pas aux yeux. Et puis nous nous demandons bien pourquoi, puisque Dreyfus avait compris le piège qui lui avait été tendu, comme dit Adrien Abauzit toujours dans son premier (p. 78), il aurait changé la « disposition des mots » et pas sa manière de former les lettres ? Quel intérêt aurait-il eu de décaler les mots ? Pour travestir son écriture ? Mais il ne la travestit pas, il a juste du mal à tenir la ligne… Pour revenir aux visions d’Adrien Abauzit, nous avons du mal à y voir « que les mots des lignes 5 et 6 ne sont pas en face les uns des autres » (comme il l’écrit dans son dernier, p. 59) et moins encore que « Chaque mot est écrit en dessous du mot qui le suit » (ainsi qu’il nous le disait dans son premier, extrait que nous avons cité un peu plus haut). D’où l’intérêt de la photoshoperie que nous avions faite dans notre réponse :

On n’y voir guère de mots écrits « en dessous » les uns des autres mais plutôt au-dessus et d’une manière à vrai dire à peu près uniforme sur tout le document :

Comme nous l’écrivions dans notre réponse :
on peut voir que les mots « …part aux manœuvres », à la 4e ligne, sont en effet un peu plus hauts que le reste de la ligne ; que, à la 5e ligne, les mots « faire adresser » le sont aussi ; comme le sont « porteur de la présente » à la 6e ligne ; « personne sûre » à la 7e ; « rappelle qu’il s’agit de » à la 8e ; « note sur la frein hydraulique » à la 9e ; « de 120 et sur la manière dont » à la 10e ; « s’est comporté aux manœuvres » à la 11e ; « sur les troupes de couverture » à la 12e ; et, enfin, « note sur Madagascar » à la 13e .
On a du mal à y remarquer ce qu’Adrien Abauzit y voit, à savoir : que son écriture se modifie à partir du mot « manœuvres », qu’à la 6e ligne « chaque mot est écrit en dessous du mot qui le suit », rompant l’aspect « harmonieux et droit des quatre premières lignes » et ouvrant trois lignes « beaucoup plus brouillonnes », qui rendent « [non] contestable qu’à partir du mot “manœuvres”, Dreyfus tente de modifier son écriture » (p. 78). Cela ne nous paraît pas d’une grande évidence et d’autant plus qu’« intérêt, Monsieur » de la 1ère, « en possession » de la 2e, « fait passer » de la 3e et même le « octobre 1894 » de la date subissent le même sort que leurs petites camarades. La conclusion que nous en tirons est que : les mots plus hauts étant présents à chaque ligne et plus nombreux d’une ligne à l’autre, Dreyfus avait, particularité bien commune, une écriture ascendante et que ce caractère ascendant avait une tendance régulière à se marquer au fil de la rédaction. Dreyfus n’écrivait pas droit ! D’où l’intérêt aussi des diagonales que nous avions proposées initialement et qui permettent de le constater :

Mais nous voyons nécessairement mal, puisque, nous dit Adrien Abauzit, Dreyfus lui-même a reconnu la « flagrante » « modification de son écriture ». Et Adrien Abauzit nous le prouve :
Le Président. – Lorsqu’on jette un coup d’œil sur cette lettre dont voici une photographie, on constate facilement que l’écriture depuis les mots : « 1° une note sur le frein hydraulique » jusqu’à la fin est beaucoup plus grande et plus large qu’au commencement.
Le capitaine Dreyfus. – L’écriture est plus large, mon colonel.
Le Président. – Elle change, elle est plus large, moins bien formée ; cela peut s’expliquer par une émotion…
Le capitaine Dreyfus. – D’abord, je vous ferai remarquer que l’élargissement des lettres commence à « je me rappelle » ; or, « je me rappelle » n’a rien qui se rapporte au bordereau.
Mais Adrien Abauzit, nous le disions déjà dans notre réponse – et il suffi de lire cet extrait –, Dreyfus n’a aucunement reconnu ici avoir « modifié son écriture », ce qui entend une action volontaire, moins encore d’avoir « tent[é] de modifier son écriture », ce qui aggrave la question de l’acte volontaire ! Il a reconnu qu’à tel endroit – qui d’ailleurs n’est ni celui que voit Jouaust ni celui que voit Adrien Abauzit, qui a chaussé les lunettes de Dutrait-Crozon –, aucunement que la disposition de ses mots était différente mais que son écriture était « plus large », juste « plus large », et qu’il expliquait (explication dont Adien Abauzit ne veut pas) cet élargissement par l’effet du froid qui lui avait raidi les doigts.
La modification de la « disposition des mots », Dreyfus ne la vit pas dans ce document, pas plus que ne le vit Jouaust. Et si Dreyfus ne la vit pas, c’est parce qu’il écrivait toujours ainsi, de manière ascendante et tenant mal la « droite », donnant souvent un sinuosité à ses lignes. Nous avons quelques centaines de lettres à disposition d’Adrien Abauzit, nous n’en donnerons qu’une (authentique et signée), de juillet 1905 :

Ou alors, il vraiment dû se passer quelque chose quand il se mit à parler de la météo dans le deuxième paragraphe et le début du troisième pour ainsi « changer son écriture », nous voulons dire la « disposition des mots »…

P. 61. Où nous proposons à Adrien Abauzit une explication des raisons pour lesquelles Dreyfus, en détention, multipliait les brouillons des lettres qu’il écrivait… pas de « nouveaux éléments de réponse » d’Adrien Abauzit.
P. 61-62. Où nous proposons à Adrien Abauzit, à propos des témoignages de subordonnés, une explication qu’on ne peut écarter et qui nous oblige à leur accorder une valeur relative… Quelques « nouveaux éléments de réponse » d’Adrien Abauzit à propos de la lettre que nous publiions, lettre d’un condisciple de Dreyfus à Dreyfus, au jour de la réhabilitation. Pour comprendre – et parce qu’elle importante – nous la redonnons :
Quand, en 1894, le sous-chef d’état-major nous réunit pour nous dire que tu étais coupable et qu’on en avait les preuves certaines, nous en acceptâmes la certitude sans discussion puisqu’elle nous était donnée par un chef. Dès lors nous oubliâmes toutes tes qualités, les relations d’amitié que nous avions eues avec toi pour ne plus rechercher dans nos souvenirs que ce qui pouvait corroborer la certitude qu’on venait de nous inculquer. Tout y fut matière.
Sur cette lettre, Adrien Abauzit se surpasse, expliquant qu’elle est « anonyme » et il ajoute, triomphant : « une lettre anonyme authentique ». Et de conclure : « Que peut valoir une telle pièce en justice ? » C’est vraiment décourageant… Décourageant de ne rien comprendre de ce qu’est l’histoire et le travail de l’historien, décourageant d’user de tels arguments pour écarter telle pièce contraire à ce qu’il veut que les choses soient. Cette lettre n’est pas anonyme… Elle est, dit Dreyfus, « d’un de mes camarades à l’État-major de l’armée en 1894 et qui redevint, quand il fut éclairé, un de mes meilleurs amis et défenseurs ». Un camarade, dont il recopie un extrait de la lettre, qu’il connaît et dont il ne donne pas le nom parce qu’il écrit en 1905, qu’il compte alors publier et qu’il est discret… Et ce sont des souvenirs, qu’écrit Dreyfus pas un mémoire en défense ! Et c’est amusant de voir Adrien Abauzit « rejeter » cette lettre et foncer tête baisser dans le témoignage de Cuignet que nous évoquions précédemment, témoignage dont nous avons montré le caractère plus que suspect et d’autant plus suspect que Cuignet affirme l’avoir porté devant la Cour et qui n’existe ni dans la sténographie autographiée, ni dans la sténographie imprimée… « Que peut valoir [un tel témoignage] en justice ? » devrait dire Adrien Abauzit.
P. 62-63. Où nous essayons de faire comprendre à Adrien Abauzit, à propos du passage du bordereau relatif au manuel de tir, et de la réponse qu’il fait à nos objections, qu’il est difficile d’être convaincant en jouant le jeu qui est le sien… De « nouveaux éléments de réponse » d’Adrien Abauzit qui se contente de triompher parce que nous reconnaissons avoir commis une imprécision. C’est amusant, cette manière de faire : bomber le torse quand l’adversaire reconnaît – ce qui est plutôt digne de sa part – son erreur (et là en l’occurrence juste une imprécision) et taire tout au long de sa réponse les réfutations indiscutables qui lui sont opposées. Indiscutables et donc indiscutées.
Dans sa réplique, Adrien Abauzit avait fait preuve d’une curieuse manière de servir la vérité en faisant semblant de ne pas comprendre et nous nous en étions désolé. En réponse, il renchérit. Nous avions publié la couverture du manuel de tir de 1895 pour montrer que la publication était annuelle et indiquer ainsi la faiblesse, à ce propos encore, de l’argumentaire d’Adrien Abauzit. Puisque Dreyfus savait quelle était la périodicité du manuel et qu’il était censé l’avoir eu en juillet par Jeannel, pourquoi aurait-il demandé à deux autres camarades, en août et en septembre, quand sortirait le prochain ? Il avait dû voir sur la couverture – comme celle que nous reproduisions, et c’est pour cela que nous la reproduisions – le millésime qui indiquait une périodicité annuelle. Adrien Abauzit avait fait semblant de ne pas comprendre – ou peut-être ne comprend-il pas – et avait écrit : « Il n’est pas soutenable d’affirmer qu’en 1894 Dreyfus aurait pu apprendre la date de parution du prochain manuel, en s’appuyant sur la photo d’un manuel datant de 1895… » Et à son habitude Adrien Abauzit reprend tout cela sans tenir compte de ce que nous lui disions et vient nous donner une première petite leçon de français – la prochaine, magnifique arrive – en nous indiquant que « 1895 », que nous donnions en rectification à « été 1895 » qui était une erreur, n’est pas une date de parution mais une année de parution, que cela, écrit-il dans une curieuse langue, « n’apporte aucune précision digne de ce nom relative à la problématique de l’espèce » et donc que l’argument « s’effondre […] de lui-même ». Notre formulation était imprécise (triomphe, ô Adrien !) mais demeure valable pour la démonstration qui est de demander pourquoi Dreyfus aurait pu chercher à savoir auprès de deux camarades si le nouveau manuel allait bientôt paraître quand il savait que sa périodicité était annuelle et ne pourrait donc en toute logique avoir lieu avant l’année prochaine.
P. 63-64. Où nous regrettons, à propos du témoignage de Sibille, la manière qui est celle d’Adrien Abauzit de ne retenir que ce qui peut être utile à sa thèse… pas de « nouveaux éléments de réponse » d’Adrien Abauzit.
65-67. Où nous corrigeons le petit cours de grammaire fautif fait par Adrien Abauzit et lui proposons, à propos de la phrase du bordereau relative au manuel de tir, un argument qui mérite devoir être discuté… pas de « nouveaux éléments de réponse » d’Adrien Abauzit et on le regrette parce que nous étions vraiment impatients de lire ce qu’il avait à dire, après notre rectification qui est un petit cours de français à l’usage des collégiens. Adrien Abauzit préfère ignorer comme il préfère ignorer l’argument au sujet de l’envoi ou du non envoi du manuel de tir à Schwartzkoppen. Dans notre réponse, nous reprenions un argument raisonnable de notre critique :
Comme nous le disions dans notre compte rendu, argument non sophistique et non psychologisant qu’Adrien Abauzit écarte dans sa réponse quand (ou parce que) il est le plus frappant : l’auteur du bordereau envoie à son correspondant : 1° une note, 2° une note, 3° une note, 4° une note, 5° le manuel de tir. S’il avait envoyé une note sur le manuel et non le manuel, comme le soutient Adrien Abauzit, sans doute aurait-il continué avec un 5° qui aurait été, comme les autres : « une note sur le manuel… » ? La chose est évidente car en effet qu’est-ce qu’un bordereau ? Un bordereau est un document récapitulatif, une liste énumérative de pièces. Donc si on écrit, ainsi que commence le bordereau, qu’on adresse par un courrier « quelques renseignements intéressants » qui sont : 1° une note, 2° une note, 3° une note, 4° une note, 5° le manuel de tir, c’est qu’on a envoyé 4 notes et un manuel de tir… et non pas 5 notes… Et y voir 5 notes quand on dit avoir envoyé un manuel est un pur et simple bricolage.
P. 67-69 et 69-71. Où nous proposons à Adrien Abauzit, une explication, elle aussi raisonnable, au sujet de la nature du bordereau… pas de « nouveaux éléments de réponse » d’Adrien Abauzit.
P. 71. Où nous proposons à Adrien Abauzit, à propos de la phrase du bordereau relative au manuel de tir, une autre lecture possible que celle de l’accusation… pas de « nouveaux éléments de réponse » d’Adrien Abauzit.
P. 71-72. Où nous proposons à Adrien Abauzit de relativiser le témoignage de Roget… pas de « nouveaux éléments de réponse » d’Adrien Abauzit. Revenons un peu sur la question de cette phrase du bordereau relative au manuel de tir parce qu’elle passionnante (même si au final elle ne dit rien du tout de la culpabilité de Dreyfus) et qu’en effet les deux lectures – manuel proposé ou envoyé – sont possibles – celle de l’accusation, que reprend Adrien Abauzit, et celle que nous proposons. Redonnons-le texte :
5° Le projet de manuel de tir de l’artillerie de campagne (14 mars 1894). Ce dernier document est extrêmement difficile à se procurer et je ne puis l’avoir à ma disposition que très-peu de jours. Le ministère de la guerre en a envoyé un nombre fixe dans les corps et ces corps en sont responsables, chaque officier détenteur doit remettre le sien après les manœuvres. Si donc vous voulez y prendre ce qui vous intéresse et le tenir à ma disposition après, je le prendrai. À moins que vous ne vouliez que je le fasse copier in extenso et ne vous en adresse la copie.
Première lecture (accusation) :
Le projet de manuel de tir de l’artillerie de campagne (14 mars 1894). Ce dernier document est extrêmement difficile à se procurer [i.e. je ne l’ai pas] et je ne puis l’avoir à ma disposition que très-peu de jours [i.e. et si je le récupère je ne pourrai l’avoir que peu peu temps]. Le ministère de la guerre en a envoyé un nombre fixe dans les corps et ces corps en sont responsables, chaque officier détenteur doit remettre le sien après les manœuvres. Si donc vous voulez y prendre ce qui vous intéresse et le tenir à ma disposition après [i.e. si vous êtes prêt à faire la copie de ce qui vous y intéresse et me le rendre], je le prendrai [i.e. je le le procurerai et vous le transmettrai]. À moins que vous ne vouliez que je le fasse copier in extenso et ne vous en adresse la copie.
Seconde lecture :
Le projet de manuel de tir de l’artillerie de campagne (14 mars 1894) [i.e. le voici]. Ce dernier document est extrêmement difficile à se procurer [i.e. j’ai eu du mal à l’avoir] et je ne puis l’avoir à ma disposition que très-peu de jours [i.e. et je ne l’ai que pour quelques jours]. Le ministère de la guerre en a envoyé un nombre fixe dans les corps et ces corps en sont responsables, chaque officier détenteur doit remettre le sien après les manœuvres. Si donc si vous voulez y prendre ce qui vous intéresse et le tenir à ma disposition après [i.e. si vous voulez y copier ce que vous intéresse et me le mettre de côté une fois que vous aurez terminé], je le prendrai [i.e. je viendrai le récupérer]. À moins que vous ne vouliez que je le fasse copier in extenso et ne vous en adresse la copie [sauf si vous préférez que je vous envoie une copie que je ferai réaliser et sous-entendu ici, il faut me le rendre].
Les deux versions sont possibles étant donné la langue plus qu’approximative dans laquelle est écrit ce morceau. Mais ce qui importe, et que nous évertuons à expliquer à Adrien Abauzit, c’est que ce texte ne vaut que par son contexte et que c’est ce contexte qui permet d’en comprendre le sens. Reprenons le bordereau, et ce que nous disions précédemment :
……………………… je vous adresse cependant, Monsieur, quelques renseignements intéressants :
1° Une note sur……………………….
2° Une note sur……………………….
3° Une note sur……………………….
4° Une note relative à……………..
5° Le projet de manuel de tir de l’artillerie de campagne (14 mars 1894). ………………………..
Si l’auteur du bordereau avait envoyé une note sur le manuel et non le manuel, comme le soutient Adrien Abauzit, sans doute aurait-il continué avec un 5° qui aurait été, comme les autres : « une note sur le manuel… » ?
……………………… je vous adresse cependant, Monsieur, quelques renseignements intéressants :
1° Une note sur……………………….
2° Une note sur……………………….
3° Une note sur……………………….
4° Une note relative à……………..
5° Une note sur le projet de manuel de tir de l’artillerie de campagne (14 mars 1894).
Si on écrit, ainsi que commence le bordereau, qu’on adresse par un courrier « quelques renseignements intéressants » qui sont : 1° une note, 2° une note, 3° une note, 4° une note, 5° le manuel de tir, c’est qu’on a envoyé 4 notes et un manuel de tir… et pas 5 notes… Il est dommage qu’Adrien Abauzit ne veuille pas poser son regard sur cette réalité plutôt que de s’époumoner dans des improvisations sémantico-grammaticales approximatives.
P. 72-73. Où nous proposons à Adrien Abauzit, à propos du « questionnaire du 27 septembre », de se méfier de ce que disent les témoins de l’accusation et de retourner aux sources… pas de « nouveaux éléments de réponse » d’Adrien Abauzit.
P. 74. Où nous proposons à Adrien Abauzit, à propos du petit bleu, de croiser les dépositions et de ne pas juste se contenter d’y relever ce qui sert sa thèse… pas de « nouveaux éléments de réponse » d’Adrien Abauzit.
P. 74-75. Où nous proposons à Adrien Abauzit, à propos du petit bleu, de pousser un peu plus loin sa réflexion et de réfléchir au fait que la question de l’écriture compte peu relativement au fait de savoir qu’il provient de la poubelle de schwartzkoppen… Cette fois – on commençait à s’ennuyer –, de « nouveaux éléments de réponse » d’Adrien Abauzit (p. 78-79). Ramassant nos objections, observations et réfutations en une idée – sans doute parce que notre phrase est en capitales et en rouge –, il écrit : « SI LE DOCUMENT VIENT DE LA VOIE ORDINAIRE, COMMENT POURRAIT-IL ETRE OBLITÉRÉ ? » Pour Adrien Abauzit, la réponse est simple, elle est un postulat : le petit bleu ne peut venir de la poubelle de Schwartzkoppen puisqu’il « a été introduit par Picquart » dans les cornets de la Bastian ! C’est pour lui le début de la discussion… même si dans ce cas, il faut bien admettre qu’il n’y a pas de discussion à avoir puisque cela revient à dire que Picquart est un menteur et un agent du Syndicat…. avoir pour argument qu’il est un faux parce qu’il est un faux ne nous permettra pas d’avancer. Essayons alors de savoir si le petit bleu est un faux de Picquart et tentons de réfléchir sur la base du postulat d’Adrien d’Abauzit et de ce que qu’il considère comme une démonstration. Admettons donc que Picquart ait introduit le petit bleu qu’il aurait fabriqué dans le cornet de la Bastian. Il cherche ainsi à faire croire qu’il vient de la voie ordinaire, et donc de la poubelle de Schwartzkoppen, pour lui donner la crédibilité nécessaire… Mais, manque de chance, ses subordonnés ne le suivent pas. Il a alors une idée lumineuse. Puisqu’on ne croit pas que le document vient de la poubelle de Schwartzkoppen, il va faire croire, pour donner au document les caractères d’authenticité qui lui manquent, et ainsi convaincre ses chefs, qu’il a été posté à Esterhazy. Re-manque de chance, pour lui donner l’aspect crédible d’un document venant de la poubelle, quand il l’a introduit dans le cornet de la Bastian, il l’a déchiré – c’est ballot – en menus morceaux. Le petit bleu qu’il a maintenant en mains et qu’il veut faire passer comme ayant été posté, a été reconstitué mais est recouvert de bandes de papiers collants qui recouvrent les nombreuses déchirures. Flûte alors ! Un document qu’il va être difficile de faire passer pour une lettre postée. Pour qu’il puisse en avoir l’air (d’avoir été posté), il a une simple et bonne idée (la deuxième en très peu de temps) : faire des photos pour faire disparaître les bandes et les déchirures et y faire apposer un timbre. De plus, ayant eu la curieuse idée, en faisant son faux, ne de le signer d’un « C. » qui ne désigne personne et de ne pas avoir pensé à imiter l’écriture de Schwartzkoppen dont il a des monceaux de spécimens à la SS, il va demander à ses subordonnés de certifier que ce document est bien de l’écriture de Schwartzkoppen. Il faut convenir que s’il n’avait pas été très malin, en faisant son faux, en ne pensant pas à la question de l’écriture ou à celle de la signature habituelle (le « nom de guerre ») de Schwartzkoppen, là, il se montre vraiment rusé. Et ce qui est vraiment rusé, c’est de faire cette demande à ses subordonnés, ceux-là mêmes qui n’ont pas été dupes de sa manœuvre ! Il a l’intention de tromper ses chefs parce qu’il a compris que les subordonnés auxquels il a montré le document dont il espérait tant n’y croient pas mais c’est à eux que ce Clausewitz de la rue Saint-Dominique demande de l’aider et ainsi de devenir complice de la falsification… Parce que, bien évidemment, ce Sun Tzu de la Section de statistique est persuadé qu’ils obéiront et qu’ils ne diront rien aux grands chefs de la manœuvre tout à fait extraordinaire qu’il est en train de mettre en place dans le but de faire réhabiliter un traître (Dreyfus) et de faire condamner un innocent (Esterhazy). Il se dit que tout se passera suivant ce plan dont l’audace ne peut échapper à personne et que ses subordonnés arriveront sans doute à donner l’aspect d’un document saisi à la poste au petit bleu qui est dans cet état :

Sans doute doit-il être sûr, avec les moyens qui se sont de la retouche d’image en 1896, qu’ils parviendront à le faire paraître comme neuf et même à reconstituer les morceaux manquants.
Quant à l’argumentation de « juriste » selon laquelle le petit bleu étant un « brouillon », non posté, non écrit et non signé par son destinateur, « n’est qu’un morceau de papier, dépourvu de toute valeur probante », Adrien Abauzit devrait justement s’apercevoir que c’est justement en cela que réside la meilleure indication de sa véracité, l’indication que Picquart n’a pu le fabriquer. Comment Picquart aurait-il pu être assez crétin pour fabriquer contre Esterhazy la pire des preuves ?
Mais revenons au scénario abauzitien, parce que ce n’est pas fini. Ses subordonnés l’aideront à falsifier le petit bleu, ils ne diront rien à leurs chefs, les chefs seront convaincus par une photographie et les juges aussi. On lui demandera l’original ? Non, il l’aura détruit et justifiera le fait de montrer une unique photographie par « des raisons de sécurité ». Les juges se diront sans doute qu’entre un document et sa photographie, il n’y a pas grande différence au regard des questions touchant à la sécurité nationale et que si on voit une photographie on peut bien voir l’original qui en est à l’origine. Mais ils ne se le diront pas puisque c’est « pour des raisons de sécurité ». Picquart sait aussi, puisque tel est l’usage, que le chef de la Section ne statistique ne peut être présent au procès et que c’est Henry, son second, qui le représentera (comme il avait paru à la place de Sandherr en 1894 au procès de Dreyfus). Mais Picquart a confiance : Henry sera convaincu par le faux auquel il aura participé, faux justifié par le fait qu’il n’avait pas cru à son arrivée par la voie ordinaire. Bien sûr… Et surtout, tous, grands chefs et juges, seront convaincus que « bien qu’“arrivé” par la voie ordinaire, […] le Petit Bleu est une lettre authentique de Schwartzkoppen envoyée par la poste à Esterhazy » (premier livre d’Adrien Abauzit, p. 170). Ils trouveront peut-être curieux que puisse provenir de la poubelle de Schwartzkoppen une lettre envoyée à Esterhazy mais ils se diront sans doute qu’elle a été postée, qu’Esterhazy l’a reçue, et puis qu’elle est revenue toute seule à l’ambassade d’Allemagne où elle a été trouvée… Tout se tient…
P. 75-76. Où nous montrons à Adrien Abauzit, à propos du petit bleu, que le postulat qui est le sien relativement au scepticisme de ses collègues ne correspond pas aux faits… pas de « nouveaux éléments de réponse » d’Adrien Abauzit.
P. 76. Où nous montrons à Adrien Abauzit que les « tentatives » de « crédibilisation » du petit bleu par Picquart ne résistent guère à la simple logique… pas de « nouveaux éléments de réponse » d’Adrien Abauzit.
P. 77-78. Où nous montrons à Adrien Abauzit, à propos du petit bleu, qu’Henry et consorts n’étaient peut-être pas aussi subtils qu’il le croit… pas de « nouveaux éléments de réponse » d’Adrien Abauzit.
P. 79-80. Où nous expliquons à Adrien Abauzit que, contrairement à ce qu’il affirme, Esterhazy était en mesure de livrer les documents énumérés au bordereau… pas de « nouveaux éléments de réponse » d’Adrien Abauzit.
P. 80. Où nous demandons à Adrien Abauzit de répondre à une question à laquelle il fait semblant de répondre… pas de « nouveaux éléments de réponse » d’Adrien Abauzit.
P. 81. Où nous expliquons à Adrien Abauzit la fragilité de sa thèse sur la complicité Esterhazy-Picquart au service du « Syndicat »… pas de « nouveaux éléments de réponse » d’Adrien Abauzit.
P. 81-82. Où nous indiquons à Adrien Abauzit quelques sources et quelques réalités historiques qu’il ignore et qui ruinent absolument sa construction des aveux d’Esterhazy comme déclencheurs de la révision… pas de « nouveaux éléments de réponse » d’Adrien Abauzit.
P. 82-83. Où nous expliquons à Adrien Abauzit combien il se fourvoie sur la question du pseudo-empoisonnement de Krantz… pas de « nouveaux éléments de réponse » d’Adrien Abauzit.
P. 83-85. Où nous expliquons à Adrien Abauzit la place qui est celle de Léonie dans la révélation de l’illégalité de 1894. Adrien Abauzit répond et nous commentons. Adrien Abauzit reprend son jeu qui consiste à faire semblant de ne pas comprendre. S’il avait donné, dans ce nouvel ouvrage, nos commentaires – vieux maintenant de deux ans et demi – plutôt que d’en extraire quelques passages en citations choisies et en écartant tous les arguments qui montrent de quelle manière sa conception de l’histoire ressemble à la manière dont Procuste envisageait le brigandage, il n’aurait pu ainsi simplement passer du temps faire de petits sauts de côté pour ne pas répondre. Mais nous ne lui reprochons pas ; Adrien Abauzit est avocat et n’est pas historien. Il n’est pas là pour dire la vérité mais pour sauver son client et pour cela l’effet de manche vaut souvent plus que l’argument. Prenons donc cette histoire Léonie. Dans notre réponse, nous tentions – parce que nous sommes opiniâtres – d’expliquer une simple chose à Adrien Abauzit : Léonie a eu une vision puisque Mathieu le raconte, comme il raconte tout dans son livre – la fausse évasion, etc. –, et que vraiment, si cela n’avait pas eu lieu, il n’aurait pas eu grand intérêt à la raconter. Nous ne disions pas autre chose et écrivons clairement que cette histoire de vision est « ahurissant[e] ». De quel droit, et sur quelle base, aurions-nous pu dire que Mathieu mentait ? Nous ne croyons définitivement pas aux visions mais nous n’avons aucune raison de douter de ce que dit Mathieu. Maintenant, écrire ça ne veut pas dire que nous y attachions une quelconque importance et c’est ce qui explique d’ailleurs que Bertrand Joly (qui soit dit en passant écrit une histoire politique de l’affaire, pas une histoire de l’affaire) et Vincent Duclert aient laissé de côté cet épisode dont l’intérêt est pour le moins relatif. Ce que nous disions à Adrien Abauzit, c’est que ce ne sont pas les séances de spiritisme qui permirent à Mathieu Dreyfus d’avoir cette certitude de l’illégalité mais les confidences de quelques-uns que sont Develle, Reitlinger, etc. Adrien Abauzit cite Mathieu qui dit bien qu’il n’insista pas quand Léonie lui fit part de sa vision et qu’il comprit quelques jours plus tard quand Gibert lui fit part de sa conversation avec Félix Faure. Ayant le sentiment de nous asséner le coup de grâce, Adrien Abauzit modestement triomphe : « Mes contradicteurs, je l’admets volontiers en tant que non-historien, sont bien mieux informés que moi en matière de « suggestion mentale», de « transmission de pensée», ou de possibilité de « voir à distance », dès lors, je crois reconnaître ne pas avoir les armes pour leur répondre sur ce terrain. » Un véritable coup de grâce… Nous nous étions refusés jusqu’alors de faire même une allusion, trouvant l’argument trop facile, à ce qui va suivre… Mais celui qui écrit la phrase qu’on vient de lire est le même que celui qui, dans son premier (p. 347), affirme hautement qu’il « ne crain[t] pas d’écrire que de sa main, [en 1917] la Vierge a repoussé l’envahisseur » et – la démonstration de la réalité du fait n’est pas évidente – qu’il « faut bien croire que les Français de l’époque, ayant vécu ces événements, ont bien assisté à cette intervention de la Vierge, puisque le 9 juin 1924, la commune de Barcy a élevé un petit monument, sur lequel repose une statue de Marie. »
Mais revenons à Léonie… Adrien Abauzit en conclut donc : « Au bout du compte, retenons qu’“après un siècle de recherches, après des milliers d’articles, des centaines de livres, de dizaines de colloques”, personne ne sait comment Mathieu Dreyfus a été mis au courant de la violation du principe du contradictoire au procès de 1894, et par ce fait, de l’existence, du dossier secret. » Mais si, Adrien Abauzit, on le sait, nous vous l’avons expliqué et vous le reprenez p. 83 et le développez en citant Bertrand Joly p. 84. Pensez-vous que vos lecteurs auront oublié d’une page à l’autre ? Et en passant, il est dommage d’ailleurs qu’une nouvelle fois vous ne commentiez pas la réfutation que nous faisions de votre : « de son vivant, le docteur Gibert n’a jamais déclaré avoir reçu de confidences de Félix Faure ». Dommage que vous n’évoquiez pas le document inédit que nous vous avons soumis, signé de Gibert, de son écriture et sur son papier a en-tête, qui sont justement ces confidences écrites faites à Mathieu… Un document qui, sans doute, serait, lui, recevable en justice….
Il est temps de conclure. Notre faillite a été prononcée par Adrien Abauzit qui nous répond en ne donnant que de petits bouts de ce que nous disons, en tirant les phrases de leur contexte, et en laissant de côté tous les moments, si nombreux en 142 000 signes, où nous lui expliquions tout ce qu’il ignore de l’affaire Dreyfus et aussi de la langue française sur laquelle pourtant, chantre – et héraut – de la « refrancisation », il devrait concentrer ses efforts. Nous avons conscience que cette discussion est vaine et qu’on ne pourra jamais parvenir à réfléchir avec quelqu’un qui plaide plus qu’il ne discute en essayant de donner le sentiment au lecteur peu informé qu’il fait de l’histoire. Mais peu importe, nous nous y obstinons parce que la SIHAD est, aux termes de l’article 2 de ses statuts, et elle s’y obstine, une « association à vocation scientifique, [qui] se veut animée par un esprit de vigilance à l’égard de la vérité historique. »
Petit PS.
Nous ne nous occuperons pas de son petit texte sur le Polanski qui est à l’image du reste. On ne peut reprocher au film (dont la critique que nous avons publiée est sans appel ; voir ici) de ne pas montrer tel un ou tel autre quand son angle est de voir l’Affaire à travers Picquart et l’État-major. Mais nous voudrions juste lui donner une dernière précision que nous avions décidé, à la lecture de son premier, de laisser de côté et dont nous parlerons finalement puisqu’il y revient. Adrien Abauzit nous explique qu’Henry n’était pas antisémite – il l’a « démontré ailleurs », écrit-il avec un sens de l’hyperbole qui laisse pantois – parce qu’il avait des « relations » « excellentes », voire de « camaraderie », avec Bertulus, un juif. Passons sur le fait qu’on puisse être antisémite en ayant un ami juif, et invitons Adrien Abauzit à s’interroger sur cette judéité de Bertulus, fils de Joseph Evariste Laurent Bertulus et de Julie de Talleyrand-Périgord, elle-même fille d’Edmond Alexandre de Talleyrand-Périgord et de Dorothéa von Biron de Courlande de Dino, elle-même fille de Pierre von Biron de Courlande et d’Anne Dorothée von Medem, elle-même fille de Georg Johann Friedrich von Medem et de Louis Charlotte Zoege von Manteufel, etc…
_______________________________________________
[1] La Révision du procès de Rennes (15 juin 1906-12 juillet 1906). Réquisitoire écrit de M. le procureur général Baudouin, Paris, Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen, 1907, p. 792.
[2] Dans son article de L’Éclair du 6 mars 1906, il expliquait que Gribelin et Gonse lui avaient affirmé que jamais, au grand jamais, ils n’avaient reconnu, lors de leur audition, que la mention de date sur la pièce 267 fût de la main d’Henry. C’est pourtant, non pour Gonse mais pour Gribelin, ce qu’on peut lire dans la sténographie (La Révision du procès de Rennes. Enquête de la chambre criminelle de la Cour de cassation (5 mars 1904-19 novembre 1904), Paris, Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen, 1908, t. I. p. 201).
[3] Même si au final elles ne prouvent pas grand-chose relativement à la culpabilité de Dreyfus.
Un inédit : les rapports des experts de 1894
Images en grand format : clic droit et « ouvrir dans un nouvel onglet »
Source : Archives Nationales BB19 101.
Une autre vidéo commentée d’Adrien Abauzit
Une autre interview d’Abauzit et les commentaires laissés sur la chaîne Youtube.
7’30. Adrien Abauzit, sa connaissance de l’affaire Dreyfus et ses conseils de lecture. Adrien Abauzit ne connaît que très peu de choses à l’Affaire et la suite de ces posts le prouvera largement. Sinon, pour aborder l’Affaire, commencer par Figuéras ne permettra que d’avoir un échantillon de la lecture d’extrême-droite de l’Affaire…
7’55. Toutes les pièces ou « tous les événements de fait [sic] » établissant la culpabilité de Dreyfus sont présents au procès de Rennes. À condition, comme le fait Adrien Abauzit avec les rares documents qu’il a eus entre les mains, de ne lire que les dépositions à charge. Une lecture intégrale et continue laisse au contraire, à moins d’être de parti pris, l’impression exactement contraire.
8’49. Peu de lectures antidreyfusardes de qualité. Et pour cause… Et ce dernier, celui d’Adrien Abauzit, ne viendra pas relever le niveau.
9’54. Les dépositions de Cavaignac et de Roget au terme desquelles la culpabilité de Dreyfus ne fait aucun doute. Aucun doute pour qui ne veut avoir aucun doute. Ces deux dépositions de l’accusation sont pour le moins relativisées par de nombreuses autres et qui connaît l’Affaire peut sans mal, ligne à ligne, démontrer le vide total des eux démonstrations de Cavaignac et de Roget.
10’. La principale preuve contre Dreyfus : la modification d’écriture pendant la scène de la dictée. Nous renvoyons au sujet de cette énôrme farce à un compte rendu fait de l’ouvrage d’Adrien Abauzit : https://affaire-dreyfus.com/2018/10/12/un-ersatz-du-dutrait-crozon-laffaire-dreyfus-entre-farces-et-grosses-ficelles-dadrien-abauzit/
11’34. « On n’a jamais retrouvé le mec qui a tiré mais non seulement on n’a jamais retrouvé le3 mec qui a tiré mais on n’a jamais retrouvé la balle dans le corps de l’intéressé ». On n’a en effet jamais retrouvé « le mec qui a tiré », faute de véritable enquête. Pourtant, Labori avait quelques idées sur l’identité du « mec » en question, à en lire ses souvenirs publiés en 1947 par son épouse (un livre qu’Adrien Abauzit aurait pu lire »). Quant à la balle, on l’a bien retrouvée et on a même la radiographie qui avait été faite le jour de l’attentat et qui la montre très clairement. On peut la voir (un livre encore qu’Adrien Abauzit aurait pu aller voir) dans Cinq semaines à Rennes, Paris, F. Juven, 1899, p. 69). Et c’est parce que la blessure était sans gravité que Labori put revenir plaider au bout de quelques jours.
15’15. L’antisémitisme. Plus aucun historien sérieux aujourd’hui ne défend la thèse que Dreyfus fut condamné parce que juif. Mais il est indéniable que le fait qu’il fût juif retint l’attention de ceux qui donnèrent dès le début son nom comme possible coupable : trois antisémites qui avaient pour nom Bertin-Mourot, d’Aboville et Fabre. Et n’oublions pas que – réalité dont ne parle naturellement pas Adrien Abauzit – quand 15 jours après l’arrestation de Dreyfus, son nom fut livré à la presse, ce n’est pas au Figaro ou au Temps que l’information fut livrée mais bien à La Libre Parole, et, nous le savons aujourd’hui, à deux reprises et par deux hommes différents. La campagne antisémite débuta aux premiers jours de l’Affaire et ne fut pas l’œuvre de dreyfusards qui n’existaient pas encore. Elle fut provoquée et alimentée par les hommes de l’État-major qui seuls alors pouvaient connaître et transmettre l’information.
17’44 L’engouement populaire et le combat des pour et de contre. Le « schisme [sic] » de la société. Nous savons aujourd’hui que si les antidreyfusards furent nombreux et les dreyfusards un poignée, la grande partie de la population se désintéressa totalement de cette Affaire, considérée comme une affaire parisienne. Et s’il y eut en effet des duels, ils ne concernèrent que les acteurs.
19’02. « Ce ne sont que des citations, je n’invente rien. […] Je travaille pièces à l’appui, moi ». Il ne suffit pas de dire qu’une chose est pour qu’elle soit. Voir : https://affaire-dreyfus.com/2018/10/12/un-ersatz-du-dutrait-crozon-laffaire-dreyfus-entre-farces-et-grosses-ficelles-dadrien-abauzit/. Sa citation de Jaurès en est d’ailleurs une bonne indication ; elle est de décembre 1897 et reflète sa pensée du moment, que quelques mois plus tard, il révisera pour le moins. En procédant ainsi, on peut tout dire et tout « prouver ».
21’21. « La défense fonde son action sur une pure fabrique de faux ». À condition que les démonstrations d’Adrien Abauzit soient justes. Le problème est qu’elles ne reposent sur rien. Nous renvoyons encore à l’article précité.
23’51’ Le « bourrinage » des notes de bas de page. C’est touchant de puérilité et d’amateurisme. Ce n’est pas le fait de citer et de sourcer qui compte, c’est de le faire bien en ayant en mains la totalité du dossier et en excluant pas tout ce qui est gênant à la démonstration.
24’09. « Je cite un maximum d’auteurs dreyfusards ». 5 auteurs au total sur plus de 2 000 publications, quelques milliers d’articles et aucune source primaire (correspondances, etc.)… Allons… Et quant au matériau que constituent les procédures et qu’il a lues dans son intégralité, nous postions ailleurs cette réflexion : « Adrien Abauzit n’a pas tout lu contrairement à ce qu’il affirme avec une fierté un peu puérile : l’affaire Dreyfus ce n’est pas 7 000 pages de débats judiciaires et 9 ou 10 volumes […] mais 20 volumes et près de 14 000 pages… A cela il faudrait ajouter les procédures non publiées et conservées dans divers centres d’archives qu’Adrien Abauzit n’a pas plus lues : instruction Pellieux, instruction Ravary, les deux instructions Tavernier, l’instruction contre de Pellieux ; et encore les procès connexes qu’il n’a toujours pas lus ; le procès Henry-Reinach, le procès Rochefort Valcarlos, le procès des ligues, le procès en Haute-Cour, le procès Grégori. »
24’47. Pas de parti pris… Si Adrien Abauzit en avait eu un je me demande alors ce qu’aurait été le résultat. Quelle pantalonnade !
25’10 Le mobile manquant de Dreyfus et sa relation avec l’espionne madame Bodson. Nous postions ailleurs : « Si la relation de Dreyfus avec Bodson est avérée, il ne fut jamais prouvé qu’elle ait été une espionne. Interviewée pour Le Journal du 6 novembre 1894, elle raconta qu’elle, qui recevait beaucoup de militaires, considérait le capitaine comme « le plus patriote », « le plus chauvin » d’entre tous et qu’ils s’étaient brouillés quand Dreyfus avait appris qu’elle fréquentait un officier allemand qu’il refusait de risquer d’être amené à le croiser un jour. Affirmer qu’elle poussa Dreyfus « à se livrer à ce qu’on appelle de l’amorçage » est une affirmation sans preuve et que rien ne peut établir. Il faudrait déjà pouvoir établir qu’elle fût une espionne ce que même Dutrait-Crozon ou l’acte d’accusation de 1894 contre Dreyfus n’osent faire… » Quant à la Déry, elle fut suspectée d’être une espionne mais rien ne put jamais en apporter la preuve. Encore une fois, ni le Dutrait-Crozon ni l’acte d’accusation de 1894 contre Dreyfus n’osent le faire. Si c’est ainsi qu’on travaille pièces à l’appui et qu’on n’invente rien…
Tournage (09/09/2018)
Réponse de Vincent Duclert à Polanski (11/07/2014)
Vincent Duclert vient de publier sur lemonde.fr une mise au point nécessaire après les déclarations de Polanski que nous citions dans notre précédent post (voir ici).
Alfred Dreyfus, le premier des ‘‘lanceurs d’alerte’’
Le Monde.fr | 11.07.2014 à 15h48 • Mis à jour le 11.07.2014 à 15h50 | Par Vincent Duclert (Historien)
La lecture de l’entretien accordé au Monde par Roman Polanski et le scénariste Robert Harris (Le Monde du 5 juillet 2014, supplément ‘‘Culture et idées’’) rend perplexe sur leur projet de film consacré à l’affaire Dreyfus. Entendons-nous bien d’emblée : l’historien ne prétend à aucun contrôle de véracité historique sur les créations qui prennent l’histoire comme prétexte ou référence. De grandes œuvres cinématographiques ont même permis d’entrer dans une nouvelle compréhension des événements historiques, souvent en s’éloignant du récit historien conventionnel.